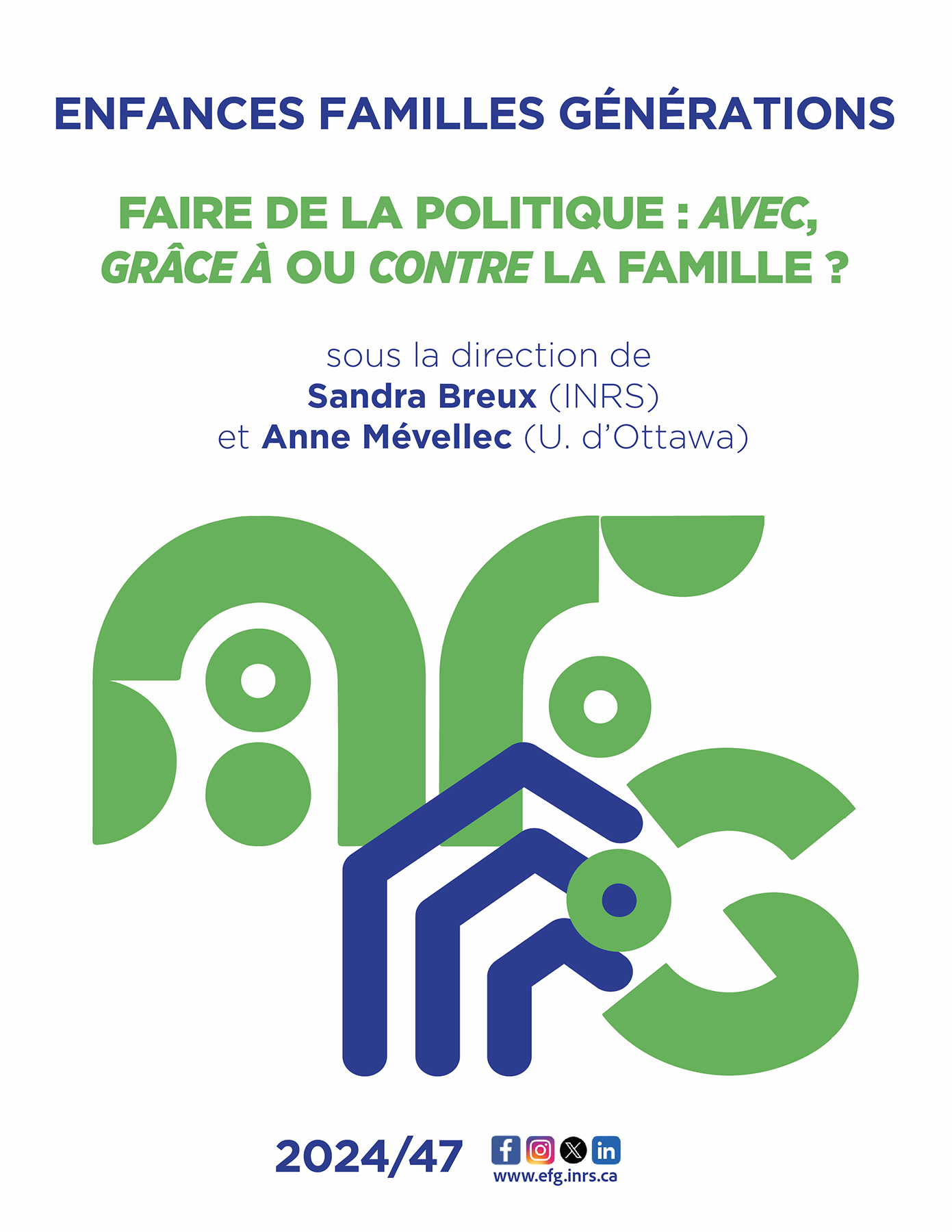Abstracts
Résumé
Cadre de recherche : Depuis quatorze ans, je réfléchis à la question de l’adoption au Brésil, avec la ville de Rio de Janeiro comme terrain d’étude privilégié. En même temps que je me consacrais aux significations de la parenté, à ses implications sociales et juridiques, à la conception euroaméricaine de la parenté (Strathern, 2015) et à ses injonctions morales, j’ai commencé à réfléchir aux significations d’une politique de l’enfance et de la jeunesse, à sa relation avec l’adoption et avec les pratiques du système brésilien de la Justice de l’enfance et de l’adolescence.
Objectifs : Mon objectif est de réfléchir à la manière dont la posture réflexive, qui est fondamentale dans les sciences sociales, peut modifier les trajectoires de recherche, mais également à la manière dont les expériences ethnographiques vécues sur le terrain sont capables de produire des effets sur les chercheurs et les enquêtés.
Méthodologie : Dans cet article, je présente les changements survenus dans ma trajectoire de recherche sur l’adoption, et qui sont liés à mon engagement .
Résultats : Pour ce faire, j’insiste sur mes expériences ethnographiques vécues dans les groupes de soutien à l’adoption et dans les tribunaux pour la Protection de l’enfance et de la jeunesse, et sur la manière dont elles m’ont affectée (Favret-Saada, 1990), provoquant – en moi-même et dans l’exercice de mes recherches – un changement de perspective. J’aborde également certains contextes entourant la restitution des données de recherche.
Conclusion : La recherche anthropologique se déploie dans le doute, dans l’incertitude et la peur d’être « conquis », « ravis » par nos interlocuteurs ou encore d’être détestés par eux. Nous devons donc chercher une voie intermédiaire qui nous permette à la fois l’autonomie et l’engagement.
Contribution : Les différentes possibilités de restitution des données aux personnes étudiées peuvent ouvrir un champ de possibilités de travaux coopératifs dans le registre effectif d’une anthropologie engagée.
Mots-clés :
- adoption,
- système de justice,
- trajectoires,
- recherche
Abstract
Research Framework: For the past fourteen years, I have been thinking about the issue of adoption in Brazil, with the city of Rio de Janeiro as a privileged field of study. As I was focusing on the meaning of kinship, its social and legal implications, the Euro-American conception of kinship (Strathern, 2015) and its moral injunctions, I began to ponder the meaning of a child and youth policy, its relationship with adoption and with the practices of the Brazilian child and adolescent justice system.
Objectives: My objective is to examine how the reflexive posture that is fundamental to social sciences can modify research trajectories, and how ethnographic experiences in the field are likely to produce effects on researchers and respondents.
Methodology: In this article, I discuss the changes in my adoption research trajectory that are linked to my commitment .
Results: To do so, I focus on my ethnographic experiences in adoption support groups and at children and youth protection courts, and how they affected me (Favret-Saada, 1990), triggering - in myself and my research - a change of perspective. I also address some of the contexts surrounding the restitution of research data.
Conclusion: Anthropological research unfolds in the midst of doubt, uncertainty and the fear of being “conquered” or “delighted” by our interlocutors, or even of being hated by them. We must therefore look for a path between autonomy and commitment.
Contribution: The various ways in which data can be returned to the people studied can open up a field of possibilities for cooperative work in the effective register of a committed anthropology.
Keywords:
- adoption,
- justice system,
- trajectories,
- research
Resumen
Marco de la investigación: Desde hace catorce años, vengo reflexionando sobre el tema de la adopción en Brasil, con la ciudad de Río de Janeiro como campo de estudio privilegiado. Al mismo tiempo que me dedicaba a los significados del parentesco, sus implicaciones sociales y jurídicas, la concepción euroamericana del parentesco (Strathern, 2015) y sus mandatos morales, comencé a reflexionar sobre los significados de una política de infancia y juventud, sobre su relación con la adopción y con las prácticas del sistema brasileño de Justicia para Niños y Adolescentes.
Objetivos: Mi objetivo es debatir el modo en que una postura reflexiva, fundamental en las ciencias sociales, puede modificar las trayectorias de investigación. Pero también de la forma en que las experiencias etnográficas en el campo son capaces de producir efectos en investigadores y encuestados.
Metodología: Aquí discuto los cambios que se han producido en mi trayectoria de investigación sobre la adopción y que están relacionados con mi compromiso .
Resultados: Para ello, insistiré en mis experiencias etnográficas en Grupos de Apoyo a la Adopción y en Tribunales de Protección de la Niñez y la Juventud, y cómo me han afectado (Favret-Saada, 1990), provocando —en mí y en mi investigación— un cambio de perspectiva. También discuto algunos de los contextos que rodean las reuniones destinadas a reproducir datos de investigación.
Conclusion: La investigación antropológica se desarrolla en la duda, la incertidumbre y el miedo a ser "conquistados" por nuestros interlocutores o a ser odiados por ellos. Por lo tanto, debemos buscar un camino intermedio que nos permita tanto autonomía como compromiso.
Contribución: Las diferentes posibilidades de restitución de datos a las personas estudiadas pueden abrir un campo de posibilidades para el trabajo cooperativo, en el registro efectivo de una antropología comprometida.
Palabras clave:
- adopción,
- sistema de justicia,
- trayectorias,
- investigación
Article body
Depuis quatorze ans, je réfléchis à la question de l’adoption au Brésil, avec la ville de Rio de Janeiro comme terrain d’étude privilégié. Tout au long de mon parcours (Robin, 2016 ; Bessin, 2009 ; Negroni, 2011 ; Negroni et al ., 2017 ; Negroni et al ., 2022), j’ai axé mon travail sur la recherche ethnographique et sur l’analyse documentaire du monde juridique, en me concentrant sur la question de la violence et des relations de genre (Rinaldi, 2015). À partir de 2009, j’ai commencé à analyser les dispositifs juridiques, les processus d’adoption et de destitution de la tutelle familiale, les programmes et les politiques d’adoption. J’ai également réalisé des recherches ethnographiques sur les pratiques d’adoption. Ainsi, j’ai réfléchi sur les textes de loi et j’ai mené des recherches documentaires et de terrain dans différents contextes, tel celui des Tribunaux de protection de l’enfance et de la jeunesse [Varas da Infância e da Juventude] et lors des réunions des groupes d’appui à l’adoption (GAA).
Au fil des années, j’ai circulé au sein de divers contextes de recherche en tant que chercheuse soucieuse de « dévoiler » le champ des études sur la famille et la parenté. J’ai développé une réflexion théorique sur la conception occidentale des liens biologiques et des relations humaines, ainsi que sur les pratiques d’adoption. J’ai analysé les dispositifs juridiques (processus d’adoption et de destitution de la tutelle familiale). De plus, j’ai enquêté, auprès des membres du monde juridique et des « candidats à l’adoption », sur les conceptions des relations de parenté, ainsi que sur les motivations pouvant guider des personnes et des couples jusqu’au processus d’adoption.
J’ai commencé à circuler sur ces terrains en tant qu’anthropologue engagée (Fassin, 2001 ; Kirsch, 2018). Mon champ d’action a toutefois été modifié par l’exercice de la réflexivité. En même temps que je me consacrais aux significations de la parenté, à ses implications sociales et juridiques, à la conception euroaméricaine de la parenté (Strathern, 2015), à ses injonctions morales et à son hétéronormativité (Butler, 2003), j’ai réfléchi aux significations d’une politique de l’enfance et de la jeunesse, à sa relation avec l’adoption et avec les pratiques du système brésilien de Justice de l’enfance et de l’adolescence.
Je pense que cette évolution de parcours n’est pas due à un dilettantisme universitaire, mais à une forme de réajustement (Bessin, 2009) de ma trajectoire de chercheuse et de mon engagement (Fassin, 2001) dans le contexte des pratiques liées aux politiques publiques de l’enfance et de la jeunesse au Brésil. Mon immersion sur le terrain – thème que j’aborderai plus loin – a coïncidé avec un grand inconfort personnel concernant la place que l’adoption a acquis au Brésil au sein des pratiques de la justice (Schuch, 2009) dans le champ de l’enfance et de la jeunesse, et dans le militantisme de l’adoption.
Circuler au sein de ces milieux m’a permis de développer réflexivité concernant les significations, les pratiques et les lois de l’adoption, et a ainsi aiguisé ma production intellectuelle. Dans cette perspective, j’ai cherché à travailler de manière critique (selon les termes de Fassin, 2001) sur les classifications, les significations, les lois et les pratiques de l’adoption. Cela m’a amené à essayer de comprendre quelle place occupait l’adoption sur la scène nationale. Qu’est-ce qui était en train de changer ? Les législations et les pratiques cesseraient-elles d’être au service d’un projet parental et matérialiseraient-elles l’idée que la « parentalité par substitution » constituerait une sorte de « salut » dans la vie des enfants et des jeunes retirés de leurs familles biologiques en raison de mesures de protection ? Les lois et les pratiques au Brésil viseraient-elles à favoriser l’adoption au détriment de la réintégration des enfants dans leur famille d’origine ? Cette perspective serait-elle matérialisée dans la loi nº 13 509/17 – qui concerne l’adoption et modifie la loi nº 8 069/90 (Statut de l’enfant et de l’adolescent) ?
Durant ce parcours, j’ai participé à des rencontres universitaires promues par des militants de l’adoption, ainsi qu’à des colloques organisés par des membres du système judiciaire du secteur de l’enfance et de la jeunesse. J’ai également rencontré certains interlocuteurs, tels que des « candidats » à l’adoption participant à des groupes d’appui à l’adoption (GAA), des coordinateurs de ces GAA et des professionnels liés à la justice, dans le but de recueillir des données pour ma recherche. Dans certains de ces entretiens, j’ai essayé de susciter des réflexions sur les significations prises par l’adoption dans le contexte national. Je m’emploie aussi à développer ces réflexions à travers certaines publications. En effet, et en accord avec Moreira et al. (2021), je pense que l’engagement est inséparable de la production théorique. À partir de 2022, j’ai rejoint le Réseau international de recherche sur la parenté – Anthera – [1] où je participe à des réflexions, dans une perspective comparative, sur les adoptions (nationales, internationales, « difficiles »), ainsi qu’à des débats sur la problématique des adoptions liées aux politiques publiques en matière de reproduction humaine ( gouvernance reproductive ), et sur les différentes modalités de la parentalité contemporaine.
Inspirée par la position de Robin (2016) selon laquelle un parcours de vie implique un exercice réflexif qui se constitue a posteriori , je présenterai et mettrai en perspective les changements survenus dans ma trajectoire de recherche sur l’adoption étant liés à mon engagement . Je prends soin d’articuler ce travail de réflexivité avec les transformations qui ont eu lieu sur la scène de l’adoption au Brésil (en termes de politiques, de pratiques et de sensibilités). Il est important pour moi de relier les effets des politiques pour l’enfance et la jeunesse à mes propres évolutions concernant l’analyse de la situation. Pour ce faire, j’insisterai sur mes expériences ethnographiques vécues dans les groupes de soutien à l’adoption et dans les Tribunaux pour la protection de l’enfance et de la jeunesse, et sur la manière dont elles m’ont affectée (Favret-Saada, 1990), provoquant – en moi et dans mes recherches – un changement de perspective. J’aborderai également certains contextes entourant les réunions visant à restituer les données de recherche.
Je vais commencer par aborder les transformations des significations des pratiques d’adoption dans le contexte national (Brésil). Ensuite, je réfléchirai à mon parcours de recherche, à mes rencontres avec mes interlocuteurs, à mon engagement dans la recherche anthropologique et enfin aux restitutions de données, à leurs limites et à leurs champs de possibilités.
Pratiques adoptives et transformation des significations
Afin de réfléchir aux significations et aux pratiques de l’adoption au Brésil, je détaillerai ici les changements qui ont eu lieu dans le corpus de lois et dans les orientations des politiques de protection des enfants et des jeunes au Brésil, en esquissant quelques comparaisons internationales. Ensuite, je construirai ma problématique sur la base de ces réflexions et présenterai mon parcours de recherche.
Selon Abreu (2002), jusqu’en 1979, le Code civil de 1916 était la seule législation régissant l’adoption. En application de ce code, l’adoption signée chez le notaire pouvait être dissoute (« adoption simple »). À cette époque, la priorité n’était pas la protection des enfants et des adolescents ni la garantie du droit à une vie familiale, comme cela est le cas au Brésil depuis la fin des années 1980. L’objectif n’était pas d’accéder à la volonté des personnes et des couples modernes d’avoir des enfants, à l’instar des pays européens et américains des années 1970 et 1980. Il s’agissait principalement d’une prescription morale visant à ce que les familles brésiliennes sans enfant puissent trouver une progéniture et garantir leur descendance, et que les personnes âgées sans héritiers puissent garantir leur droit de succession.
D’après Nizard (2005) et Leblic (2014), l’adoption a des significations différentes selon le contexte culturel et temporel. Par exemple, dans ses recherches sur les Kanaks de Nouvelle-Calédonie et les Maoris de Polynésie française, Isabelle Leblic (2014) a montré que, au sein de ces sociétés traditionnelles, les déplacements d’enfants ne doivent pas être reliés avec la conception moderne visant à « donner une famille aux enfants et aux adolescents » ou à satisfaire les intérêts des adultes en quête de cette affiliation (Ouellette, 2000). Dans les sociétés traditionnelles, comme l’explique Nizard (2005), l’adoption peut permettre de créer des alliances, d’assurer la continuité des dynasties et de répondre aux obligations sociales découlant de l’absence d’enfant, favorisant ainsi l’équilibre des liens traditionnels. Le premier Code des mineurs fut promulgué au Brésil en 1927[2]. Toutefois, la conception de l’adoption demeura inchangée, l’adoption continuant d’être régie par le Code civil de 1916. En 1957, la loi n° 3 133 modifia le Code civil en facilitant la possibilité de filiation d’enfants en « situation irrégulière » (pauvres ou séparés de leur famille biologique). Malgré cela, Abreu (2002) soutient que l’objectif général de l’adoption restait le même : satisfaire les intérêts des couples sans enfants.
Huit ans plus tard, en 1965, avec la loi n° 4 655, une nouvelle législation entrait en vigueur, qui maintenait les éléments établis par la loi précédente. La principale innovation de cette loi fut toutefois l’introduction de la « légitimation adoptive » (Dutra de Paiva, 2004). En plus de mettre sur un plan d’égalité les droits des enfants adoptifs et ceux des enfants biologiques, elle déterminait également l’irrévocabilité de l’acte d’adoption.
Vers la fin des années 1960 et le début des années 1970, les notions de « droits de l’enfant » et de « bien de l’enfant » (Sheriff, 2000) se sont parallèlement construites sur les scènes européenne et américaine. Des idées telles que l’importance d’aimer les enfants, de s’en occuper et de les protéger sont devenues incontournables et universelles. Ces idées n’intégraient pas le fait que certaines pratiques culturelles basées sur la discipline, les punitions et les châtiments corporels puissent être assimilées à des formes de soins.
Selon Collard et Leblic (2009), la question des droits de l’enfant surgit en 1979. L’Organisation des Nations unies (ONU) attira alors l’attention sur la situation déplorable des enfants dans diverses parties du monde. Vers le milieu des années 1980, la perception de l’enfant comme sujet vulnérable, victime innocente d’« adultes violents et négligents », émergea à l’échelle mondiale (Collard et Leblic, (2009). Une rhétorique apparut, présentant les enfants comme autonomes et détachés de leurs liens sociaux et familiaux. En outre, l’idée se propagea que les garçons et les filles des pays en développement étaient victimes de la pauvreté et de mauvais traitements, et le fait qu’ils évoluent dans la « rue » les plaçaient en une situation de « danger ». Pour éviter de passer de la « situation de danger » au statut d’« enfants dangereux », le périmètre des droits des enfants était élaboré en considérant l’adoption comme une possibilité de « sauvetage » de l’enfant (ou, pour ainsi dire, de « salut »).
L’idée de l’importance du retrait forcé des « enfants en danger » de leur famille biologique et de leur placement en famille d’accueil est alors présente non seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi dans des nations comme le Canada, les États-Unis et l’Angleterre. Selon Ouellette et Goubau (2009), à partir des années 1970, les services de protection sociale se sont rendu compte que des enfants retirés de leur famille restaient en institutions d’accueil jusqu’à l’âge adulte. Face à ce constat, l’Angleterre et les États-Unis ont commencé à proposer des services alternatifs à un placement en institution, tels que la tutelle, le droit de garde et le placement en famille d’accueil. Cependant, l’adoption a été désignée comme la meilleure option.
Parallèlement à ce contexte international, un nouveau code des mineurs est promulgué au Brésil en 1979. Dans la lignée des changements intervenus à l’étranger, les enfants et les jeunes sont alors considérés comme des sujets ayant besoin d’être pris en charge. Au Brésil, à cette époque, la condition de mineur (menoridade) est devenue un objet du droit public. Cependant, les conceptions discriminatoires des enfants « en situation irrégulière » persistent et l’évaluation des conditions économiques et sociales de leurs parents fournit l’argument juridique nécessaire à l’intervention de l’État, tel que l’hébergement obligatoire ou le placement dans des « familles de substitution ». Ainsi, la production de significations sur la pauvreté, qui est associée à l’idée d’« abandon » parental, motive les interventions publiques de l’État visant à « corriger » la situation, en séparant les enfants de leur famille d’origine et en les conduisant vers la procédure d’adoption.
À part les changements dans la signification du statut des mineurs (menoridade), le Code de 1979, en prévoyant l’« adoption plénière », a aussi apporté d’autres changements. Selon Barbara Yngvesson (2007), il s’agit alors d’un modèle basé sur un principe exclusif de parenté, dont la philosophie implique une intégration complète de l’enfant ou de l’adolescent dans la famille adoptive ainsi que l’effacement des liens de la famille consanguine. D’après Ouellette et Goubau (2009), cette forme d’adoption, en exigeant une rupture définitive des liens familiaux antérieurs, fait de l’adopté un étranger au sein de son groupe de naissance[3].
Dans les années 1980, le deuxième Code des mineurs a été critiqué pour son manque de clarté juridique concernant les raisons menant à la mise en institutions des « mineurs ». Parallèlement, Schuch (2009) montre que les lignes directrices sur la scène internationale étaient élaborées, telles que les réglementations de Pékin (1985) et de Riyad (1988), en soutenant la Convention des droits de l’enfant, signée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1989. Ces orientations ont fourni un nouveau cadre national pour l’élaboration de règles de protection de l’enfance et de l’adolescence, dont l’étape majeure a été la promulgation de la Constitution de 1988. Influencée par la « doctrine de la protection intégrale » établie par l’ONU, la Constitution fédérale brésilienne abrogeait le Code des mineurs de 1979 et entérinait le point de vue de l’époque selon lequel les enfants et les adolescents en « situation irrégulière » n’étaient pas des « objets », mais plutôt des « sujets de droit ».
La « doctrine de protection intégrale » adoptée par la Constitution fédérale de 1988 a été incorporée en 1990 dans la loi n° 8 069, connue sous le nom de Statut de l’enfant et de l’adolescent (ECA). Cette loi a formellement consolidé l’importance du maintien des enfants et des adolescents dans leur famille de naissance (Rinaldi, 2019). Cela a conduit à l’idée que l’adoption ne pouvait avoir lieu qu’une fois épuisées toutes les possibilités de « réintégration familiale ». Selon Fonseca (2000), en vertu de cette loi, la pauvreté des familles d’origine cessa d’être un motif de placement en institution et d’éloignement des enfants et des adolescents de leur famille d’origine, établissant ainsi un modèle de justice sociale.
D’après Fonseca (2000) et Fonseca et Cardarello (1999), la loi ECA a coïncidé avec le déplacement d’un « problème socio-économique » vers une question de « négligence ». Les familles « pauvres » ne sont plus tenues pour responsables des dommages auxquels leurs enfants pourraient être exposés, les parents « négligents » sont devenus responsables de ces situations, prétendument en raison du caractère « déstructuré » de leurs situations conjugales, ainsi que de leur attitude peu « zélées » envers leurs enfants et de leur « incapacité à prendre soin » de leurs enfants et/ou des « mauvais traitements » qu’ils leur font subir. (cf. CNJ et al., 2022).
Selon Fonseca (2019), le Statut de l’enfant et de l’adolescent stipule que le placement dans une « famille de substitution » représente une mesure exceptionnelle. En outre, le Brésil a créé un Plan national pour la promotion, la protection et la défense du droit des enfants et des adolescents à la vie familiale et communautaire (CONANDA/CNAS, 2006), qui donne la priorité au maintien des enfants et des adolescents dans leur famille d’origine. Malgré cela, on peut considérer qu’à partir de la fin de la décennie 2000, il y a eu au Brésil une incitation aux pratiques adoptives[4] (Fonseca, 2019).
En ce qui concerne « le principe directeur des politiques de protection », cette période représente un moment de « recul du modèle de justice sociale au profit d’une vision plus pragmatique basée sur les droits individualisés de l’enfant », pour reprendre les termes de Fonseca (2019 : 10). Ainsi, les actions visant à la réintégration familiale et au « maintien des liens » furent minimisées tandis que les avantages apportés par la suppression de la tutelle familiale et par l’orientation ultérieure des garçons et des filles vers l’adoption furent mis en valeur.
Un phénomène semblable a eu lieu au Canada à la fin des années 1980. En 1988, le « Programme québécois d’adoption en banque mixte » a été créé à Montréal. Selon Ouellette et Goubau (2009), ce programme, inspiré des initiatives nord-américaines d’accueil d’enfants avant leur adoption, visait à préserver les liens familiaux d’origine. Cette initiative ouvrait aussi la possibilité aux familles d’accueil de devenir des familles adoptives si les tentatives de réintégration n’aboutissaient pas. Il s’agissait donc d’un programme ambigu basé sur la réintégration familiale, mais donnant une importance manifeste à l’adoption.
Évoquer cet exemple québécois nous sert à souligner le fait que la survalorisation de l’adoption n’est pas un phénomène propre au Brésil des années 2000. D’après Cuthbert, Murphy et Quartly (2009), durant cette même période, les adoptions ont été fortement encouragées en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni, au détriment de la réintégration familiale. Les familles adoptives ont été valorisées en tant que moyen de « sauver » les enfants qui étaient censés être en situation de risque dans leurs groupes de naissance.
Il s’agit de visions concurrentes présentes sur la scène brésilienne au début des années 2000. Peut-être ce recul du modèle de justice sociale a-t-il conduit, près de deux décennies après la promulgation de l’ECA, à sa réforme, en 2009, par le biais de la loi n° 12 010/09, connue sous le nom de nouvelle loi sur l’adoption. Ce dispositif était fondé sur la critique, considérant que les familles à faibles revenus étaient incapables de s’occuper de leurs enfants (Rinaldi, 2019). Selon Silva et Arpini (2013), la modification de l’ECA a permis de renforcer la vie familiale d’origine et communautaire, en établissant que la situation de l’enfant ou de l’adolescent placé en famille d’accueil devait être évaluée tous les six mois, et en déterminant que la durée du séjour d’accueil en institution ne pouvait excéder deux ans, sauf en cas de besoin avéré répondant à l’intérêt de l’enfant. Enfin, il a été souligné que le maintien ou la réintégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille primeraient sur toute autre action.
De 2010 à 2017, la loi nº 12 010/09 a été appliquée. Cependant, la question de son efficacité, et la nécessité qu’elle soit réformée, a été débattue par différents acteurs évoluant dans le milieu de la justice des enfants et des adolescents et par les praticiens de l’adoption. Guidés par des points de vue divers, ces professionnels se sont posés les questions suivantes : quels sont les effets de la loi nº 12 010/09 sur la vie des enfants et des adolescents placés en institutions et sur leur famille biologique ? Quelles sont les conséquences des tentatives de « réintégration » des enfants dans leur famille biologique telles que le prévoit la loi ? (Rinaldi, 2019)
En ce qui concerne la nécessité d’une nouvelle réforme de l’ECA, l’Institut brésilien du droit de la famille (IBDFAM), un des acteurs ayant un poids symbolique important, s’est exprimé publiquement contre la loi nº 12 010/09, en proposant des « alternatives » aux pratiques d’adoption. Cette entité, ainsi que plusieurs autres[5], a contribué, par sa participation aux audiences publiques, à l’élaboration du texte de la loi nº 13 509/17.
Du point de vue de ces acteurs, l’argument principal était que la tentative de réintégration familiale conduisait à la mise en institutions en répétition de garçons et de filles ; ces derniers finissaient par grandir dans les institutions et n’étaient plus adoptés. Ces mêmes acteurs ont attiré l’attention sur le fait qu’au Brésil, les chances d’un enfant d’être adopté varient en fonction son âge. En d’autres termes, plus l’enfant est jeune, plus il a de chances d’être adopté[6]. Il est important de noter que ce type d’argument a été mobilisé lors de la rédaction du projet de loi (PL) n° 101, en 2017, qui a donné lieu à la loi n° 13 509/17. La justification « pleine et entière » (inteiro teor) du projet de loi nº 5 850/2016, rédigée par le député Augusto Coutinho, du parti Solidariade/PE, et publiée sur le site Internet de la Chambre des députés du Brésil (Brasil, 2016 : 5), avance que :
« Il s’agit d’une mesure efficace et immédiate qui permet aux enfants âgés de zéro à cinq ans d’éviter d’atteindre un âge où, comme le montrent diverses études spécialisées, l’adoption est beaucoup plus difficile. En résumé, après l’application de cette loi, il n’y aura plus d’enfants de cette tranche d’âge (plus de 6 ans) disponibles dans les foyers d’accueil, car ils auront déjà été dûment adoptés, dans le cadre d’une procédure légale régulière, avec la rapidité mise en œuvre et souhaitée par toutes les parties impliquées, en particulier les mineurs. »[7]
En 2017, cette loi a été adoptée, modifiant ainsi le Statut de l’enfant et de l’adolescent. Il est important de noter que cette disposition est le produit d’interprétations disparates (Rinaldi, 2019). Bien que cette loi avance que les pratiques adoptives peuvent être un instrument permettant de résoudre la situation des enfants et des adolescents placés en institutions, elle affirme aussi que l’adoption ne doit avoir lieu que lorsque toutes les possibilités de « réintégration familiale » ont été épuisées.
Bien qu’il s’agisse d’un texte visant à « résoudre un problème social émergent » (le séjour prolongé des enfants dans les foyers d’accueil), il est devenu une politique pour les enfants et les adolescents (Rinaldi, 2019). En accélérant la procédure de destitution de la tutelle familiale relative à des enfants de moins de 6 ans en vue de leur adoption éventuelle, cette législation « quasi-privatiste » tend à satisfaire les désirs des adoptants qui cherchent à accueillir des enfants en bas âge.
Pour cette raison, j’émets l’hypothèse que, la loi met l’accent sur la « remise volontaire [de l’enfant] » (« entrega voluntária »). Ce terme se réfère à des situations dans lesquelles les femmes enceintes, les femmes en post-partum et/ou leurs partenaires décident de ne pas garder les enfants pendant la grossesse et/ou après la naissance, les remettant directement au pouvoir judiciaire, dont la responsabilité sera de les conduire à l’adoption (Rinaldi et al., 2024). Bien que les dispositions mentionnées fassent partie du texte de la loi nº 13 509/17, la « remise volontaire » a été normalisée au Brésil en 2009 par le biais de la loi nº 12 010/09. Cependant, la loi précédente ne mettait pas l’accent sur la remise du nouveau-né comme le fait cette nouvelle loi, et n’envisageait pas non plus la garantie du droit au secret des femmes pendant la « remise volontaire »[8]. En ce qui concerne cette « remise volontaire », la loi nº 13 509/17, en vigueur jusqu’à aujourd’hui, a été élaborée dans le but d’accélérer les procédures judiciaires de séparation des nouveau-nés de leur famille biologique, afin que les bébés « remis » soient rapidement adoptés. Pour cette raison, le texte de la loi vise à éviter l’introduction d’une action en destitution de la tutelle familiale[9], en accord avec les principes de « l’économie de la procédure et de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Les parcours : une recherche en constante évolution
Vers 2009, je me suis intéressée à ce qui pouvait pousser des individus ou des couples à déposer un dossier d’adoption à la municipalité de Rio de Janeiro. Au départ, je voulais comprendre les raisons qui incitaient les individus et les couples à adopter. Dans ce contexte, je n’ai pas analysé les politiques nationales de l’enfance et de la jeunesse ni leurs effets sur les parcours des personnes et sur les pratiques de justice (Schuch, 2009). Je me suis plutôt concentrée sur les adoptants, en essayant de comprendre « pourquoi ils ont choisi l’adoption ». Je présupposais que les individus ou les couples étaient poussés à l’adoption par un impératif de reproduction. Je considérais que les futurs adoptants recherchaient l’adoption comme une « issue » à un projet parental « biologique/naturel » qui n’avait pas abouti. Sans m’en rendre compte, je me basais alors sur un modèle hégémonique de la famille conjugale moderne, centré sur une unité domestique composée d’un père, d’une mère et d’une progéniture (existante ou désirée).
Quand j’ai entamé mes recherches, j’ai choisi de travailler sur les processus et les habilitations à l’adoption, au sein de la municipalité de Rio de Janeiro, afin de comprendre les raisons menant à ce processus juridique. Lors de mes visites aux Tribunaux de protection de l’enfance et de la jeunesse, au cours de conversations informelles avec des membres de cette institution, de nombreuses personnes ont souligné l’importance des GAA. J’ai ainsi constaté que ces organisations gagnaient en importance sur la scène nationale et municipale.
En 2010, j’ai commencé une recherche ethnographique auprès des GAA dans la municipalité de Rio de Janeiro, et je suis ensuite retournée sur le terrain à deux reprises, en 2012 et en 2020. Lors des premières incursions sur le terrain, mon intention était de présenter ma proposition de travail aux différents participants afin de pouvoir les interviewer ultérieurement sur les raisons qui les avaient conduits à cette parentalité et sur les parcours adoptifs qu’ils avaient suivis.
J’ai circulé au sein de certains GAA à Rio de Janeiro, menant parmi eux (jusqu’à l’année 2020), 48 entretiens avec des individus et des couples de sexes, d’identités, de classes et d’origine territoriale différents. Je me suis rendu compte, en particulier au cours des premières années de recherche, que les trajectoires et les récits produits par mes interlocuteurs faisaient souvent écho à mon propre parcours de vie . Une forte identification s’établissait entre moi et certaines personnes (Goldman, 2006). Je désirais alors vraiment avoir des enfants, ayant subi deux fausses couches et ayant eu recours à la procréation médicalement assistée. Avant et après la naissance de ma fille, j’ai voulu adopter un enfant, mais cela ne s’est pas concrétisé.
En allant sur le terrain, en participant à des réunions et en menant des entretiens, j’ai pu constater des parcours quelque peu similaires au mien. J’ai entendu des histoires tristes sur la douleur liée au désir d’enfant et sur la difficulté d’en avoir. J’ai pu être le témoin de nombreuses belles histoires chargées d’affect sur les adoptions, les familles composées et recomposées, ainsi que sur la difficulté de vivre la parentalité adoptive. De nombreuses réunions ont abordé la manière dont ces familles avaient vécu l’arrivée des nourrissons et des jeunes, les décalages entre les attentes et le vécu parental, les regrets, la dépression, l’angoisse et/ou les tensions conjugales face à l’arrivée de l’enfant, les souvenirs des adoptifs, la différence entre l’enfant réel et l’enfant idéal, et le rôle fondamental des GAA dans ce contexte.
Lors de ces rencontres, j’ai ressenti un accueil chaleureux et une acceptation de mon travail, exprimé à la fois par les coordinateurs des GAA, par les personnes interrogées et les participants aux réunions. J’ai moi-même été invitée à coordonner un GAA. Malgré mon refus, je me suis sentie fortement engagée au sein de ce réseau de relations. Il y avait entre nous un horizon commun , une communauté de vues (Cardoso de Oliveira, 1996). J’ai pu dépasser la notion appauvrissante d’objectivisme à travers cette relation dialogique avec mes interlocuteurs.
Insérée dans ce contexte ethnographique, j’ai vécu des expériences qui ont changé ma perspective ; je n’étais plus dans une posture d’ identification . En questionnant moins et en laissant parler plus mes interlocuteurs (Goldman, 2006), j’ai pu vraiment voir et écouter ce qui se disait et se faisait (Peirano, 2002) à propos de ces organisations et de leur importance pour l’adoption sur la scène nationale et municipale. Lors de nombreuses réunions, les coordinateurs et les orateurs invités se sont appliqués à expliquer aux candidats à l’adoption, comment elle allait se dérouler, en suivant les étapes et les dispositifs juridiques. Grâce aux témoignages de parents adoptifs invités à s’exprimer, les participants ont été sensibilisés à la réalité des enfants et des adolescents susceptibles d’être adoptés, ainsi qu’aux différentes possibilités de devenir parents de garçons et de filles « difficiles à adopter » (âgés de plus de 6 ans, membre d’une fratrie, noirs, souffrant de maladies chroniques et/ou ayant des « besoins spéciaux »).
Dans ce contexte, j’ai pu constater qu’il existait une communication produite par le biais d’une micropolitique des émotions (Rezende et al ., 2010), s’exerçant parfois à travers des commotions collectives (Bessin, 2009), et visant à sensibiliser les participants sur l’existence d’enfants et d’adolescents handicapés, et/ou avec des frères et sœurs, et/ou âgés de plus de 6 ans, et/ou non blancs, et tous « aptes à l’adoption » (les parents biologiques ayant été destitués de la tutelle familiale). En conséquence, j’ai commencé à réaliser qu’au sein de ces espaces, l’adoption ne se limitait plus seulement à un projet parental, mais se transformait en une politique de l’enfance et de la jeunesse.
Au fil des ans, j’ai circulé sur le terrain, participant à des événements – tels que la rencontre nationale des groupes d’appui à l’adoption (ENAPA), à des conférences, à des réunions de GAA –, menant ainsi une enquête ethnographique au sein des Tribunaux pour la protection de l’enfance et de l’adolescence, et effectuant des recherches documentaires. Ce travail s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui, une partie de la recherche ayant été suspendue lors de la pandémie de COVID-19. En discutant avec des membres de ces organisations, avec des membres des Tribunaux pour la protection de l’enfance et de l’adolescence, avec des « Défenseurs publics » [10] et des procureurs (« Promoteurs de Justice ») attachés à la Justice pour l’enfance et de l’adolescence, j’ai pu constater qu’il existe des controverses autour des significations et des pratiques de l’adoption. Des slogans, tels que « l’adoption est un acte d’amour », sont fréquents dans les réunions des GAA et ne sont pas « bien vus » par le personnel technique (psychologues et assistantes sociales) des Tribunaux de protection de l’enfance et de la jeunesse, pour qui l’adoption ne doit pas consister en un acte de charité, mais en la concrétisation d’un « réel désir de parentalité ».
Dans ces contextes ethnographiques, des idées concernant « une nouvelle culture de l’adoption » (Rinaldi, 2010) circulent. Parmi les membres de la magistrature, les membres des GAA et au sein des organisations liées à la promotion des droits des enfants et des adolescents, il y a l’idée qu’il est important que les candidats à l’adoption puissent élargir les profils des enfants qu’ils désirent adopter. Pour ce faire, il faut ouvrir la possibilité d’inclure dans la filiation des enfants « difficiles à adopter », c’est-à-dire des enfants noirs, de plus de cinq ans, possédant une fratrie, ayant une forme de handicap ou des problèmes de santé. [11]
En outre, j’ai constaté que l’argument suivant circulait : plus que de satisfaire les souhaits des parents adoptifs potentiels, la question principale serait de résoudre le « problème » des enfants et adolescents placés en institutions publiques au Brésil. Ces points de vue étaient présents, même si, dans la pratique, des positions divergentes étaient exprimées. Des membres d’ONG défendant les droits des enfants et des adolescents, des associations de magistrats, des procureurs (« Promoteurs de Justice ») et des « Défenseurs publics » chargés de la protection de l’enfance et de l’adolescence ont formulé des interprétations différentes concernant de la parentalité adoptive. Ces interlocuteurs s’appuyaient sur l’idée que l’adoption représente une mesure exceptionnelle à laquelle il faut recourir lorsqu’il n’est pas possible de réintégrer un enfant ou un jeune dans sa famille de naissance.
Dans les pratiques judiciaires, des membres de l’équipe technique (psychologues et assistantes sociales) – considérés des experts aux Tribunaux de protection de l’enfance et de la jeunesse – appréhendent dans leurs rapports techniques l’adoption comme un projet parental. Par conséquent, la transformation de l’adoption en une politique pour l’enfance et la jeunesse serait préjudiciable aux enfants et adolescents qui seraient conduits dans des familles adoptives pour des raisons autres que celle d’un désir de parentalité. Selon ces professionnels, cela rendrait irréalisable le sentiment d’appartenance à un espace « socio-familial », condition fondamentale pour la construction d’une identité filiale.
Dans ce contexte marqué par la complexité, je me suis interrogée sur les tenants et les aboutissants de cette situation. Quels étaient les effets des transformations décrites précédemment ? Quelles étaient les conséquences des significations – controversées, divergentes et parfois contradictoires – de l’adoption dans la vie des enfants, des jeunes, des familles « donneuses » et des familles adoptives ? Quelle était ma place dans ce tableau complexe et ambigu ? Devais-je prendre position, voire m’opposer à cet état de fait ? Mon rôle se limitait-il à évaluer et à mettre en perspective la diversité des points de vue, en restant une observatrice « neutre » ?
Les inconforts de la recherche
En accord avec Goldman (2006), je pense qu’une anthropologie « digne d’intérêt » doit susciter des remises en question épistémologiques, éthiques et politiques. En d’autres termes, je crois en une science « capable de ne pas reproduire les rapports de domination auxquels sont soumis les groupes sociaux que nous étudions » (Goldman, 2006 : 169). Nos recherches, nos inconforts, nos « découvertes » et nos positions critiques doivent circuler parmi nos pairs sous la forme de production théorique et nos interlocuteurs, dans le but d’alimenter un dialogue critique.
La réflexion sur l’adoption appréhendée comme une politique de l’enfance et de la jeunesse comporte une autre dimension : celle concernant les familles (pères et mères biologiques) qui sont privées de la tutelle familiale. Pour qu’un individu ou un couple puisse adopter, il faut que l’enfant ou l’adolescent « adoptable » ait été retiré à sa famille de naissance par une action de destitution de la tutelle familiale [12] , ou que les parents biologiques aient volontairement décidé de « placer » leur(s) enfant(s) en adoption.
Au fil de mes incursions sur le terrain et sur la base d’une recherche réalisée par le Conseil national de la justice (CNJ) en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) (2022) dans laquelle je suis intervenue en tant que consultante, j’ai constaté qu’il existe au Brésil un excès de placements des enfants en institutions d’accueil ainsi qu’une banalisation de la destitution de la tutelle familiale et une culpabilisation des familles pauvres pour les situations auxquelles elles sont exposées, les enfants étant alors retirés à leurs familles. (CNJ, 2020 ; CNJ et al ., 2022).
Au Brésil, la justice des mineurs, avec l’appui du système de santé publique, a agi de manière arbitraire face à une partie de la population en situation de vulnérabilité sociale. On le voit, par exemple, avec l’idée qu’une femme toxicomane est « incapable de s’occuper de son bébé », lequel est supposément placé par cette mère dans une situation de « risque » (Diniz et al ., 2014 : 228). Cette situation justifierait des mesures d’intervention sociale, qui culmineraient par la prise en charge des bébés peu après la naissance par les institutions publiques et avec l’action consécutive visant à la destitution de la tutelle de la famille biologique.
Dans ce contexte, les maternités deviennent des « partenaires » importants dans les pratiques discriminatoires et d’exclusion, issues du pouvoir judiciaire ou du parquet (« Ministère public »). Ces instances considèrent parfois que les hôpitaux ont l’obligation de signaler la naissance d’enfants dont les mères présentent des signes d’« alcoolisme » ou de « toxicomanie ». Pour ce faire, certains fonctionnaires des Tribunaux de protection de l’enfance et de l’adolescence et des représentants du parquet (« Ministère public ») émettent des ordonnances et des lettres officielles les obligeant à signaler immédiatement la naissance de ces bébés.
Ces institutions hospitalières collaborent avec les Tribunaux de protection de l’enfance et de l’adolescence non seulement dans les situations de retrait obligatoire des enfants de leur famille, mais aussi lorsque les mères biologiques optent pour une « remise volontaire ». Lorsqu’elles choisissent de ne pas garder leurs enfants et les remettent directement à la justice, qui se chargera de les faire adopter ultérieurement. Cette « remise » peut avoir lieu juste après l’accouchement. Dans ces cas, il appartient aux maternités d’en informer les Tribunaux de protection de l’enfance et de l’adolescence et le parquet. Si la femme enceinte souhaite ne pas garder l’enfant, elle peut s’adresser aux autorités judiciaires. En coopération avec les professionnels des services de santé publique liés à la protection maternelle et infantile, l’équipe technique des Tribunaux de protection de l’enfance et de l’adolescence assurera le suivi de ce processus. Ces lignes directrices sont le fruit de la promulgation de la loi nº 13 509/17 qui, en 2017, a modifié l’ECA.
Réaliser une ethnographie engagée implique de se préoccuper de cet état de fait et selon Moreira et al. (2021), d’adopter une approche critique qui va au-delà de l’écriture ethnographique (Clifford et al ., 2016), « en construisant des attitudes et des engagements qui rendent les connaissances construites pertinentes et directement applicables dans la vie de ceux qui n’étaient auparavant que des “informateurs” » (Moreira et al ., 2021 : 20). En s’inspirant également du travail de Kyriakides et al. (2017), il est important d’agir en tant que chercheur à travers des projets et des écrits qui ont une pertinence sociale et politique. Cela ne signifie toutefois pas qu’il faille survaloriser l’intervention sociale et/ou le travail critique et collaboratif par rapport à la rigueur intellectuelle. La distinction entre pratique et théorie devient de moins en moins pertinente, étant donné la montée en puissance des agendas institutionnels, des analyses d’impact et des actions collaboratives entre les chercheurs et les personnes étant l’objet des enquêtes.
D’après les termes de Haraway (2009), nous avons besoin de recherches critiques et localisées, qui nous permettent d’accéder aux significations, aux constructions inégales des corps et à leurs assujettissements, afin de ne pas se contenter de rester dans le domaine de la connaissance, et d’ouvrir sur un futur possible. En ce sens, « […] les savoirs localisables et critiques, soutenus par la possibilité de réseaux de connexions, appelés réseaux de solidarité en politique et conversations partagées en épistémologie » (Haraway, 2009 : 23) sont importants.
Ainsi, une anthropologie réflexive peut s’exercer par le biais de travaux collaboratifs et en établissant des dialogues avec des interlocuteurs. L’une des manières possibles de procéder est de restituer les données de recherche aux personnes impliquées. Mais comment le faire sans endommager les relations, les accords et les coopérations établis sur le terrain ?
La restitution des données dans la recherche anthropologique
L’anthropologue Françoise Zonabend (1994) a montré que la restitution des données peut être comprise comme une activité qui consiste à rendre publics les résultats d’une recherche, ce qui est une manière pour les chercheurs de rendre à leurs collaborateurs l’accès aux données de la recherche. Elle s’inscrit dans le cadre d’un accord entre les chercheurs et ceux étant l’objet de la recherche, garantissant une maîtrise du matériel produit, tant sur le plan éthique qu’épistémologique[13].
Contrairement à ce qui se passe dans la recherche expérimentale dans laquelle les humains peuvent participer en tant que cobayes, la recherche en sciences humaines et sociales s’établit à partir d’un champ de relations humaines subjectives (Knauth et al., 2015). Les données produites dans les rapports, les textes scientifiques et les vidéos ethnographiques sont le produit de récits recueillis sur le terrain, de relations enregistrées et textualisées a posteriori (Clifford et al., 2016) afin d’être objectivées. Or, cette objectivation est mêlée d’affects (Favret-Saada, 1990) éprouvés au cours de l’expérience ethnographique. Tout au long de la recherche, l’anthropologue est intégré au groupe étudié, et cette personne est facilement envahi par des sentiments contradictoires sur sa position et sur le groupe étudié (Zonabend, 1994).
Malgré une immersion profonde dans le milieu de l’adoption et dans les expériences des GAA, j’ai vécu des situations de questionnement et de doute sur moi-même et sur mes interlocuteurs. En même temps que j’étais touchée par les témoignages qui démontraient l’importance des GAA dans le projet d’adoption, j’étais préoccupée par le glissement de sens que subissait la parentalité adoptive. Comment pouvons-nous écrire sur ces préoccupations et, pour reprendre les termes de Zonabend (1994), comment construire un récit objectif et éthique ? Comment produire une écriture engagée, réflexive et responsable sans fragiliser, voire détériorer, les relations de complicité et d’amitié qui s’établissent entre les chercheurs et les enquêtés ?
Bien qu’il y ait de nombreux risques de porter atteinte à la qualité des relations, il est important de restituer les données aux interlocuteurs. Comme l’affirment Knauth et al. (2015), la restitution n’est pas seulement un engagement éthique, c’est aussi un engagement politique. Malgré les dérangements, les contestations et les frustrations que les rapports de recherche et les articles scientifiques peuvent produire, il est important de s’assurer que ces derniers parviennent bien à nos collaborateurs.
Il convient de souligner qu’il n’existe pas une manière unique ou exclusive de divulguer ces résultats. Au moment de finaliser mes projets et mes publications, j’ai opté pour différentes stratégies. J’ai présenté les résultats partiels de mon travail devant quelques GAA, envoyé mes rapports de recherche et mes articles à certains interlocuteurs privilégiés de la recherche, participé à des publications collectives organisées par des militants de l’adoption, présenté les résultats de mes recherches lors d’événements universitaires et dans des espaces de militantisme pour l’adoption, ainsi qu’en participant à des réunions de travail proposées par des représentants du pouvoir judiciaire, après l’envoi de mes rapports et de mes articles.
Lors des présentations dans les GAA, les résultats intéressaient moins les candidats à l’adoption que les coordinateurs, qui étaient désireux de connaître les effets produits par ces groupes sur la vie des participants. Certains candidats à l’adoption qui ont participé aux réunions posèrent des questions sur les méthodes et les parcours d’adoption, plutôt que sur le travail de recherche lui-même.
Dans ces présentations où j’abordais surtout les raisons et les difficultés du projet d’adoption (sans m’étendre sur l’idée de l’adoption comme politique nationale de l’enfance et de la jeunesse ni sur ses effets sur les pratiques judiciaires), les résultats présentés n’ont pas suscité de désaccord de la part des coordinateurs. Comme la plupart d’entre eux venaient du domaine du droit et/ou de la psychologie, à part certains qui circulaient dans les cercles universitaires, l’intérêt manifesté concernait surtout les domaines des études familiales, de la parenté et de la biogénétique. Quelque temps plus tard, je me suis rendue compte que mes recherches avaient été instrumentalisées, de manière imprévue, en faveur du projet d’adoption, dans la mesure où elles pointaient les limites de la biologie dans la production des liens parentaux – un trait perçu favorablement dans le contexte de l’activisme proadoption.
En ce qui concerne les autres formes de restitution des données, telles que celles réalisées lors des réunions de travail, elles ont eu lieu individuellement et en équipe. La rencontre individuelle a eu lieu avec une coordinatrice d’un GAA, une interlocutrice privilégiée en raison de son importance à l’échelle nationale dans le domaine du militantisme en faveur de l’adoption. Il s’agissait d’une personne membre actif de commissions liées aux droits des enfants et des adolescents, membre de l’Association nationale des groupes de soutien à l’adoption, et directrice d’une institution défendant les droits des familles. Outre son importance nationale, je l’ai choisie parce qu’elle avait facilité mon entrée dans différents contextes de recherche. Cette rencontre a eu lieu à ma demande, car je venais d’écrire un article critique autour de la question du changement législatif et il me semblait important d’entendre son témoignage concernant la réception de mes écrits dans le milieu du militantisme de l’adoption.
La rencontre fut respectueuse, mais quelque peu tendue et conflictuelle, car mon interlocutrice avait participé activement aux auditions publiques qui contribuèrent à l’élaboration du projet de loi ayant donné naissance à la loi nº 13 509/17, à propos de laquelle j’avais écrit un article critique. Bien qu’elle l’ait lu avant la réunion et qu’elle ait écouté mes explications sur le sujet à l’époque, elle n’a pas voulu poursuivre la conversation et m’a dit : « Vous n’avez rien compris »… J’ai quitté la réunion sans savoir si cet épisode allait signifier une rupture entre nous. Nous sommes malgré tout restées en contact sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Je suis parfois invitée à présenter les résultats de mes recherches lors d’événements organisés par des organismes de promotion de l’adoption. Avec un mélange de plaisir et de gêne, je rends publiques mes analyses quelque peu dissonantes, en pariant sur les possibilités de dialogue que ce débat pourrait favoriser.
En ce qui concerne les réunions collectives de restitution des données, elles ont eu lieu avec des psychologues et des travailleurs sociaux auprès des Tribunaux pour la protection de l’enfance et l’adolescence, là aussi après avoir soumis des articles et/ou rapports de recherche. Bien que j’aie envoyé des rapports et des articles à certains juges, procureurs pour enfants et adolescents, ainsi qu’à des « Défenseurs publics », je n’ai reçu que des réponses se limitant à un remerciement pour le courrier envoyé. Par conséquent, il n’y a pas eu de discussion critique avec toutes ces équipes, mais uniquement avec certains interlocuteurs.
Les matériaux et contenus sujets à discussion concernaient mes analyses des actions visant la destitution de la tutelle familiale ainsi que des cas impliquant un transfert volontaire de l’enfant aux institutions publiques. À travers ces rapports, je cherchais à comprendre comment, dans les pratiques de la justice des mineurs, des jugements de valeur sont établis concernant les familles biologiques, la question du genre, ou encore l’adoption et son lien avec les politiques reproductives. Les deux réunions ont coïncidé avec un accueil favorable de la recherche, bien qu’il y eût des critiques sur le fait que les recherches universitaires fournissent finalement peu de matériaux offrant des possibilités de transformer la situation. Malgré le bon accueil réservé à ce qui a été présenté planait l’idée selon laquelle les études anthropologiques sont très éloignées de la réalité et ont peu de chances d’être appliquées à la vie « réelle ». Ces critiques voilées peuvent être en partie dues au fait que, comme le montrent Knauth et al. (2015), l’anthropologie brésilienne est très axée sur les activités académiques et moins active en ce qui concerne l’anthropologie appliquée. Autrement dit, ce qui est considéré comme urgent et nécessaire en termes d’évaluation d’expériences professionnelles n’est pas toujours perçu comme pertinent d’un point de vue universitaire. Malgré cela, ces réunions ont débouché sur des invitations à publier dans des ouvrages organisés par l’instance judiciaire, ainsi que sur des invitations faites à des professionnels [de la justice] à participer à des activités de travail produites par le réseau de recherche Anthera.
Considérations finales
L’objectif de mon article est de s’interroger sur la façon dont une posture réflexive, fondamentale dans les sciences sociales, peut modifier les trajectoires de recherche ; mais aussi de débattre de la manière dont les expériences ethnographiques vécues sur le terrain sont capables de produire des effets sur les chercheurs et les enquêtés.
Ainsi, les relations dialogiques qui s’établissent sur le terrain peuvent dépasser le stade de la rédaction d’un rapport et/ou de la production d’un article scientifique. En ce sens, le retour sur le terrain peut se faire non seulement pour vérifier une donnée ou valider une information, mais aussi comme contrepartie de la recherche.
Les différentes possibilités de restitution des données aux personnes étudiées peuvent ouvrir un champ de possibilités de travaux coopératifs, dans le registre effectif d’une anthropologie engagée.
Le savoir des experts doit permettre de se confronter aux pouvoirs établis et de lutter contre les inégalités sociales. Cet engagement peut se faire par le biais d’un travail coopératif, ainsi que par la déstabilisation, la confrontation, les ruptures temporaires d’accords et le brouillage des relations établies entre les interlocuteurs et les anthropologues.
La restitution des données de recherche, au-delà du respect de l’éthique de la recherche, et de l’importance de la dimension déontologique et épistémologique, peut être considérée dans sa dimension collaborative de transformation sociale. Grâce à une communication pérenne et continue sur les données de la recherche, les interlocuteurs et les anthropologues peuvent être invités à revoir leurs positions. De cette manière, les espaces de discussion, qu’ils soient publics ou privés, sont susceptibles de déboucher sur des plans d’action présentant des avantages mutuels.
Il est important de considérer que la restitution des données ne coïncide pas toujours aux attentes des personnes étudiées, qui souhaitent que les chercheurs deviennent les « porte-paroles » des causes qu’ils défendent, ou qu’ils produisent des « recettes magiques » capables de résoudre les problèmes du monde. La recherche anthropologique se déploie dans le doute, dans l’incertitude et dans la peur d’être « conquis » par nos interlocuteurs ou d’être détestés par eux. Nous devons donc chercher une voie intermédiaire qui nous permette à la fois l’autonomie et l’engagement.
Appendices
Notes
-
[1]
« Rede internacional de pesquisas antropológicas sobre família e parentesco ». Selon son site web [https://www.redeanthera.com/sobre], ce réseau a été officiellement créé en 2022, suite à l’approbation de deux appels à projets du Conseil national pour le développement scientifique et technologique - CNPq (Appel n.26/2021 Soutien à la recherche scientifique, technologique et d’innovation : Bourses à l’étranger ; Appel n.40/2022 - Ligne 3B - Projets de réseau - Politiques publiques pour le développement humain et social). Le réseau Anthera a pour siège principal l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul (PPGAS/UFRGS) et pour sièges régionaux les universités partenaires suivantes : Université Catholique Pontificale du Rio Grande do Sul (PUCRS), Université rurale fédérale de Rio de Janeiro (UFRRJ) et Université Fédérale d’Alagoas (UFAL).
-
[2]
Ce code, étant le fruit d’une nouvelle manière de concevoir l’enfance au Brésil, visait à intervenir directement afin de contrôler et à réglementer les segments les plus pauvres de la population brésilienne de l’époque (Rizzini et al., 2004).
-
[3]
Au Brésil, à cette époque, il était possible de procéder à la fois à une « adoption simple » (qui ne rompait pas les liens de l’enfant avec sa famille biologique) et à une « adoption pleine » de sorte que les deux modèles coexistaient.
-
[4]
Créé en 2006, le « Plan national pour la promotion, la protection et la défense des droits des enfants et des adolescents » visait à créer des politiques publiques dans ce domaine (Silva et Arpini, 2013). L’objectif était en particulier de soutenir les familles en situation de « vulnérabilité sociale » afin qu’elles puissent rester avec leurs enfants.
-
[5]
Tribunal de justice de São Paulo, Association nationale des groupes de soutien à l’adoption, Commission de l’enfance et de la jeunesse de l’Association nationale des [avocats de la défense, Association du barreau brésilien-section Paraná, Groupe d’étude de soutien à l’adoption du Paraná, Centre de soutien opérationnel aux enfants, aux adolescents et à l’adoption du parquet du Paraná, Association des chercheurs sur l’enfance et l’adolescence (NECA), Commission intersectorielle de suivi de la mise en œuvre du Plan national de promotion, de protection et de défense du droit des enfants et des adolescents à une existence familiale et communautaire, Mouvement national pour la vie familiale et communautaire, Bureau des « défenseurs publics » de l’État de São Paulo, Association du barreau brésilien-conseil fédéral, Bureau du procureur public de l’État de São Paulo, juges [femmes] du 3e tribunal de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées - Rio de Janeiro, 4e tribunal pour la protection de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées - Florianópolis.
-
[6]
Selon une étude menée par le CNJ (2022), les personnes et les couples qui choisissent l’adoption au Brésil préfèrent les enfants blancs de moins de 6 ans.
-
[7]
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1477583&filename=PL%205850/2016
-
[8]
Les adolescents ne peuvent pas prendre cette décision sans l’autorisation de leurs parents ou d’un tuteur, ou d’un curateur désigné par le juge.
-
[9]
Le parquet (Ministério Público) est chargé d’intenter l’action en suppression de la tutelle familiale (Rinaldi, 2020), mais elle peut être intentée par un parent de l’enfant ou de l’adolescent lorsqu’il est établi, selon l’article 1637 du Code civil de 2002 (loi nº 10.406), qu’un parent « a abusé de son autorité ou a manqué à ses devoirs le concernant ».
-
[10]
Le Défenseur public, soit l’avocat public de la défense, a pour mission constitutionnelle d’apporter une assistance juridique à ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’engager un avocat. Il s’agit donc d’une fonction judiciaire et sociale.
-
[11]
Voir Sistema Nacional de Adoção, CNJ 2021 ; 2022.
-
[12]
La demande de « destitution de la tutelle familiale » (DPF) relève de la compétence du parquet [ministère public], mais peut être sollicitée par un parent de l’enfant ou du jeune dans la mesure où, conformément à l’article 1637 du Code civil de 2002, un parent a « abusé de son autorité ou manqué à ses devoirs ». Dans ce cas, il appartiendra au juge pour mineurs de décider, à titre « préliminaire ou incidentiel », du sort de l’enfant ou du jeune concerné, qui restera sous la tutelle de l’État ou sous la garde d’une « personne appropriée » avant que le magistrat prenne une décision finale. Cependant, il est fréquent au Brésil que la décision de DPF, action demandée généralement par le parquet [ministère public], soit prise par le biais d’une destitution « liminaire » de la tutelle familiale précédant la décision de destitution. Dans ces situations, l’enfant peut être séparé du groupe de naissance, grâce à la procédure de destitution, avant qu’une décision finale ne soit prise.
-
[13]
Selon Knauth et al. (2015 : 2660), « le droit d’accès aux résultats de la recherche est l’un des principes directeurs du code d’éthique de l’anthropologue ».
Bibliographie
- Abreu, D. 2002. No bico da cegonha: Histórias de adoção e da adoção internacional no Brasil , Rio de Janeiro, Relume Dumará, Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ.
- Brasil. 1990. Lei nº 8.069 , de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF.
- Brasil. 2002. Lei nº 10.406 , de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil, Brasília, DF.
- Brasil. 2009. Lei nº 12.010 , de 3 de agosto de 2009. Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências, Brasília, DF.
- Brasil. 2017. Lei nº 13.509 , de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre adoção e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Brasília, DF.
- Brasil. Câmara dos Deputados. 2016. Projeto de Lei nº 5.850 , de 14 de julho de 2016. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”, Brasília: Câmara dos Deputados. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1477583&filenam e=PL-5850-2016.
- Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) et Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 2006. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária , Brasília, DF.
- Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 2020. Diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento , Brasília, CNJ.
- Conselho Nacional de Justiça (CNJ) et Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2022. Relatório justiça começa na infância: fortalecendo a atuação do sistema de justiça na promoção de direitos para o desenvolvimento humano integral , Brasília, CNJ.
- Bessin, M. 2009. « Le trouble de l’événement : la place des émotions dans les bifurcations », dans Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement , sous la dir. de M. Bessin, C. Bidart et M. Grossetti, Paris, La Découverte, p. 306-328.
- Butler, J. 2003. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade , trad. R. Aguiar, Rio de janeiro, Civilização Brasileira.
- Cardoso de Oliveira, R. 1996. « O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever », Revista de Antropologia , vol. 39, no 1, p. 13-37.
- Clifford, J. et G. E. Marcus (dir.). 2016. A Escrita da cultura: poética e política da etnografia , trad. M. C. Coelho, Rio de Janeiro, Editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (EdUERJ).
- Collard, C. et I. Leblic. 2009. « Présentation : enfances en péril : abandon, capture, inceste », Anthropologie et Sociétés , vol. 33, no 1, p. 7-30
- Cuthbert, D., K. Murphy et M. Quartly. 2009. « Adoption and Feminism ». Australian Feminist Studies , vol. 24, no 62, p. 395-419.
- Diniz, A. P., E. O. Alvez, T. Moreira et V. Fadigas. 2014. « Maternidad y consumo de drogas: ¿una cuestión para el Poder Judicial? » dans ¿Cómo intervenir en las urgencias? Nuevas subjetividades, nuevos dispositivos , sous la dir. de M. Cantarelli et M. C. de Oliveira, Buenos Aires, Ediciones Licenciada Laura Bonaparte, p. 225-233.
- Dutra de Paiva, L. 2004. Adoção: significados e possibilidades , São Paulo, Casa do Psicólogo.
- Favret-Saada, J. 1990. « Être affecté », Gradhiva : Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie , no 8. p. 3-9.
- Fassin, D. 2001. « Les sciences sociales comme pratique engagée », Nature Sciences Sociétés , vol. 9, no 4, p. 43-46.
- Fonseca, C. et A. Cardarello. 1999. « Direito dos mais ou menos humanos », Horizontes Antropológicos , vol. 5, no 10, p. 83-121.
- Fonseca, C. 2000. « La circulation des enfants pauvres au Brésil : une pratique locale dans un monde globalisé », Anthropologie et Sociétés , vol. 24, no 3, p. 53–73.
- Fonseca, C. 2019. « (Re)descobrindo a adoção no Brasil trinta anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente », Runa , vol. 40, no 2, p. 17-38.
- Goldman, M. 2006. « Alteridade e experiência: antropologia e teoria etnográfica », Etnográfica , vol. 10, no 1, p. 161-173.
- Haraway, D. 2009. « Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial », Cadernos Pagu , no 5, p. 7–41.
- Leblic, I. 2014. « From French Polynesia to France: The Legacy of fa’a’amu Traditional Adoption in ‘International’ Adoption », Anthropologica , vol. 56, no 2, p. 451–464.
- Kirsch, S. 2018. Engaged Anthropology , Oakland, University of California Press.
- Knauth, D. R. et N. E. Meinerz. 2015. « Reflexões acerca da devolução dos dados na pesquisa antropológica sobre saúde », Ciênc. saúde coletiva , vol. 20, no 9, p. 2659-2666.
- Kyriakides, T., H. Clarke et X. Zhou. 2017. “Introduction: Anthropology and the Politics of Engagement”, Anthropology Matters , vol. 17, no 1, p. 1-21.
- Moreira, J. V. F., J. S. Vidal et C. S. Nicácio. 2021. « Engajamento e recusa etnográfica: reflexões a partir de dois contextos de pesquisa empírica em direito », Revista de Estudos Empíricos em Direito , vol. 8, p. 1-37.
- Negroni, C. et S. Lo. 2017. « Introduction. L’autonomie dans les parcours professionnels : de quelle autonomie parle-t-on ? », Formation emploi , no 139, p. 7- 14.
- Negroni, C. 2011. « Les parcours d’insertion à l’épreuve du travail sur soi. Reprise des études et reconversion professionnelle », Recherches sociologiques et anthropologiques , vol. 42, no 2, p. 143-158.
- Negroni, C et M. Bessin. (dir.). 2022. Parcours de vie. Logiques individuelles, collectives et institutionnelles , Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, « Le regard sociologique ».
- Nizard, S. 2005. « Isabelle Leblic, éd., De l’adoption. Des pratiques de filiation différentes : Clermont-Ferrand, Presse Universitaire Blaise Pascal, coll. “Anthropologie”, 2004, 340 p. », Archives de sciences sociales des religions , no 131-132, p. 57-57.
- Ouellette, F.-R. 2000. « Parenté et adoption », Sociétés Contemporaines , no 38, p. 49-65.
- Ouellette, F.-R. et D. Goubau. 2009. « Entre abandon et captation : l’adoption québécoise en “banque mixte” », Anthropologie et Sociétés , vol. 33, no 1, p. 65–81.
- Peirano, M. (dir.). 2002. O dito e o feito: ensaios de antropologia dos rituais , Rio de Janeiro, Relume Dumará.
- Rezende, C. B. et M. C. Coelho. 2010. Antropologia das emoções, Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas.
- Rinaldi, A. A. 2010. « A “nova cultura da adoção”: o papel pedagógico dos Grupos de Apoio à Adoção no município do Rio de Janeiro », Jurispoiesis (Rio de Janeiro) , vol. 13, p. 13-37.
- Rinaldi, A. A. 2015. A sexualização do crime no Brasil: um estudo sobre criminalidade feminina no contexto de relações amorosas (1890-1940) , Rio de Janeiro, Mauad X.
- Rinaldi, A. A. 2019. « Adoção: políticas para a infância e juventude no Brasil? », Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro) , no 33, p. 273–294.
- Rinaldi, A. A. 2020. « Ações de destituição do poder familiar em processos de adoção no Rio de Janeiro: valores morais e práticas legais », Revista Sociais e Humanas , vol. 33, no 2, p. 75–91.
- Rinaldi, A. A., A. L. C. Vicente, G. Escuri et J. N. Rocha. 2024. « Gestar, parir e não se tornar mãe: recusas, impossibilidades e violações no contexto da Covid-19 », Interface , vol. 28, p. 1-15.
- Rizzini, I. et I. Rizzini. 2004. A institucionalização de crianças no Brasil , Rio de Janeiro, Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
- Robin, P. 2016. « Le parcours de vie, un concept polysémique ? », Les Cahiers Dynamiques , vol. 1, no 67, p. 33-41.
- Schuch, P. 2009. Práticas de justiça: Antropologia dos modos de governo da infância e juventude no contexto pós-ECA , Porto Alegre, Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Sheriff, T. 2000. « La production d’enfants et la notion de “bien de l’enfant” », Anthropologie et Sociétés , vol. 24, no 2, p. 91–110.
- Silva, M. L. et D. M. Arpini. 2013. « A nova lei nacional de adoção: desafios para a reinserção familiar », Psicologia Em Estudo , vol. 18, no 1, p. 125–135.
- Strathern, M. 2015. Parentesco, Direito e o inesperado. Parentes são sempre uma surpresa , São Paulo, Editora da Universidade Estadual Paulista (UNESP).
- Yngvesson, B. 2007. « Parentesco reconfigurado no espaço da adoção », Cadernos Pagu , no 29, p. 111-138.
- Zonabend, F. 1994. « De l’objet et de sa restitution en anthropologie », Gradhiva : revue d’histoire et d’archives de l’anthropologie , no 16, p. 3-14.