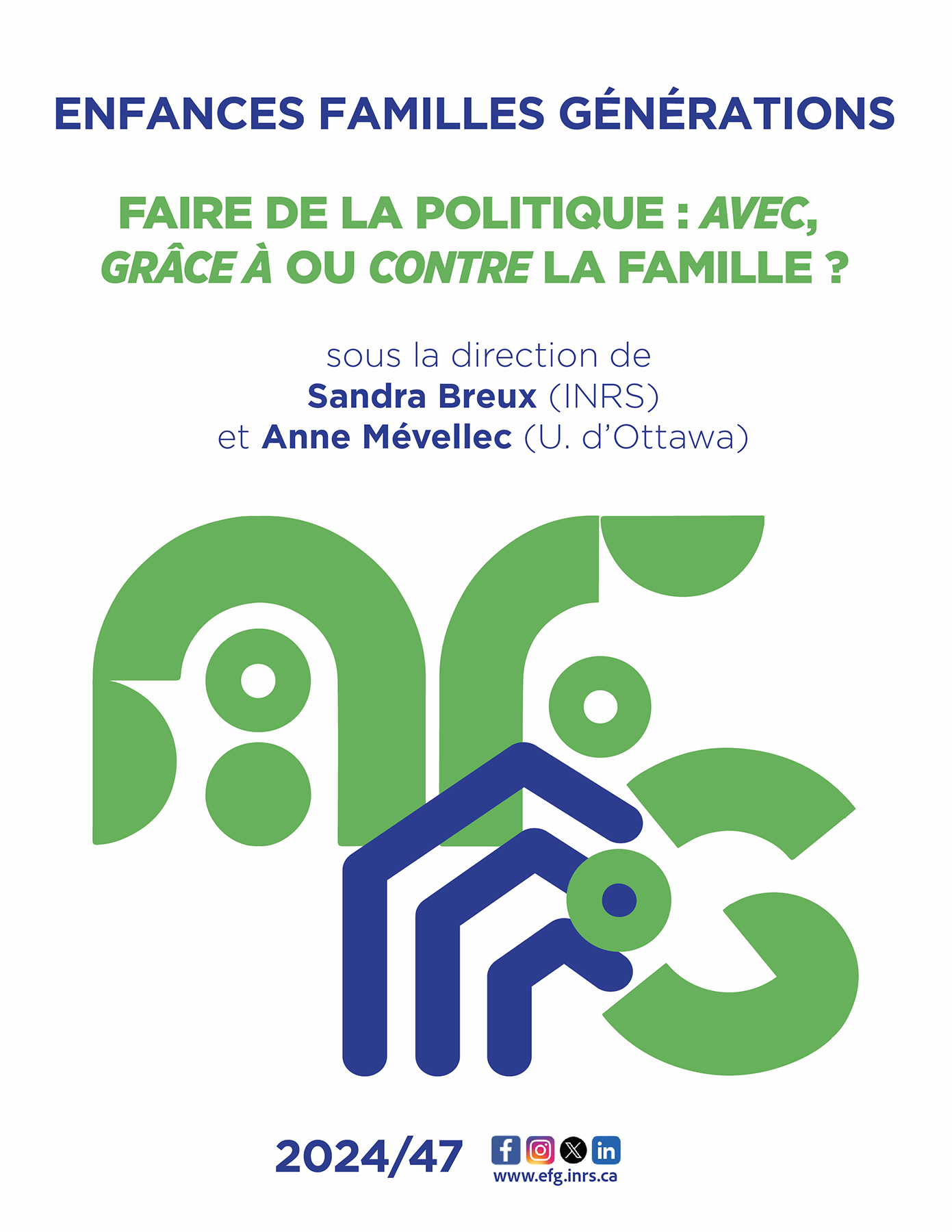Abstracts
Résumé
Cadre de la recherche : Lorsque, dans les années 1980, les couples d’immigré.es malien.nes font le choix d’une installation en France, ils se trouvent pris dans un système de « parenté mutilée » par l’émigration (Barou, 1991). Il s’opère un véritable « travail de parenté » (di Leonardo, 1987) pour maintenir des liens avec la parentèle restée au Mali et transmettre aux enfants nés et socialisés en France un sentiment d’appartenance au groupe familial malgré la distance.
Objectifs : L’article s’intéresse à la manière dont les enfants, nés en France dans les années 1980 et le milieu des années 1990, sont socialisés à l’attachement familial et transnational durant leur enfance et préadolescence – soit avant leurs premiers séjours au Mali.
Méthodologie : Les 50 entretiens approfondis de type récit de vie, menés auprès de dix familles d’immigré.es malien.nes, permettent de reconstruire les univers de socialisation familiale de manière rétrospective.
Résultats : Je montre d’abord que le récit du passé parental, plus que la transmission intergénérationnelle des prénoms, construit l’affiliation à la lignée familiale. Je souligne ensuite que les pratiques parentales d’entraide et d’accueil des membres de la parentèle transnationale en France participent à habituer les enfants à leur futur devoir de redistribution et de solidarité transnationales. Enfin, je donne à voir les effets socialisateurs de la fréquentation régulière des foyers de travailleurs migrants, où résident des hommes de la parentèle, en insistant sur la dimension genrée de cette socialisation.
Conclusions : Par ces trois processus de socialisation au sens de la famille, les enfants apprennent des rôles familiaux et transnationaux genrés, même si leur frontière est en partie brouillée par la migration. Les fils apprennent surtout un sens économique de la famille (envoyer de l’argent à la parentèle restée au Mali et soutenir la famille en France), là où les filles sont davantage socialisées à un sens matrimonial de la famille (épouser un homme de la parentèle malienne et perpétuer la lignée).
Contribution : À la croisée de la sociologie de la socialisation, de la famille et des migrations, ce texte contribue à la connaissance de la vie ordinaire des familles immigrées et/ou transnationales en insistant sur les effets socialisateurs des configurations familiales transnationales et leurs variations genrées.
Mots-clés :
- socialisation,
- familles transnationales,
- immigration,
- parenté,
- lien familial,
- pratiques éducatives,
- descendants d’immigrés,
- Sahel (Mali, Sénégal),
- France
Abstract
Research Framework: When, in the 1980s, Malian immigrant couples chose to settle in France, they found themselves caught up in a system of “mutilated kinship” caused by emigration (Barou, 1991). A veritable “work of kinship” (di Leonardo, 1987) is required to maintain links with relatives who have remained in Mali, and to pass on to children born and socialized in France a sense of belonging to the family group, despite the distance.
Objectives: This article looks at how children born in France in the 1980s and mid-1990s are socialized to family and transnational ties during their childhood and preadolescence - i.e., before their first stays in Mali.
Methodology: The 50 in-depth life story interviews conducted out with ten Malian immigrant families enable us to reconstruct family socialization universes in retrospect.
Results: I show at first that the recounting of the parental past, more than intergenerational transmission of first names, constructs affiliation to the family line. I then highlight how parental practices of mutual aid and welcoming transnational relatives to France help accustom children to their future duty of transnational redistribution and solidarity. Finally, I outline the socializing effects of regular visits to migrant workers’ hostels, where male relatives reside, by highlighting the gendered dimension of this socialization.
Conclusions: Through these three processes of family socialization, children learn gendered family and transnational roles, even if their boundaries are partly blurred by migration. Sons learn above all an economic sense of family (sending money to relatives in Mali and supporting the family in France), while daughters are more socialized to a matrimonial sense of the family (marrying a male Malian relative and perpetuating the lineage).
Contribution: At the crossroads of the sociology of socialization, the family and migration, this text contributes to our knowledge of the ordinary life of immigrant and/or transnational families, by emphasizing the socializing effects of transnational family configurations and their gendered variations.
Keywords:
- socialization,
- transnational families,
- immigration,
- kinship,
- family ties,
- educational practices,
- descendants of immigrants,
- Sahel (Mali, Senegal),
- France
Resumen
Marco de la investigación: Cuando las parejas de inmigrantes malienses decidieron instalarse en Francia en los años ochenta, se encontraron atrapadas en un sistema de «parentesco mutilado» debido a dicha emigración (Barou, 1991). Como consecuencia, tuvieron que hacer un verdadero «trabajo de parentesco» (di Leonardo, 1987) para mantener el vínculo con la familia que se quedó en Mali y transmitir a los niños nacidos y socializados en Francia un sentimiento de pertenencia al grupo familiar a pesar de la distancia.
Objetivos: Este artículo examina cómo los niños nacidos en Francia en los años ochenta y mediados de los noventa fueron socializados en el apego familiar y transnacional durante su infancia y preadolescencia, es decir, antes de sus primeras visitas a Mali.
Metodología: 50 entrevistas realizadas en diez familias de inmigrantes malienses permiten recomponer retrospectivamente el universo de la socialización familiar.
Resultados: En primer lugar, muestro que el relato del pasado parental, más que la transmisión intergeneracional de los apellidos, construye la afiliación a la línea familiar. A continuación, subrayo que las prácticas parentales de ayuda y acogida de los miembros de la familia transnacional en Francia contribuyen a inculcar a los hijos su futuro deber de redistribución y solidaridad transnacional. Por último, muestro los efectos socializadores de las visitas regulares a los albergues de trabajadores inmigrantes, donde residen los hombres de la familia, destacando la perspectiva de género de esta socialización.
Conclusiones: A través de estos tres procesos de socialización del sentido de la familia, los niños acaban aprendiendo roles familiares y transnacionales diferenciados por género, aunque sus límites se difuminen por la migración. Los hijos aprenden sobre todo un sentido económico de la familia (enviar dinero a los parientes en Mali y ayudar a la familia en Francia), mientras que las hijas se socializan más en un sentido matrimonial de la familia (casarse con un pariente varón en Mali y perpetuar el linaje).
Contribución: En la encrucijada entre la sociología de la socialización, de la familia y de las migraciones, este texto contribuye a nuestra comprensión de la vida ordinaria de las familias inmigrantes y/o transnacionales haciendo hincapié en los efectos socializadores de las configuraciones familiares transnacionales y sus variaciones de género.
Palabras clave:
- socialización,
- familias transnacionales,
- inmigración,
- parentesco,
- vínculos familiares,
- prácticas educativas,
- descendientes de inmigrantes,
- Sahel (Mali, Senegal),
- Francia
Article body
« On a besoin de se ressourcer ; d’aller au Mali. Quand on arrive en Afrique, déjà ça soulage. […] Et voir la maman aussi, ça soulage. [ Il marque une pause ]. C’est comme un petit poussin qui a besoin de sa maman. On a besoin de voir sa maman, son papa. Moi j’ai pas connu mon papa, mais quand j’ai perdu ma maman [dans les années 2000], c’est comme si j’avais perdu la moitié du pays. [ Il s’arrête, ému ] ». (M. Tandia [1] , né au Mali en 1955, en France depuis 1975, père de 4 enfants, retraité anciennement employé de restauration)
Vieil homme affable, souriant et loquace, M. Tandia s’assombrit soudainement quand il en vient à me parler de son village malien d’origine et de sa mère, qu’il a quittée à 20 ans pour partir travailler en France. Son visage se ferme, son débit de parole ralentit et je vois des larmes monter dans ses yeux. Cette courte séquence aurait pu se noyer dans les trois heures d’entretien, mais sa charge émotionnelle me marque aussitôt. D’autant qu’elle fait écho à des situations d’entretien semblables, vécues une semaine auparavant, lorsque M. Diarra d’abord (né au Mali en 1954, en France depuis 1973, père de 11 enfants en France, retraité anciennement chef de bordée dans une entreprise de nettoyage) et ensuite M. Diallo (né au Mali en 1954, en France depuis 1973, père de 6 enfants en France, retraité anciennement contremaitre dans une entreprise de nettoyage), évoquaient leur départ respectif du Mali et le souvenir de leurs mères. En entretien comme dans leur vie de tous les jours, l’attachement de ces pères à leur parentèle malienne [2] et à la terre de leur enfance est manifeste. Tous trois ont des contacts réguliers avec leurs proches restés au Mali, leur envoient chaque mois de l’argent et retournent chaque année dans leur pays d’origine – où ils ont fait construire une maison et souhaitent être enterrés [3] . Si cet attachement des parents émigrés se comprend par la force des liens affectifs forgés durant leur enfance et leur adolescence au Mali, qu’en est-il de leurs enfants, nés et socialisés en France ? Dans quelle mesure et comment les parents immigrés transmettent-ils à leurs enfants un attachement à la parentèle restée sur place et au devoir d’entraide économique ? Comment s’apprend le « faire famille » [4] transnational ?
Alors que dans les écrits francophones, l’attachement des descendant.es de migrant.es ou des enfants de couples mixtes [5] au(x) pays d’origine de leur(s) parent(s) immigré(s) a surtout été abordé comme un enjeu individuel et symbolique – que les concepts soient ceux d’« identité ethnique » (Meintel, 1992), de « bricolages identitaires » (de Villers, 2005), de « sentiment d’appartenance à la communauté d’origine immigrée » (Brouard et Tiberj, 2005), de « compositions identitaires » (Aouici et Gallou, 2013), d’« injonctions » et d’« assignations » (Belkacem, 2013) ou encore d’« identité symbolique affective » (Unterreiner, 2015) – cet article propose de faire un pas de côté en réinscrivant le transnationalisme des descendant.es d’immigré.es dans une matérialité, des liens de parenté et des pratiques faisant l’objet d’apprentissages et de transmissions. Il s’insère en cela dans la lignée des travaux sur les familles transnationales examinant « comment les liens familiaux et affectifs sont maintenus au travers du temps et des générations » (Besure et al ., 2014 : 64 ; Coe, 2013 ; Zontini et Reynolds, 2018 ; Merla et al ., 2021). Ancré dans une sociologie de la socialisation visant à saisir « l’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit » (Darmon, 2006 : 6), l’article explore plus spécifiquement la manière dont des adultes descendant.es d’immigré.es malien.nes ont intériorisé un attachement familial et transnational durant leur enfance et préadolescence.
Cette période de leur vie est reconstituée rétrospectivement à partir de récits de vie croisés (Delcroix, 1995) menés auprès de dix familles d’immigré.es malien.nes installées en France depuis les années 1980 (Cf. Encadré méthodologique). L’article se centre sur les ainé.es et milieux d’adelphie des familles concernées – qui sont au cœur de l’enquête. Né.es dans les années 1980 et le milieu des années 1990, ils et elles grandissent avant l’usage généralisé des technologies de la communication. Cela les différencie de leurs cadet.tes comme de l’ensemble des jeunes descendant.es d’immigré.es, connecté.es à leur parentèle par ces outils numériques depuis petit.es (Besure et al. , 2014). Appartenant à des familles (très) nombreuses (quatre à 13 enfants) disposant de peu de ressources économiques, ils et elles n’ont pas fait de séjour au Mali avant leur adolescence (voire l’âge adulte), ce qui aurait pu conduire à des situations de « co-présence physique » et raffermir leurs liens affectifs avec les membres de la parentèle malienne ( idem ) [6] . Durant toute leur enfance et préadolescence, leur attachement familial et transnational se construit en France et par d’autres canaux.
Lorsque, dans les années 1980, leurs parents font le choix d’une installation en France, ces derniers se trouvent pris dans un système de « parenté mutilée » par l’émigration (Barou, 1991). Faisant éclater l’unité de résidence qui régit les relations familiales dans leurs villages maliens d’origine, ils doivent composer « des formes de pérennisation [du lien familial] dans la distance » (Razy et Baby-Collin, 2011 : 18). Il s’opère un véritable « travail de parenté » [7] (di Leonardo, 1987) pour maintenir des liens avec la parentèle restée au Mali et transmettre aux enfants un sentiment d’appartenance au groupe familial malgré la distance géographique qui sépare ses membres. Pilier de la respectabilité et de la réussite sociale dans l’esprit des parents, cet attachement familial transnational repose sur le maintien de liens affectifs et économiques avec la parentèle et la transmission d’une piété filiale [8] . Il s’agit de « fabriquer des enfants redevables » (Grysole, 2020) vis-à-vis de leurs parents et liés à leur parentèle malienne, plutôt que des enfants autonomes et déconnectés de celle-ci.
L’article passe en revue différents aspects de ce travail de parenté. Le récit du passé familial et parental ainsi que la transmission intergénérationnelle des prénoms servent de support à la construction d’une affiliation à la lignée et contribuent au façonnement de la piété filiale (1). Les pratiques parentales d’entraide et d’accueil des membres de la parentèle transnationale en France participent quant à elles à habituer les enfants à leur futur devoir de redistribution et de solidarité transnationales (2). Enfin, en fréquentant régulièrement les foyers de travailleurs migrants [9] où résident des hommes de la parentèle, les enfants tissent des liens avec des derniers et intériorisent des rôles familiaux genrés qui font écho à l’apprentissage ordinaire des rôles de genre dans l’espace domestique : les fils construisent surtout un sens économique de la famille (envoyer de l’argent à la parentèle restée au Mali et soutenir la famille en France), là où les filles sont davantage socialisées à un sens matrimonial de la famille (épouser un homme de la parentèle malienne et perpétuer la lignée) (3).
Encadré méthodologique
Récit du passé parental et construction de l’affiliation familiale
Les spécialistes de la mémoire familiale et de la transmission montrent que l'affiliation familiale passe d’abord par le truchement du récit du passé familial (Muxel, 1996 ; Fogel, 2007). Servant de pont narratif et affectif entre les générations, les époques et les espaces, il instaure un rapport de filiation – avec les parents comme avec la lignée – autant que des relations affectives. Néanmoins dans les familles enquêtées, inscrites dans deux univers sociaux de référence, le récit parental des ancêtres et de la lignée rencontre souvent l’incompréhension des enfants, et n’a en réalité que peu d’effets socialisateurs au moment de son énonciation (1.1). Le sentiment familial se construit dès lors surtout par la transmission d’un roman familial émotionnellement chargé, créant des ponts d’identification entre parents et enfants (1.2).
Le poids de la lignée : une forme de continuité familiale et transnationale
Plusieurs travaux insistent sur le fait que, dans les familles immigrées, la construction du sens de la famille repose sur le récit parental des origines et de la lignée familiale, remontant à un temps plus éloigné que celui de l’enfance des parents (Santelli, 2001 ; Delcroix, 2009 ; Ichou, 2018). Par ce récit, les parents favorisent l’inscription de leurs enfants dans la biographie familiale afin qu’ils puissent « reconstruire l’ordre générationnel de leur famille » (Le Gall et Meintel, 2011 : 129) et s’identifier à leur lignée. On voit la trace d’un tel récit dans les familles enquêtées – et à plus forte raison dans les familles nobles, qui trouvent sans doute d’autant plus d’intérêt à transmettre leur honorabilité familiale qu’elle permet de contrecarrer la condition minoritaire de la famille en France. Passant sous silence leur passé migratoire « au profit d’une histoire mythique des patronymes, des animaux totémiques et de la filiation plus lointaine » (Belkacem, 2013 : 74), les parents se réfèrent à ce récit valeureux et valorisant des origines familiales pour construire chez les enfants une estime d’eux-mêmes. Ce récit constitue, dans le même temps, une injonction implicite à tenir le rang familial. Censé procurer aux enfants un « sentiment de reconnaissance sociale » (Santelli, 2001 : 71) et de « légitimité sociale » (p. 70), il les invite à maintenir cette honorabilité familiale. Ainsi, Ramata Soumaré (fille ainée, 42 ans, sans emploi, bac +3) explique que sa mère mobilisait le récit de ses origines familiales nobles (côté maternel) et maraboutiques (côté paternel) dans une visée éducative : « c’était sans doute pour pas que j’aie une vie de travers entre guillemets, genre “Tu dois rester droite” ; “Tu dois représenter notre famille” ».
Néanmoins, durant l’enfance des ainé.es, la réception enfantine d’un tel récit des origines ne colle pas nécessairement aux ambitions de transmission et d’éducation parentales [12] . Nés et socialisés en France, les enfants ne saisissent pas toujours de quoi il retourne et le discours de leurs parents a peu de résonance pour elles et eux au moment de son énonciation. Lorsque la mère de Ramata lui raconte qu’ils sont « maures » et issus d’« une grande famille de marabouts », cette dernière ne comprend pas :
Ramata: « Ma mère me disait tout le temps “oublie pas d’où tu viens” ; “oublie pas que tu es maure”, mais “maure” – M.A.U.R.E. Moi je comprenais pas, je croyais c’était “mort”, genre décédé ! Ah non, mais laisse tomber, je comprenais rien moi ! Et aussi, elle me disait que du côté de mon père y’avait des marabouts et tout ; mais c’est pas les marabouts en mode les charlatans que tu vois ici. C’est des gens qui sont beaucoup dans la prière, tout ça ; le marabout, c’est celui qui apprenait la religion, en Afrique ; moi je l’ai su tard ça, je l’ai su y’a trois ans. » (Journal de terrain, Discussion avec Ramata Soumaré)
Grandissant dans un contexte français, Ramata ne sait pas alors que, dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, les marabouts sont des saints de l’islam disposant d’un pouvoir religieux et d’un prestige social ni que les Maures constituent un groupe ethnolinguistique. Durant toute son enfance et adolescence, le discours maternel sur le statut social élevé de ses ancêtres n’a donc pas vraiment eu d’effet sur sa manière de penser ses origines familiales. Ce même « raté » de la socialisation familiale est évoqué par Coumba Sylla :
Coumba: « Quand j’étais petite, [mon père] me disait “On est chefs du village”, je disais “ça veut dire quoi ?” Et quand je suis partie au Mali [à 23 ans], j’ai vraiment vu : […] en fait toute sa famille, c’est eux qui ont construit toute la région […]. Y’a toute cette espèce de culture que tu dois transmettre à tes enfants, une espèce de fierté aussi de dire “C’est nous qui avons construit tout ça !” ; mon père c’est quelqu’un, hein ! Quand tu viens là-bas, on te fait […] : [prenant un ton élogieux] “Oh, vous êtes la fille de M. Sylla, vous êtes la bienvenue et tout”. Mais avant je comprenais rien du tout ; faut vraiment aller sur place pour comprendre. » (Entretien avec Coumba Sylla, fille ainée, 39 ans, coordinatrice sociale, bac +5)
Séjourner au Mali adulte fait prendre conscience à Coumba du statut social élevé de sa parentèle malienne et de ses parents. Mais avant cela, comme dans le cas de Ramata Soumaré et d’autres enquêté.es, le récit de la lignée demeure pour elle très énigmatique et ne produit pas d’effet en termes de construction identitaire. Bien loin d’imprimer des marques, il parait plutôt glisser, tant il est abstrait et hors sol. Le discours parental sur la notabilité de la lignée semble procurer le « sentiment de reconnaissance sociale » et de « légitimité sociale » dont parle Emmanuelle Santelli (2001), qu’à partir du moment où ce statut de notabilité est vécu et éprouvé par les enfants en personne – par des séjours au Mali notamment – ou bien étayé par des lectures sur l’histoire de l’Empire du Mali ou de l’organisation villageoise statutaire. L’affiliation des enfants à la lignée malienne passe par un réinvestissement, à l’âge adulte [13] , du récit parental du passé familial, et nécessite des capitaux culturels spécifiques pour être appropriée. À cet égard, l’enquête révèle qu’au sein des adelphies, le rapport à la mémoire familiale se différencie non tant uniquement en fonction du genre, comme de nombreuses enquêtes le montrent (Muxel, 1996 ; Le Pape, 2005 ; Billaud et al ., 2015), mais également selon le volume de capital culturel et/ou scolaire des enfants. Les plus diplômé.es sont celles et ceux qui s’intéressent le plus à leur histoire familiale et à celle du pays de naissance de leurs parents : par des recherches généalogiques, des lectures sur l’origine de leur nom de famille, des séjours au village d’origine de leurs parents, etc. [14] En entretien, ces personnes sont d’ailleurs celles qui connaissent et restituent le plus de détails sur l’histoire de leur lignée et de leur parentèle.
Le choix des prénoms donnés aux enfants œuvre plus directement à inscrire les enfants dans l’histoire familiale – et cela dès leur plus jeune âge. Ceci est possible notamment parce que, dans les familles enquêtées, la plupart des prénoms sont « puisés dans le patrimoine familial » (Le Gall et Meintel, 2011 : 137) : il est fréquent qu’un enfant porte en premier prénom celui d’un grand-parent, d’un oncle ou d’une tante, ou bien d’un.e ami.e des parents – que cette personne soit décédée ou non. Pour les parents, nés et socialisés dans des villages sahéliens, donner à un enfant le prénom d’une autre personne exprime « la volonté de lui faire honneur et d’encourager des liens d’affinité entre elles et l’enfant portant son prénom » (Feldman, 2012 : 244). Cette pratique d’homonymie est désignée par le terme soninké torola – et les enfants disent alors que « [telle personne] est mon torola » ou que « mes parents m’ont torola » de telle personne. Par exemple, Dado Sylla porte le prénom d’une sœur de son père, sa sœur Adja a le prénom de sa grand-mère maternelle, Djibril Tandia s’appelle comme son grand-père maternel. Quand ce prénom n’apparait pas dans l’état civil de l’enfant (prénom de naissance), il peut être utilisé comme surnom (prénom d’usage), par lequel l’enfant est appelé quotidiennement par ses proches. C’est le cas d’Ibrahim Tambara par exemple, qui se fait appeler Sibi (prénom de son oncle paternel) depuis qu’il est petit.
Cette transmission intergénérationnelle des prénoms n’est pas propre aux familles malo-françaises et des spécialistes de la parenté l’ont décelée dans bien d’autres milieux et époques, montrant qu’elle permet de resserrer les liens familiaux, de rappeler une généalogie et/ou de rendre présents des membres de la lignée éloignés ou décédés (Déchaux, 1997). Pour les familles françaises immigrées et/ou transnationales, cette pratique a néanmoins la particularité d’instituer la parentèle restée « au pays » dans le quotidien en France, et de réinscrire des liens familiaux malgré la distance géographique. Dans les familles enquêtées, en plus du nom de famille transmis aux enfants par les pères, l’homonymie des prénoms avec des membres de la parentèle malienne instaure un potentiel lien affectif entre les deux personnes concernées, raffermissant symboliquement le lien entre des individus appartenant à deux générations familiales distinctes et vivant (ou ayant vécu) sur deux continents différents. Mais du fait de la rareté des rencontres entre les enfants et leur homonyme (voire de l’impossibilité de ces rencontres, dans le cas où la personne torola est décédée), ces pratiques d’homonymie conduisent la plupart du temps à un attachement qui n’est au plus que symbolique. Le sentiment familial se construit dès lors surtout par la transmission d’un roman familial émotionnellement chargé, créant des ponts d’identification entre parents et enfants.
Roman familial et émotions : support d’identification intergénérationnelle et socle de piété filiale
Lorsqu’on interroge des enfants nés en France de parents issus de migrations de travail postcoloniales, un grand flou entoure les dates et conditions d’arrivée en France de ces derniers (Lepoutre et Cannoodt, 2005 ; Lagrange, 2010 ; Jamoulle, 2013). Mon enquête confirme ce constat : durant l’enfance des ainé.es, le passé migratoire parental ne fait pas l’objet de transmission directe, volontaire et systématique de la part des parents. Il est la plupart du temps recomposé et découvert par les enfants par petites touches et souvent par accident – à l’occasion d’une démarche administrative, d’une discussion avec un oncle ou un petit-enfant, ou bien d’un commentaire d’actualité. En regardant de plus près, on observe que ce silence parental entourant le parcours migratoire laisse place à un autre « roman familial » [15] (de Gaulejac, 2002). Nettement moins marqué par le sceau du curriculum administratif construit et imposé par les institutions françaises (préfecture, Caisse d’allocations familiales, école, etc.), ce roman familial repose moins sur la transmission de dates que celle d’émotions – positives ou négatives – et d’anecdotes circulant dans la famille. Il en va ainsi des historiettes amusantes de l’enfance des parents, que les enfants relatent en entretien : « [ma mère] avait des cousines qui étaient des jumelles et elle me racontait comment elles faisaient pour embêter un peu leurs parents en leur disant “C’est pas moi, c’est elle !” » (Bakou Tandia, 2e fils, 34 ans, ingénieur, bac +5) ; « quand mon père était au village, petit, sa mère lui disait de porter son petit frère – donc il le portait dans le dos […] et quand il en avait marre, il mettait des coups à son petit frère pour qu’il pleure, comme ça, il le donnait à sa mère ! » (Ramatoulaye Traoré, milieu d’adelphie, 30 ans, infirmière, bac +3) ; « mon père il me racontait qu’avec ses copains, ils s’amusaient à chasser des rats dans les champs et après ils les faisaient cuire ! » (Ramata Soumaré). Par ailleurs, si les enfants enquêtés ont peu d’éléments objectifs et datés du passé prémigratoire de leurs parents, toutes et tous font le récit d’une enfance parentale « compliquée », « complexe », « difficile » et témoignent à cet égard d’une grande empathie :
Aïssatou: « Mon père, il a un parcours de vie qui [émue, elle fait une pause] ouais qui me touche beaucoup. […] Sa mère était deuxième femme et il parait qu’elle a beaucoup souffert. Il a du mal à en parler ; parce qu’il a perdu sa mère très jeune, je crois qu’il avait 6 ou 7 ans. […] Donc tu vois ils ont un parcours de vie assez complexe, et qui me touche beaucoup parce qu’on sent que […] c’est une famille qui a beaucoup souffert, qui était beaucoup dans la pauvreté. La mère de mon père elle était très, très malade et du coup elle est morte jeune, ils étaient très pauvres ; ils avaient pas forcément de soutien de la part de la famille parce que son père aussi est mort très jeune ; donc sa mère, quand elle a perdu son mari, elle avait personne d’autre. Elle avait des enfants en bas âge. Et du coup les garçons, ils ont dû traverser tout le village pour arriver à la capitale et ensuite venir en France. » (Entretien avec Aïssatou Diarra, fille ainée de France, 35 ans, éducatrice spécialisée, bac +5)
Comme Aïssatou, quand ils évoquent l’enfance de leurs parents, les enfants décrivent une vie marquée par la pauvreté : « ils mangeaient pas forcément à leur faim », « ils vivaient dans la misère un peu », « c’était dur ». Ayant une fonction de réflexivité (Muxel, 1996), ce récit du passé parental partagé familialement construit un faire famille fondé sur les expériences parentales (leur enfance « difficile », la dureté de la vie « au bled », les deuils familiaux, les séparations, leurs épreuves de l’émigration et de l’installation en France) et la réflexion commune à ce propos. Ce roman familial crée un pont affectif entre les générations et sert également le projet migratoire parental, visant la réussite socioprofessionnelle des enfants. Prenant conscience des « sacrifices » (le mot revient souvent en entretien) de leurs parents, les enfants se sentent redevables et construisent un « sentiment de devoir filial de réussite » (Ichou, 2018 : 159). Cela ressort du discours d’Aïssatou Diarra lorsqu’elle affirme : « nos parents, ils viennent de loin, ils viennent de très, très loin. Quand tu comprends ça, t’as envie de… tu te sens obligée de réussir en fait ! ».
Le récit du passé parental apparait dès lors comme une pratique éducative en tant que telle : les souffrances et difficultés des parents viennent nourrir les attendus et ambitions de réussite sociale des enfants (Santelli, 2001 ; Shahrokni, 2021), tout en constituant les bases de la piété filiale fondée sur l’empathie et la reconnaissance. Ainsi, le passé migratoire parental, dont l’absence de transmission a été relevée dans les écrits scientifiques, fait en réalité l’objet de transmissions par-delà les silences et participe à la construction de l’affiliation familiale, grâce aux émotions qu’il charrie. Nous verrons dans ce qui suit que les pratiques parentales ne construisent pas uniquement un attachement parental, mais contribuent également à socialiser les enfants à la parenté transnationale.
Pratiques parentales et socialisation à la vie familiale transnationale
Si l’émigration peut représenter « une déchirure » pour l’émigré.e (Quiminal, 2021 : 23), elle constitue également « une responsabilité envers sa famille : ascendants, descendants et collatéraux » (Ichou, 2018 : 154). Depuis qu’ils sont en France, les parents des familles enquêtées sont investis d’une responsabilité auprès de leur parentèle : ils et elles ont une charge de famille (Weber et al ., 2003). Ce rôle familial régit un ensemble de discours et pratiques dont leurs enfants sont les destinataires et témoins, intériorisant un sens de l’entraide transnationale. Sans que cela soit nécessairement conscient, par leurs manières de faire et d’être, les parents socialisent leurs enfants à un devoir de solidarité au niveau de la parentèle transnationale (2.1), ainsi qu’à un devoir d’hospitalité et d’accueil des apparenté.es (2.2).
Les pratiques transnationales de care : l’apprentissage de l’entraide familiale
Dans les villages maliens où les parents ont grandi, la parentèle régit un réseau d’interdépendances et de rôles (Barou, 1991 ; Quiminal, 2021). Support de solidarités, elle pallie l’absence d’État-providence et constitue l’« institution microsociale de base sur laquelle repose la protection sociale » (Grysole et Bonnet, 2020 : 15). En France, ce système familialiste de protection individuelle continue de jouer un rôle central pour les émigré.es originaires de ces régions rurales. C’est d’ailleurs pour cela que, depuis qu’ils et elles sont petit.es, les enfants entendent de la bouche de leurs parents qu’il faut être « soudés », « compacts », « aider la famille », « mettre la famille à l’abri du besoin » et qu’ils ne peuvent « compter que sur la famille » – sans que les contours de cette « famille » soient toujours très clairs (famille nucléaire vivant en France, ou parentèle plurigénérationnelle et transnationale). En plus de ces discours parentaux, les enfants sont également témoins des pratiques concrètes de « circulation du care » (Baldassar et Merla, 2014) [16] de leurs parents, qui les habituent ainsi, par imprégnation et par effet diffus, à une parenté pratique transnationale. Depuis leur plus jeune âge, ils et elles voient leurs parents « toujours au téléphone » pour prendre des nouvelles de « la famille du bled ». Ils remarquent les « lettres du bled, dans des enveloppes avec le truc bleu-blanc-rouge » – dont certaines ont été conservées dans les archives familiales. Les enfants observent le travail de parenté qu’effectuent leurs parents en maintenant la communication et le lien avec leurs proches vivant au Mali. Ils les regardent envoyer de l’argent tous les mois à ces derniers, leur préparer des colis alimentaires, ou bien rassembler des vêtements pour les leur expédier. En plus de démontrer de manière concrète et matérielle l’amour qui les lie à leurs proches restés au Mali (Coe, 2013), ces pratiques rendent ces derniers présents en pensée et dans l’espace des discussions familiales. En voyant que leurs parents portent une attention à eux, les enfants expérimentent le lien familial transnational, et cette manière de faire famille à distance.
Ils et elles savent en outre pertinemment que leurs parents ont organisé et financé l’émigration de membres de leur parentèle malienne vers l’Europe (« mon père a fait venir ses petits frères », « mon oncle est venu en France grâce à ma mère », « c’est ma mère qui a tout géré pour son frère qui est en Italie […] même sa carte bleue, c’est ma mère qui gérait pour lui »), ce qui est un nouvel exemple de solidarité familiale en actes. Les enfants de M. Sylla (né en 1952, émigré en France depuis 1970, père de 10 enfants en France, retraité anciennement contremaitre dans une entreprise de nettoyage) sont par exemple au courant qu’il « cotise pour le village depuis toujours » :
Dado: « Les petits frères de mon père [qui ont émigré en France dans les années 1980 et se sont mariés avec des Françaises], […] ils vont plus au Mali ; ils sont pas forcément partis revoir la famille, etc., et c’est pas sans conséquence. C’est pour ça que mon père il se sent redevable de certaines choses. Voilà, lui il se dit, “Non il faut que quand même… l’honneur quoi” […] »
Coumba: « Parce que ça lui fait mal qu’on dise que ses frères ils sont venus en France et qu’ils ont oublié toute la famille quoi. Du coup même pour les cotisations par exemple, il paye. Mon père il a toujours payé pour ses frères, alors que ses frères ils en ont rien à foutre des cotisations, du Mali et tout. Mais en fait il paye pour faire genre ils participent pour le Mali. » (Entretien collectif avec Coumba et Dado Sylla, respectivement ainée et milieu d’adelphie, 39 et 28 ans, coordinatrice sociale et assistante sociale, bac +5 et bac +3)
M. Sylla a « tout payé, tout financé » pour son plus jeune frère vivant au Mali – études, mariage, maison. Ses envois réguliers d’argent ont permis à son frère cadet de faire des études à Bamako, y vivre, et y obtenir un emploi de cadre. Retraité au moment de l’enquête, il vit dans la maison que M. Sylla a fait construire à Bamako, et il n’échappe à personne que M. Sylla est le véritable « pilier de famille ». Des mères peuvent également avoir ce rôle. Mme Soumaré (née en 1960, émigrée en France depuis 1980, mère de 6 enfants, agente d’entretien) a fait venir ses deux petits frères en Europe et a « tout financé » pour un de ses neveux (fils d’un frère de son mari). Né dans les années 1970 au Mali, celui-ci a été confié à Mme Soumaré avant qu’elle-même ne devienne mère. Depuis, Mme Soumaré le considère comme son fils et s’occupe de lui (soutien moral à distance, envoi d’argent, paiement des frais de scolarité, etc.). Assumées par les pères comme par les mères, ces pratiques de solidarité familiale apprennent aux enfants « l’éthos du partage » (Grysole, 2020 : 20) et les socialisent à leur « futur devoir de redistribution matérielle » intra et intergénérationnelle (p. 11). Cela est attendu d’elles et eux, comme leur rappelle leur parentèle malienne : « ils pensent que parce que tu es en France, tout va bien pour toi et ils te demandent toujours de l’argent » (Youssouf Traoré, dernier fils, 28 ans, prothésiste dentaire, bac +2).
Adama: « Parfois les cousins du bled ils te demandent des choses, laisse tomber ! Exemple moi j’ai un cousin il me demande une Mercedes ! […] Après c’est qu’il veut faire taxi ; donc il veut une Mercedes des années 90, plus solide au niveau mécanique et carrosserie, etc. […] Même si entre guillemets ça coute rien – on peut cotiser pour lui acheter ça et qu’il bosse correctement là-bas ; pour éviter qu’il vienne ici, et peut-être mourir j’sais pas où dans la Méditerranée – sur le coup, tu te dis “Putain, le mec il me demande une voiture quand même !” » (Entretien avec Ibrahim Tambara, milieu d’adelphie, 35 ans, conducteur de bus, CAP[17])
Si, en théorie, le devoir d’être un pilier économique pour la parentèle malienne se transmet en lignée masculine (de père en fils), en pratique, les reconfigurations des rapports de genre qu’entraine l’émigration des mères en France contribuent à brouiller ces frontières genrées des rôles familiaux et de leur transmission [18] . Filles comme fils intègrent un devoir de redistribution transnationale, auquel ils et elles sont socialisé.es par l’exemple et par la pratique de leurs parents, depuis leurs plus jeunes années. Leur apprentissage de l’éthos du partage passe également par les pratiques parentales d’accueil et d’hébergement de membres de la parentèle transnationale en France, répondant lui-même au « devoir d’hospitalité » (Mbojd-Pouye, 2016 : 53) qui incombe aux émigré.es.
Les pratiques d’accueil : entre devoir d’hospitalité et négociations
Depuis leur installation, dans les années 1980 et 1990, dans des appartements spacieux (entre trois et cinq pièces, hors cuisine et salle de bain) – comparés aux chambres de foyer de travailleurs, où plusieurs hommes cohabitent dans une dizaine de mètres carrés –, la plupart des parents hébergent des membres de la parentèle pour des durées parfois longues (de quelques mois à plusieurs années). Régulières et répétées durant l’enfance des ainé.es de certaines familles, ces pratiques socialisent les enfants à ce que Djibril Tandia (ainé, 37 ans, chef de projet, bac +5), dont les parents ont accueilli différents oncles et cousins dans les années 1990 et 2000 pour des durées allant de 6 mois à 6 ans, nomme « une culture d’accueil familial ». Dans ces familles, le devoir d’hospitalité se matérialise dans l’ameublement des salons. Les six que j’ai pu voir (en vrai ou en photos) font une place aux membres de la parentèle de passage : tous les salons comprennent des divans se composant de deux matelas empilés l’un sur l’autre, et aisément transformables en couchages.
Les chambres des enfants elles-mêmes sont rarement investies comme des espaces privatisés et individuels. La chambre à soi, plutôt associée au style de vie des classes moyennes et supérieures, n’est pas une réalité vécue par les enfants enquêtés. Ces derniers circulent de pièce en pièce – les règles étant de ne pas dormir dans la même pièce que les parents lorsque ceux-ci l’occupent, et de séparer les filles et les garçons. Ainsi, Youssouf Traoré a dormi jusqu’à ses 12 ans dans le lit de sa mère (première épouse) quand elle n’était pas « de tour » avec son mari, et dans le salon lorsque cela était le cas. Au moment de son adolescence, il dort de plus en plus souvent dans le salon, où il investit « le canapé de gauche » comme son lit. Plus tard, il « récupère » un lit dans « la chambre des grands » (ses quatre frères ainés, nés au début des années 1980) au moment où deux de ces derniers quittent le domicile parental. Au début de l’enquête, en 2019, Youssouf dort dans « l’ancienne chambre des filles », mais il y retrouve très souvent ses neveux et nièces en train de faire un bout de sieste ou de nuit dans son lit – ce qui le conduit à « [s]e poser dans le salon quand le lit est occupé ». Cette souplesse dans l’organisation des chambres et des couchages est une manière concrète de pratiquer et transmettre l’éthos du partage en famille.
Alors que la plupart des enfants se souviennent de l’espace domestique comme d’« un vrai moulin », où, à tout moment de la journée, des membres de la parentèle transnationale (cousin.es, oncles, tantes) pouvaient aller et venir, « squatter » un temps puis repartir, j’ai aussi recueilli quelques récits qui nuançaient cette description. La famille Sylla, qui a la particularité d’être composée essentiellement de filles (8 sur 11 enfants), en est un exemple. La mère (née en 1963 au Mali, en France depuis 1982, agente d’entretien et commerçante) se montre « très accueillante » – ce qui fait d’ailleurs dire à ses enfants que, depuis qu’ils et elles sont petit.es, leur domicile est « un vrai centre social » et leur mère « trop accueillante ». Néanmoins, mère de huit filles, elle redoute que des hommes de la parentèle dorment à son domicile et limite donc le devoir d’hospitalité.
Dado: « On était en suroccupation [dans le logement] mais ça, c’est pas un problème. Pour elle, le problème c’était tout ce qui est histoire d’incestes, agressions sexuelles, etc.[19] […] Là du coup [la première personne à être hébergée chez les Sylla, au moment de l’enquête], c’est la nièce de mon père. Après y’a eu grave des oncles qui étaient hébergés administrativement parlant chez nous. Mais c’est tout. Juste une fois y’a une personne qui a dormi [chez nous] ; mais mon père, il a dormi avec lui et c’est limite, il a pas fermé l’œil de la nuit. Ma mère, elle l’avait tellement briefé ! » (Entretien avec Dado Sylla, milieu d’adelphie, 28 ans, assistante sociale, bac +3)
Malgré ces arrangements parentaux avec le devoir d’hospitalité, les enfants intériorisent des dispositions à l’entraide familiale – qu’ils et elles pourront actualiser, une fois adultes. Alors que le rôle de pilier de famille et de logeur est, en contexte malien, plutôt un rôle dévolu aux hommes et transmis en lignée masculine (Bertrand, 2016), cette frontière de genre est plus floue en migration. Les configurations familiales qu’elle occasionne modifient les rôles de genre « ici » (en France) et « là-bas » (au Mali). D’une part, les mères (et notamment les mères veuves et/ou divorcées), en émigrant en France, deviennent des soutiens au sein de leur propre parentèle et se rapprochent ainsi de la figure masculine de breadwinner . D’autre part, les pères, qui vivent entre la France et le Mali, utilisent les moyens de communication pour prendre des nouvelles de leurs proches, s’impliquant de plus en plus dans des rôles de caregiver à distance [20] . Si la migration brouille les frontières genrées des rôles familiaux appris dans l’espace domestique, le foyer de travailleurs migrants, qui est un autre espace d’apprentissage de la parenté pour les enfants d’immigré.es malien.nes nés et socialisés en France, tend à les reproduire de manière moins équivoque.
« Le foyer » : un espace de socialisation à des rôles familiaux genrés
Dans la foisonnante littérature sur les foyers de travailleurs migrants, très peu de travaux envisagent ce lieu comme un espace de socialisation pour les descendant.es d’immigré.es [21] . Depuis les années 1980, il a surtout été appréhendé en tant qu’espace de sociabilités pour les immigré.es (les hommes notamment) et de vie communautaire culturelle, économique et politique (Barou, 1986 ; Quiminal, 1990 ; Fiévet, 1996 ; Hmed, 2007 ; Mbodj-Pouye, 2016). Pourtant « le foyer » a très vite émergé dans les entretiens comme un espace de référence pour les enfants – en particulier pour les ainé.es. Jusqu’aux années 2000, tous les pères des familles enquêtées ayant vécu en foyer de travailleurs avant l’arrivée de leur épouse [22] , y emmènent leurs enfants le week-end, pour rendre visite à leurs oncles et cousins qui y résident ou bien pour assister à des fêtes (mariages, fêtes religieuses, baptêmes). Dans l’enfance des ainé.es, le foyer apparaît comme un espace de loisirs en famille qui prolonge l’espace domestique (3.1). En fréquentant ce lieu, ils et elles se familiarisent également avec leur parentèle transnationale et l’histoire de leurs parents – de leur père plus précisément –, raffermissant les liens affectifs avec ces derniers (3.2). Néanmoins, malgré ces effets socialisateurs généraux de la fréquentation du foyer, ceux-ci se distinguent très nettement selon le sexe des enfants : le foyer étant un espace de vie masculin (Sayad, 1980), il n’est pas vécu de la même manière par les filles et les garçons et ne produit donc pas les mêmes expériences socialisatrices (3.3).
Un lieu de loisirs en famille : fêtes, jeux et repas
Interrogé.es adultes, les ainé.es se souviennent avec force détails des après-midis et soirées « au foyer ». Lors du premier entretien avec Djibril Tandia, il me parle longuement du foyer de travailleurs immigrés qui jouxtait la résidence où sa famille vivait – son entrain à évoquer ces souvenirs soulignant son rapport heureux à ce passé. Enfant, il s’y rendait fréquemment, que ce soit pour acheter des bonbons – qui étaient « moins chers qu’à la boulangerie » – dans l’une des nombreuses boutiques du foyer, ou pour y suivre des cours de Coran avec son petit frère. Adolescent, il organisait avec les résidents du foyer des repas pour les fêtes nationales laïques (1er mai et 14 juillet) ou religieuses (fête de l’Aïd et Noël). Chez les Traoré, l’ainé se souvient que le foyer « était un endroit de jeux » où il allait chaque week-end avec son père et ses frères, quand il était enfant. Dans la famille Soumaré, l’ainée, qui a surtout des souvenirs douloureux de son enfance marquée par la précarité et les violences familiales, évoque avec une grande joie les après-midis de jeu dans le square voisin du foyer où elle allait rendre visite à des oncles, avec son père et son frère. Comme d’autres enquêté.es, elle a le souvenir de « bonbons partout », de parties de cache-cache, de courses avec son frère dans les couloirs du foyer, et de nourriture « trop bonne » :
Ramata : « Y’avait des fêtes là-bas ; des fêtes de fous ! Des fois, ils ramenaient des chanteurs ; et tellement y’avait du monde que y’avait des gens sur les toits [les hauts vents des perrons] […] Et le poulet de là-bas, on l’aimait trop ; le poulet frit, croustillant là. Mmmmh ! C’était trop bon ! Ah ouais je me souviens : les cuisinières, avec les grandes marmites, la chaleur et tout ; la cantine… Et on aimait trop parce que y’avait des bonbons ; des bonbons partout ! Tu disais “Achète-moi ça !” ; tes oncles ils te donnaient de l’argent, tu revenais t’étais refaite ! » (Entretien avec Ramata Soumaré, fille ainée, 42 ans, sans emploi, bac +3)
Le foyer est un lieu familial, car il « engage la production de lien affectif » (Grysole, 2020 : 11) avec des membres de la parentèle.
Bakou : « On y allait plusieurs fois par mois ; souvent le week-end, on y allait avec notre père, ou notre oncle [qui a vécu chez eux plusieurs années] ; on allait les voir, leur dire bonjour – bah histoire qu’ils nous voient, qu’ils nous connaissent. […] On parlait beaucoup avec nos oncles. C’est comme si j’allais chez mes cousins qui habitaient en banlieue ou à Paris en fait ; c’est une ambiance familiale. Les oncles, c’est des seconds pères en fait ; parce que quand on les nomme on dit “Papa + leur prénom”, on dit pas “tonton”. Notre père, il nous demandait de dire ça. Et il nous emmenait là-bas pour nous inculquer la proximité avec la famille ; c’était surtout ça le but en fait. » (Entretien avec Bakou Tandia, 2e fils, 36 ans, ingénieur, bac +5)
Les liens affectifs créés sur place tissent des ponts entre les générations et sont les supports de la future redistribution économique transnationale. Aujourd’hui adultes, les fils ainés et milieux d’adelphie se rendent dans les foyers de travailleurs pour envoyer de l’argent « au bled » et donner des cotisations à des membres de la parentèle en partance pour le Mali.
Un lieu de mémoire familiale et de liens
En plus d’être un espace de loisirs, le foyer est, pour les enfants l’ayant fréquenté durant leur enfance, le lieu « où tout a commencé » (Ismaël Doucouré, 2e fils, 35 ans, sans emploi, bac +2). La photo de leur père « en jeune homme, avec la coupe afro et les pattes d’eph’, dans sa chambre au foyer » ou devant celui-ci se retrouve d’ailleurs dans plusieurs albums-photos de famille consultés, ou dans les archives des pères. C’est une photo que les enfants connaissent bien et qui a marqué leur enfance. Le foyer de travailleurs devient dès lors le point de départ de l’histoire familiale en France autant qu’un lieu de mémoire familiale. Même si ce n’est pas nécessairement le foyer où leur père a habité (en raison de la destruction de nombreux foyers de travailleurs immigrés), les enfants constatent, en fréquentant de tels lieux, les conditions matérielles dans lesquelles leur père a vécu. Nombreux.ses sont celles et ceux qui évoquent notamment les rats, le bruit, le surpeuplement (« ils logeaient à mille dans une chambre »), soulignant l’état de délabrement et de précarité du lieu. En voyant que leurs oncles et cousins maliens vivent « entassés », les enfants mesurent le chemin parcouru par leur père. Ils et elles constatent que, devenus locataires d’un appartement de plusieurs pièces, leurs parents « s’en sont bien sortis finalement », comparés à d’autres immigrés restés en foyer et ayant, pour certains, femme(s) et enfants au Mali.
Adja : « Petites, on y allait tout le temps avec mon père, il nous montrait ; tout le temps il nous disait “Voilà, c’est ça la chambre 182 ; c’est là que je dormais”. Du coup, même aujourd’hui quand on va pour envoyer des fax[23] au pays, bah y’a quand même quelque chose quoi. Je sais que mon père, il est passé par là avant d’avoir tout ce qu’il a eu aujourd’hui ; donc ça me fait quelque chose c’est sûr. » (Entretien avec Adja Sylla, milieu d’adelphie, 35 ans, assistante sociale, bac +2)
Si les pères parlent peu de leur passé migratoire à leurs enfants quand ils et elles sont petit.es (Cf. supra), ils donnent néanmoins accès à un pan de leur histoire personnelle en les emmenant au foyer. Dans sa matérialité même, le foyer devient le support d’une transmission implicite de la pente de la trajectoire sociale familiale (Bourdieu, 1974) : représentant le bas de celle-ci, il matérialise la mobilité ascendante engagée par les parents et incite les enfants à la poursuivre à leur tour.
Donnant lieu à des rencontres et discussions avec des hommes de la parentèle, le foyer est un espace de transmission de la mémoire familiale. Les immigrés sahéliens s’y retrouvent pour des « causeries » – dans le prolongement des grins pratiqués au Mali [24] – et les enfants y entendent des anecdotes sur l’enfance et la jeunesse de leur père, par la bouche de parents ou d’amis de leur père. Par exemple, Lamine Sylla (ainé, 40 ans, routier, sans diplôme) a appris au foyer ce qu’il n’a jamais su par son père : ses sorties en boîtes de nuit et son goût pour la fête, avant que sa femme ne le rejoigne en France. De même, en fréquentant un foyer de travailleurs près de chez lui, en tant que bénévole pour des ateliers de français et d’aide administrative, Djibril Tandia (fils ainé, 37 ans, chef de projet, bac +5) a pu échanger avec des immigrés sahéliens sur leur histoire migratoire, parvenant ainsi à situer celle de son propre père. Malgré ces effets socialisateurs généraux de la fréquentation du foyer, ce dernier construit des souvenirs et des expériences différenciées selon le sexe des enfants.
Un lieu-sanctuaire des rôles familiaux de genre ?
Alors que, dans l’enfance, « le foyer » représente un univers heureux et léger pour tous les enfants l’ayant fréquenté (indistinctement selon leur sexe), cela change brutalement pour les filles, quand elles commencent à grandir. Pour elles, le foyer devient un espace d’inconfort où elles font l’objet de demandes en mariage récurrentes et de regards qui les incommodent.
Ramata: « J’y allais quand j’étais enfant avec mon père ; mais après vers 12-13 ans, j’ai arrêté. Eux ils veulent tous t’épouser, c’est des pervers ! Même comment ils te regardent…. […] Ouais, non c’était insoutenable ; tout le monde veut se marier avec toi ; tout le monde te regarde ; y’a des regards j’te jure, tu sens que c’est bizarre ; c’était malsain. » (Entretien avec Ramata Soumaré, fille ainée, 42 ans, sans emploi, bac +3)
Espace conçu pour des hommes célibataires (Sayad, 1980), le foyer est un lieu où les jeunes filles sentent une pression matrimoniale forte, alors que leurs frères y entretiennent des sociabilités masculines amicales et familiales. Cela conduit à une rupture de fréquentation du lieu plus précoce chez les filles (aux alentours de leurs 13 ans en général), là où les fils continuent de s’y rendre occasionnellement. Dans l’adelphie Sylla (composée de 8 filles et 3 fils), Lamine (fils ainé) a des souvenirs heureux du foyer où vivaient ses oncles paternels. Il mentionne notamment les parties de flipper dans le bar du foyer, les matches de foot avec des jeunes résidents, et les discussions interminables avec ses oncles. Ses sœurs ont en revanche un récit plus en demi-teinte. Elles se souviennent surtout qu’elles étaient « gênées » par les regards « vicieux » des hommes sur leurs corps de « femmes à marier ». Au moment de leur puberté, elles finissent par ne plus mettre les pieds au foyer – à la demande expresse de leur mère, qui insiste auprès de son mari pour qu’il cesse d’y emmener leurs filles.
Adja: « Plus on grandissait, plus ma mère elle disait à mon père “C’est bon, c’est des femmes, c’est un lieu d’hommes ; faut arrêter [de les amener] ; même si on veut conserver cette culture” […] du coup vers 14-15 ans, on n’allait plus trop, c’était vraiment juste pour le tailleur ; quand y’avait besoin de faire une tenue, bah on n’avait pas le choix, on allait, pour reprendre nos mesures, dire le modèle qu’on voulait, etc. […] Moi quand je rentrais [dans le foyer], je marchais suuuuper vite, je voulais pas rester tu vois […] ; j’avais grave honte […] de monter au premier étage, aller dire bonjour à tous mes oncles. Donc j’allais vite, je passais au sous-sol pour faire ma tenue chez le tailleur, et je repartais en fait. » (Entretien avec Adja Sylla)
Lamine continue d’aller fréquemment au foyer et d’y « trainer » jusqu’à ses 17 ans – le plus souvent sans son père. Il en va de même des frères ainés Tandia (fratrie composée de 4 frères) qui se rendaient encore régulièrement au foyer quand ils étaient jeunes adultes, avec leur oncle, leur père ou bien seuls ; pour déposer de l’argent, saluer un oncle, ou bien se faire couper les cheveux.
La manière de fréquenter le lieu est liée au genre de l’enfant – non seulement d’un point de vue temporel (les filles cessant plus tôt d’y aller), mais aussi spatial. Si filles et garçons vont dans les espaces communs « en bas » (les ateliers de couture, la cantine, la cour, le bar), seuls les fils montent dans les espaces privés situés à l’étage (chambres et douches). Fortement marqué par les asymétries de genre, cet espace de socialisation familiale qu’est « le foyer » construit des rôles familiaux genrés. Les fils intériorisent surtout un sens économique de la famille (envoyer de l’argent à la parentèle restée au Mali et soutenir la famille en France) là où les filles sont davantage socialisées à un sens matrimonial de la famille (épouser un homme de la parentèle malienne et perpétuer la lignée).
Conclusion
L’article a permis de mettre en lumière les manières plus ou moins conscientes et efficientes par lesquelles les parents émigrés cherchent à « créer, nourrir et entretenir un sentiment d’appartenance qui perd son caractère donné » du fait de la migration (Merla et al. , 2021 : 6). Il montre que, loin d’être un lien symbolique et abstrait, l’attachement des enfants d’immigré.es au pays d’origine parental est une question de relations familiales et de lien affectif – que les parents ont fait perdurer malgré la distance instaurée par l’installation en France. Cela passe par des pratiques ordinaires (appels téléphoniques, envois d’argent, hébergement d’apparenté.es, entraide familiale, visites « au foyer », etc.), des pratiques éducatives et mémorielles (récit du passé familial, choix de prénoms, etc.), mais aussi par la spatialité et la matérialité des lieux fréquentés par les enfants (ameublement du salon familial, organisation rotative des couchages dans l’appartement, organisation spatiale du foyer de travailleurs) qui les socialisent silencieusement à un esprit de famille et à la parenté pratique transnationale.
Le récit du passé familial, les pratiques parentales d’entraide familiale, et les après-midis et soirées passées au foyer de travailleurs constituent des espaces et modes d’apprentissage des rôles familiaux autant que des occasions de tisser des liens intergénérationnels et transnationaux. L’article prouve ainsi de manière concrète le « rôle de vecteur que jouent les parents dans la transmission d’une appartenance et dans l’ancrage de leurs enfants en Afrique » (Aouici et Gallou, 2013). Sans être mécanique ni totalement homogène d’une famille à l’autre et d’un enfant à l’autre, cette socialisation familiale transnationale forge un sens de la famille et de la parenté spécifique, prédisposant les enfants à leur devoir de redistribution et d’attachement transnational.
À cet égard, l’article souligne que les frontières genrées des rôles familiaux sont brouillées au sein des maisonnées transnationales, où les mères tiennent des rôles qui auraient été masculins si elles n’avaient pas migré, et où les pères adoptent des rôles qui auraient été féminins s’ils ne vivaient pas à cheval entre deux pays. Inversement, je montre que ces frontières de genre sont plus nettement conservées dans les foyers de travailleurs, qui apparaissent dès lors comme un lieu-sanctuaire des rôles de genre en migration. Cet espace socialise les enfants à un sens de la famille et de la parenté qui prend des formes différenciées selon leur genre : les fils apprennent surtout un sens familial économique (envoyer de l’argent à la parentèle restée au Mali et soutenir la famille en France), là où les filles sont davantage socialisées à un sens familial matrimonial (épouser un homme de la parentèle malienne et perpétuer la lignée).
Appendices
Notes
-
[1]
Les noms et prénoms utilisés dans cet article sont des pseudonymes. Pour renforcer l’anonymat des enquêté.es, certaines informations ont également été modifiées par des équivalents sociologiques.
-
[2]
Ici comme dans la suite du texte, le terme de « parentèle » désigne la parentèle plurigénérationnelle et transnationale, et celui de « famille » renvoie aux membres de la famille nucléaire résidant en France.
-
[3]
Les immigré.es sahélien.nes représentent le groupe d’origine le plus transnational, notamment dans le domaine économique : 39 % apportent une aide financière régulière à un ménage hors métropole (contre 14 % de l’ensemble des immigré.es), et 21 % contribuent financièrement à un projet collectif dans leur région d’origine (ce qui n’est le cas que de 9 % de l’ensemble des immigré.es) (Beauchemin et al., 2015).
-
[4]
La notion est empruntée à David Morgan (2011), qui définit la famille non par sa configuration, mais par différentes pratiques : le partage d’événements communs, les discussions plus ou moins anodines et l’ensemble des pratiques d’entraide (morale, financière, matérielle). Dans le contexte français, voir le concept de « parenté pratique » (Weber, 2005).
-
[5]
L’expression désigne les couples composés d’un.e Françai.se (natif.ve) et d’un.e immigré.e. Pour un tour d’horizon critique de la notion, voir Varro, 2012.
-
[6]
Pour un aperçu des effets socialisateurs des séjours en Afrique des descendant.es d’immigré.es subsaharien.nes, voir Razy, 2007 ; Belkacem, 2016 ; Camara, 2022.
-
[7]
L’expression originale que je traduis est « work of kinship » (di Leonardo, 1987).
-
[8]
En socioanthropologie de la famille, l’expression renvoie aux pratiques qui s’inscrivent dans une logique de loyauté aux parents et à leurs attendus. Elle est notamment utilisée pour rendre compte de la prise en charge des parents dépendants par les enfants adultes. Voir, par exemple, Weber et al., 2003 ; Attias-Donfut et Gallou, 2006.
-
[9]
Les premiers foyers de travailleurs migrants (FTM) ont vu le jour en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Initialement placée sous la houlette du ministère du Travail, leur gestion est rapidement passée aux mains d’associations (Barou, 1986).
-
[10]
Sur ce type de circulations enfantines, voir Razy, 2007.
-
[11]
Dans les villages maliens d’origine, les lignées familiales sont hiérarchisées selon leurs positions statutaires héritées de l’organisation sociale esclavagiste de la période précoloniale. On distingue les lignées d’ascendance captive et, parmi les gens libres, les lignées artisanes (forgerons, griots, cordonniers) et les lignées nobles (princes, guerriers et marabouts). Pour de plus amples développements à ce sujet, voir Wagué, 2023.
-
[12]
Cette transmission intergénérationnelle de la mémoire familiale est en revanche « réussie » dans les familles d’immigré.es plus fortement dotées en capitaux culturels – qui sont le plus souvent celles qui se sont déplacées pour des raisons politiques et dans lesquelles au moins un parent est diplômé (Lagier, 2016).
-
[13]
Sur la réactivation du sentiment de filiation au moment de l’entrée en parentalité, voir Le Pape, 2005.
-
[14]
Margot Delon présente un résultat similaire à propos de descendants d’immigré.es nord-africain.es (Delon, 2017).
-
[15]
Vincent de Gaulejac emprunte cette notion à Freud. Elle permet selon lui de penser l’écart « entre l’histoire “objective” et le récit “subjectif” » et désigne « les histoires de famille que l’on transmet de génération en génération » qui évoquent les événements du passé, les destinées des différents personnages de la saga familiale (de Gaulejac, 2002 : 200).
-
[16]
La notion de « care » permet aux autrices de ne pas limiter ces pratiques transnationales à la seule redistribution économique. Elles relèvent cinq dimensions de l’entraide familiale dans les familles transnationales : les soins personnels (nourrir et laver une personne dépendante et/ou malade), le soutien pratique (échange de conseils), le soutien financier, la fourniture d’un logement (la maison que l’émigré.e a quittée ou qu’il.elle n’habite qu’occasionnellement) et le soutien émotionnel (qui est transversal aux quatre autres types d’entraide et soutien).
-
[17]
Le CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) est considéré comme un « petit diplôme » dans le contexte français (Depoilly et al., 2023). Obtenu au cours de la scolarité secondaire en filière professionnelle, il est reconnu de niveau 3 (soit un niveau inférieur au baccalauréat, qui est reconnu niveau 4).
-
[18]
Sur les reclassements de genre produits par la migration en milieu sahélien, voir Feldman, 2018. Sur les reconfigurations des rôles de genre au sein des familles immigrées, voir Vatz-Laaroussi, 2001 ; Delcroix, 2004.
-
[19]
On peut aussi penser que Mme Sylla cherchait à préserver la virginité de ses filles, qui constitue un élément central de leur valeur sur le marché matrimonial transnational.
-
[20]
Voir Dia, 2007.
-
[21]
Les études sur les associations villageoises transnationales montrent toutefois les efforts effectués vers la génération des enfants pour les intégrer à la vie des émigrés du même village, notamment pour assurer la relève des actions financières (Kane, 2001 ; Dia, 2008 ; Grysole et Mbodj-Pouye, 2017).
-
[22]
Donc tous exceptés deux pères, qui ont vécu dans des appartements qu’ils louaient avec d’autres compatriotes.
-
[23]
Le fax est un envoi dématérialisé d’argent ou de denrées alimentaires. Voir Grysole et Mbodj-Pouye, 2017.
-
[24]
En milieu rural, le grin est un lieu de causeries fréquenté par les hommes (hormis les vieillards et les malades) en dehors de leurs horaires de travail aux champs. En milieu urbain, le grin peut être associé à un café où les hommes se retrouvent après le travail pour parler de politique, boire le thé, et accessoirement prier.
Bibliographie
- Aouici, S. et R. Gallou. 2013. « Ancrage et mobilité de familles d’origine africaine : regards croisés de deux générations », Enfances, Familles, Générations , no 19, p. 168-194.
- Attias-Donfut, C. et R. Gallou, 2006. « L’impact des cultures d’origine sur les pratiques d’entraide familiale », Informations sociales , no 134, p. 86-97.
- Baldassar, L. et D. Merla (dir.). 2014. Transnational Families, Migration and the Circulation of Care , Londres, Routledge.
- Barou, J. 1986. « Les communautés africaines en France : quand le foyer demeure au centre de la vie sociale », Migrants-Formations , no 67, p. 5‑9.
- Barou, J. 1991. « Familles africaines en France : de la parenté mutilée à la parenté reconstituée », dans Jeux de famille : parents, parenté, parentèle , sous la dir. de M. Segalen, Paris, Éditions du CNRS, p. 157‑171.
- Beauchemin, C., H. Lagrange et M. Safi. 2015. « Liens transnationaux et intégration : ici et là-bas », dans Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France , sous la dir. de C. Beauchemin, C. Hamel et P. Simon, Paris, Ined, p. 87-115.
- Belkacem, L. 2013. « Jeunes descendants d’immigrants ouest-africains en consultations ethnocliniques : migrations en héritage et mémoires des "origines" », Revue européenne des migrations internationales , vol. 1, no 29, p. 69‑89.
- Belkacem, L. 2016. « La colonie “Des racines pour ton avenir”. Expériences de disqualification/requalification d’enfants d’immigrants maliens », Agora débats/jeunesses , no 72, p. 21-34.
- Bertrand, M. 2016. « Bamako en héritage ? Vieillissement de migrants maliens et cohabitations intergénérationnelles dans un environnement précaire de la capitale malienne », Cahiers de démographie locale , no 2013-14, p. 155-194.
- Besure, C., Y. de Stexhe, C. Durant, F. Rinschbergh, L. Merla et J. Mol. 2014. « Co-présence physique, co-présence virtuelle et liens familiaux en situation migratoire », dans Distances et liens , sous la dir. de L. Merla et A. François, Louvain-la-Neuve, L’Harmattan, p. 63-82.
- Billaud, S. Gollac, A. Oeser et J. Pagis (dir.). 2015. Histoires de famille. Les récits du passé dans la parenté contemporaine , Paris, Éditions rue d’Ulm.
- Bourdieu, P. 1974. « Avenir de classe et causalité du probable », Revue française de sociologie , no 15, p. 3‑42.
- Brouard, S. et V. Tiberj. 2005. Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque , Paris, Presses de Sciences Po.
- Camara, T. 2022. « La famille, les vacances et les affaires. Séjours en Afrique d’adultes descendants d’immigrés subsahariens », Espaces et sociétés , no 184-185, p. 149-164.
- Coe, C. 2013. The Scattered Family: Parenting, African Migrants, and Global Inequality , University of Chicago Press.
- Darmon, M. 2006. La socialisation , Paris, Armand Colin.
- Déchaux, J.-H. 1997. Le souvenir des morts. Essai sur le lien de filiation , Paris, Presses Universitaires de France.
- Delcroix, C. 1995. « Des récits de vie croisés aux histoires de famille », Current Sociology , no 43, p. 61-67.
- Delcroix, C. 2004. « La complexité des rapports intergénérationnels dans les familles ouvrières du Maghreb. L’exemple de la diagonale des générations », Temporalités , no 2, p. 44-59.
- Delcroix, C. 2009. « Transmission de l’histoire familiale et de la mémoire historique face à la précarité », Migrations Société , no 123‑124, p. 141‑58.
- Delon, M. 2017. « Les liens de la mémoire. Sociabilité et visibilité à travers un blog d’anciens habitants des cités de transit de Nanterre », Sociologie , no 8, p. 23-38.
- Depoilly, S., G. Moreau, A. Pégourdie et F. Renard. 2023. Idées reçues sur les « petits diplômes » , Paris, Le Cavalier bleu.
- Dia, H. 2008. « Villages multi-situés du Fouta-Toro en France. Le défi de la transition entre générations de caissiers, lettrés et citadins », Asylon(s) , no 3.
- Dia, H. 2007. « Le téléphone portable dans la vallée du fleuve Sénégal », Agora débats/jeunesses , no 46, p. 70-80.
- Feldman, N. 2018. Migrantes : du bassin du fleuve Sénégal aux rives de la Seine , Paris, La Dispute.
- Feldman, N. 2012. « Violence domestique des femmes au Mali », dans Penser la violence des femmes , sous la dir. de C. Cardi et G. Pruvost, Paris, La Découverte, p. 231-244.
- Fiévet, M. 1996. « Le foyer, lieu de vie économique pour les Africains », Hommes et Migrations , no 1202, p. 23‑27.
- Fogel, F. 2007. « Mémoires mortes ou vives. Transmission de la parenté chez les migrants », Ethnologie française , vol. 3, no 37, p. 509‑516.
- de Gaulejac, V. 2002. « Histoires de vie : héritage familial et trajectoire sociale », dans Familles. Permanence et métamorphoses , sous la dir. de J.-F. Dortier, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, p. 199‑206.
- Grysole, A. 2020. « Fabriquer des enfants redevables. Pluriparentalité transnationale entre les États-Unis et le Sénégal », Revue des politiques sociales et familiales , no 134, p. 11‑24.
- Grysole, A. et D. Bonnet. 2020. « Observer les mobilités sociales : l’investissement migratoire des familles », Politique africaine , vol. 3, no 159, p. 7‑32.
- Grysole, A. et A. Mbodj-Pouye. 2017. « Bons, fax et sacs de riz. Tenir et maintenir un circuit économique transnational (France, Sénégal) », Cahiers d’études africaines , no 225, p. 121‑150.
- Hmed, C. 2007. « Contester une institution dans le cas d’une mobilisation improbable : la “grève des loyers” dans les foyers Sonacotra dans les années 1970 », Sociétés contemporaines , no 65, p. 55-81.
- Ichou, M. 2018. Les enfants d’immigrés à l’école. Inégalités scolaires, du primaire à l’enseignement supérieur , Paris, Presses Universitaires de France.
- Jamoulle, P. 2013. Par-delà les silences : non-dits et ruptures dans les parcours d’immigration , Paris, La Découverte.
- Kane, A. 2001. « Diaspora villageoise et développement local en Afrique. Le cas de Thilogne association développement », Hommes et migrations , no 1229, p. 96-107.
- Lagier, E., 2016. « Parcours migratoires des parents et rapport des enfants à la politique. La part de l’histoire migratoire familiale dans la socialisation politique des descendants d’immigrés », Recherches familiales , no 13, p. 21-33.
- Lagrange, H. 2010. Le déni des cultures , Paris, Seuil.
- Le Gall, J. et D. Meintel. 2011. « Liens transnationaux et transmission intergénérationnelle : le cas des familles mixtes au Québec », Autrepart , no 57‑58, p. 127‑143.
- di Leonardo, M. 1987. « The Female World of Cards and Holidays. Women, Families, and the Work of Kinship », Signs , vol. 3, no 12, p. 440‑453.
- Le Pape, M.-C., 2005. « Mémoire familiale, filiation et parentalité en milieux populares », Revue des politiques sociales et familiales , no 82, p. 17-32.
- Lepoutre, D et I. Cannoodt. 2005. Souvenirs de familles immigrées , Paris, Odile Jacob.
- Mbodj-Pouye, A. 2016. « “On n’ignore pas la solidarité”. Transformation des foyers de travailleurs migrants et recompositions des liens de cohabitation », Genèses , no 104, p. 51‑72.
- Meintel, D. 1992. « L’identité ethnique chez les jeunes Montréalais d’origine immigrée », Sociologie et sociétés , no 24, p. 73-89.
- Merla, L., B. Nobels, S. Murru et C. Theys. 2021. « “Faire famille” dans et par l’espace : vers un habitus multilocal », Recherches sociologiques et anthropologiques , no 52, p. 1-23.
- Morgan, D. H. G. 2011. Rethinking Family Practices , Basingstoke, Palgrave McMillan.
- Muxel, A. 1996. Individu et mémoire familiale , Paris, Hachette.
- Quiminal, C. 1990. « Du foyer au village : l’initiative retrouvée », Hommes et Migrations , no 1131, p. 19‑24.
- Quiminal, C. 2021. La République et ses étrangers. Cinquante années de rencontre avec l’immigration malienne en France , Paris, La Dispute.
- Razy, É. et V. Baby-Collin. 2011. « La famille transnationale dans tous ses états », Autrepart , no 57‑58, p. 7‑22.
- Razy, É. 2007. « Les sens contraires de la migration. La circulation des jeunes filles d’origine soninké entre la France et le Mali », Journal des africanistes , no 77, p. 19-43.
- Santelli, E. 2001. La mobilité sociale dans l’immigration. Itinéraires de réussite des enfants d’origine algérienne , Toulouse, Presses Universitaires du Mirail.
- Sayad, A. 1980. « Le foyer des sans-famille », Actes de la recherche en sciences sociales , no 32, p. 89‑103.
- Shahrokni, S. 2021 . Higher Education and Social Mobility in France. Challenges and Possibilities among Descendants of North African Immigrants , Londres, Routledge.
- Unterreiner, A. 2015. Enfants de couples mixtes. Liens sociaux et identités , Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- Varro, G. 2012. « Les "couples mixtes" à travers le temps : vers une épistémologie de la mixité », Enfances, Familles, Générations , no 17.
- Vatz-Laaroussi, M. 2001. Le familial au cœur de l’immigration. Les stratégies de citoyenneté des familles immigrantes au Québec et en France , Paris, L’Harmattan.
- de Villers, J. 2005. « Entre injonctions contradictoires et bricolages identitaires : quelles identifications pour les descendants d’immigrés marocains en Belgique ? », Lien social et Politiques , no 53, vol. 15, p. 15-27.
- Wagué, C. 2023. Histoire des Soninkés dans le Fouta Toro. Une minorité culturelle entre Mauritanie et Sénégal (XVIIIe – XXIe siècles) , Paris, Karthala.
- Weber, F., S. Gojard et A. Gramain. 2003. Charges de famille. Dépendance et parenté dans la France contemporaine , Paris, La Découverte.
- Weber, F. 2005. Le sang, le nom, le quotidien : une sociologie de la parenté pratique , La Courneuve, Éditions Aux lieux d’être.
- Zontini, E. et T. Reynolds. 2018. « Mapping the Role of ‘Transnational Family Habitus’ in the Lives of Young People and Children », Global Networks , no 18, vol. 3, p. 418-436.