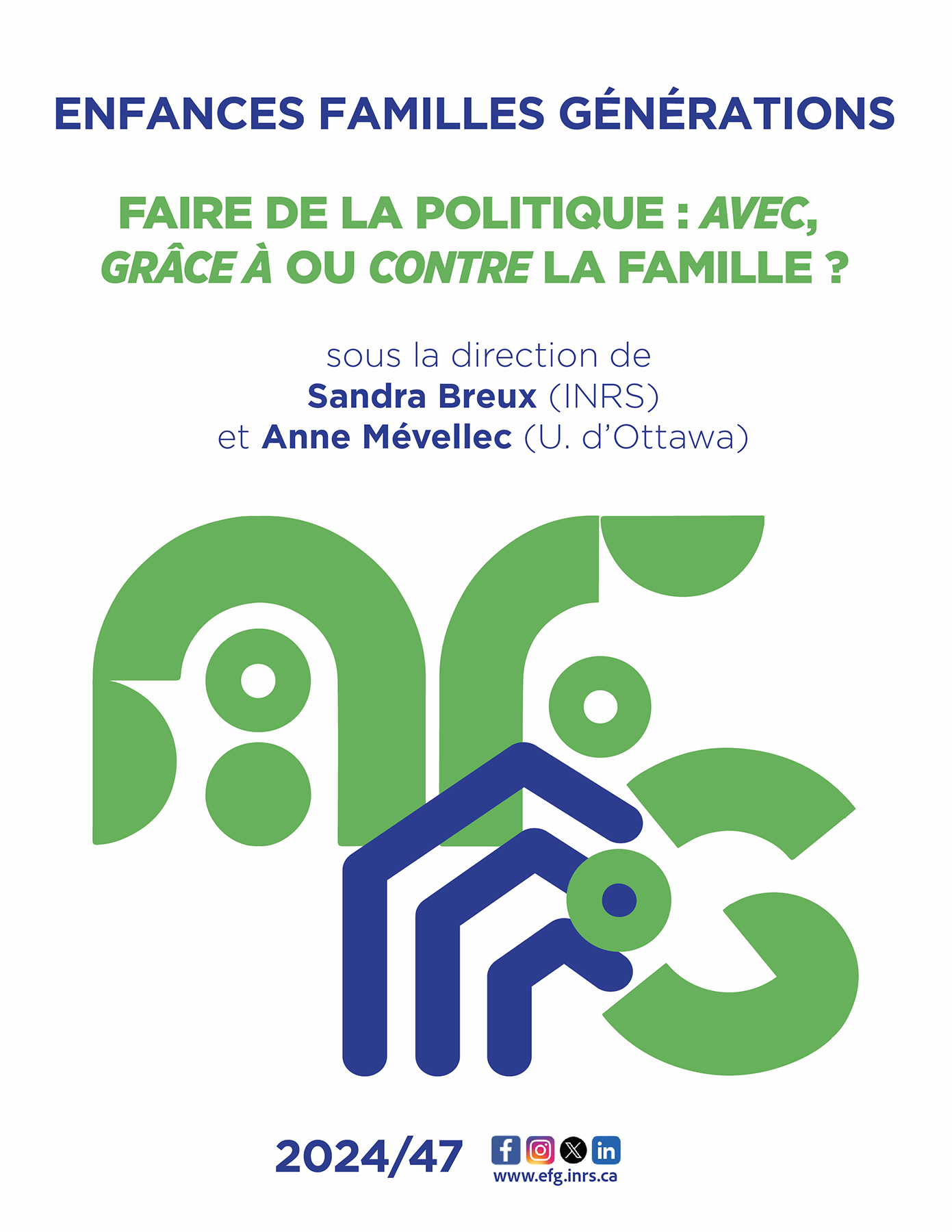Abstracts
Résumé
Cadre de la recherche : En France, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, le Parti communiste s’est structuré en politisant les communautés locales. En investissant les familles, il a rendu possible des socialisations politiques « au berceau ».
Objectifs : Cet article propose de mettre l’accent sur le rôle de l’appartenance familiale dans la formation et la transformation des positionnements politiques.
Méthodologie : À partir d’un entretien biographique mené avec une ancienne militante du Parti communiste français (PCF) dans un site et un contexte historique spécifiques, il s’agit de reconstituer une trajectoire qui éclaire les mécanismes d’attachement puis de détachement partisan.
Résultats : Irène Delvaux, née en 1936 dans le bassin minier du Pas-de-Calais, où le PCF renforce alors son influence, est une communiste « native » : venue au monde dans une famille engagée, sa socialisation militante s’amorce avec sa socialisation primaire. Fille d’un ouvrier des mines devenu dirigeant syndical, cadre et dirigeant communiste, puis député et maire, elle hérite d’une politisation « rouge ». Si elle qualifie, a posteriori, le contexte de sa jeunesse de « stalinien » et « sectaire », son récit est marqué par une admiration sans limite pour son père, qu’elle décrit comme un autodidacte dévoué et un militant exemplaire. Devenue employée municipale, elle s’investit à la « base » du parti et adopte ses politiques d’« ouverture ». Dans les années 1990, cette position la place en porte-à-faux avec l’orientation politique fédérale. Si ce désaccord contribue à sa rupture avec le PCF en 1996, le sentiment de non-reconnaissance de son père par les responsables locaux précipite son exit.
Conclusion : Cette trajectoire de femme communiste, en s’inscrivant dans des logiques indissociablement socio-historiques et affectives (formation d’un personnel politique ouvrier, évolutions stratégiques et divisions partisanes, loyauté à un père incarnant l’autorité domestique autant que politique, succession des générations dans les dynasties communistes, gestion de l’héritage), éclaire les manières dont les liens familiaux affectent le lien partisan, et réciproquement.
Contribution : Inscrit dans une entreprise d’histoire orale, ce texte est une contribution à la sociologie de la socialisation.
Mots-clés :
- biographie,
- classes populaires,
- engagement,
- famille,
- France,
- Parti communiste,
- père,
- politique
Abstract
Reseach framework : In France’s Pas-de-Calais coalfield, the Communist Party structured itself by politicizing local communities. By investing in families, it made possible “native” political socialization.
Objectives: This article focuses on the role of family ties in shaping and transforming political involvements.
Methodology: Thanks to a biographical interview with a former French Communist Party (FCP) activist in specific site and historical context, the aim is to reconstruct a trajectory which sheds light on the mechanisms of partisan attachment and then detachment.
Results: Irène Delvaux, born in 1936 in the Pas-de-Calais coalfield, where the FCP was strengthening its influence at the time, is a “native” communist: born into a committed family, her militant socialization began with her primary socialization. Daughter of a mineworker who became a trade union leader, a Communist executive and leader, then a member of parliament and mayor, she inherited a “red” politicization. Although she describes the context of her youth as “stalinist” and “sectarian” in retrospect , her story is marked by boundless admiration for her father, whom she describes as a devoted self-taught man and exemplary activist. Having become a municipal employee, she got involved with the party’s “base” and adopted its “openness” policies. In the 1990s, this position put her at odds with federal political direction. While this disagreement contributed to her break with the FCP in 1996, the feeling of non-recognition of her father by local activists precipitated her exit.
Conlusion: This trajectory of a Communist woman, which is inextricably bound up with socio-historical and affective logics (formation of a working-class political staff, strategic developments and partisan divisions, loyalty to a father who embodied domestic as well as political authority, succession of generations in Communist dynasties, inheritance management), sheds light on the ways in which family ties affect the partisan bond, and vice versa.
Contribution: As part of an oral history project, this text is a contribution to the sociology of socialization.
Keywords:
- biography,
- working class,
- commitment,
- family,
- France,
- Communist Party,
- father,
- politics
Resumen
Marco de la investigación: En Francia, en la cuenca minera de Pas-de-Calais, el Partido Comunista se estructuró politizando a las comunidades locales. Entrando en las familias, hizo posible una socialización política “nativa”.
Objetivos: Este artículo propone enfatizar sobre el papel de la afiliación familiar en la formación y transformación de posiciones políticas.
Metodología: A partir de una entrevista biográfica realizada con una ex activista del Partido Comunista Francés (PCF) en un lugar y un contexto histórico específicos, el objetivo es de reconstruir una trayectoria que informa los mecanismos de compromiso partidista y luego de desafiliación.
Resultados: Irène Delvaux, nacida en 1936 en la cuenca minera de Pas-de-Calais, donde el PCF fortaleció su influencia, es una comunista “nativa”: nacida en una familia comprometida, su socialización militante comenzó con su socialización primaria. Hija de un trabajador minero que llegó a ser dirigente sindical, ejecutiva y dirigente comunista, luego diputada y alcaldesa, heredó una politización “roja”. Si, en retrospectiva, describe el contexto de su juventud como “estalinista” y “sectaria”, su historia está marcada por una admiración ilimitada por su padre, a quien describe como un devoto autodidacta y un activista ejemplar. Tras convertirse en empleada municipal, se involucró en la “base” del partido y adoptó sus políticas de “apertura”. En la década de 1990, esta posición la puso en desacuerdo con ladirección política federal. Si este desacuerdo contribuyó a su ruptura con el PCF en 1996, el sentimiento de no reconocimiento de su padre por parte de los activistas locales precipitó su salida.
Conclusiones: Esta trayectoria de una mujer comunista, al ser parte de lógicas inseparablemente sociohistóricas y afectivas (formación de un estado mayor obrero, desarrollos estratégicos y divisiones partidistas, lealtad a un padre que encarna tanto la autoridad doméstica como política, sucesión de generaciones en las dinastías comunistas, gestión de la herencia), arroja luz sobre las formas en que los vínculos familiares afectan los vínculos partidistas, y viceversa.
Contribución: Situado en una perspectiva de historia oral, este texto es una contribución a la sociología de la socialización.
Palabras clave:
- biografía,
- clases trabajadoras,
- compromiso,
- familia,
- Francia,
- partido comunista,
- padre,
- política
Appendices
Bibliographie
- Ariès, P. 1971 (1948). Histoire des populations françaises, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire ».
- Bargel, L. et M. Darmon. 2017. « La socialisation politique », Politika, en ligne : https://www.politika.io/fr/article/socialisation-politique
- Beaud, S. et M. Pialoux. 1999. Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, Paris, Fayard.
- Berger, P. et T. Luckmann. 1996 (1966). La construction sociale de la réalité, trad. P. Taminiaux, Paris, Armand Colin.
- Boughaba, Y., A. Dafflon et C. Masclet. 2018. « Socialisation (et) politique. Intériorisation de l’ordre social et rapport politique au monde », Sociétés contemporaines, no 112, p. 5-21.
- Boulland, P. et J. Mischi. 2015. « Promotion et domination des militantes dans les réseaux locaux du Parti communiste français », Vingtième siècle. Revue d’histoire, no 126, p. 73-86.
- Boulland, P. 2016. Des vies en rouge. Militants, cadres et dirigeants du PCF (1944-1981), Paris, Éditions de l’Atelier.
- Bourdieu, P. 1980. Le sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun ».
- Bourdieu, P. 1986. « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, no 62-63, p. 69-72.
- Bourdieu, P. 1993. « À propos de la famille comme catégorie réalisée », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 100, p. 32-36.
- Bourdieu, P. 1997. Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, coll. « Liber ».
- Dubar, C., G. Gayot et J. Hédoux. 1982. « Sociabilité minière et changement social à Sallaumines et à Noyelles-sous-Lens (1900-1980) », Revue du Nord, vol. 64, no 263, p. 365-463.
- Fayolle, S. 2005. L’Union des Femmes Françaises : une organisation féminine de masse du parti communiste français (1945-1965), thèse de doctorat en science politique, Paris, Université Paris 1.
- Fillieule, O., C. Leclercq et R. Lefebvre. 2022. Le malheur militant, Louvain-la-Neuve, De Boeck, coll. « Ouvertures politiques ».
- Fitzpatrick, S. 2002. Le stalinisme au quotidien. La Russie soviétique dans les années 1930, Paris, Flammarion.
- Gaxie, D. 1977. « Économie des partis et rétributions du militantisme », Revue française de science politique, vol. 27, no 1, p. 123-154.
- Halbwachs, M. 1994 (1925). Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel.
- Hoggart, R. 1970 (1957). La culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, trad. F et J. C. Garcias, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun ».
- Jennings, M. K. et N. J. Niemi. 1968. « The transmission of political values from parent to child », American Political Science Review, no 62, p. 169-184.
- Lavabre, M. C. 1994. Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste, Paris, Presses de la FNSP.
- Lechien, M-H. et Y. Siblot. 2019. « “Eux/nous/ils” ? Sociabilités et contacts sociaux en milieu populaire », Sociologie, vol. 10, no 1.
- Leclercq, C. 2008. Histoires d’ex. Une approche socio-biographique du désengagement des militants du Parti communiste français, Thèse de doctorat en science politique, Paris, Institut d’études politiques.
- Leclercq, C. 2018. « “Crise” des partis, doxa du renouveau et délaissement des classes populaires », dans Que faire des partis politiques ?, sous la dir. de D. Gaxie et W. Pelletier, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, p. 137-157.
- Leclercq, C. 2022. « La relégation. Un ouvrier communiste “quitté par le parti” », dans Le malheur militant, sous la dir. de O. Fillieule, C. Leclercq et R. Lefebvre, Louvain-La-Neuve, De Boeck, p. 195-216.
- Lenoir, R. 1992. « L’État et la construction de la famille », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 91-92, p. 20-37.
- Loiseau, D. 2018. « L’Union des femmes françaises pendant les Trente glorieuses : entre “maternalisme”, droit des femmes et communisme », Le mouvement social, no 265, p. 37-53.
- Mak, A. 2021. « Enquêtes orales, enquêtes historiennes », Le mouvement social, no 274, p. 3-30.
- Maruani, M. et M. Meron. 2012. Un siècle de travail des femmes en France, Paris, La Découverte, coll. « Sciences Humaines ».
- Matonti, F. et F. Poupeau. 2004. « Le capital militant. Essai de définition », Actes de la recherche en sciences sociales, no 155, p. 4-11.
- Mischi, J. 2003. « Travail partisan et sociabilités populaires. Observations localisées de la politisation communiste », Politix, vol. 16, no 63, p. 91-119.
- Molinari, J.-P. 1996. Les ouvriers communistes. Sociologie de l’adhésion ouvrière au PCF, Paris, L’Harmattan.
- Noiriel, G. 1986. Les ouvriers dans la société française. XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, coll. « Points histoire ».
- Offerlé, M. 2002 (1987). Les partis politiques, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? ».
- Pennetier, C. et B. Pudal. 2014. Le sujet communiste. Identités militantes et laboratoires du « moi », Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- Percheron, A. 1974. L’univers politique des enfants, Paris, Armand Colin/Presses de la FNSP.
- Perdoncin, A. 2021. « Tous au charbon ? Inégalités de carrières et mobilités ouvrières dans la récession (Nord–Pas-de-Calais, 1945-1990) », Genèses, no 122, p. 9-33.
- Pudal, B. 1989. Prendre parti. Pour une sociologie historique du PCF, Paris, Presses de la FNSP.
- Pudal, B. 2009. Un monde défait. Les communistes français de 1956 à nos jours, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, coll. « Savoir/Agir ».
- Sawicki, F. 1997. Les réseaux du Parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, Paris, Belin, coll. « Socio-histoires ».
- Sawicki, F. et J. Siméant. 2009. « Décloisonner la sociologie de l’engagement militant », Sociologie du travail, vol. 51, p. 97-125.
- Schwartz, O. 1990. Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, Paris, PUF.
- Schwartz, O. 2018. « Les femmes dans les classes populaires, entre permanence et rupture », Travail, genre et sociétés, no 39, p. 121-138.
- Siblot, Y., M. Cartier, I. Coutant, O. Masclet et N. Renahy. 2015. Sociologie des classes populaires contemporaines, Paris, Armand Colin.
- Thorez, P. 1982. Les enfants modèles, Paris, Lieu commun.
- Thorez, P. 1985. Une voix, presque mienne, Paris, Lieu commun.
- Verret, M. 1984. « Mémoire ouvrière, mémoire communiste », Revue française de science politique, vol. 34, no 3, p. 413-427.
- Verret, M. 1988. La culture ouvrière, Saint-Sébastien, ACL Éditions.
- Vigna, X. 2006. « Le crible de la mémoire : usages du passé dans les luttes ouvrières des années 68 », dans Concurrence des passés. Usages politiques du passé dans la France contemporaine, sous la dir. de M. Crivello, P. Garcia et N. Offenstadt, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, p. 145-156.
- Weber, M. 2013 (1913). « La transformation du charisme et le charisme de fonction », trad. I. Kalinowski, Revue française de science politique, vol. 63, no 3, p. 463-486.