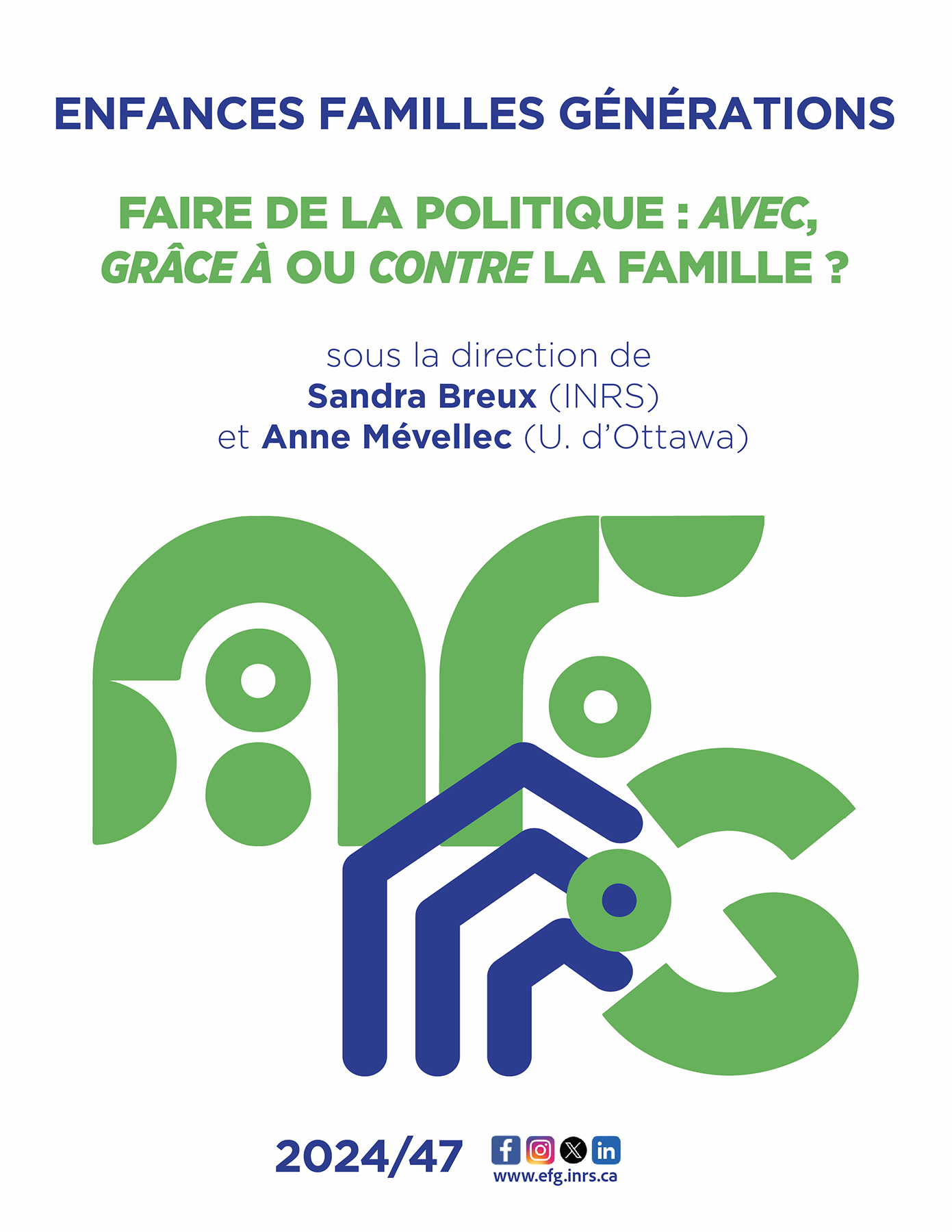Abstracts
Résumé
Cadre de recherche : L’engagement politique électif est-il compatible avec la préservation d’une vie de famille ? Quel rôle joue les entourages privés dans les carrières des acteurs et actrices politiques ?
Objectifs : Cette enquête entend précisément questionner le rôle joué par la famille dans les carrières politiques des élus, que cela soit dans les processus d’engagement et de désengagement, mais également au cours des parcours politiques.
Méthodologie : Cet article présente cinq portraits, soit cinq trajectoires politiques (analysées à l’aide du concept de carrière de la sociologie interactionniste), permettant d’illustrer différemment les rôles de la famille dans l’engagement politique des élus, dans leur décision de retrait de la vie politique, et dans leurs « vies d’après » la politique élective.
Résultats : La famille peut d’abord constituer un soutien pour l’élu en encourageant à l’engagement et au maintien en poste des acteurs politiques : un soutien dans le travail domestique pour que l’élu puisse s’engager pleinement en politique, un soutien moral, un soutien dans le travail politique en lui-même. L’espace familial constitue un endroit cloisonné où il est possible de se ressourcer et d’exprimer ses émotions. La famille peut également jouer un rôle dans les doutes et la remise en cause de l’engagement, voire dans la décision de retrait de la vie politique. Par exemple, un événement biographique peut jouer le rôle d’un « rappel à l’ordre » pour l’élu sur l’urgence de rééquilibrer ses temps sociaux. Le sentiment d’être trop absent pour ses proches et/ou la volonté de passer davantage de temps avec les siens peuvent motiver des retraits de la vie politique.
Conclusions : Pour autant, ces éléments ne comptent pas de la même manière selon le genre, l’âge de l’élu, l’âge de ses enfants, le fait d’être en couple ou non, le milieu social d’origine et la culture politique partisane. Enfin, la croissance des retraits liés aux contraintes familiales témoigne d’un processus de normalisation du métier politique.
Contribution : La famille constitue assurément un soutien dans l'entrée en politique et au cours de la carrière politique. Elle pèse dans la réévaluation des rétributions de l'engagement et joue un rôle dans les décisions de poursuite de l'engagement comme dans les choix de retrait de la vie politique
Mots-clés :
- conciliation famille-travail,
- vie quotidienne,
- temps,
- politique,
- emploi du temps
Abstract
Research Framework: Is elective political commitment compatible with maintaining a family life? What role does private relationships play on the careers of elected politicians?
Objectives: The aim of this study is to examine the role played by the family in the political careers of elected representatives, both in the processes of engagement and disengagement, and in the course of political careers.
Methodology: This article presents five portraits, or five political trajectories (analysed using the interactionist sociology concept of career), which illustrate in different ways the role played by the family in the political involvement of elected representatives, in their decision to withdraw from political life, and in their ‘lives after’ elective politics.
Results: Firstly, the family can provide support for the elected official by encouraging the commitment and retention of political players: support in domestic work so that the elected official can commit fully to politics, moral support, support in the political work itself. The family space is a enclosed place where it is possible to recharge one’s batteries and express one’s emotions. The family can also play a role in the doubts and questioning of the commitment, or even in the decision to withdraw from political life. For example, a biographical event can act as a “wake-up call” for the elected representative on the urgent need to rebalance their social time. The feeling of being too absent for family and friends and/or the desire to spend more time with their loved ones can motivate their withdrawals from political life.
Conclusions: However, these factors do not count in the same way depending on gender, the age of the elected representative, the age of their children, whether or not they are in a relationship, their social background and the culture of their political party. Finally, the increase in withdrawals linked to family constraints bears witness to a process of normalization in the political profession.
Contribution: The family is undoubtedly a source of support when entering politics and during a political career. It weighs in the re-evaluation of the rewards of commitment and plays a role in decisions to continue involvement as well as in choices to withdraw from political life.
Keywords:
- reconciling family and work,
- daily life,
- time,
- politics,
- use of time
Resumen
Marco de investigación: ¿Es compatible el compromiso político electoral con el mantenimiento de una vida familiar? ¿Qué papel desempeñan las relaciones privadas en la carrera de los actores y actrices de la política?
Objetivos: El objetivo de este estudio es examinar el papel desempeñado por la familia en la trayectoria política de los representantes electos, tanto en los procesos de implicación y desvinculación como en el curso de las carreras políticas.
Metodología: Este artículo presenta cinco retratos, o cinco trayectorias políticas (analizadas utilizando el concepto de carrera de la sociología interaccionista), que ilustran de diferentes maneras el papel desempeñado por la familia en la implicación política de los representantes electos, en su decisión de retirarse de la vida política y en sus «vidas después» de la política electiva.
Resultados: En primer lugar, la familia puede proporcionar apoyo al elegido o elegida favoreciendo el compromiso y la permanencia de dichos actores políticos: apoyo en el trabajo doméstico para que la persona electa pueda comprometerse plenamente con la política, apoyo moral, apoyo en el propio trabajo político; el espacio familiar es un lugar protegido donde es posible recargar las energías y expresar las emociones. En segundo lugar, la familia también puede desempeñar un papel en las dudas y el cuestionamiento del compromiso, o incluso en la decisión de retirarse de la vida política. Es el caso, por ejemplo, cuando se produce un acontecimiento biográfico que actúa como «llamada de atención» para la persona elegida sobre la necesidad urgente de reequilibrar su tiempo social. La sensación de estar demasiado ausente para sus allegados y/o el deseo de pasar más tiempo con sus seres queridos también pueden ser motivos para retirarse de la vida política.
Conclusiones: Sin embargo, estos factores no cuentan de la misma manera según el sexo, la edad de la persona, la edad de sus hijos, el hecho de estar o no en pareja, su origen social y la cultura política de su partido. Por último, el aumento de salidas de la vida política vinculadas a las obligaciones familiares atestigua un proceso de normalización de la profesión política.
Contribución: No cabe duda de que la familia proporciona apoyo al entrar en política y durante la carrera política. Es un factor en la reevaluación de las recompensas de la participación y desempeña un papel en las decisiones de continuar participando, así como en las decisiones de retirarse de la vida política.
Palabras clave:
- conciliación familia-trabajo,
- vida cotidiana,
- tiempos,
- política,
- empleo del tiempo
Article body
L’engagement politique électif est-il compatible avec la préservation d’une vie de famille ? Se consacrer aux autres nécessite-t-il le sacrifice du temps passé avec les siens ? Dès les premiers pas de la République américaine, la distance qui séparait le parlementaire de sa famille a été considérée comme un sacrifice personnel (Zagarri, 2013). Partir à Washington durant des mois entiers loin des siens était alors assimilé à une forme d’exil, à une souffrance qui privait le parlementaire d’un soutien et d’un réconfort familial, mais cette souffrance était également celle des épouses qui se retrouvaient seules à élever leurs enfants et parfois à poursuivre l’activité professionnelle familiale (une ferme, une entreprise).
L’essentiel des enquêtes exposant la difficile conciliation entre vie politique et vie familiale concerne les Assemblées du 20e siècle et majoritairement depuis les années 1970. Dès le départ, ce champ d’études a été très lié aux écrits consacrés aux retraits de la vie politique. Diane Kincaid Blair et Ann R. Henry sont les premières à aborder le sujet : elles affirment que les considérations familiales sont un facteur susceptible de jouer un rôle dans les décisions des élus de ne pas se représenter à leur succession. Elles parlent du family factor (Kincaid Blair, Henry, 1981) et montrent que si les problèmes familiaux ne sont pas l’unique raison d’un retrait de la vie politique (dans le sens où ils peuvent s’ajouter et s’imbriquer à d’autres sources d’insatisfaction du mandat politique), une majorité des retraits volontaires (ceux qui ne se sont pas représentés à leur succession) sont liés à des problèmes familiaux. Alors que les retraits de la vie politique faisaient l’objet de nombreux travaux (essentiellement les retraits du Congrès américain en réalité), le facteur familial avait été, jusqu’à cet article, de manière globale écarté à de rares exceptions près (Wahlke et al., 1962 ; Smith et Miller, 1977), à cause du recours quasi exclusif à des matériaux quantitatifs et au postulat selon lequel les contraintes familiales étaient beaucoup trop difficiles à objectiver (notamment à intégrer dans des modèles économiques, Moore et Hibbing, 1998).
Il n’en reste pas moins que les contraintes familiales apparaissent comme un coût du métier politique et qu’elles peuvent constituer une insatisfaction en mandat susceptible de jouer un rôle dans les décisions de retraits de la vie politique (Docherty, 2001 ; Fisher et Herrick, 2002 ; McKay, 2011 ; Heinsohn et Freitag, 2012 ; Roberts, 2017). La variable du genre se révèle rapidement déterminante dans ces enquêtes : si la difficile conciliation entre vie politique et vie familiale constitue un coût du métier politique et un facteur de retrait, cela est encore plus vrai pour les femmes que pour les hommes (Byrne et Theakston, 2015 ; Johansson Sevä et Öun, 2019 ; Joshi et Goehrung, 2021 ; Weber et al., 2024). Cette inégalité ne concerne pas seulement les fins de carrière. Ces inégalités de genre se reflètent au cours de la carrière puisque les Parlements sont dominés par une culture masculine du travail (consacrer ses soirées et week-ends au travail politique) ce qui ne va pas dans le sens de l’égalité des sexes (McKay, 2011 ; Palmieri, 2018) et se traduisant par des carrières politiques plus courtes pour les femmes que pour les hommes (Vanlangenakker et al., 2013). Si les hommes sont toujours favorisés par rapport aux femmes, d’autres facteurs entrent en considération : le fait d’être parents ou non, l’âge de l’élu, l’âge de ses enfants, l’accord et le degré d’investissement du conjoint dans la sphère domestique, et pour les parlementaires la distance entre sa circonscription et la capitale politique (Tremblay et Pelletier, 1995 ; Weinberg et al., 1999 ; Zagarri, 2013 ; Melanee et Bittner, 2017).
En France, le facteur familial a surtout été abordé du point de vue du genre : presque l’ensemble des enquêtes ont porté sur des trajectoires de femmes. La conciliation entre vie politique, professionnelle et familiale serait l’un des principaux motifs du non-engagement des femmes en politique ; l’inégale division du travail entre les sexes aboutit à la sous-représentation des femmes en politique (Achin et Lévêque, 2006). L’auto-éviction des femmes a surtout lieu en amont puisque les femmes n’ayant pas d’enfant ou ayant des enfants éduqués sont surreprésentées parmi celles qui s’engagent en politique et qui s’y maintiennent (Dulong et Matonti, 2007 ; Gris, 2021). L’articulation des temps professionnel, politique et domestique constitue une vraie difficulté lors de l’entrée dans la carrière politique (Della Sudda, 2009). Cette difficile conciliation des temps sociaux nécessite non seulement une redéfinition de la division du travail domestique au sein de la sphère privée, mais elle peut aboutir à des situations de tiraillements, voire de souffrance (Le Quentrec et Rieu, 2003 ; Le Quentrec, 2008). Il existe pourtant des différences : les jeunes élues en milieu de carrière professionnelle sont plus confrontées à des conflits de temporalités que les élues s’étant engagées au moment où débutait leur retraite professionnelle (Della Sudda, 2009). La difficile conciliation entre vie politique et vie familiale intervient surtout dans les choix de carrière des femmes politiques jusqu’à devenir un motif de retrait de la vie politique pour les moins professionnalisées d’entre elles ou pour celles qui ont des enfants en bas âge (Navarre, 2015). Ces travaux s’intéressent surtout à des élues en début de carrière, qui occupe généralement un mandat local et dont la professionnalisation n’est pas aboutie. Les autrices soulignent que les contraintes de l’exercice d’un mandat local semblent moins importantes que les mandats nationaux, et ils sont davantage compatibles avec l’emploi du temps de mères de famille (Achin et Lévêque, 2006 ; Della Sudda, 2009). Les professionnelles de la politique sont mentionnées en contraste : pour devenir « du métier », il faudrait ne plus être concernée par ces contraintes familiales (être à la retraite, ne pas avoir d’enfants, etc.).
À rebours sur la plupart des enquêtes traitant du facteur familial, la famille peut être envisagée comme un soutien (Beauvalet, 2019), un lieu de réconfort, un « cocon » protecteur pour l’élu (Gris, 2021). Selon cette perspective, les conjointes d’élus (ces derniers étant majoritairement des hommes) peuvent endosser différents rôles : aide dans la progression de carrière, soutien dans la défaite, rôle de figuration et de représentation, travail (non rémunéré) de conseillère voire d’auxiliaire politique et enfin gardienne de la maisonnée et de la préservation des temps conjugaux et familiaux (Gris, 2017 ; 2021). Puisque leur femme assure le travail domestique, les hommes peuvent s’engager pleinement en politique et y consacrer l’essentiel de leur temps (Le Quentrec, 2008). Dans un autre registre, les travaux menés sur les agendas politiques des élus (Marrel et Payre, 2006 ; 2018 ; Godmer et Marrel, 2014 ; 2015) distinguent trois principaux types de « temps » : le temps politique (dédié au mandat, au parti, à la représentation), le temps professionnel (lorsque l’élu travaille en sus de ses mandats) et le temps « privé » (temps de repos, temps personnel). Cette distinction est imparfaite, tant ces différents temps s’imbriquent en réalité.
Si les contraintes familiales constituent assurément un coût de l’engagement politique professionnel et peuvent jouer un rôle dans les hésitations au maintien, voire dans les décisions de retrait de la carrière politique, comment ces décisions interviennent-elles dans les trajectoires individuelles des acteurs et actrices politiques ? La famille intervient-elle uniquement comme une contrainte ou au contraire peut-on l’envisager aussi comme un soutien à l’élu ? Comment la famille influe-t-elle tout au long de la carrière politique et dans les choix opérés par les professionnels de la politique ? Cet article présentera successivement cinq parcours biographiques d’acteurs politiques et s’attachera à montrer, pour chacun d’eux, le rôle différent qu’a pu avoir la famille durant leur carrière politique ainsi que dans les choix qui s’offraient à eux.
Méthodologie
Cette enquête s’appuie sur notre travail de doctorat consacré aux retraits de la vie politique. Notre corpus de thèse porte sur les acteurs politiques ayant été députés (entre 1997 et 2017) et s’étant retirés de la vie politique avant la fin d’année 2021. Au total, 933 individus ont attiré notre attention et à partir desquels nous avons construit une typologie des retraits de la vie politique. Cette dernière comporte huit types de sortie. Il y a des retraits involontaires, c’est-à-dire la mort (6,8 %), la maladie (3,9 %), la vieillesse (22,9 %), la défaite (34,9 %), le discrédit des affaires (6,6 %), et des retraits apparemment volontaires, soit la nomination à un emploi public (3,2 %), la reconversion professionnelle (7,4 %) et la retraite (14,3 %). La difficile conciliation entre vie politique et vie familiale n’a pas été retenue en tant que l’un des huit types de retrait de la vie politique du fait que son caractère est difficilement objectivable. Elle est bien souvent mentionnée par les acteurs en entretien, ou dans l’annonce de leur retrait dans la presse. Ce volet quantitatif a été complété par la réalisation de 36 entretiens auprès d’acteurs ayant quitté la vie politique ou bien étant en fin de carrière (annonce de leur retrait) issue du corpus précité. Ces entretiens ne portaient pas spécifiquement sur le rôle de la famille dans la carrière des élus, mais sur le parcours biographique de l’élu avec un accent porté sur la décision de retrait de la vie politique. Il s’agit des réponses des enquêtés à une question relativement simple intervenant au cours de l’entretien : « Et qu’en était-il de votre vie familiale durant votre parcours politique ? ». Cette question a souvent été posée au moment où les enquêtés revenaient sur leur quotidien lorsqu’ils étaient élus.
Les carrières politiques de nos enquêtés et les décisions de retraits de la vie politique seront envisagées comme des bifurcations biographiques. Le cadre théorique utilisé dans cet article s’appuie sur la notion de carrière définie par la sociologie interactionniste (Hughes, 1996 ; Chapoulie, 2001). Développé par Everett Hughes, ce concept renvoie à « une suite de changements objectifs de positions et la série des remaniements subjectifs qui y sont associés » (Fillieule, 2009). Le concept revêt deux dimensions (Becker, 1985) : la première, qui est objective, entend la carrière comme « une série de statuts et d’emplois clairement définis, de suites typiques de positions, de réalisations, de responsabilités et même d’aventures » (à savoir ici, les différentes étapes des carrières professionnelles des acteurs, de leur engagement jusqu’à leurs « vies d’après ») ; et la seconde « faite de changements dans la perspective selon laquelle la personne perçoit son existence comme une totalité et interprète la signification de ses diverses caractéristiques et actions, ainsi que tout ce qui lui arrive »[1]. Chaque séquence de la carrière correspond à une dynamique spécifique qui conditionne la suivante.
Le concept de turning point a d’abord été énoncé par Hughes avant d’être retravaillé, en particulier par Andrew Abbott qui propose une définition plus aboutie (mais aussi plus objectivante) : « Des changements courts, ayant des conséquences, qui réorientent un processus. Le concept est inévitablement narratif, puisqu’un tournant ne peut être conçu sans que l’on puisse établir une nouvelle réalité ou une nouvelle direction, ce qui implique au moins deux observations séparées dans le temps. Tous les changements soudains ne sont pas des tournants, seulement ceux qui débouchent sur une période caractérisée par un nouveau régime » (Abbott, 2001). Il y a turning point lorsqu’il y a un changement de séquence biographique, et que l’entrée en professionnalisation politique ou la sortie des mandats en constitue un. Les trajectoires doivent donc être envisagées comme processuelles. La notion de bifurcation est centrale, parce qu’elle désigne des configurations dans lesquelles des événements contingents, des perturbations légères peuvent susciter des réorientations biographiques non négligeables dans les trajectoires individuelles (Bessin et al., 2009). L’intérêt pour ces moments de crise est déterminant pour la recherche puisque les moments de basculement se révèlent « des enjeux, des systèmes de contraintes et des logiques de choix qui resteraient invisibles dans le cours tranquille des choses. Dans ces moments-là également apparaissent la pluralité des mondes sociaux en coprésence, ainsi que les enjeux de positionnement et de recomposition des identités personnelles » (Bidart, 2006).
Jean-Pierre : le drame familial comme élément déclencheur du retrait de la vie politique
Préparateur en pharmacie, Jean-Pierre[2] s’engage d’abord comme président de l’association des commerçants de sa commune avant d’être approché pour les élections municipales. Il devient maire de sa commune de 15 000 habitants en 1989 et adhère au petit parti centriste : le Centre des démocrates sociaux. En 1993, il est sollicité par le député sortant pour prendre sa suite, mais demande un délai de réflexion. Il explique : « Il fallait que j’en parle à Josiane [sa femme]. On en a parlé, beaucoup. Mais elle ne m’a pas dissuadé donc voilà je suis parti comme candidat ». La prise de décision (se présenter à l’élection législative) est discutée au sein du couple et avalisée par la conjointe. Une nouvelle séquence biographique s’ouvre pour Jean-Pierre qui se consacre à ses mandats politiques à temps plein. Il quitte la pharmacie dans laquelle il continuait à travailler à temps partiel depuis son élection de maire et conquiert, en 1998, un mandat de conseiller régional. Conscient d’être un « gros cumulard » et qu’il « ne peut objectivement pas être partout », il ne se représente pas à la mairie en 2001 où il intronise un successeur. À l’Assemblée, il se spécialise sur les questions liées à la psychiatrie[3] et consacre sa carrière politique à cette cause ; il devient la référence sur ce sujet. Durant cette séquence, Jean-Pierre reconnaît qu’il était « aux abonnés absents » pour sa famille : « La politique, c’était 7 jours sur 7 et le temps ne vous appartient pas », précise-t-il. Durant cette période, il peut compter sur le soutien de Josiane ainsi que sur son travail domestique qui lui permet de se dédier entièrement à son activité politique.
Alors qu’il est âgé de 64 ans, son retrait de la vie politique est annoncé en 2011 dans la presse sans déclaration publique de sa part, ce qui est extrêmement rare. En entretien, Jean-Pierre justifie son retrait de la vie politique par sa conviction d’un nécessaire renouvellement du personnel politique et sa volonté de transmission. Il s’agit d’un entretien particulier puisque l’enquêté avait convié à ce déjeuner une de ses amies. Sans l’intervention de cette dernière, Jean-Pierre aurait très certainement tu l’événement qui semble avoir été essentiel dans la réévaluation des coûts de son engagement. Il raconte :
« J’ai fait quatre mandats, ce qui est déjà pas mal. Mais ce n’est pas possible d’en faire cinq, ce n’est pas normal. […] Après il n’y a plus rien à faire, on est dans une espèce de routine qui devient malsaine. Donc je me suis dit qu’il fallait laisser la place à d’autres, tout simplement. »
Son amie : « Est-ce que… J’interviens parce que, quand même… [blanc] tu avais mûri ta décision, mais… Est-ce que… moi j’ai eu en tous cas cette impression, que le décès de ta petite-fille, tu l’as reçu de plein fouet… »
Jean-Pierre : « Oh bah ça c’est un choc personnel ! »
Son amie : « Oui, mais quand même ce n’est pas la fin du déclencheur ? Parce que tu disais quand même, je ne suis jamais avec ma famille quand ils ont besoin de moi. Je m’en rappelle bien de cette phrase. »
Jean-Pierre : « Oui. Le député, il est souvent aux abonnés absents pour sa famille. Mais très souvent. Et moi j’ai dit, tu as raison de le dire, parce que ça a été l’un des arguments aussi dans ma décision. Je me suis dit, je suis passé à côté de mes enfants, je ne veux pas passer à côté de mes petits-enfants. Et l’élément déclencheur c’est le décès. Voilà. »
Il ne s’agit pas de dire que les premiers éléments énoncés par Jean-Pierre ne sont pas sincères ou réels, mais le décès de sa petite fille constitue assurément un turning point dans sa trajectoire. Cet événement lui fait réinterroger les rétributions de son engagement politique et lui fait prendre conscience que le fait de passer du temps auprès de sa famille est primordial dans le quotidien qu’il souhaite. Josiane a-t-elle joué un rôle dans cette décision ? Jean-Pierre ne décrit pas les choses ainsi, mais il reconnait qu’elle ne tolère désormais plus qu’il parte loin et longtemps :
« Forcément, maintenant, Josiane me dit : “Y’en a marre. À l’âge qu’on a, il faut qu’on vive la vie qu’on n’a pas vécue !” Donc quand je pars à Paris elle me dit : “Si tu y vas, tu pars le matin et tu rentres le soir. Parce qu’avant [quand il était député], c’était trop dur” ».
Dans la séquence biographique suivant son retrait de la vie politique, Jean-Pierre a rééquilibré ses temps sociaux. S’il continue de s’engager bénévolement dans de nombreuses associations en lien avec la psychiatrie, son engagement est moins chronophage que par le passé :
« Demain j’interviens à Agde puis après-demain à Marseille, c’est encore prenant. Mais désormais je pars avec Josiane, elle est avec moi. Et en remontant, on va passer faire un coucou à un couple de nos enfants qui est par là […] On rend à sa famille ce qu’on lui a pris en fait. On lui a pris du temps, on lui a pris tout un tas de choses, et il faut le rendre maintenant, et ça, je le fais. ».
Ainsi, son retrait de la vie politique et le temps qu’il consacre désormais à sa famille est presque énoncé comme la réponse à une forme de culpabilité : celle de s’être consacré à sa carrière politique au détriment de ses proches.
Le cas de Jean-Pierre témoigne, d’une part, du rôle central de la conjointe : dans le soutien à la décision de l’engagement, dans le travail domestique, mais aussi en partie dans la décision de retrait et dans le nouveau quotidien après la politique. D’autre part, l’événement biographique (le décès du petit-enfant) intervient de manière claire comme l’élément déclencheur du désengagement.
Margot : prendre sa retraite pour profiter de ses proches
Margot a commencé à militer suite à un projet de loi qui l’a mise hors d’elle : le service laïc et unifié de l’enseignement proposé par François Mitterrand. Cette mère de famille qui venait de donner naissance à son troisième enfant s’engage pour la première fois à l’âge de 30 ans et s’implique au sein de l’enseignement catholique de sa région. À cette période, elle occupe un poste de chargée des relations publiques pour la Chambre régionale de commerce. Elle utilise ses compétences professionnelles pour son engagement militant : « J’avais encore des cartes de visite dans la poche, un savoir-faire, et donc très rapidement je me suis mise au service du mouvement régional de résistance en tant que chargée des relations publiques ». Même si le projet de loi Savary est abandonné, Margot est repérée et recrutée d’abord pour représenter l’enseignement catholique au sein du Conseil économique et social régional, puis par le président de Région pour intégrer sa liste aux régionales de 1992 : « J’étais la seule femme en position éligible », précise-t-elle avec fierté. Elle adhère ensuite au Rassemblement pour la République (RPR, un parti de droite traditionnelle). Son premier mandat correspond à sa professionnalisation politique puisqu’elle se consacre désormais entièrement à la politique.
Margot se présente en 1995 comme tête de liste lors des municipales de sa commune de 4 000 habitants et est élue maire. En 1998, elle devient également vice-présidente de Région. Cette période se caractérise par son divorce (en 1995). Elle se souvient :
« Les années où j’étais toute seule, ça n’a quand même pas été facile. Évidemment, on ne peut pas compter sur les enfants pour être des confidents, mes filles étaient derrière moi, elles étaient très fières de la réussite de leur maman. Mais enfin… C’était compliqué. J’ai pensé tout arrêter à plusieurs reprises. Il fallait tout gérer en même temps, c’était lourd. […] Et je me sentais tellement seule ».
En 1999, elle rencontre un nouveau conjoint qui habite Paris et il l’encourage à se présenter à la députation en 2002 alors que la proposition lui a été faite par son parti ; elle est élue. Elle revient longuement sur le soutien moral qu’il lui a apporté :
« Lui, a accepté cette vie-là. […] Je n’aurai jamais pu affronter la campagne des législatives si j’étais restée seule. J’avais vraiment besoin d’avoir quelqu’un qui me détende le soir par sa simple présence. […] Et puis, comme j’étais députée, il avait la chance de me voir deux nuits dans la semaine [rires] ! Il essayait de venir un peu le week-end, mais il savait qu’il ne me verrait pas, car je n’avais pas de temps à lui accorder ».
Elle ne s’étend pas sur les raisons de son divorce, mais elle souligne que son nouveau compagnon « lui, a accepté cette vie-là », en sous-entendant que son engagement politique avait pu être un sujet de discorde dans son couple précédent. En revanche, elle revient longuement sur le soutien de son deuxième mari lorsqu’elle était parlementaire :
« J’avais trois salariés qui étaient en circonscription et je n’en avais pas à Paris. Donc ici il n’y avait personne sauf mon mari. Quand j’arrivais ici le mardi midi, il fallait qu’il imprime tout ce qui avait été tapé à la permanence, il y avait tous les courriers à signer, etc. Il donnait deux jours et demi par semaine de disponibilité diverse, gratuitement bien sûr. Il était en préretraite, il l’a fait naturellement, il trouvait ça… normal. […] Le conjoint il ne peut pas être en dehors, il est tellement impacté par la vie de l’élu, il est obligatoirement dans les rouages ».
Elle partage avec son conjoint le travail politique et son élection de députée favorise des moments passés ensemble pour le couple.
Durant cette séquence biographique de cumul des mandats assez intense (maire, députée et vice-présidente du Conseil régional), Margot regrette le temps qui lui manque, et notamment auprès de ses enfants, même si elle relativise a posteriori :
« Il y a certainement des conséquences négatives et puis il y en a des positives. Ma fille aînée suit aujourd’hui le chemin de sa mère, elle est devenue maire de sa commune, ça n’a donc pas dû la décourager. […] Mais c’est vrai qu’il a manqué des choses, surtout avec ma troisième fille, je n’ai pas partagé autant de choses qu’avec les deux autres et ça me manque maintenant. Il y a des conséquences sur la famille c’est certain ».
Cette citation illustre l’ambiguïté de la relecture des événements par Margot : d’un côté, elle conforte les choix qu’elle a effectué dans le passé en soulignant l’engagement politique de sa fille aînée et, de l’autre, elle concède une sorte de regret de son désengagement du foyer au profit de la politique. Il s’agit d’un mécanisme classique observé chez les femmes professionnelles de la politique (Gris, 2021), et plus généralement par les femmes menant une carrière professionnelle chronophage. Toujours durant cette séquence biographique, Margot exprime deux éléments qui lui ont manqué : « Parmi ce qui m’a privée, je dirais que durant toute cette période, je n’ai quasiment pas voyagé et aussi, je ne pouvais pas recevoir mes amis ». Elle est l’une des rares enquêtées à aborder le manque de temps pour les relations amicales. Elle revient sur la limite stricte qu’elle s’était fixée :
« Quand j’allais dîner chez des amis, j’arrivais à 20h, ils savaient qu’à 22h30 j’étais partie, quel que soit l’endroit de la soirée. Quelquefois, c’est l’été, il fait beau et on est quasiment encore à l’apéritif, quelquefois c’était en plein milieu du dîner. Mais si je disais oui, c’était à cette condition. Et aussi que moi je ne pouvais pas recevoir ».
Cette période de cumul des mandats connaît un coup d’arrêt en 2007, date à laquelle Margot est battue aux législatives. Elle ne se représente pas aux régionales en 2010. Depuis sa défaite à la députation, Margot va moins à Paris où réside son mari. Elle parvient néanmoins à se faire nommer comme personnalité associée au Conseil économique, social et environnemental (CESE) et fait des allers-retours entre la capitale et sa commune.
En 2012, Margot surprend tout le monde en démissionnant de son mandat de maire. Elle revient sur cette décision en entretien : « J’ai décidé d’abandonner la mairie, alors que j’adorais mon mandat, je le trouvais passionnant. […] Mais j’avais décidé que je ne ferais pas un quatrième mandat. La vie politique est trop accaparante, trop vorace. Il y un moment où il faut lâcher prise ». Pour expliquer son choix, elle ajoute :
« Maman était décédée, papa approchait des cent ans, il avait besoin quand même d’une présence. Et puis mes petits-enfants, j’en avais deux à l’époque, et j’en ai eu un troisième, je ne les voyais pas beaucoup. Enfin, mon mari était en retraite depuis longtemps et on ne pouvait pas voyager, parce que quand on a des mandats, c’est pas possible ».
Les considérations familiales sont surtout mises en avant : l’aspect chronophage de l’engagement politique, le rôle d’aidante auprès de son père et la volonté de se consacrer davantage à son rôle de grand-mère et d’épouse, ainsi que l’envie de voyager. Pour autant, Margot ne rompt pas brutalement son rythme d’élue, elle se fraye une transition en continuant son engagement au CESE qui lui laisse un minimum de temps libre tout en maintenant une activité qui l’intéresse. À côté de cela, elle s’investit au sein de l’association des anciens députés. Pour toutes ces raisons, elle réside plus souvent à Paris.
Dans sa nouvelle séquence biographique, Margot comble précisément les éléments qu’elle énonçait comme problématiques durant sa vie politique : elle voit davantage son conjoint, ses petits-enfants et elle voyage. Elle apprend l’italien afin de réaliser son rêve : louer un appartement pendant un mois, suffisamment grand pour accueillir ses enfants et petits-enfants. « Ce sont des choses que je ne pouvais pas faire quand j’étais maire. Ciao je m’en vais pendant un mois ! »
À propos de sa décision de quitter la vie politique, elle livre une analyse très stéréotypée des retraits de la vie politique selon le genre :
« J’ai vu des collègues qui ont fait la campagne électorale de trop et qui ont été battus. […] Ils prennent dix ans d’un coup, et ce sont surtout des hommes. J’en conclus que peut-être que pour les hommes c’est plus difficile parce qu’il n’y a pas la possibilité de se raccrocher à la vie quotidienne. Une femme, en général, elle aime sa maison, moi j’adore faire la cuisine, j’adore recevoir des amis, penser un peu à moi, me maquiller, enfin, il y a quelque chose de concret qui m’attend. […] Une femme, la vie politique l’a privée alors que ce n’est pas forcément le cas pour les hommes ».
Le schéma traditionnel de la femme assurant le travail domestique et y trouvant du plaisir est intériorisé par Margot, cela s’explique surtout par sa socialisation et son positionnement politique conservateur et très lié au catholicisme. Il n’en reste pas moins que les femmes quittent plus souvent volontairement leur mandat pour prendre leur retraite que les hommes. Parmi les députées élues entre 1997 et 2017, elles sont 18,3 % à être sortis pour ce motif contre 13,2 % des hommes. La plupart du temps, ces femmes justifient leur décision par la volonté de consacrer davantage de temps à leur famille. Elles évoquent aussi la nécessité du renouvellement en politique et revendiquent l’idée selon laquelle il faut savoir s’arrêter.
Olivier : quitter la vie politique pour voir grandir ses enfants
Il est un pur professionnel de la politique. Olivier fait des études de science politique dans un Institut d’Etudes Politiques (IEP) de province et réalise ensuite une thèse de doctorat. À 28 ans, il est mis en relation avec le maire d’une ville de 50 000 habitants en région parisienne qui l’embauche au sein de son cabinet. Cet homme devient littéralement son mentor. Il revient sur le moment où ce dernier lui propose de s’engager en politique :
« Il me dit : “Olivier est-ce que t’as envie de t’investir en politique ?” Évidemment quand il me pose la question il connaissait déjà ma réponse […]. Et donc je décide de sauter le pas, je déménage, à l’époque j’habitais Paris, je m’installe dans cette ville. Rien ne me retenait dans ma vie privée, donc je prends mes clics et mes claques ».
Lorsqu’Olivier prend cette décision, il est célibataire et ne rend de compte qu’à lui-même. Il prend alors sa carte au Parti socialiste (PS) et s’implique énormément au sein du parti et prend la tête de sa fédération.
En 2008, il entame à son tour une carrière élective en devenant conseiller municipal, puis adjoint au maire et conseiller communautaire. Durant cette séquence, il vit d’une part de ses mandats politiques et d’autre part de postes comme collaborateur d’élus. En 2012, il est élu député. Il démissionne donc de son mandat exécutif local et se consacre à temps plein à ses mandats nationaux (de parlementaire et au bureau national du PS). Sa situation familiale a également évolué puisqu’il a rencontré sa compagne au début des années 2000 et qu’il est jeune papa de deux enfants. Il déclare sans détour à ce propos :
« L’avantage, c’est qu’avec ma compagne, on s’est rencontrés au début de mon investissement en politique, et je lui ai toujours dit : Ce sera la politique et ensuite toi. Ce qui n’était pas très sympa d’ailleurs [rires]. Mais comme c’était un engagement extrêmement personnel, elle l’a supporté. Et dans les deux sens du terme, français et anglais ».
Olivier assume le fait que la politique est à cette époque la priorité dans sa vie, qu’elle passe devant sa compagne et sa vie de famille. De plus, la référence à la traduction anglaise de to support sous-tend un double rôle de sa conjointe : un rôle de soutien et d’encouragement. Dans le quotidien, Olivier explique s’être fixé des règles afin de conserver un minimum de temps auprès de sa famille :
« À un moment donné, ce n’est pas 35 heures, mais plutôt 80 heures par semaine. […] Donc la vie familiale elle en paye le prix, et en même temps on peut très bien s’organiser pour en limiter le prix. Depuis que je suis élu, ma règle était de ne jamais être pris plus de trois soirs par semaine. Bon, ça pouvait être quatre. Alors quand je dis être pris, c’est être pris après 21h30, évidemment vous ne rentrez pas à 19h, vous rentrez à 20h30-21h-21h30. […] Et le samedi soir, c’était pour moi et mes proches. Je disais non à 90 % des invitations parce que j’avais des enfants qui étaient en bas âge ».
Il est clair que le temps consacré à sa famille est relativement mince.
Pourtant, il prend la décision en 2016 de ne pas se représenter à sa succession, une décision énoncée comme un « choix de vie » et justifiée par la volonté d’accorder plus de temps à sa famille. Un turning point étonnant puisque jusqu’ici, la politique passait avant sa conjointe et ses enfants. Il revient sur cette décision :
« Ça m’est tombé dessus comme une évidence, parce que j’ai pris conscience que mes enfants auront donc à la fin de mon mandat 13 et 10 ans. […] Mais, si je repars et que je suis réélu, mes enfants auront 18 et 15 ans à la fin, et moi j’ai toujours avec ma compagne voulu, à un moment ou à un autre, vivre ailleurs. […] Ce que je sais c’est que je rentre dans une phase de ma vie où je n’ai plus envie de ça [de la politique]. Ça reviendra peut-être. Mais là les enfants ont un âge où il faut être à leurs côtés ».
Olivier ajoute même que cette décision n’est pas une décision du couple, mais bien sa décision personnelle : « Pour être très honnête, c’est même pas une discussion qu’on a eue à deux », précise-t-il. Il y a quelque chose de l’ordre de l’urgence à quitter la vie politique élective. Au moment où il annonce sa décision, Olivier n’a pas véritablement d’idée de sa reconversion professionnelle. Il sait simplement qu’il veut aller vivre dans le Pays basque avec sa famille : « J’ai des idées, des pistes, des hypothèses, mais pour l’instant je n’ai pas envie de me mettre la ratte au court-bouillon », déclare-t-il. Contrairement aux autres enquêtés cités dans cet article, la bifurcation d’Olivier est plus lourde de conséquences puisqu’il est le seul à ne pas avoir atteint l’âge de la retraite et que par conséquent, le retrait de la vie politique (et d’autant plus qu’il n’a quasiment toujours fait que cela) implique une reconversion professionnelle pour pouvoir continuer à gagner sa vie. Par la suite, il obtient une responsabilité au sein d’un think tank et est ensuite embauché comme enseignant en science politique.
Le cas d’Olivier est surprenant. La prise de conscience de la nécessité de privilégier sa famille au détriment de sa carrière politique est relativement brutale, et ce, alors même qu’il assumait l’inverse jusqu’ici. De plus, il semble tenir à distance l’influence de sa conjointe sur sa décision en répétant à plusieurs reprises qu’il s’agit de sa décision personnelle. L’âge de ses enfants (13 et 10 ans) est mobilisé plus précisément comme motif du retrait. Sur ce point, plusieurs de nos autres enquêtés abondent en ce sens : c’est à la période de la préadolescence et de l’adolescence des enfants que la conciliation vie familiale et vie politique est la plus compliquée. Une autre enquêtée raconte :
« C’est infiniment plus facile avec des enfants petits qu’avec des enfants adolescents. Avec des enfants petits, ils sont toujours dispos quand vous l’êtes. À partir de 13-14 ans, ça devient plus compliqué. Et j’ai eu des réflexions dures de ma fille aînée en particulier. […] Elle m’a dit un jour où je partais animer un débat, je les emmenais tous les quatre et je leur disais : “On est un peu pressés, parce que je pars animer un débat.” Elle avait 13 ans, elle me dit : “il est sur quoi le débat ?” Je lui dis : “il est sur les enfants en danger, il y a des enfants délinquants, des enfants en danger.” Et elle me répond : “Tu ne crois pas que c’est nous les enfants en danger ?” Donc il y a des formes de rappel parfois comme ça, parce que même si on trouve qu’on fait les choses très bien, et bien en fait pas forcément toujours très bien. » (Ancienne adjointe au maire et députée PS, âgée de 59 ans à son départ de la vie politique, et originellement universitaire, PS).
Hortense : la politique comme héritage familial
En entretien, les premiers mots d’Hortense pour revenir sur son parcours sont les suivants : « D’abord, je suis d’une famille politique ». Il faut le comprendre au premier sens du terme. Son père a été ambassadeur, député et ministre et sa mère députée, sénatrice et ministre. Son père est le fils d’un amiral et sa mère est issue de la noblesse. Hortense a elle aussi, par son mariage, un nom composé d’une particule. Aînée de huit enfants, elle va suivre les pas de ses parents en s’engageant en politique. Après une licence de sociologie, elle travaille quelques mois dans un service de ressources humaines, mais elle est embauchée, à 25 ans, comme assistante parlementaire de son père. Sa carrière politique élective débute à 31 ans. Elle est élue conseillère de Paris sous la même étiquette politique que ses parents : le parti gaulliste. Sa carrière va durer au total 35 ans. Hortense devient adjointe au maire de Paris, députée, ministre et maire d’arrondissement. Elle explique : « Et puis le temps a passé, et j’ai continué d’être une élue et j’ai adoré ce que j’ai fait ».
À propos de la conciliation entre vie politique et vie familiale, Hortense souligne la grande facilité que lui apporte le fait d’être une élue de Paris par rapport à ses collègues des territoires. Mariée (à un haut fonctionnaire, puis cadre dirigeant de grandes entreprises) et mère de quatre enfants, elle revient sur son quotidien lors de sa carrière politique très marquée par le cumul des mandats :
« Je partageais ma vie en deux. Le mardi, mercredi, jeudi, c’est l’Assemblée nationale, avec des réunions dans l’hémicycle et le travail en commissions. Mais j’étais élue de Paris, ce qui est un immense avantage parce que je suis à deux pas de ma famille, donc je rentrais dîner à la maison avec mon mari et les enfants c’était beaucoup plus facile ».
Le reste du temps était consacré à la fois à la circonscription et à la mairie : « le samedi, le dimanche, le lundi entre l’Hôtel de Ville et la permanence », poursuit-elle. Tout au long de l’entretien, Hortense ne retient de sa carrière politique que les bons côtés. Elle utilise le mot « incroyable » quatorze fois et « formidable » quinze fois. La vie familiale n’est perçue à aucun cas comme un poids ou une difficulté. Au contraire, interrogée sur d’éventuelles déceptions en politique, elle revient sur son limogeage du gouvernement, un moment difficile de sa carrière politique où elle a trouvé du réconfort auprès de sa famille :
« Les trahisons, il faut vraiment les encaisser. […] Mon éviction du gouvernement… […] Vous passez dans tous les bureaux, et vous voyez les gens qui pleurent, qui ne comprennent pas. Et vous dites : “Ce n’est pas grave, ce n’est pas votre boulot, vous avez bien travaillé, vous allez retrouver du travail et évidemment que si vous avez un problème vous m’appelez.” Mais maintenant il faut s’en aller, en quelques heures. En vous-même vous êtes déchirée. Et il ne faut rien montrer, évidemment. […] Et puis vous rentrez chez vous et là vous avez les enfants qui vous attendent, et votre mari et qui disent : “Tu sais quoi ? T’es la meilleure ! Alors on t’a préparé du Champagne, du saumon fumé, des huitres, parce qu’on sait que t’aimes ça.” Et vous avez une table qui vous attend, et que des choses que vous aimez, entourée que de gens que vous adorez, et là [elle souffle], vous vous effondrez ».
Le retour à la maison correspond ici à l’espace privé où Hortense trouve un soutien et un réconfort de ses proches, le lieu où l’expression des émotions est possible. Elle poursuit son récit en racontant le lendemain matin de cette soirée :
« Et le lendemain matin, vous vous réveillez, et là, vous prenez votre petite fille qui a quatre ans et demi, la dernière, et vous l’emmenez à l’école. Vous sortez dans la rue et là vous voyez votre chauffeur que vous avez depuis 23 ans, qui était en vacances, mais qui, ayant entendu les informations, est malgré tout venu vous emmener à l’école. […] Donc vous avez des grandes déceptions, et puis immédiatement après arrivent des grands bonheurs ».
Par cette anecdote, Hortense révèle une donnée importante de l’articulation de ses temps sociaux : le couple emploie du personnel de maison pour assurer le travail domestique et l’éducation des enfants.
La députée-maire justifie en partie son retrait de la vie politique par la volonté de passer davantage de temps en famille, même si elle explique « vouloir s’engager dans des projets bénévoles ». De plus, elle présente les retraits de la vie politique de ses parents comme une référence, un modèle qu’elle a voulu réitérer. Hortense précise :
« Quand je suis partie, je suis partie sans états d’âme, ce n’était pas je rejette la politique, pas du tout. J’avais cette peur du mandat de trop. […] D’autant plus que j’avais vu mes parents à l’exercice. Mon père a cherché à partir, il a préparé sa succession, il avait 60 ans. Et ma mère, à 65 ans, était sénatrice, ils sont venus la chercher pour lui dire de repartir, et elle a dit non ».
Hortense poursuit son engagement au sein de structures culturelles, ce qui lui permet d’être concrètement toujours occupée et d’activer ses réseaux politiques lorsque cela est nécessaire tout en profitant de son nouveau temps libre pour ses loisirs (elle s’est « mise au golf »), ses voyages et ses proches.
Si le retrait de la vie politique d’Hortense peut faire écho à celui de Margot dans le sens où les deux femmes motivent leur choix par la volonté de disposer davantage de temps pour leurs loisirs et leurs proches, la grande différence entre elles réside dans l’articulation des temps politiques et familiaux durant la carrière politique. Le fait d’habiter Paris permet à Hortense de s’éviter des trajets entre la capitale et la circonscription qui sont chronophages, épuisants et qui obligent à vivre plusieurs jours par semaine loin de sa famille. Son milieu social aisé et le recours à des employés de maison lui facilitent la conciliation de ses différents temps sociaux.
Jacques : l’engagement total comme crédo du couple
Pour Jacques, l’engagement associatif, syndical et politique va de soi : « D’abord, je viens d’une famille où la porte est ouverte. Les autres, je vis avec depuis que je suis petit. […] Donc quand on nait comme ça, on a facilement un engagement associatif ». Avant même d’évoquer son parcours professionnel, Jacques fait la liste de ses premiers engagements associatifs. Après mai 68, il s’engage à Emmaüs et ensuite chez les Compagnons bâtisseurs au milieu des années 1970. Il rencontre Mireille, son épouse, via son engagement associatif ; ils ont deux filles ensemble. En 1974, il se syndique à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) « parce que à l’époque on parlait de planification démocratique, d’appropriation sociale des moyens de production, d’autogestion, donc voilà », précise-t-il. Jacques travaille à cette période dans une grande entreprise du bâtiment avant de rejoindre le ministère de l’Équipement en tant qu’assistant technique de travaux publics d’État. Entre 1980 et 1989, il devient permanent syndical, un premier engagement très prenant en termes de temps : « J’étais sur une mission particulière qui consistait à développer une nouvelle fédération […] J’ai été neuf ans sur ce chantier qui concernait toute la côte ouest ». Jacques est souvent en déplacement et s’investit pleinement dans cette mission. Les mandats syndicaux étant de trois ans, il en effectue trois : « C’était un engagement limité dans le temps, et je m’étais dit que je ferais trois mandats maximums. D’ailleurs, même en politique, je me suis toujours dit que ce serait trois mandats maximums. Un mandat pour découvrir, un mandat pour faire et un mandat pour transmettre », résume-t-il.
En 1989, il reprend le travail au ministère de l’Équipement jusqu’à ce que la dissolution de l’Assemblée nationale de 1997 vienne bousculer ses plans. Il avait adhéré en 1984 au Parti socialiste après avoir longuement hésité (à cause de la séparation entre l’engagement politique et l’engagement syndical), mais l’engouement autour des assises du socialisme et son adhésion à la pensée de Michel Rocard le convainquent. Dans un premier temps, il ne prend pas de responsabilités au sein du parti. Lorsqu’il n’est plus permanent syndical, il s’engage davantage et devient en 1993 responsable de la fédération de son département. Il était surtout, depuis 1995, conseiller municipal d’opposition de la plus grande ville de son département (qui comptait 40 000 habitants). En 1997, il se porte candidat à la députation et fait son entrée au Palais Bourbon. Ce basculement vers la politique professionnelle ouvre une nouvelle séquence biographique pour Jacques.
À cette époque, il est l’un des rares députés à ne presque pas cumuler les mandats (il est seulement conseiller municipal d’opposition). Il revient sur son quotidien de parlementaire :
« C’est un engagement sept jours sur sept et voilà. C’est deux ou trois jours sur Paris et le reste du temps sur la circonscription et évidemment les week-ends à sillonner la circonscription. […] C’est quelque chose qui doit être porté familialement parce que sinon ce n’est pas la peine, sinon ce n’est pas possible ».
Pourtant, il insiste sur le fait que ce surengagement important au détriment de sa famille n’est pas quelque chose de nouveau. Il l’a déjà expérimenté lorsqu’il était permanent syndical :
« En réalité, je n’avais pas beaucoup de difficulté de ce point de vue là parce que quand j’étais permanent syndical, je partais avec ma 4L pour la semaine des fois, faire les ports, etc. Mes filles, quand elles étaient petites, mon épouse leur expliquait : “Si papa était marin, ou si papa était routier, ce serait pareil, vous n’allez pas vous plaindre. En plus il fait des choses qui l’intéressent donc voilà, il y en a d’autres qui n’ont pas cette chance” ».
La réplique peut paraître quelque peu virulente, mais c’est ainsi que l’on conçoit l’engagement chez Jacques et Mireille. Même si le député s’empresse de compléter ses propos : « Mais bon… Parfois quand on part le dimanche soir ou le lundi matin, les premières heures sont difficiles… On a facilement la tête qui tourne. Mais on a toujours vécu comme ça, c’est ça l’engagement ». Il ajoute que son revenu de député, plus confortable que ses revenus précédents, a permis de financer les études de ses filles. L’enchaînement dans le récit fonctionne ici comme si le financement des études venait éventuellement contrebalancer l’absence de leur père. Même sur ce point, Jacques se reprend :
« Ce qu’on a essayé de faire, c’est de faire en sorte que les moments passés ensemble soient les moments les plus riches possibles. Je me souviens de mes filles ados qui disaient : “Vous vouliez renverser la table, vous vouliez la changer la société, ah bah bravo ! Toutes vos réunions, tous vos trucs, tous vos machins là ! On vous voit jamais !” ».
Dès que Jacques parle de choix, il est intéressant de constater qu’il utilise le « on » qui désigne le couple qu’il forme avec Mireille. Le couple décide, ou bien (dans la bouche de sa fille), ce sont « les parents » qui sont absents ; Mireille étant, elle aussi, très engagée dans le secteur associatif. Peu de temps après avoir évoqué les reproches de sa fille, Jacques s’empresse pourtant de nuancer l’épisode en mentionnant (de la même manière que l’a fait Margot en mentionnant la carrière politique de sa fille aînée) la perpétuation du schéma familial chez ses enfants :
« Aujourd’hui, j’ai une fille qui est médecin et qui fait des consultations pour Médecins du monde. Mon autre fille, qui a fait Science Po et qui travaille à la Caisse des dépôts, elle est dans plusieurs associations, etc. Donc je ne dis rien, mais c’est du bonheur. Car quelque part on a bien dû transmettre des petites choses… ».
Les engagements de ses filles viennent ainsi valider en quelque sorte les choix opérés dans le passé, et notamment les absences liées à l’engagement politique.
En 2012, après avoir effectué trois mandats à l’Assemblée, et conformément à ce qu’il avait annoncé en 2007, Jacques ne se représente pas pour un quatrième mandat : il a 61 ans. Il l’explique avec humour : « Je ne suis pas Dalida, moi ! C’est un engagement que j’avais pris. […] Et puis, ce n’est pas un métier et ça ne doit pas le devenir. C’est comme permanent syndical, il faut l’être un temps, mais pas dans le temps ». Jacques ne peut pas dire explicitement que son choix de ne pas se représenter s’explique par la volonté de passer davantage de temps en famille. Justifier une décision par son intérêt personnel est tout simplement impensable dans la conception de l’engagement et du militantisme que le couple défend depuis de nombreuses années. Pour autant, la raison est éthique et partagée au sein du couple : il ne faut pas effectuer plus de trois mandats, il l’avait annoncé et il a défendu (tout au long de son combat syndical et politique) la nécessité du temps libre et du droit à la retraite à 60 ans qu’il ne brigue pas par un nouveau mandat. Sa décision est ainsi très politique (et rejoint celles d’autres élus de notre corpus, tous socialistes ou communistes, qui revendiquent de ne pas briguer des fonctions politiques au-delà de l’âge légal de la retraite pour lequel ils ont combattu).
De manière logique, la retraite de Jacques n’en est pas une. Il explique avoir croulé sous les sollicitations après son retrait de la vie politique :
« Ce que je n’ai pas géré, c’est la vitesse avec laquelle on m’est tombé dessus en me disant : “Écoute, tu peux bien venir là, mais t’inquiète pas, ce sera qu’un peu, on a bien compris.” Et donc là aujourd’hui, c’est Emmaüs, j’ai la présidence d’Emmaüs ici. J’ai hérité de la présidence d’un centre de soins psy et de rééducation qui est une gestion associative également que j’avais aidée comme parlementaire sur un dossier […] Un petit peu les gens du voyage parce que j’avais bossé sur ce dossier aussi. […] Et puis j’ai renoué un peu avec l’athlétisme, pour aider le club. J’ai repris une licence. Donc ça fait au moins quatre sujets qui remplissent mon agenda. […] Je suis convaincu qu’on se soigne dans l’engagement. […] Encore aujourd’hui, j’ai beaucoup trop d’engagements associatifs. […] Mais par ailleurs je ne sais pas vivre sans ça. J’ai besoin des autres. […] On n’est pas là pour counier comme on dit chez nous, counier c’est faire des petites choses, bricoler, etc. On est là pour donner le maximum de ce qu’on peut donner. Mais après c’est des choix de vie ! Des gens qui ont arrêté ont pu faire des tas de choses différentes, voyager ou je ne sais pas, aller dans un conseil d’administration avec des jetons de présence… Vous l’avez compris, ce n’est pas ma conception de l’engagement », conclut-il.
Il insiste surtout sur le fait que cette philosophie de l’engagement est partagée avec Mireille : « On a vécu ensemble plus de quarante ans maintenant en regardant dans le même sens sans avoir toujours le temps de se regarder l’un l’autre. C’est une formule qui est connue, mais c’est aussi ce qui permet de durer quelque part ».
Après la politique, Jacques reconnaît qu’il s’est adonné à des loisirs qu’il n’avait même pas imaginés jusqu’ici. Il raconte :
« Alors ce qui change, c’est que je viens d’aller cette année à la neige pour la première fois de ma vie ! […] Ça a été une semaine merveilleuse, les paysages étaient magnifiques, on y retournera c’est promis. […] Parce qu’accessoirement, je fais un peu de balisage pour la fédération randonnée, donc avec le groupe avec lequel on travaille on va aller en Corse cet été faire un peu de randonnée. Chose que je ne faisais pas. Passer un week-end chez nos enfants, les uns les autres, etc. Et se dire que le week-end ça peut aller jusqu’au lundi soir. […] On a la liberté de le faire, même avec des engagements associatifs, parce que bon on prévient qu’on ne sera pas là, chose que je me serais pas permis en étant élu, s’il y avait une réunion à tel endroit ou s’il y a une commission à l’Assemblée, j’y étais ».
La culture politique partisane joue ici un rôle, ou peut-être plus précisément, la conception que Jacques se fait de l’engagement, son éthique (ou plutôt leur éthique avec sa femme) est déterminante. La conjointe est vue comme l’archétype de la supportrice au nom des valeurs, qui assure le travail domestique et d’éducation des enfants, et qui a des engagements elle-même dans le secteur associatif.
Les retraits pour raisons familiales : un phénomène en progression
Les enquêtés ayant justifié leur retrait de la vie politique par des considérations familiales insistent sur la surprise qu’a constituée, pour leurs collègues, leur décision. Jean-Pierre raconte : « Ils étaient très surpris, personne ne comprenait vraiment ma décision. Enfin, à l’époque [il s’est retiré en 2011], ça surprenait, mais maintenant ça commence à venir un peu dans les mœurs. Mais un député qui abandonne c’était forcément qu’il est malade, ou qu’il a peur d’être battu. Or dans mon cas pas du tout ». Olivier a connu la même chose en 2017. Selon lui, le phénomène devrait se banaliser à l’avenir : « Beaucoup n’ont pas compris. Mais au fond, je pense qu’on aura de plus en plus des trajectoires comme ça, des gens qui viendront puis qui repartiront, et puis qui reviendront peut-être d’ailleurs, ou pas ». Ces retraits justifiés par des raisons personnelles sont, certes encore contenus, mais ils sont en constante augmentation sur notre période étudiée. De manière générale, les « retraits volontaires » à savoir les situations où l’acteur politique a démissionné ou ne s’est pas représenté à sa succession alors qu’il aurait objectivement pu continuer n’ont cessé de croître. Parmi les députés élus entre 1997 et 2017, on comptait 18 retraits apparemment volontaires entre 1997 et 2002, tandis qu’ils étaient 95 entre 2013 et 2017. Le modèle de la « carrière à vie » tend à s’effacer et laisse entrevoir un processus de banalisation et de normalisation du métier politique (Dalibert 2022 ; 2023 ; 2024). L’engagement politique ne se fait pas (ou plus) à n’importe quel prix, et en particulier au prix des sacrifices familiaux. En réalité, la difficile articulation entre temps personnel et temps professionnel n’est pas propre au métier politique (Flipo et Régnier-Loilier, 2003 ; Garner et al., 2004 ; Cette et al., 2005 ; Pailhé, 2009). Globalement, « les multiples mutations sociales liées à l’entrée massive des femmes sur le marché du travail, au développement des couples à deux carrières, à l’augmentation du nombre de divorces et de familles monoparentales et au vieillissement de la population rendent difficile la conciliation des vies professionnelle et personnelle » (Barel et Frémeaux, 2008). Au-delà du fait que ces difficultés se posent davantage qu’auparavant, le fait qu’elles soient énoncées comme motif du retrait ou bien comme ayant joué un rôle dans la décision de retrait, constitue un réel changement. À l’instar d’autres activités professionnelles, les bifurcations peuvent être motivées par des « choix de vie », parce que la politique tend à devenir une profession de plus en plus ordinaire qu’il est possible d’en changer et/ou de privilégier son épanouissement personnel et familial.
Conclusion
Si la difficile conciliation entre vie politique et vie familiale constitue l’une des caractéristiques du métier d’élu, les professionnels de la politique peuvent compter sur le soutien de leur famille pour assurer au mieux leur travail politique. Ces cinq cas permettent de dégager plusieurs enseignements. D’abord, la famille peut être un soutien pour l’élu en l’encourageant à l’engagement et au maintien en poste des acteurs politiques : un soutien dans le travail domestique pour que l’élu puisse s’engager pleinement en politique, un soutien moral, un soutien dans le travail politique en lui-même. L’espace familial est un endroit cloisonné où il est possible de se ressourcer et d’exprimer ses émotions. Ensuite, la famille peut jouer un rôle dans les doutes et la remise en cause de l’engagement, voire dans la décision de retrait de la vie politique. Par exemple, un événement biographique survient comme un « rappel à l’ordre » pour l’élu sur l’urgence de rééquilibrer ses temps sociaux. Le sentiment d’être trop absent pour ses proches et/ou la volonté de passer plus de temps avec les siens peuvent motiver des retraits de la vie politique. Le conjoint peut parfois pousser l’élu à se désengager afin de pouvoir le voir davantage (et estime avoir déjà assez donné). Pour autant, ces éléments ne comptent pas de la même manière à cause de différentes variables, dont le genre. En effet, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de quitter volontairement leur mandat pour des raisons familiales. Mais ce type de décision ne concerne plus uniquement les femmes puisque les hommes justifient de plus en plus leur retrait pour ces raisons. L’âge de l’élu, l’âge des enfants, le fait d’être en couple ou non, le milieu social d’origine et la culture politique partisane sont des variables qui pèsent dans l’appréhension des contraintes familiales et dans leur impact dans les choix de carrière des élus.
Enfin, si le surengagement au détriment de ses proches constitue l’une des caractéristiques du métier politique, cela ne signifie pas que cela lui est propre. D’autres professions ou engagements entraînent ce difficile équilibre des temps publics et privés : les militants associatifs, les chefs d’entreprise, les militaires ou les marins sont également des activités connaissant des désagréments similaires. La particularité tient davantage à la combinaison du surengagement avec le caractère public de la fonction (au fait d’être une personnalité publique). Le rapprochement avec d’autres activités est ici possible, soit avec les artistes (comédiens, chanteurs) ou encore avec les sportifs de haut niveau. « La spécificité du métier politique devrait être relativisée par une comparaison plus systématique à d’autres activités chronophages qui mêlent hautes responsabilités, environnement concurrentiel et fonctions de représentation » (Gris, 2021). Ces différents cas de figure éclairent la question de la stricte délimitation entre sphère publique et privée. Les temps de répétition, de tournages, de tournées et de promotion (pour les artistes), d’entraînement et de prise de parole publique (pour les sportifs), de préparation des dossiers et les contraintes de représentation (pour les acteurs politiques) sont autant d’activités difficilement classables entre sphère publique et privée.
Plutôt que d’être pensée en opposition à l’engagement public, la vie familiale, et plus largement la vie privée, joue un rôle à la fois en amont, pendant et en aval de la vie politique. Pour cette raison, les sphères privées et politiques doivent être envisagées comme flottantes, et parfois comme imbriquées. Les acteurs politiques composent entre l’une et l’autre sans que les deux soient toujours nettement dissociées.
Appendices
Notes
-
[1]
A savoir l’évolution personnelle des individus, leur réflexivité propre qui dépend de leur environnement, leur socialisation, leur système de valeurs, leur conception de leur rôle et des perspectives qui leur sont disponibles.
-
[2]
Le nom a été changé, comme tous les noms mentionnés dans cet article, afin de garantir l’anonymat des enquêtés.
-
[3]
Le thème a été changé afin de garantir l’anonymat de l’enquêté.
Bibliographie
- Abbott, A. 2001. Time Matters. On Theory and Method , Chicago, Presses universitaires de Chicago.
- Achin, C. et S. Lévêque. 2006. Femmes en politique, La Découverte, Paris.
- Barel, Y. et S. Frémeaux. 2008. « Faut-il sacrifier sa vie personnelle et celle de ses collaborateurs ? Le cas de la grande distribution », Humanisme et Entreprise, vol. 290, no. 5, p. 1-18.
- Beauvalet, S. (dir.) 2019. « Couples en politique : des guerres de religion à nos jours », Parlement[s], Revue d’histoire politique, vol.2, n° 14.
- Becker, H. 1985 [1963]. Outsiders , Paris, Metailié.
- Bessin, M., C. Bidart et M. Grossetti (dir.). 2009. Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte.
- Bidart, C. 2006. « Crises, décisions et temporalités : autour des bifurcations biographiques », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 120, no. 1.
- Byrne, C. et K. Theakston. 2015. « Leaving the House: The Experience of Former Members of Parliament Who Left the House of Commons in 2010 », Parliamentary Affairs , vol. 69, no 3.
- Cette, G., N. Dromel et D. Méda. 2005. « Conciliation entre vies professionnelle et familiale et renoncements à l’enfant », Revue de l’OFCE, vol. 92, no. 1, p. 263-313.
- Chapoulie, J-M. 2001. La tradition sociologique de Chicago 1882-1961, Paris, Seuil.
- Dalibert, L. 2022. Les retraits de la vie politique. Un regard décalé sur la professionnalisation de la vie politique, thèse de doctorat en science politique, Nantes, Université de Nantes.
- Dalibert, L. 2023. « Le temps libre des élu•es : un révélateur des rétributions du métier politique », Mouvements, vol. 114, no. 2, p. 149-161.
- Dalibert, L. 2024. « Les retraits volontaires du métier politique, vers une normalisation du métier d’élu ? », dans Des élus déclassés ?, sous la dir. de D. Demazière et R. Lefebvre, Paris, La Vie des idées.
- Docherty, DC. 2001. « To run or not to run? A survey of former members of the parliament of Canada », Canadian Parliamentary Review, no 24, p. 16-23.
- Della Sudda, M. 2009. “Temporalités à l’épreuve de la parité. Parité et temporalités professionnelle, familiale et politique chez les élues d’une ville moyenne (2001-2002) », Temporalités, no 9.
- Dulong, D. et F. Matonti. 2007. « Comment devenir un(e) professionnel(le) de la politique ? L’apprentissage des rôles au conseil régional d’Île-de-France », Sociétés et représentations, no 24, p. 251-267.
- Fillieule, O. 2009. « Désengagement », dans Dictionnaire des mouvements sociaux, sous la dir. de O. Fillieule, Paris, Presses de Sciences Po, p. 180-188.
- Fisher, SH. et R. Herrick. 2002. « Whistle while you work: job satisfaction and retirement from the U.S. house », Legislative Studies Quarterly , vol. 27, no 3, p. 445-457.
- Flipo A. et A. Régnier-Loilier. 2003. « Articuler vie familiale et vie professionnelle en France : un choix complexe », Insee, Données sociales.
- Garner, H., D. Méda et C. Senik. 2004. « La difficile conciliation entre vie professionnelle et vie familiale », Premières Synthèses, no 50.3.
- Godmer L. et G. Marrel. 2014. « La production de l’agenda. Comment se fabrique l’emploi du temps d’une vice-présidente de conseil régional », dans Les mondes du travail politique. Les élus et leurs entourages, sous la dir. de D. Demazière et P. Le Lidec, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Res Publica », p. 37-52.
- Godmer L. et G. Marrel. 2015. La politique au quotidien. L’agenda et l’emploi du temps d’une femme politique, Lyon, ENS Éditions, coll. « Gouvernement en question(s) ».
- Gris, C. 2017. « Devenir un membre public de l’entourage politique : le rôle de figuration des conjointes d’élus en situation de représentation », dans Dans l’ombre des élus. Une sociologie des collaborateurs politiques, sous la dir. de W. Beauvallet et S. Michon, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 31-51.
- Gris, C. 2021. Femmes d’élus. Sociologie d’un second rôle, Lormont, Le Bord de l’Eau.
- Heinsohn T. et M. Freitag. 2012. « Institutional foundations of legislative turnover: a comparative analysis of the Swiss Cantons », Swiss Political Science Review, no . 18, p. 352–370.
- Johansson Sevä, I. et I. Öun. 2019. « Conditional Representation: Gendered Experiences of Combining Work and Family among Local Politicians », Journal of Women, Politics & Policy , vol. 40, no 3, p. 367–384.
- Joshi, DK. et R. Goehrung. 2021. « Mothers and Fathers in Parliament: MP parental status and family gaps from a global perspective », Parliamentary Affairs , vol. 74, no 2, p. 296-313.
- Kincaid Blair, D. et R. Henry Ann. 1981. « The Family Factor in State Legislative Turnover », Legislative Studies Quarterly , vol. 6, no. 1, p. 55-68.
- Le Quentrec, Y. et A. Rieu. 2003. Femmes : Engagements publics et vie privée, Paris, Syllepse, coll. « Nouvelles questions féministes ».
- Le Quentrec, Y. 2008 « Femmes publiques et princes consorts : histoires de recompositions conjugales », Enfances Familles Générations, no 9.
- Marrel, G. et R. Payre. 2006. « Temporalités électorales et temporalités décisionnelles. Du rapport au temps des élus à une sociologie des leaderships spatio-temporels », Pôle Sud, no 25, p. 71-88.
- Marrel, G. et R. Payre (dir.). 2018. Temporalité(s) politique(s) : Le temps dans l’action politique collective, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur.
- McKay, J. 2011. « Having it All? Women MPs and Motherhood in Germany and the UK », Parliamentary Affairs , vol. 64, no 4, p. 714-736.
- Melanee, T. et A. Bittner. 2017. « The ‘mommy problem’? Gender, parental status, and politics », dans Mothers and Others: The Role of Parenthood in Politics , sous la dir. de T. M Bittner A, Vancouver, UBC Press, p. 3-22.
- Moore, M. et J. Hibbing. 1998. « Situational Disatisfaction in Congress: Explaining Voluntary Departures », The Journal of Politics , p. 1088-1107.
- Navarre, M. 2015. « De la professionnalisation au désengagement : les bifurcations dans les carrières politiques des élues en France », Politique et Sociétés, vol. 33, no 3, p. 79–100.
- Pailhé, A. (dir.). 2009. Entre famille et travail. Des arrangements de couple aux pratiques des employeurs, Paris, La Découverte.
- Palmieri, S. 2018. « Gender-sensitive parliaments », dans Oxford Research Encyclopedia: Politics, sous la dir. de W. R. Thompson, Oxford, Oxford University Press.
- Roberts, J. 2017. Losing Political Office , London, Palgrave Macmillan.
- Smith, R. E. et W. Miller Lawrence. 1977. « Leaving the Legislature: Why Do They Go? », Public Service , no 4, p. 6-8.
- Tremblay, M. et R. Pelletier. 1995. Que font-elles en politique ?, Sainte-Foy, Presses de l’Université de Laval.
- Vanlangenakker, I., B. Wauters et B. Maddens. 2013. « Pushed toward the exit? How female MPs leave parliament », Politics and Gender , vol. 9, no 1, p61–75.
- Wahlke, J. C., H. Eulau, W. Buchanan et C. Ferguson LeRoy. 1962 The Legislative System: Explanations in Legislative Behavior , New York, John Wiley & Sons.
- Weber, A., M-A. Bodet, F. Gélineau et A. Blais. 2024. « An election too far: Why do MPs leave politics before an election? », Party Politics, vol. 30, no 3, p. 493-504.
- Weinberg, A., CL. Cooper, et A. Weinberg. 1999. « Workload, stress and family life in British members of parliament and the psychological impact of reforms to their working hours », Stress Medicine , no 15, p. 79–87.
- Zagarri, R. 2013. « The Family Factor: Congressmen, Turnover, and the Burden of Public Service in the Early American Republic », Journal of the Early Republic , vol. 33, no 2, p. 283-316.