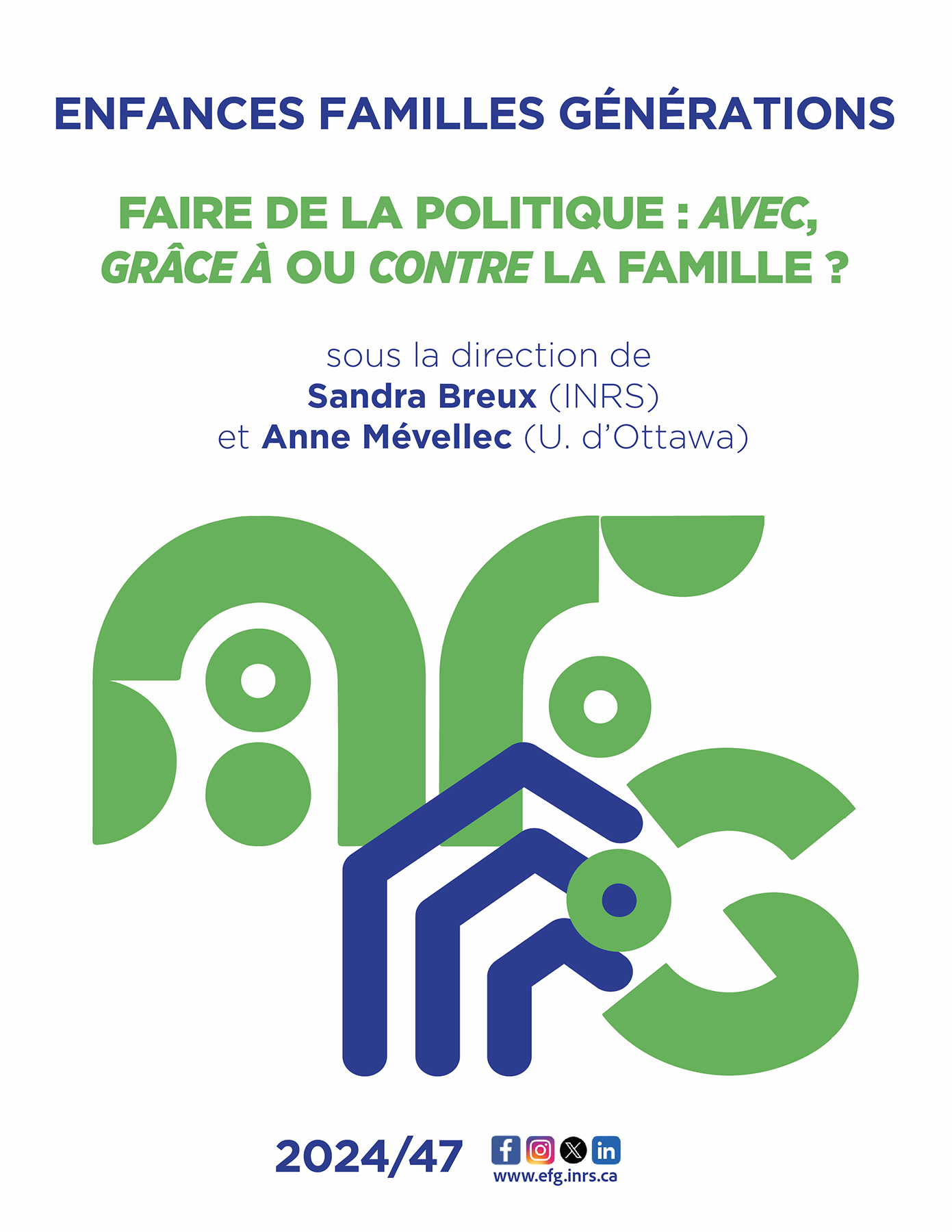Abstracts
Résumé
Cadre de recherche : Les relations entre famille et politique se caractérisent par leur diversité. Cette variété tire son origine tant des évolutions de la notion de famille que de l’étendue contemporaine des formes et types d’engagement politique.
Objectifs : Le présent numéro participe à documenter les configurations diverses que prennent les liens entre la famille et le politique.
Méthodologie : Les contributions du numéro se basent sur des démarches qualitatives, permettant une analyse fine des interractions parfois complexes entre famille et politique.
Résultats : La famille apparait être toujours une variable pertinente dans l’analyse de l’engagement politique. Si l’engagement peut se faire contre l’avis de la famille, la famille peut également être l’objet de l’engagement. De plus, si les liens entre famille et politique peuvent être pluriels, ils dépendent aussi de la nature de la transmission politique qui se réalise au sein du cercle familial.
Conclusions : L’ensemble des contributions de ce numéro met en évidence que le couple famille et politique ne peut faire l’économie d’une réflexion sur les intrications entre la sphère publique et la sphère privée.
Contribution : En questionnant de nouveau les liens entre famille et politique, le présent numéro poursuit les réflexions antérieures, tout en invitant à discuter tant les rapports de genre, l’importance des affects que la place de l’intime dans ces relations.
Mots-clés :
- famille,
- politiques,
- genre,
- transmission,
- hérédité,
- émotion,
- intimité
Abstract
Research framework: The relations between family and politics are characterized by their diversity. This variety stems as much from changes in the notion of family as from the contemporary range of forms and types of political commitment.
Objectives: This issue seeks to document the various forms taken by the relationship between family and politics.
Methodology: The papers in this issue are based on qualitative approaches, enabling a detailed analysis of the often complex interplay between family and politics.
Results: The family still appears to be a relevant variable in the analysis of political commitment. While political involvement can take place against the family's wishes, the family can also be the cause of the involvement. Moreover, while the links between family and politics may be plural, they also depend on the nature of the political transmission that takes place within the family circle.
Conclusions: The contributions in this issue highlight the fact that the family/political pair cannot do without a reflection on the intertwining of the public and private spheres.
Contribution: By re-examining the links between family and politics, this issue builds on previous reflections, while inviting us to discuss gender relations, the importance of affects and the place of intimacy in these relationships.
Keywords:
- family,
- politics,
- gender,
- transmission,
- heredity,
- emotion,
- intimacy
Resumen
Marco de la investigación: Las relaciones entre la familia y la política se caracterizan por su diversidad. Dicha diversidad deriva tanto de los cambios en el concepto de familia como de la variedad contemporánea de formas y tipos de implicación política.
Objetivos: Este número propone documentar las diversas formas en que se están configurando los vínculos entre la familia y la política.
Metodología: Las contribuciones de este número se basan en enfoques cualitativos, lo que permite un análisis detallado de la interacción, a veces compleja, entre familia y política.
Resultados: La familia sigue siendo una variable relevante en el análisis del compromiso político. Si bien la implicación política puede ir en contra de los deseos de la familia, esta también puede ser la causa de dicha implicación. Además, aunque los vínculos entre familia y política pueden ser plurales, también dependen de la naturaleza de la transmisión política que tiene lugar dentro del círculo familiar.
Conclusiones: Las contribuciones de este número destacan que el binomio familia/política no puede prescindir de una reflexión sobre la interconexión entre las esferas pública y privada.
Contribución: Al reexaminar los vínculos entre familia y política, este número se basa en reflexiones previas, al mismo tiempo que nos invita a debatir sobre las relaciones de género, la importancia de los afectos y el lugar de la intimidad en dichas relaciones.
Palabras clave:
- familia,
- políticas,
- género,
- transmisión,
- herencia,
- emoción,
- íntimo
Article body
Si elles ont été longuement étudiées depuis plusieurs décennies, et ce, dans des contextes géographiques variés, les relations entre famille et politique font figure de boite noire. Cette situation s’explique tant par le fait que « la famille est une réalité en mouvement » (Wieviorka, 2018) – qui peut prendre différentes formes selon les sociétés (Tournier, 2010) – que par l’étendue et l’évolution des activités politiques. Ainsi, si famille et politique sont liées, l’élasticité de la définition de ces termes rend difficile l’écriture de conclusions généralisables et définitives (Tournier, 2010).
Cette difficulté tient également à la nature des relations potentielles entre famille et politique. En science politique, dès le milieu du vingtième siècle, de premiers écrits se sont d’abord intéressés au comportement électoral et à l’influence éventuelle de la famille pour faire du choix idéologique un potentiel « legs ». Les grands courants explicatifs du comportement électoral (école de Michigan, choix rationnels, etc.; Mayer, 2007) ont ainsi été mobilisés pour saisir, déconstruire ou démystifier le rôle éventuel de la famille dans la détermination des orientations politiques (Smets et van Ham, 2013), ce que d’autres nomment l’« hérédité politique » (Offerlé, 1993). De l’acte de voter au choix politique, l’influence de la famille est visible (Bhatti et Hansen, 2012; Gidengil, O’Neill, et Young, 2010; De Landtsheer et al ., 2018; Jennings, Stoker, et Bowers, 2009). Considérée comme le lieu primaire de la socialisation politique, l’influence de la famille reste pourtant difficile à appréhender : au sein de la famille, « qui transmet », « que transmet-on ? » et « à qui » (Gotman, 2006) ?
Les travaux contemporains ont montré qu’au sein de la famille, la transmission politique – lorsqu’elle est présente –, quelle que soit sa nature, n’échappe pas aux logiques genrées : hommes et femmes, en fonction des contextes, ne transmettent pas ou n’héritent pas de la même façon (Marneur, 2016; Mévellec et Tremblay, 2016). En outre, certains travaux proposent d’explorer la transmission, comme une interaction sociale, ayant lieu non seulement dans l’ordre descendant, c’est-à-dire des parents vers les enfants, mais également dans l’ordre inverse, lorsque les enfants sont eux-mêmes à l’origine des discussions politiques au sein de la famille (McDevitt et Chaffee, 2002). De même, que transmet-on ? Pour certains, la transmission touche les attitudes politiques et les comportements : une partie de cet héritage serait génétique (Alford, Funk, et Hibbing, 2005). D’autres considèrent que la famille – en tant que lieu de socialisation politique – vient nourrir l’ambition politique (Oskarsson, Dawes, et Lindgren, 2018) : si un parent a été candidat, les probabilités que les enfants le deviennent sont plus élevées. Toutefois la causalité n’est pas toujours simple à confirmer. Ainsi, lorsqu’on observe de jeunes militants de partis politiques, leur ambition électorale ne semble plus vraiment être influencée par leur socialisation politique familiale (Ammassari, McDonnel et Valbruzzi, 2023). Néanmoins, selon van Liefferinge et Steyvers (2009), les maires qui ont été élevés dans des familles très politisées commencent souvent leurs carrières plus jeunes. La présence d’une mère politiquement active peut également structurer l’engagement futur des enfants (Oskarsson, Dawes, et Lindgren, 2018; Lawless et Fox, 2005). Héritage et transmission opèrent cependant dans des contextes institutionnels et spatiaux-temporels précis.
En effet, si l’hérédité cadre mal avec les principes de la démocratie égalitaire et qu’il faut dépasser l’analyse par les régimes politiques (Brossier et Dorronsoro, 2016), tant le couple « famille et politique » transcende ceux-ci, les caractéristiques institutionnelles peuvent cependant favoriser l’hérédité dite « élective », c’est-à-dire la transmission de mandats électifs au sein d’une même famille. Cela peut se faire de génération en génération (Patriat, 1992; Offerlé, 1993) ou de façon moins systématique, au sein de mêmes grandes familles politiques dans une logique plus lignagère que dynastique (Jaffrelot, 2006). Certaines caractéristiques du système institutionnel tendent ainsi à favoriser la transmission de mandats : les systèmes peu concurrentiels et centrés sur les candidat·e·s (Fiva et Smith 2018). De telles configurations favoriseraient la transmission, cette fois-ci d’un « avantage », défini comme « une prime au sortant » qui transiterait par la transmission d’un patronyme (Dal Bó, Dal Bó, et Snyder, 2009). D’autres soulignent que le patronyme peut aussi être érigé en défense du territoire et de ses qualités (Marmont, 2010; Broutelle, 2011). Cet exemple invite aussi à considérer la famille « comme […] un médiateur essentiel de la mémoire collective » (Broutelle, 2011). L’influence de la famille peut aussi être plus informelle et se réaliser grâce à des capitaux symbolique, social et un patrimoine particulier (Kenawas, 2015). Si les membres d’une même famille tendent à obtenir des scores supérieurs à leurs concurrents aux élections, cela crée ce que certains appellent des « dynasties politiques » (van Coppenolle, 2017). Quels que soient les contextes, les études soulignent la nécessité d’opter pour une définition large de la famille pour englober l’hétérogénéité des formes de la famille contemporaine et de ses influences.
Si cette prise en compte d’une conception élargie de la famille fait consensus, les travaux n’ont pas encore épuisé, à notre sens, l’ampleur des dimensions de l’évolution du métier politique, mais aussi de la participation politique. À l’heure où le congé de maternité de Jacinda Ardern, Première Ministre Néo-Zélandaise et son choix de siéger avec son bébé à l’ONU ont fait les manchettes, la famille constitue-t-elle un frein ou un tremplin à l’exercice du mandat politique ? Avoir une famille et être engagé·e politiquement sont-ils deux choix compatibles ? La conciliation travail-famille-engagement politique constitue-t-elle un enjeu ? Y a-t-il des répercussions sur l’avancement en carrière, en tenant compte du genre (Navarre, 2015) ? Les politiques publiques qui cherchent à favoriser la présence des femmes en politique active permettent-elles de neutraliser les pesanteurs familiales ? Sur quels soutiens familiaux ces élu·e·s peuvent-ils ou peuvent-elles compter pour mener à bien leurs différentes activités (Pini et McDonald, 2004) ? Inversement il est possible de penser que des élu·e·s plus âgé·e·s puissent aussi être engagé·e·s dans des relations d’aide intra-familiales. Cela influence-t-il leurs carrières politiques ? De plus, alors que les formes traditionnelles d’adhésion à des partis politiques et l’exercice du droit de vote sont plutôt en déclin, d’autres formes d’engagement politique se déploient (Ogien et Laugier, 2014). Comment la famille est-elle susceptible d’exercer une influence sur ces autres formes d’engagement ?
Par ailleurs, selon Broutelle (2011 : 35), « […] la famille transmet une certaine lecture de l’Histoire en fonction du système de représentations sociopolitiques qui lui est propre, ou du rôle joué par ses membres au cours de certains évènements, qui rend ces derniers plus ou moins pensables et leur confère une interprétation particulière ». Comment cette mémoire affecte-t-elle les engagements politiques ? Quels types d’engagements sont concernés ? Les « héritier·ère·s » reproduisent-ils les schémas précédents à l’identique ? Comment les membres d’une même famille se démarquent-ils face au « patrimoine » reçu ? Les cinq articles de ce numéro thématique abordent d’une façon ou d’une autre ces questionnements, en se focalisant tantôt sur les configurations diverses que prennent les liens entre la famille et la politique, tantôt sur la transmission d’un capital symbolique et émotionnel.
Des configurations à géométrie variable
Si les modes de socialisation infrafamiliaux conduisent certains individus à embrasser la carrière politique (Tournier 2009; Garraud 1992) et si la famille contemporaine réfère à des réalités variées, cette dernière semble toujours influencer fortement l’engagement politique traditionnel (Lacroix et Lardeux, 2022). La première partie de ce numéro thématique prend au sérieux cette idée en la traitant toutefois sous deux angles différents. D’une part, et même si la socialisation familiale est importante, il arrive que l’engagement en politique se fasse contre l’avis de sa famille et plus précisément de son conjoint. Il est possible, d’autre part, de s’engager pour sa famille : la famille devenant l’objet de l’engagement.
Ainsi, la contribution de Louise Dalibert met en évidence la façon dont la famille s’impose comme une variable importante dans les trajectoires d’engagement politique. À partir de 36 entretiens menés auprès d’élus ayant quitté la vie politique ou étant sur le point de le faire, et la mise en récit de cinq parcours biographiques, cet article répond à l’interrogation suivante : « comment la famille influe-t-elle tout au long de la carrière politique et dans les choix opérés par les professionnels de la politique ? » L’analyse invite à considérer la perméabilité et l’imbrication des sphères privées et politiques et à faire en sorte que la « vie privée » des élus ne soit pas un angle mort de la recherche.
Les auteurs Taladi Narcisse Tonli et Issa Ouattara rappellent dans l’article présenté dans ce numéro l’importance de la vie privée dans le cas des femmes burkinabé, soulignant l’influence de la famille dans leur engagement en politique et les différentes formes qu’il peut prendre selon les contextes. Les auteurs écrivent ainsi : « Les femmes politiques burkinabé sont écartelées entre l’entre soi masculin en politique, dans la famille et les représentations socioculturelles à caractère sexiste ». Cette réalité amène ces femmes à élaborer des stratégies et des logiques différentes pour accéder à cet engagement politique. Dans un contexte où la famille se révèle à la fois une ressource et une contrainte forte, les femmes doivent faire preuve, selon les mots des autrices, de « résilience ».
Adoptant une tout autre perspective, Manon Laurent nous amène à envisager l’importance de la famille comme objet de l’engagement. Dans son article, elle analyse la participation, en Chine, de parents à des groupes de discussion en ligne, le suivi des actualités éducatives et la surveillance des activités éducatives de leurs enfants. Si l’engagement se réalise initialement pour les enfants de la famille, il conduit parfois également des parents à développer une vision plus critique de la société et des politiques éducatives qui s’imposent à eux. Plus précisément, l’autrice montre que l’engagement parental participe à développer une conscience de classe qui prend un sens politique important dans le contexte du régime chinois.
Des transmissions sous réserve
L’importance de la famille ne dépend pas seulement des configurations dans lesquelles se trouvent celles et ceux qui s’impliquent en politique, mais également de la manière dont la transmission (l’hérédité) se manifeste. Si elle peut prendre la forme traditionnelle du passage, en ligne directe, d’un patrimoine ou d’un capital symbolique, elle se manifeste aussi avec plus de nuances, soit dans les chemins qu’elle emprunte, soit dans les contenus qu’elle véhicule et les effets qu’elle produit.
Dans cette deuxième partie, la première contribution plonge le lectorat dans l’univers plus classique de la transmission de l’hérédité élective ou du moins une des formes les plus connues : celle où le patronyme est associé à une classe sociale. La position sur l’échelle sociale détermine l’avenir des membres de la famille, dans ce cas-ci des hommes. En effet, la contribution de David Stefanelly, analyse la façon dont Paul de Dieuleveut entre en politique et s’engage naturellement dans le mouvement légitimiste de la France du dix-neuvième siècle. Cet engagement « naturel » se réalise grâce à sa famille, qui lui offre tant un patronyme qu’un patrimoine. Examinant la façon dont Paul de Dieuleveut fait fructifier ce capital symbolique et financier familial, l’auteur souligne cependant que « les antécédents familiaux ne sont donc pas toujours déterminants et la dimension personnelle est un critère à prendre en compte », rappelant les conclusions des travaux présentés plus haut.
La contribution de Jeanne Toutous rappelle quant à elle le fait que la famille constitue la pierre angulaire du militantisme, ici linguistique, qu’il soit mis à distance ou non. La famille fait figure d’instance de socialisation première. La contribution rappelle toutefois que la filiation militante n’est pas restreinte aux parents mais peut sauter des générations, démontrant la nécessité d’opter pour une définition élargie de la famille, et d’envisager la puissance fictionnelle, voire mythique, de l’entité famille. Travailler sur la transmission linguistique invite ainsi à explorer les formes de socialisation politique familiale à travers différentes trajectoires militantes qui dépassent l’idée de transmission linéaire.
Cette image de la famille comme autorité symbolique et émotionnelle est également visible au sein de la dernière contribution, témoignant comme le souligne Catherine Leclercq des dimensions affectives des transmissions. À partir d’entretiens biographiques d’une militante communiste, l’autrice retrace son engagement, et son désengagement, à travers une histoire familiale, sociale et politique, inscrivant ce parcours individuel « dans la socio-histoire des partis politiques et des affects ». Ces derniers se manifestent dans la figure d’un père omniprésent, tant dans la sphère de l’intime que celle du politique et marquent de façon indélébile son rapport au parti.
S’il y a bien un point commun à l’ensemble des contributions de ce numéro, c’est l’intrication entre la sphère publique et privée que crée le couple « famille et politique ». Alors que la famille renvoie à l’espace privé et la politique à l’espace public (Martin et Commaille, 2001), tant le vocabulaire politique emprunte à la famille (succession, héritage pour n’en citer que quelques-uns (Offerlé, 1993) que l’usage des métaphores familiales pour décrire le rôle des autorités publiques (Lenoir, 1998) invitent à creuser davantage ces relations sous l’angle de l’intime. Ainsi, si la famille n’est pas un thème nouveau dans les travaux sur la socialisation et l’engagement politique, elle trouve néanmoins pleinement sa place dans les questionnements les plus récents qui animent ce champ de recherche en science politique. D’une part, elle permet de (ré)interroger des rapports de genre (Bargel, 2013; Dutoya, 2016) qui s’imposent aux activités politiques (de la primo-socialisation à l’exercice des mandats, en passant par l’engagement et l’ambition électorale). Elle invite, d’autre part, à engager la discussion avec les celles et ceux qui s’inscrivent dans le tournant émotionnel (Filleul, Leclerc, Lefebvre, 2022; Faure, 2016). En effet, au terme de ce numéro, il est évident que l’entrée par la famille invite à penser le politique à travers l’intime, sans réifier à priori la distinction entre le « privé » et le « public ».
Appendices
Bibliographie
- Alford, J. R., C. L. Funk et J. R. Hibbing. 2005. « Are Political Orientations Genetically Transmitted? », American Political Science Review , vol. 99, no 2, p. 153‑67.
- Ammassari, S., D. McDonnell et M. Valbruzzi. 2023. «It's about the Type of Career: The Political Ambition Gender Gap among Youth Wing Members », European Journal of Political Research , vol. 62, p. 1054-1077.
- Bargel, L. 2013. « Socialisation politique », dans Dictionnaire. Genre et science politique Concepts, objets, problèmes , sous la dir. de C. Achin et L. Bereni, Paris, Presses de Sciences Po, p. 468-480.
- Bhatti, Y. et K. M. Hansen. 2012. « Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters », Journal of Elections, Public Opinion & Parties , vol. 22, no 4, p. 380‑406.
- Brossier, M. et G. Dorronsoro. 2016. « Le paradoxe de la transmission familiale du pouvoir », Critique internationale , no 73, p. 9‑18.
- Broutelle, A.-C. 2011. « La politique, une affaire de famille(s) ? », Idées économiques et sociales , no 166-4, p. 31‑38.
- Coppenolle van, B. 2017. « Political Dynasties in the UK House of Commons: The Null Effect of Narrow Electoral Selection », Legislative Studies Quarterly , vol 42, no 3, p. 449‑75.
- Dal Bó, E., P. Dal Bó et J. Snyder. 2009. « Political Dynasties », The Review of Economic Studies , vol 76, no 1, p. 115‑42.
- De Landtsheer, C., L. Kalkhoven, W. Heirman et P. De Vries. 2018. « Talking Politics at the Dinner Table: Stereotypes in Children’s Political Choices », Politics, Culture and Socialization , vol. 7, no 1‑2, p. 143‑56.
- Dutoya, V. 2016. « Quand les femmes héritent », Critique internationale , vol. 73, no 4, p. 19-36.
- Faure, A. 2016. Des élus sur le divan , Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble.
- Fillieule, O., C. Leclercq et R. Lefebvre. 2022. Le malheur militant , Bruxelles, De Boeck Supérieur.
- Fiva, J. H. et D. M. Smith. 2018. « Political Dynasties and the Incumbency Advantage in Party-Centered Environments », American Political Science Review , vol 112, no 3, p. 706‑12.
- Garraud, P. 1992. « La ville en héritage. Hérédité familiale et héritage politique chez les maires urbains », dans L’hérédité politique chez les maires urbains , sous la dir. de C.Patriat et J.-L. Parodi, Paris, Economica, p. 219‑34.
- Gidengil, E., B. O’Neill et L. Young. 2010. « Her Mother’s Daughter? The Influence of Childhood Socialization on Women’s Political Engagement », Journal of Women, Politics & Policy , vol 31, no 4, p. 334‑55.
- Gotman, A. 2006. L’héritage , Paris, Que sais-je ?
- Jaffrelot, C. 2006. « L'Inde, démocratie dynastique ou démocratie lignagère ? », Critique internationale , vol. 33, no 4, p. 135-152.
- Jennings, M. K., L. Stoker et J. Bowers. 2009. « Politics across Generations: Family Transmission Reexamined », The Journal of Politics , vol. 71, no 3, p. 782‑99.
- Kenawas, Y. 2015. « The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society », Arryman Fellow Research Paper , no 30.
- Lacroix, I. et L. Lardeux. 2022. Jeunes et déjà maires: le prix de l’engagement dans la politique municipale . Espaces politiques , Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
- Lawless, J. L. et R. L. Fox. 2005 . It Takes a Candidate: Why Women Don’t Run for Office , Cambridge; New York, Cambridge University Press.
- Lenoir, R. 1998. « Famille et politique : les métaphores familiales et de l’ordre politique », Regards sociologiques , vol 15, no 2, p. 7-14.
- Liefferinge van, H. et K. Steyvers. 2009. « Family Matters? Degrees of Family Politicization in Political Recruitment and Career Start of Mayors in Belgium », Acta Politica , vol 44, no 2, p. 125‑49.
- Marmont, T. 2010. « Devenir “amateur” en politique. Les ressources politiques des élus ruraux », dans Battre la campagne. Élections et pouvoir municipal en milieu rural , sous la dir. de S. Barone et A. Troupel, Paris, L’Harmattan, p. 115‑40.
- Marneur, V. 2016. « Le genre de l’hérédité en politique : une filière d’accès pour les élues municipales en Gironde ? », Critique internationale , no 73, p. 53‑70.
- Martin, Cl. et J. Commaille. 2001. « La repolitisation de la famille contemporaine », Comprendre-Revue annuelle de philosophie et de sciences sociales , no 2, p. 129‑49.
- Mayer, N. 2007. « Qui vote pour qui et pourquoi ? Les modèles explicatifs du choix électoral », Pouvoirs , vol 1, no 120, p. 17-27.
- McDevitt, M. et S. Chaffee. 2002. « From Top-Down to Trickle-Up Influence: Revisiting Assumptions About the Family in Political Socialization », Political communication , vol. 19, no 3, p. 281-301.
- Mévellec, A. et M. Tremblay. 2016. Genre et professionnalisation de la politique municipale. Un portrait des élues et élus du Quebec , Québec, Presses de l’Université du Québec
- Navarre, M. 2015. Devenir élue. Genre et carrière politique , Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- Offerlé, M. 1993. « Usages et usure de l’hérédité en politique », Revue française de science politique , vol 43, no 5, p. 850-856.
- Oskarsson, S., C. T. Dawes et K.-O. Lindgren. 2018. « It Runs in the Family », Political Behavior , vol 40, no 4, p. 883‑908.
- Patriat, Cl. 1992. « Perspective cavalière : où il est question de personnes éligibles naturellement légitimement par voie d'héritage », dans L'hérédité en politique , sous la dir. de Cl. Patriat et J.-L. Parodi, Paris, Economica, p. 1-22.
- Pini, B. et P. McDonald. 2004. « A Good Job for a Woman? The Myth of Local Government as Family Friendly », Local Governance , vol 30, no 3, p. 144‑51.
- Smets, K. et C. van Ham. 2013. « The Embarrassment of Riches? A Meta-Analysis of Individual-Level Research on Voter Turnout », Electoral Studies , vol 32, no 2, p. 344‑59.
- Tournier, V. 2009. « Le rôle de la famille dans la transmission politique entre les générations: Histoire et bilan des études de socialisation politique », dans L'intergénérationnel Regards pluridisciplinaires , sous la dir. de A. Quéniart et R. Hurtubise, Rennes, Presses de l’EHESP, p. 169‑94.
- Tournier, V. 2010. « Le rôle de la famille dans la transmission politique entre les générations [Histoire et bilan des études de socialisation politique] », Revue des politiques sociales et familiales , no 99, p. 59-72.
- Wieviorka, M. 2018. « Introduction », dans La Famille dans tous ses états , sous la dir. de M. Wieviorka, Paris, Éditions Sciences Humaines, p. 5-12.