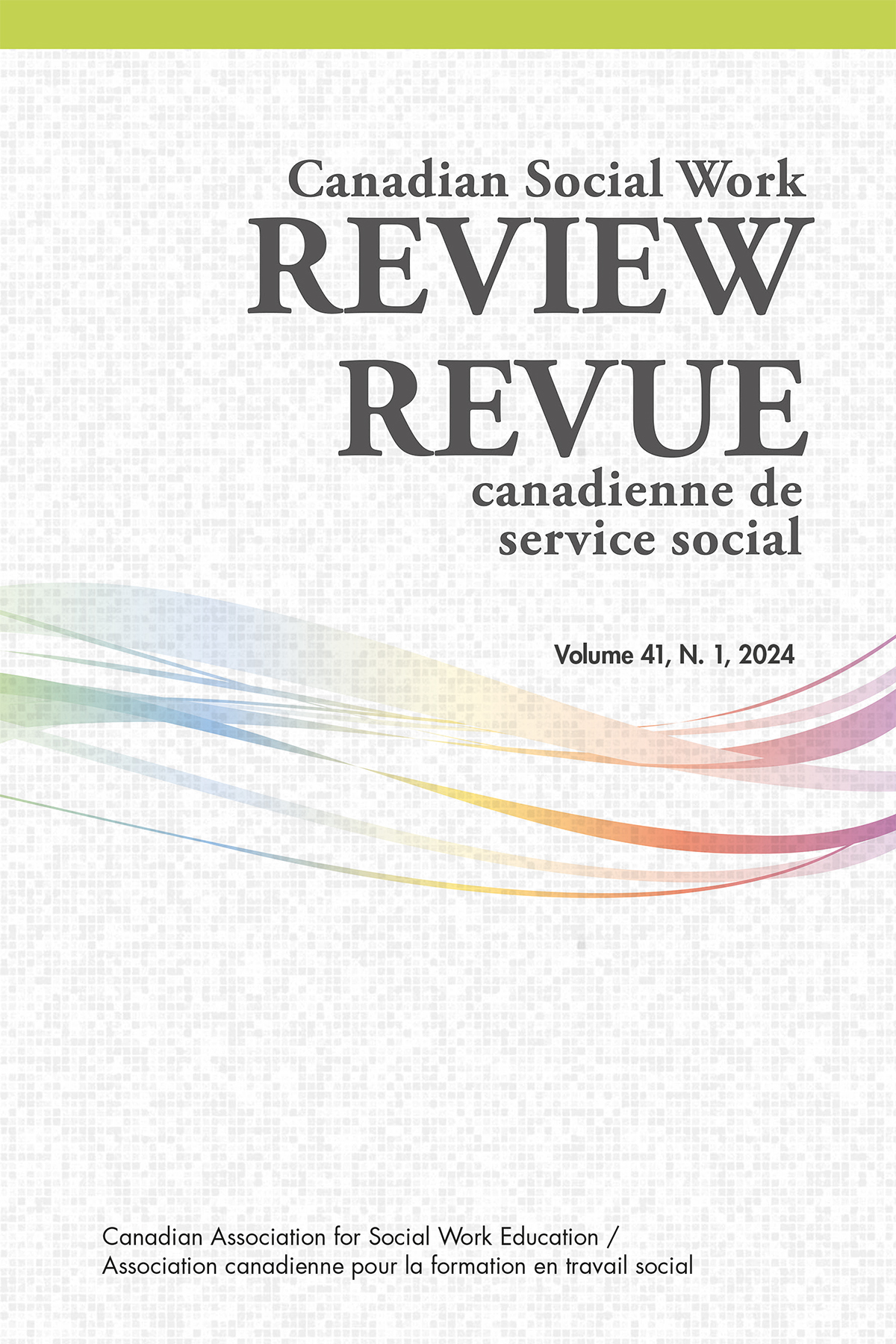Abstracts
Résumé
Les inondations historiques de 2019 ont affecté plus de 300 municipalités québécoises et ont forcé l’application de mesures d’urgence, entraînant le déploiement de plusieurs centaines d’intervenants sociaux et municipaux pour aider à l’évacuation de milliers de résidents et leur offrir du soutien pour des périodes variant de quelques semaines à plusieurs mois. Cet article présente les résultats d’une étude qualitative qui a permis de recueillir, lors de 20 rencontres de groupe, le point de vue de 113 intervenants de première et deuxième ligne sur les conséquences à la fois négatives et positives de leur implication auprès des personnes sinistrées et ce, sur leur vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
Mots-clés :
- inondation,
- désastre,
- catastrophe,
- intervenants sociaux,
- intervenants municipaux
Abstract
The historic floods of 2019 affected more than 300 Quebec municipalities and forced the application of emergency measures, leading to the deployment of several hundred social and municipal workers to help evacuate thousands of residents and offer them assistance. Support lasted for periods varying from a few weeks to several months. This article presents the results of a qualitative study which made it possible to collect, during 20 group meetings, the point of view of 113 first- and second-line workers on the consequences, both negative and positive of their involvement with victims and this, in their personal, family, social and professional lives.
Keywords:
- flood,
- disaster,
- catastrophe,
- social workers,
- municipal workers
Article body
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit que d’ici 2050, les changements climatiques entraîneront 250 000 décès supplémentaires par an (OMS, 2021). Pour tenter de freiner l’accélération du réchauffement planétaire, les personnes dirigeantes de partout dans le monde se réunissent depuis 1995 lors d’un sommet annuel, la Conférence des Parties (COP), afin de s’entendre sur les moyens à prendre pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Lors de la COP26 en 2021, les pays se sont engagés à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C, mais selon les prévisions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2022), si aucun changement substantiel n’est fait concernant la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel et sables bitumineux) le réchauffement climatique pourrait dépasser les quatre degrés d’ici la fin du siècle.
Au Canada, les conséquences de ce réchauffement se font déjà sentir, en étant de plus en plus affecté par des événements météorologiques extrêmes (EME) : inondations récurrentes, tornades, feux de forêt et un rare derecho en mai 2022 au Québec et en Ontario. Chaque année, le climatologue d’Environnement Canada, David Phillips, met à jour la liste des 10 pires événements météorologiques à survenir au Canada. En 2019, il a accordé la première place à la crue record de la rivière des Outaouais et aux inondations de grande ampleur qui ont suivi, notamment en raison de la longue durée de ces inondations (cinq semaines; de mi-avril à fin mai) et du nombre élevé de logements inondés (plus de 6 000) (Environnement Canada, 2020). Selon le Bureau d’assurance du Canada (2021), les inondations de 2019 auraient coûté près de 390 millions de dollars au gouvernement du Québec, ce montant excluant les coûts des services de santé et des services sociaux qui ont été offerts aux différentes personnes ayant été affectées par cette catastrophe naturelle.
Plus de 300 municipalités du Québec ont été touchées par les inondations de 2019, avec les conséquences qui accompagnement la plupart des catastrophe naturelles ou technologiques : application des mesures d’urgence, évacuation de plusieurs milliers de personnes, dommages importants aux infrastructures collectives, déploiement de centaines d’intervenants et intervenantes de première et de deuxième lignes ainsi que de plusieurs gestionnaires ou chefs d’équipe responsables d’encadrer ces personnes ou de coordonner l’ensemble des mesures d’urgence à mettre en place au sein des instances municipales ou institutionnelles. Les membres de la première ligne interviennent rapidement pour assurer la sécurité physique des victimes d’une catastrophe et incluent, entre autres, les personnes occupant les postes de pompiers, policiers et ambulanciers paramédicaux. Pour leur part, les membres du personnel rémunérés ou bénévoles des institutions publiques de santé et de services sociaux ainsi que des organismes communautaires sont considérés des intervenants et intervenantes de deuxième ligne. Ces derniers interviennent auprès des personnes sinistrées, une fois que leur sécurité est assurée, pendant la crue des eaux et par la suite pour des périodes variant de quelques semaines à plusieurs mois.
Recension des écrits
La gestion et l’accompagnement des personnes évacuées ou exposées lors d’une catastrophe naturelle nécessitent la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs et d’actrices de divers milieux (tant publics que communautaires) afin d’assurer la sécurité et le bien-être physique et psychologique de tous (Maltais, 2015).
La littérature existante sur l’intervention en contexte de catastrophe nous informe que les intervenants et intervenantes qui se rendent sur le terrain doivent constater l’ampleur des dégâts, planifier et participer au processus d’évacuation, identifier les personnes à risque de souffrir de problèmes biopsychosociaux et offrir une présence rassurante (Maltais, 2015). Ces personnes peuvent également être appelées à diffuser de l’information sur les réactions possibles pouvant survenir à la suite d’un événement traumatique (telles que des inondations) et sur les ressources disponibles pour y faire face. Intervenir auprès des personnes sinistrées pendant et après une catastrophe peut être déstabilisant, car très peu de personnes employées par les municipalités et par les organismes publics et communautaires ont l’habitude d’effectuer des tâches qui les sortent de leurs cadres d’interventions habituels reliées à la gestion d’une catastrophe et de ses conséquences (par exemples, annoncer le décès d’un proche, reloger des familles, travailler auprès d’une communauté qu’on connaît peu, travailler en collaboration avec des partenaires ayant diverses formations, intervenir dans des centres de services sans espace intime et confidentiel, etc.) (Harms et coll., 2022; Hickson et Lehmann, 2014; Maltais, 2015; Maltais et Lansard, 2022). De plus, le sentiment de « chaos » résultant d’une catastrophe peut ajouter du stress et une charge de travail supplémentaire pour les personnes déployées sur le terrain (Drolet et coll., 2021). Finalement, les intervenantes et intervenants, les gestionnaires et leurs proches peuvent être sinistrés lors d’une catastrophe, ce qui peut venir augmenter le stress et la détresse chez ces personnes (Faust et Ven, 2014). À cet égard, dans une étude de Drolet et ses collègues (2021), les personnes intervenantes qui avaient été elles-mêmes sinistrées affirmaient : « it was hard to provide support to others when you are personally impacted » (p.1670).
Les études portant sur l’intervention en situation de catastrophe recensent des conséquences à la fois négatives et positives chez les personnes qui gèrent ou appliquent les mesures d’urgence. Ainsi, la fatigue de compassion, le traumatisme vicariant (aussi appelé « stress post-traumatique secondaire ») et l’épuisement professionnel sont des problèmes qui peuvent être vécus (Downing et coll., 2021; Harms et coll., 2022; Hickson et Lehmann, 2014; Tosone, 2019; Tosone et coll., 2015). Notons également l’étonnement, l’incrédulité, l’engourdissement émotionnel, le sentiment d’impuissance, la présence de manifestations dépressives, d’isolement, d’irritabilité, de problèmes de sommeil, d’angoisse, etc. (Bell et Robinson III, 2013; Maltais et Lansard, 2022; Trumello et coll., 2020). Raphael (1986) affirme d’ailleurs que les membres du personnel des municipalités et des organismes publics et communautaires peuvent être considérés comme le troisième palier de victimes, après les victimes primaires (directement touchées) et secondaires (proches indirectement touchés).
Des horaires comprenant de longues périodes de travail consécutives et un environnement de travail déficient constituent deux des facteurs exacerbant le stress des personnes intervenantes (Harutyunyan et coll., 2021; Maltais et Gerin, 2018). La combinaison de ces deux facteurs peut amener ces dernières à ressentir un épuisement et un stress continu, aboutissant en une réduction de leur productivité et les exposant à un plus grand risque de séquelles psychosociales (Harutyunyan et coll., 2021). Qui plus est, différents autres facteurs ou événements peuvent empêcher les intervenants et intervenantes de première et deuxième lignes de déployer toute leur expertise professionnelle afin de soutenir les victimes à surmonter leurs difficultés, soit par manque de temps lors de l’évaluation des besoins ou lors du déploiement des stratégies d’intervention. Des ressources humaines ou matérielles insuffisantes peuvent aussi empêcher ces personnes de mettre en pratique leurs connaissances tant théoriques que pratiques et nuire à l’accomplissement des différentes tâches et actions considérées primordiales à mettre en place par ces dernières. Dans ces différents contextes, l’entièreté de leurs rôles et de leurs compétences ne peut pas être déployée, ce qui selon Bajoit (2003) a des impacts négatifs sur les perceptions qu’ont les personnes de leur identité professionnelle désirée. Ainsi, lors de catastrophe, les attentes et les besoins des intervenants et intervenantes de secourir et de soutenir les victimes sont généralement les principaux motifs qui les poussent à se présenter volontaires à intervenir en dehors de leur cadre habituel de travail. Toutefois, dans certaines circonstances, il leur est impossible de le faire parce que les victimes ne sont pas réceptives à leurs conseils ou à recevoir du soutien, ou parce que les consignes de leur organisation les obligent à réaliser d’autres tâches que celles souhaitées ou considérées essentielles pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes sinistrées. De plus, lorsque les rôles attendus de ces personnes ne sont pas clairement définis par leurs gestionnaires, les intervenants et intervenantes peuvent avoir l’impression de ne pas déployer assez d’efforts pour soutenir les victimes ou de ne pas avoir été suffisamment utiles (Maltais et Gerin, 2018)
L’intervention auprès de personnes sinistrées peut toutefois permettre aux intervenants et intervenantes ainsi qu’à leurs gestionnaires de reconnaître la capacité humaine à guérir de traumatismes, de réaffirmer l’importance du processus thérapeutique et le pouvoir de la solidarité d’une communauté (Hickson et Lehmann, 2014; Tominaga et coll., 2020). Finstad et ses collègues (2021) nomment ce processus comme étant de la « résilience vicariante » définit comme étant une adaptation positive et la capacité de maintenir un niveau fonctionnel malgré des événements destructeurs. Cela peut engendrer des conséquences positives, telles que le développement personnel, un sentiment de confiance professionnelle renouvelé et une plus grande appréciation de sa propre vie (Finstad et coll., 2021).
Toutefois, les intervenants et intervenantes peuvent aussi faire face à des obstacles d’ordre organisationnels et structurels pouvant amplifier leur détresse, comme le manque de soutien ou supervision de la part de leur organisation et de leurs pairs. Une coordination déficiente entre les organisations déployées sur le terrain et le manque de formation ou d’expérience des personnes qui interviennent auprès des individus sinistrés lors de situation de catastrophe sont aussi des facteurs qui peuvent avoir des impacts sur la santé à la fois des personnes sinistrées et des intervenants et intervenantes es (Harms et coll., 2022; Kranke, Gioia, et coll., 2022). Pourtant, malgré l’augmentation des EME, la préparation à ce type d’intervention est peu ou pas enseignée dans les établissements collégiaux et universitaires du Québec, tout comme dans les organismes qui emploient des personnes intervenantes sociales, ce qui fait en sorte que ces dernières peuvent se sentir non adéquatement préparées lorsqu’elles doivent intervenir dans un contexte de catastrophe (Drolet et coll., 2021; Harms et coll., 2022; Hay et Pascoe, 2021; Kranke et coll., 2020; Kusmaul et coll., 2021; Miller et coll., 2022; Wu, 2021) tout en étant davantage exposées aux risques associés à ce type d’événement (Boetto et coll., 2021). Pour les personnes effectuant des études collégiales ou universitaires en travail social, ce manque de formation peut s’expliquer par le fait que peu d’études se sont antérieurement intéressées aux rôles qu’elles peuvent assumer en cas de catastrophe et à leurs conséquences (Kranke, Mudoh, et coll., 2022; Maltais et coll., 2015). D’ailleurs, Kranke et ses collègues (2020; 2022) révèlent qu’aucune revue scientifique en travail social ne s’intéresse spécifiquement aux questions entourant les désastres, et que la création d’un colloque spécialement consacré à ces questions serait une opportunité de sensibilisation pour les actuels et futurs praticiens et praticiennes en travail social.
À la lumière de cette revue de la littérature, qui souligne le manque d’études sur les répercussions de l’intervention en contexte de catastrophe, particulièrement chez les intervenants et intervenantes du social, et en sachant que les inondations historiques de 2019 ont mobilisé des centaines de personnes sur le terrain afin d’assurer la sécurité et le bien-être des individus exposées à cet EME, deux questions se posent : 1) Quels sont les impacts, autant négatifs que positifs, qu’ont eu les inondations de 2019 dans différentes sphères de la vie des membres du personnel de première et de deuxième lignes ainsi que chez leurs gestionnaires qui ont soutenu, par leurs actions, les personnes sinistrées lors de cette catastrophe naturelle? et 2) Quel soutien professionnel et organisationnel souhaitent recevoir ces personnes lorsqu’elles oeuvrent lors d’une catastrophe? Cet article répond à ces deux questions en présentant les résultats du volet qualitatif d’une étude mixte[1] concomitante qui a consisté, d’une part, à réaliser un sondage téléphonique auprès de 3 437 adultes demeurant dans l’une ou l’autre des 300 municipalités ayant été affectées par les inondations de 2019 afin d’en documenter les impacts de cet événement sur leur santé physique et mentale. Pour sa part, le volet qualitatif nous a permis d’interviewer, lors de 20 groupes de discussion, 113 intervenants et intervenantes de première et deuxième lignes ainsi que leurs gestionnaires ayant été impliqués dans le secours et le soutien des personnes sinistrées avant, pendant et après ces inondations.
Méthodologie
La méthode des rencontres de groupe réunissant séparément des gestionnaires et des personnes intervenantes sociales et municipales oeuvrant dans quatre régions socio-sanitaires du Québec (Outaouais, Laurentides, Montérégie et Montréal) a été retenue pour récolter leur point de vue sur les conséquences qu’ont eu les inondations de 2019 sur elles-mêmes et chez les personnes sinistrées tout en identifiant les interventions psychosociales qui semblent avoir eu des impacts positifs sur la santé et le fonctionnement social des personnes exposées ou perturbées par cet EME (Maltais et coll., 2021). La technique des rencontres de groupe a été privilégiée, car l’interaction à l’intérieur des groupes favorise l’émergence de réponses spontanées (Lane et coll., 2001; Saulnier, 2000) et permet l’expression de points de vue davantage critiques (Robinson, 1999). Elle peut également créer un effet d’entraînement, car il suffit qu’une seule personne dévoile ses émotions, ses pensées ou ses opinions pour que d’autres ressentent l’envie de faire la même chose. Le fait de parler collectivement d’un événement peut aider certaines personnes à se remémorer des expériences vécues qui seront ensuite exprimées dans le groupe (Duchesne et Haegel, 2013). Pour les personnes provenant des CISSS ou des CIUSSS (CI(U)SSS)[2], leur participation à ces groupes leur ont permis de réaliser un retour d’apprentissages sur les mesures mises en place et les interventions effectuées lors des inondations de 2019, solidifiant du même coup leurs pratiques psychosociales en sécurité civile.
Guide d’entrevue utilisé lors des rencontres de groupe
Plusieurs thèmes et sous-thèmes ont été abordés lors des rencontres de groupe à l’aide d’un guide d’entrevue semi-dirigé comprenant 38 questions ouvertes, dont, entre autres, des questions portant sur le contexte dans lequel les participants et participantes sont intervenus lors des inondations de 2019 (ex. : Pouvez-vous nous décrire le contexte et l’ampleur des inondations printanières de 2019 ?); les conséquences des inondations sur les citoyens ainsi que sur eux-mêmes (ex. : Quels sont les impacts négatifs puis positifs que vous avez vécus dans différentes sphères de votre vie personnelle, conjugale, familiale, sociale et professionnelle pendant et après les inondations de 2019 ?); les sentiments éprouvés pendant et après les inondations (ex. : Quels sentiments avez-vous éprouvés pendant et après les inondations de 2019 ?) et le soutien reçu et souhaité de la part de son organisation et de ses pairs (ex. : Quel type de soutien et de supervision avez-vous reçu pendant et après les inondations de 2019 ?). Chacun de ces thèmes a été abordé dans l’ensemble des rencontres de groupe, peu importe la catégorie professionnelle des participants et participantes.
Modes de recrutement et population à l’étude
Une fois obtenues les autorisations de six CI(U)SSS de quatre régions particulièrement affectées par les inondations de 2019, les responsables des mesures d’urgence, volet psychosocial, de ces établissements et ceux des différentes municipalités où oeuvrent ces CI(U)SSS ont été contactés par voie téléphonique et par courriel afin de leur expliciter les objectifs et le déroulement des rencontres de groupe. Puis, chaque organisation s’est chargée de recruter des personnes répondant aux critères de sélection de cette étude[3]. Parmi les 20 rencontres de groupe, huit ont été réalisées en Outaouais (n = 46 personnes), quatre en Montérégie (n = 27), cinq à Montréal (n = 11) et trois dans les Laurentides (n = 29). Le Tableau 1 présente la provenance professionnelle des personnes ayant participé à l’une ou l’autre des 20 rencontres de groupe. Au total, 68 femmes et 45 hommes ont participé à notre étude. L’âge des personnes participantes varie de 23 à 65 ans, avec une moyenne de 42,8 ans.
Tableau 1
Fonction et milieu professionnel des personnes ayant participé aux rencontres de groupe
Le nombre d’années d’expérience professionnelle au sein de son poste varie selon le secteur d’emploi. Ainsi, 40,7% des personnes provenant des CI(U)SSS et 42,2% de celles oeuvrant au sein d’une municipalité occupaient leur emploi depuis plus de 10 ans lors des inondations de 2019 tandis que 42,2% des personnes rencontrées provenant d’organismes communautaires occupaient leur poste depuis moins de quatre ans. Parmi l’ensemble des personnes ayant participé aux rencontres de groupe, 92% sont intervenues durant la phase d’intervention et 73,4% lors du rétablissement[4].
Collecte et analyse des données
La collecte de données s’est échelonnée d’octobre 2019 à la fin du mois de novembre 2019 (soit six mois après les inondations de 2019) et les rencontres ont duré entre une heure et demie à trois heures. Les personnes devaient signer un formulaire d’information et de consentement en plus de remplir un court questionnaire permettant de recueillir des informations sur leurs caractéristiques sociodémographiques et professionnelles. La taille des groupes a varié entre 2 à 14 personnes et le nombre de rencontre de groupe à réaliser a été déterminé conjointement avec les CI(U)SSS et les municipalités de chaque région. La tenue d’un nombre important de rencontres de groupe et le nombre de personnes participant à ceux-ci a permis d’obtenir la saturation des données, autant pour les municipalités urbaines que rurales.
Le contenu de chaque rencontre de groupe a été enregistré et retranscrit intégralement par une professionnelle de recherche, et par la suite codifié à l’aide du logiciel N’Vivo11 par les deux personnes qui ont animé les rencontres de groupe[5]. Cette façon de procéder a facilité la compréhension du contenu et réduit le risque de mauvaise interprétation. De plus, les grands thèmes et sous-thèmes pouvant ressortir des rencontres de groupe avaient préalablement été établis en fonction du contenu du guide d’entrevue, ce qui a facilité l’étape de codification des données. Lorsque le contenu des comptes rendus exhaustifs ne correspondait à aucun des thèmes et sous-thèmes préalablement identifiés, d’autres thèmes étaient créés en cours de codification. Chaque compte rendu intégral a été associé à deux types de classification professionnelle. La première en fonction du type d’organisation des répondants : municipalité, organismes communautaires ou CI(U)SSS, et la deuxième selon le statut des personnes rencontrées : intervenants/intervenantes ou gestionnaires de première ligne, ainsi que intervenants/intervenantes ou gestionnaires de deuxième ligne. Cette façon de faire a permis d’analyser les données en fonction des caractéristiques des personnes présentes dans chacune des rencontres de groupe lorsque cela était pertinent.
RÉSULTATS
Conséquences des inondations de 2019 chez les intervenants et intervenantes de première et de deuxième lignes ainsi que sur les gestionnaires
Impacts négatifs. Au sein de 16 des 20 rencontres de groupe réunissant l’une ou l’autre des différentes catégories d’emploi et d’organisation, la majorité des participants et participantes ont souligné avoir vécu une grande fatigue pendant la phase d’intervention, notamment en raison de la surcharge de travail et du nombre important d’heures supplémentaires qui ont dû être accomplies. La récurrence des inondations dans les dernières années est un facteur ayant contribué à cette situation:
Tu es sur l’adrénaline au début et là un moment donné, l’adrénaline c’est comme… bon, bien là je rentre et… […] C’est ça, c’est de la fatigue et c’est que ça n’arrête jamais. Il n’y a plus rien qui existe autour. Parce que quand on sort d’ici, il n’y a plus rien qui bouge autour de nous, parce qu’on s’en va se coucher et quand on rentre, on sait qu’on est 100% à la gestion de l’urgence, alors… c’est épuisant.
Groupe 05 : gestionnaires municipaux
Pendant cette même phase, quelques groupes (n = 3) ont aussi fait part de changements de leurs habitudes alimentaires et ont constaté qu’ils avaient pris du poids, alors que d’autres (n = 6) ont mentionné que leur état de santé physique a été affecté par les inondations. Quatre groupes ont par ailleurs souligné que leur santé psychologique n’a pas été épargnée en ayant vécu de la détresse, de l’anxiété, des manifestations dépressives et d’épuisement professionnel. Ces problèmes ont été plus souvent mentionnés par les membres du personnel des municipalités que par les personnes oeuvrant au sein des CI(U)SSS, ces dernières étant généralement mieux préparées à intervenir auprès de personnes en détresse. De plus, le fait d’être soi-même en situation de vulnérabilité soit parce que sa propre demeure était située en zone inondable, ou encore parce que sa vie familiale était chamboulée en raison de longues heures de travail n’a pas facilité la tâche des intervenants et intervenantes de première ligne, ainsi que celle des gestionnaires :
Nos employés à nous ont montré des signes de détresse. Et là, ils se disaient… moi, je ne suis plus capable d’absorber la détresse des gens, c’est too much.
Groupe 07 : gestionnaires municipaux
Ce qu’on s’est aperçu, c’est qu’il y avait énormément de préoccupations des intervenants parce qu’ils venaient travailler et ils se souciaient de la sécurité de leurs enfants, de leur famille proche, que ce soit parents ou encore femme, conjoint. Aussi niaiseux que… je n’ai plus de bouffe dans le frigidaire et mes enfants qui sont des ados, qui ont 12, 13 ans, ils n’ont plus de bouffe ce soir […] Les préoccupations viennent carrément nuire au bon fonctionnement d’une gestion de mesures d’urgence.
Groupe 07 : gestionnaires municipaux
Des perturbations dans la vie familiale ont aussi été soulevées dans 11 rencontres de groupe, allant même jusqu’à entraîner des séparations conjugales chez certains des participants oeuvrant au sein des municipalités, en raison du stress vécu au niveau familial et de l’absence prolongée de ces derniers au sein de leur foyer au cours des dernières années dû au cumul de catastrophes (notamment, les inondations de 2017).
On met toute notre vie à off, on met tout sur standby et nos familles, on ne les voit pas, nos enfants, on ne les voit plus.
Groupe 05 : gestionnaires municipaux
Les inondations de 2019 ont également entraîné des impacts négatifs sur la vie professionnelle de la majorité des personnes participantes. Ainsi, dans 16 rencontres de groupe, ces dernières ont souligné avoir dû travailler de longues heures, parfois sans arrêt, de jour comme de nuit, pendant plusieurs semaines, tandis que dans 13 groupes, certaines personnes, en particulier les intervenants et intervenantes des CI(U)SSS, ont maintenu leurs fonctions habituelles et ont ainsi dû assumer leurs tâches régulières en même temps que celles reliées aux inondations. De plus, dans sept groupes, des personnes ont mentionné avoir subi des pressions de leur gestionnaire, lors de la phase de rétablissement, afin de diminuer les retards accumulés dans la gestion de leurs dossiers réguliers.
Ce n’est pas tous les gestionnaires qui voulaient libérer leurs intervenants. Dans les premiers mois, ce n’était pas rare de faire entre 25 et 40 heures de surtemps. […] Mais quand tu fais deux jobs, on faisait l’équivalent de deux semaines par semaine.
Groupe 01 : intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
Quatre groupes ont également rapporté que des accidents de travail, la détérioration de l’état de santé physique et psychologique, ou que l’épuisement professionnel ont entraîné une augmentation des congés de maladie pendant les phases d’intervention et de rétablissement.
Pour d’autres (n = 6), l’intervention en contexte de catastrophe a été vécu comme une expérience professionnelle des plus stimulante et pour ces personnes, le retour au sein de leur équipe régulière, lors de la phase de rétablissement, leur a fait sentir de l’ennui, une désorientation et une difficulté à réintégrer une équipe de travail avec laquelle ils ont été tenus éloignés pendant plusieurs semaines :
Bien moi, en fait, il y a le petit blues post-sinistre qui s’installe. Moi, j’ai des bénévoles qui ont eu des petites phases dépressives après 2019. Bien là, qu’est-ce que je fais de ma peau, je me sens moins utile. Moi, je l’ai moins senti en 2019 parce que la pile m’attendait au bureau, mais effectivement, ce sentiment de ce que je faisais était vraiment utile et là je viens remplir de la paperasse, qu’est-ce que je fais là?
Groupe 12 : gestionnaires municipaux
Impacts positifs. Malgré les difficultés rencontrées, la majorité des personnes ayant participé aux rencontres de groupe ont identifié des conséquences positives de leur implication auprès des familles sinistrées. Ainsi, neuf groupes ont souligné qu’intervenir en contexte de mesures d’urgence leur a permis de créer de nouveaux liens professionnels, autant avec leurs propres collègues qu’avec les partenaires et les citoyens et citoyennes de leur communauté.
Moi, je pense que ça a eu un impact sur la cohésion d’équipe. […] On se connaît aussi dans cet événement-là et on développe... on se connaît plus, on travaille ensemble longtemps, donc c’est sûr que ça a solidifié des liens.
Groupe 12 : gestionnaires municipaux
Et ça permet de connaître des gens de plein d’autres différentes équipes, là… Moi, ça m’a permis de rencontrer plein de gens en ville, c’est le fun, j’ai fait plusieurs connaissances, des nouveaux collègues. Ça a créé des amitiés, même
Groupe 03 : intervenants et intervenantes des CI(U)SSS
Intervenir lors des inondations de 2019 a aussi rendu possible la réalisation de nouveaux apprentissages, de découvrir des forces insoupçonnées et de prendre conscience des aspects à améliorer en ce qui a trait à leur manière d’intervenir auprès des personnes vulnérables. Ces trois retombées positives ont été nommées lors de dix rencontres de groupe, composées surtout d’intervenants et intervenantes des CI(U)SSS.
Ça permet aussi un certain apprentissage chez certains individus, en tout cas dans ma boîte, qui viennent me voir après et qui disent… je sais où sont mes capacités et où il faut que je m’améliore et la prochaine fois, j’aimerais ça t’accompagner, ou quelque chose comme ça.
Groupe 03 : Intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
Dans trois rencontres de groupe, les personnes participantes estiment aussi que les inondations de 2019 leur ont fourni l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement et les missions de leur propre organisation, alors que deux groupes ont affirmé qu’intervenir durant ces inondations a été une opportunité de se familiariser avec les caractéristiques de leur territoire et de ses ressources :
Moi, je n’étais pas dans ce domaine-là avant, donc ça m’a permis aussi de comprendre assez rapidement c’était quoi la structure du monde municipal.
Groupe 04 : gestionnaires municipaux
Mais ça m’a fait plus connaître le contexte social de ma municipalité et les ressources aussi.
Groupe 03 : Intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
Le fait d’intervenir lors des inondations de 2019 a offert un cadre plus dynamique et moins formel que d’habitude aux intervenants et intervenantes des CI(U)SSS, qui ont eu moins de tâches administratives à effectuer et plus de contacts directs avec des personnes en détresse. Ainsi, sortir de sa routine de travail habituelle et de ses façons d’intervenir a été mentionné comme un impact positif dans huit rencontres de groupe, car les personnes rencontrées ont eu l’impression de mettre en pratique leurs compétences, les valeurs et les fondements de leur métier.
« Moi j’aurais juste le goût de dire… le fait que… moi je travaille dans un programme spécifique, le fait juste de changer, ça vient nous donner d’autres énergies et c’est quand même positif ça. »
Groupe 01: Intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
Versus là, c’était l’inverse, c’était 90% du temps faire ma job, finalement, ce pour quoi j’ai étudié et ce pour quoi que j’aime faire et tout ça. Et le restant, c’était des petites notes, mes petits ci, mes petits ça, mais tu étais vraiment terrain.
Groupe 19 : intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
La reconnaissance et la gratitude qu’ont fait part les personnes sinistrées à l’égard du travail accompli par les bénévoles et par les intervenants et intervenantes déployées sur le terrain et le fait de constater immédiatement des impacts positifs de ses interventions ont augmenté le niveau d’estime professionnel de plusieurs des répondants et répondantes.
Le sentiment de reconnaissance du travail qu’on fait pour ces gens-là et de dire qu’on fait une différence et qu’on les aide dans ce qu’ils vivent actuellement. Je pense que c’est positif, surtout quand on voit cette reconnaissance-là qui nous est… qui nous le redit… merci, ça m’a fait du bien. Même si c’est juste une conversation, un petit quelque chose qu’on l’a écouté, qu’on a pris le temps, bien de se faire dire ce merci-là, je pense que c’est une belle reconnaissance que les intervenants reçoivent du temps qui est offert.
Groupe 06 : gestionnaires d’organismes communautaires
Finalement, à la suite de leur expérience de travail lors des inondations de 2019, des membres de quatre groupes ont mentionné des changements positifs dans leur vie personnelle, notamment une plus grande appréciation de la vie, un sentiment de gratitude et un changement positif de leurs valeurs.
« Au niveau personnel en tout cas pour moi, il y a comme une reconnaissance de pas avoir été touché, une reconnaissance de la vie, je ne sais pas comment dire. De prendre conscience du fait qu’on est choyé, de notre chance. […] Une gratitude envers la vie. »
Groupe 02 : intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
« Au niveau du matérialisme, ça remet bien des choses en perspective au niveau des valeurs humaines. Oui, énormément. »
Groupe 19 : intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
Soutien reçu et souhaité. Lors des rencontres de groupe, les personnes participantes ont identifié des comportements et moyens qui pourraient être mis en place pour limiter les impacts négatifs de l’intervention en situation de catastrophe. Ainsi, pendant la phase d’intervention, plusieurs groupes (n = 11) ont souligné l’importance de prendre soin de soi, notamment en faisant de l’exercice, en se reposant, en limitant son exposition aux médias et aux réseaux sociaux et en passant du temps de qualité avec les membres de sa famille. Dans trois rencontres de groupe, il a également été suggéré de s’imposer des limites personnelles et professionnelles durant la phase d’intervention et de prendre quelques jours de congé lors de la phase du rétablissement, afin de limiter les impacts négatifs que peut avoir ce type d’événement sur la santé :
À un certain moment, moi, j’ai mis mes limites personnelles aussi en disant… bien, j’ai besoin d’une semaine de vacances parce que j’en ai besoin personnellement pour réussir à continuer les autres tâches. Donc des arrangements aussi qu’on a réussi à prendre.
Groupe 18 : intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
Reconnaître la valeur de son travail et croire aux effets bénéfiques de ses interventions sont également des stratégies qui aident à faire face au stress que peut engendrer l’intervention en contexte de catastrophe :
Alors, je dirais aux intervenants au moins d’être fiers de ce qu’on apporte aux gens et de reconnaître que juste le fait que vous êtes là et votre présence, ça fait toute la différence pour ces gens-là. Oui, on voudrait tout le temps en faire plus, mais pour le moment, on fait ce qu’on peut et il faut en être fier.
Groupe 15 : intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
Pouvoir compter sur le soutien des membres de sa famille immédiate (partenaire et enfants), tout comme celui de ses collègues, de ses gestionnaires et de son organisation, est aussi un facteur qui minimise les impacts négatifs de l’application des mesures d’urgence chez les personnes déployées sur le terrain tout comme chez les gestionnaires qui coordonnent la mise en place des services destinées aux personnes sinistrées.
Bien, la compréhension du conjoint, des enfants. Oui, ils comprennent quand tu leur expliques comme il faut, mais c’est aidant. Là, s’ils ne comprennent pas, bien là tu te sens déchiré entre aller travailler et… oui. Et tu le sais aussi que c’est passager, ce n’est pas quelque chose qui va durer trois ans en principe là, donc le côté temporaire aide aussi beaucoup au niveau de la famille.
Groupe 01 : intervenants et intervenantes de CI(U)SSS
Ainsi, dans la majorité des groupes (n = 13), il a été mentionné qu’il a été possible de bénéficier du soutien de ses collègues et de ventiler sur les situations difficiles vécues en exprimant mutuellement ses émotions.
Alors, quand j’étais jumelé avec quelqu’un et que j’étais plus sensible à un sujet, bien, la personne qui était jumelée avec moi l’était moins, alors on dirait que ça aidait à ce niveau-là de pas partager nécessairement cette inquiétude-là.
Groupe 20 : gestionnaires municipaux et communautaires
Il y avait aussi un mécanisme qui avait été mis en place, là je ne sais pas s’il est encore en place; en étant au rétablissement, j’ai perdu la trace un peu. Mais s’il y avait des bénévoles qui voulaient… au lieu de discuter avec une personne qui était spécialisée en service psychosocial, c’était possible de parler à un autre bénévole, alors c’est la même réalité et tout ça.
Groupe 06 : Intervenants et intervenantes oeuvrant au sein d’organismes communautaires
Dans huit rencontres de groupe, les membres du personnel de première et de deuxièmes lignes des municipalités et d’organismes communautaires ont apprécié avoir eu accès à du soutien formel de la part de leur CI(U)SSS lors de la phase d’intervention, pouvant ainsi partager leurs craintes, leurs inquiétudes et leur désarroi à une personne qui ne provenait pas de leur propre organisation. De plus, dans douze rencontres de groupe, il a été soulevé que la mise en place de mécanismes quotidiens de supervision et de soutien a permis de se sentir soutenus et leur a offert un espace où il était possible de partager ses émotions et ses inquiétudes.
Nous autres, il y avait toujours un superviseur au centre pour les enligner et pour réagir quand il y avait des appels plus complexes et qu’eux-mêmes pouvaient avoir certains impacts physiques et psychologiques sur eux.
Groupe 08 : membres du personnel de deuxième ligne d’une municipalité
Dans six rencontres de groupe, composés de gestionnaires ou de membres du personnel des municipalités de deuxième ligne, il a aussi été évoqué que recevoir des formations continues sur les fondements et les principes de base de l’intervention en contexte de catastrophe et sur certains sujets spécifiques, comme l’évaluation du risque suicidaire, demeure un facteur de protection leur permettant d’être mieux outillées pour intervenir auprès des individus exposés à une catastrophe.
Lors de la phase d’intervention, le roulement des ressources humaines appelées à intervenir auprès des personnes sinistrées est aussi une des stratégies de soutien qui a été proposée dans certaines rencontres de groupe (n = 6) afin de préserver la santé physique et psychologique des intervenants et intervenantes déployés sur le terrain, tout comme le fait de prendre en charge certains de leurs besoins personnels, comme ceux de s’alimenter, de s’assurer que leurs proches sont en sécurité, ou encore d’avoir accès à des services spécifiques.
Vous avez planifié le transport des enfants ? On n’a pas le choix, parce que sinon, c’est la préoccupation principale de notre personne qui est ici, elle ne fera pas sa job comme il faut, elle va juste se soucier de sa famille. Alors, ce service-là c’est… Tu veux garder ton monde en intervention ou sur les lieux stratégiques des différents centres, il y a un support incroyable des ressources humaines qu’il faut qu’il soit fait.
Groupe 05 : Gestionnaires municipaux
Tu n’avais pas besoin d’amener ton lunch, le lunch était fourni pour ceux qui étaient autour de la table. […] Il y avait des brosses à dents, de la pâte à dents. Il y avait une petite pharmacie avec tout, justement… Tu avais mal à la tête, il y avait des Tylenol dans le… alors pour l’employé qui vient travailler, sa mission, il ne se casse pas la tête avec ça, lui, il fait juste se concentrer sur son travail.
Groupe 05 : Gestionnaires municipaux
Finalement, lors de la phase de rétablissement, un retour graduel au sein de son équipe de travail habituelle et le fait que ses collègues fassent preuve d’ouverture, de flexibilité et de compréhension sont considérés comme des éléments essentiels au bien-être des personnes qui ont travaillé auprès des familles sinistrées.
On l’a vu, quand la démobilisation… Une des choses qu’on va faire différemment, […] la démobilisation de l’équipe dédiée va être très différente. […] Quand on va avoir fini, qu’il n’y en aura plus, qu’on les retourne dans leurs équipes, le retour au day to day… c’est qu’on prépare le retour dans leur équipe. […] Oui, beaucoup plus graduellement. Tu vois, a déjà un dossier dans son autre équipe pour déjà se remettre…
Groupe 11 : Gestionnaires de CI(U)SSS
Discussion
Les propos tenus lors des rencontres de groupe concernant les conséquences positives de l’intervention en contexte de catastrophe vont de pair avec ce qui est recensé dans les écrits scientifiques consultés et antérieurement démontrés dans des études réalisées au Québec (Maltais, 2015; Maltais et coll., 2015; Maltais et Gerin, 2018), à savoir que ce type d’intervention peut contribuer à un développement personnel et à un sentiment de confiance professionnelle renouvelé. Plusieurs retombées positives ont été mentionnées par les personnes participantes qui sont directement en lien avec le concept de « résilience vicariante », qui est défini par Hernandez, Gangsei et Engstrom (2007) comme un processus de transformation positive des personnes intervenantes au contact de la résilience de personnes ayant surmonté un traumatisme. A ce sujet, il a été souligné par les personnes déployées sur le terrain que le fait d’intervenir lors des inondations de 2019 a entre autres permis de 1) reconnaître la capacité des personnes sinistrées à faire face à l’adversité 2) constater de la solidarité entre pairs et au sein de sa communauté 3) offrir une opportunité de contribuer activement à une prise de conscience des valeurs de sa profession 4) relativiser l’importance de ses problèmes personnels et 5) avoir une plus grande reconnaissance de sa propre vie. Ainsi, bien qu’intervenir en contexte de catastrophe peut être déstabilisant, voire traumatisant, il n’en reste pas moins que dans plusieurs rencontres de groupe, il a été mentionné que l’implication lors de cet EME a permis d’en retirer des bénéfices insoupçonnés.
Notre étude, en concordance avec les écrits scientifiques traitant de la santé mentale post-désastre, démontre donc que les effets de l’adversité d’un événement traumatique sur la santé psychologique, autant des personnes exposées que des intervenants et intervenantes qui les accompagnent, peut créer des états émotionnels positifs et de la croissance personnelle (Brooks et coll., 2020; Ramos et Leal, 2013). Ceci ne signifie pas pour autant que ces derniers ne vont pas ressentir de l’inconfort relié à l’intervention en contexte de mesures d’urgence, mais plutôt que cela ne viendra pas compromettre leur fonctionnement global (Bonanno, 2004).
Comment, alors, favoriser le développement d’une résilience « vicariante », de stratégies d’adaptation positives et d’une croissance post-traumatique lorsque l’on intervient en contexte de catastrophe ? Plusieurs suggestions ont été proposées lors des rencontres de groupe et dans les écrits existants, telles que la création d’un sentiment d’efficacité collectif à travers une communication transparente de la part des gestionnaires envers les personnes intervenantes; des séances d’aide et de techniques de relaxation offertes pendant les heures de travail; des ateliers et des programmes de réinterprétation et de recadrage positif afin de transformer les moments de crise en opportunité de croissance personnelle, etc. (Finstad et coll., 2021). Dans leur étude auprès de personnes intervenantes sociales ayant agi dans un contexte de désastre, Kranke et ses collègues (2020) dévoilent notamment que plusieurs gestionnaires ont encouragé les membres de leur équipe à prendre une journée de congé pour leur santé mentale lorsque ces derniers se sentaient épuisés, même si cela signifiait que l’équipe allait manquer de ressources humaines. Les gestionnaires ayant participé à cette étude ont justifié cette décision en affirmant qu’être « ill-effective at work could be more damaging than not being present in the work setting » (Kranke et coll., 2020, p. 666). De plus, l’épuisement des personnes déployées sur le terrain peut aggraver le roulement de personnel, ce qui peut à son tour détériorer la santé mentale de celles-ci (Kranke et coll., 2022). Les résultats de Drolet et ses collègues (2021) vont dans le même sens, en affirmant que le bien-être au travail lors d’une catastrophe (et par la suite) doit demeurer prioritaire en tout temps, pas seulement lorsque le besoin s’en fait ressentir. Les spécialistes qui ont aussi étudié le bien-être des intervenants et intervenantes lors de situations de catastrophe proposent le terme « emotional preparedness » comme stratégie afin de les aider à développer des habiletés qui les aident à mieux s’adapter aux défis émotionnels reliés aux désastres tout en continuant à fournir des services aux personnes sinistrées. Ce concept s’intéresse au stress traumatique partagé entre les personnes sinistrées et les intervenants et intervenantes oeuvrant autant au sein d’une municipalité qu’au sein d’un organisme public ou communautaire (Tosone et coll., 2015) et propose, entre autres, qu’une meilleure anticipation émotionnelle et le fait d’être préparé à donner des services additionnels à l’extérieur de ses champs de compétences habituels peut permettre aux personnes intervenantes de réduire les risques de souffrir de traumatisme vicariant (Kranke et coll., 2022). Avec ces réflexions, il semble possible d’effectuer, particulièrement pour les intervenants et intervenantes du social, une boucle de rétroaction avec la théorie de Bajoit (2003), car l’intervention en situation de catastrophe permet de déterminer des éléments liés à l’identité professionnelle désirée de ces personnes. En d’autres termes, face à un idéal du travail parfois mis à mal par le travail prescrit et les exigences de leur employeur (cadre classique d’intervention), bon nombre des personnes participantes ont mentionné que lors des inondations de 2019, elles ont eu la possibilité de mettre à profit les valeurs et les pratiques de leur métier et de faire preuve d’originalité et d’autonomie dans leur travail.
Conclusion
Cet article démontre l’importance de soutenir la recherche dans le domaine des impacts des EME sur la santé des personnes intervenantes et de leurs gestionnaires et d’investir dans la formation continue et le soutien organisationnel, autant au sein des municipalités que dans les organisations publiques et communautaires, d’autant plus qu’avec le réchauffement climatique, il est prévu que les catastrophes naturelles et les EME vont croître en intensité et en occurrence (Field et coll., 2012; Masson-Delmotte et coll., 2021; Stocker et coll., 2014). Cette étude démontre aussi que l’intervention en situation de catastrophe peut engendrer des répercussions physiques et psychosociales communes à la fois négatives et positives chez les intervenants et intervenantes de première et de deuxième lignes tout comme chez leurs gestionnaires. Plusieurs recommandations émanent de cette étude. Premièrement, les personnes participantes ont émis des suggestions dans l’ensemble des rencontres de groupe, indépendamment de leur statut et de leurs rôles. Mentionnons, à l’étape de la prévention, la nécessité de 1) tenir des rencontres régulières de l’ensemble des partenaires appelés à mettre en place les interventions de secours et de soutien aux personnes sinistrées afin de développer un sentiment d’appartenance de solidarité et un langage commun et 2) bien définir et délimiter les rôles des organisations et des membres de leur personnel afin de diminuer les frustrations, conflits et le dédoublage des services offerts. Lors de la phase de préparation, tous les groupes ont souligné l’importance que les gestionnaires acceptent de libérer les membres de leur équipe qui se portent volontaires à intervenir auprès des personnes sinistrées. Pour sa part, lors de la phase de l’intervention, il a été suggéré de mettre en pratique les principes de l’intervention intersectorielle et interdisciplinaire tout comme ceux d’une communication claire, transparente et efficace. De plus, il a été évoqué de tenir compte du point de vue des intervenants et intervenantes qui sont déployés sur le terrain en ce qui a trait aux besoins des personnes sinistrées et aux interventions à mettre en place, à modifier ou à abandonner. Enfin, lors de l’étape du rétablissement, il a été rapporté l’importance pour les organisations de souligner le travail accompli par les membres de leur personnel, de reconnaître que certaines personnes intervenantes peuvent être affectées à la suite de leur soutien à des personnes vulnérables et en détresse et que cette phase peut s’échelonner sur plusieurs mois.
Face à l’ampleur des facteurs pouvant influencer le bien-être des personnes intervenantes en situation de catastrophe, il importe dans les recherches futures de porter un regard écosystémique sur la réalité de ces personnes en identifiant les facteurs tant personnels, conjugaux, familiaux, professionnels et organisationnels qui sont associés à leur bien-être ou à leur détresse émotionnelle, à leur résilience vicariante ou à leur stress traumatique secondaire (nommé aussi traumatisme vicariant), tout en mettant en place des moyens de les protéger lorsqu’elles apportent leur soutien aux personnes sinistrées.
Le volet qualitatif de notre étude présente l’avantage d’avoir été réalisée auprès d’un nombre important de personnes ayant intervenu lors d’un EME (n = 113) oeuvrant dans différentes régions du Québec au sein de différents organismes ayant le même objectif, soit celui de protéger le bien-être, la santé et la sécurité de la population lors de la survenue d’une catastrophe. Malgré ces forces, il n’en demeure pas moins que la recherche présente des limites qu’il faut prendre en considération. Ainsi, peu de jeunes intervenants ont participé aux différentes rencontres de groupe, ce qui peut faire en sorte que les particularités de leur vécu professionnel, personnel ou familial a pu ne pas être suffisamment pris en considération dans l’analyse et l’interprétation des résultats. Il arrive aussi que dans des rencontres de groupe, il soit plus facile pour certaines personnes plus expérimentées de s’exprimer. Le point de vue des personnes plus silencieuses ou plus gênées peut alors ne pas être suffisamment pris en considération.
Appendices
Notes biographiques
Danielle Maltais, Ph.D. est professeure émérite au Département des sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Elle est détentrice d’un doctorat en sciences humaines appliquées de l’université de Montréal, d’une maîtrise en travail social de l’Université de Laval et d’un baccalauréat en science politique de l’Université d’Ottawa. Elle est directrice de la Chaire de recherche Événements traumatiques, Santé mentale et Résilience et chercheure au sein du Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ). Ses travaux de recherche portent principalement sur les conséquences des catastrophes sur la santé des individus et des intervenants de première et deuxième lignes dont les intervenants psychosociaux ainsi que sur le développement des communautés. Elle a participé à l’écriture de plusieurs volumes, chapitres de livre et articles scientifiques dans ce domaine.
Ariane Hamel est candidate à la maîtrise en travail social à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Elle s’intéresse aux conséquences des événements météorologiques extrêmes sur les individus et les communautés et à la période de rétablissement qui s’ensuit. Son mémoire porte sur le processus de rétablissement d’individus ayant vécu les inondations de 2017 et de 2019 dans le quartier socioéconomiquement défavorisé de Pointe-Gatineau et sur la place que joue leur attachement à leur milieu dans ce processus. Elle est récipiendaire de bourses du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et du Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) pour sa maîtrise, en plus d’avoir reçu depuis le début de son parcours universitaire de nombreuses bourses d’excellence et d’engagement social.
Anne-Lise Lansard détient une maîtrise en travail social de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Son mémoire a porté sur la croissance post-traumatique chez les adultes à la suite du déraillement du train de Lac-Mégantic. Au cours de sa scolarité de maîtrise, elle a été assistante de recherche dans plusieurs études au sein de l’UQAC, puis professionnelle de recherche à la suite de l’obtention de son diplôme de deuxième cycle à l’Université de Sherbrooke. Elle a entre autres participé à la rédaction d’une recension des écrits portant sur les conséquences des catastrophes chez les enfants et les adolescents et sur les interventions pouvant être mis en place pendant et après de tels événements. Elle est maintenant travailleuse sociale pour la protection de la jeunesse au sein du Centre intégré universitaire de services de santé et services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Notes
-
[1]
Étude mixte intitulée « Une évaluation sociosanitaire des inondations 2019, six mois plus tard : optimiser les services de santé et l’intervention psychosociale post-désastre visant la résilience des collectivités aux extrêmes hydrométéorologiques ». (Généreux, Gachon, Maltais et coll. 2019). Étude financée par l’INSPQ et le MSSS par l’entremise du plan d’action 2013–2020 sur les changements climatiques (PACC 2013–2020).
-
[2]
CISSS=Centre intégré de services de santé et de services sociaux et CIUSSS=Centre intégré universitaire de services de santé et de services sociaux (CI(U)SSS)
-
[3]
Avoir intervenu pendant un nombre élevé d’heures (plus de 50 heures) pendant ou après ces inondations auprès des personnes sinistrées, soit en tant qu’intervenant ou intervenante ou en tant que responsable d’équipe ou de personnes coordonnant la mise en place des mesures d’urgence (nommé dans cet article « gestionnaire »). De plus, des rencontres de groupe devaient se réaliser en milieu rural et en milieu urbain.
-
[4]
Selon le ministère de la Sécurité publique, il y a quatre grandes phases d’intervention en situation de catastrophe : Prévention : Ensemble des mesures établies sur une base permanente qui concourent à éliminer les risques, à réduire les probabilités d’occurrence des aléas ou à atténuer leurs effets potentiels; Préparation: Ensemble des activités et des mesures destinées à renforcer les capacités de réponse aux sinistres; Intervention: Ensemble des mesures prises immédiatement avant, pendant ou immédiatement après un sinistre pour protéger les personnes, assurer leurs besoins essentiels et sauvegarder les biens et l’environnement; Rétablissement: Ensemble des décisions et des actions prises à la suite d’un sinistre pour restaurer les conditions sociales, économiques, physiques et environnementales de la collectivité et réduire les risques (MSP, 2018, repéré à https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/soutien-municipalites/pl_action_inondations.pdf?1583766995).
-
[5]
Chercheure responsable du volet qualitatif de l’étude (Danielle Maltais) et une professionnelle de recherche (Anne-Lise Lansard)
Bibliographie
- Bajoit, G. (2003). Le changement social: approche sociologique des sociétés occidentales contemporaines. Armand Colin.
- Bell, C. H. et Robinson III, E. H. (2013). Shared Trauma in Counseling: Information and Implications for Counselors. Journal of Mental Health Counseling, 35(4).
- Boetto, H., Bell, K. et Ivory, N. (2021). Disaster Preparedness in Social Work: A Scoping Review of Evidence for Further Research, Theory and Practice. British Journal of Social Work, 51(5), 1623–1643. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab103
- Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American psychologist, 59(1), 20.
- Brooks, S., Amlot, R., Rubin, G. J. et Greenberg, N. (2020). Psychological resilience and post-traumatic growth in disaster-exposed organisations: overview of the literature. BMJ Mil Health, 166(1), 52–56.
- Bureau d’assurance du Canada. (2021). Enjeux en assurance de dommages - Inondations. https://bac-quebec.qc.ca/fr/enjeux-en-assurance-de-dommages/inondations/
- Downing, K. S., Brackett, M. et Riddick, D. (2021). Self-care management 101: Strategies for social workers and other frontline responders during the COVID-19 pandemic in rural communities [Article]. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 31(1–4), 353–361. https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1825265
- Drolet, J. L., Lewin, B. et Pinches, A. (2021, Jul 2021). Social Work Practitioners and Human Service Professionals in the 2016 Alberta (Canada) Wildfires: Roles and Contributions. British Journal of Social Work, 51(5), 1663–1679. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab141
- Duchesne, S. et Haegel, F. (2013). L’entretien collectif : l’enquête et les méthodes. Armand Colin.
- Environnement Canada. (2020). Les dix événements métérologiques les plus marquants au Canada en 2019.https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/dix-evenements-meteorologiques-plus-marquants/2019.html
- Faust, K. L. et Ven, T. V. (2014). Policing Disaster: An Analytical Review of the Literature on Policing, Disaster, and Post-traumatic Stress Disorder [Article]. Sociology Compass, 8(6), 614–626. https://doi.org/10.1111/soc4.12160
- Field, C. B., Barros, V., Stocker, T. F. et Dahe, Q. (2012). Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: special report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press.
- Finstad, G. L., Giorgi, G., Lulli, L. G., Pandolfi, C., Foti, G., León-Perez, J. M., Cantero-Sánchez, F. J. et Mucci, N. (2021). Resilience, coping strategies and posttraumatic growth in the workplace following COVID-19: A narrative review on the positive aspects of trauma. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(18), 9453.
- Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). (2022). Climate Change 2022: impacts, adaptation and vulnerability. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
- Harms, L., Boddy, J., Hickey, L., Hay, K., Alexander, M., Briggs, L., Cooper, L., Alston, M., Fronek, P., Howard, A., Adamson, C. et Hazeleger, T. (2022). Post-disaster social work research: A scoping review of the evidence for practice. International Social Work, 65(3), 434–456. https://doi.org/10.1177/0020872820904135
- Harutyunyan, H., Mukhaelyan, A., Hertelendy, A. J., Voskanyan, A., Benham, T., Issa, F., Hart, A. et Ciottone, G. R. (2021). The psychosocial impact of compounding humanitarian crises caused by war and CoViD-19 informing future disaster response. Prehospital and Disaster Medicine, 36(5), 501–502.
- Hay, K. et Pascoe, K. M. (2021, Jul 2021). Social Workers and Disaster Management: An Aotearoa New Zealand Perspective. British Journal of Social Work, 51(5), 1531–1550. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab127
- Hernandez, P., Gangsei, D. et Engstrom, D. (2007). Vicarious resilience: A qualitative investigation into a description of a new concept. Family Process, 46(2), 229–241.
- Hickson, H. et Lehmann, J. (2014). Exploring social workers’ experiences of working with bushfire-affected families. Australian Social Work, 67(2), 256–273.
- Kranke, D., Der-Martirosian, C., Hovsepian, S., Mudoh, Y., Gin, J., Weiss, E. L. et Dobalian, A. (2020). Social workers being effective in disaster settings. Social Work in Public Health, 35(8), 664–668. https://doi.org/10.1080/19371918.2020.1820928
- Kranke, D., Gioia, D., Mudoh, Y. et Dobalian, A. (2022). Nothing Beats Experience: Case Study of How Withstanding the Effects of a Prior Disaster Impacted Provider Preparedness and Response during the Pandemic [Article]. Health & Social Work, 47(3), 225–228. https://doi.org/10.1093/hsw/hlac015
- Kranke, D., Mudoh, Y., Weiss, E. L., Hovsepian, S., Gin, J., Dobalian, A. et Der-Martirosian, C. (2022). ‘Emotional preparedness’: a nuanced approach to disaster readiness among social workers [Article]. Social Work Education, 41(5), 860–873. https://doi.org/10.1080/02615479.2021.1900099
- Kusmaul, N., Beltran, S., Buckley, T., Gibson, A. et Bern-Klug, M. (2021). Structural Characteristics of Nursing Homes and Social Service Directors that Influence Their Engagement in Disaster Preparedness Processes [Article]. Journal of Gerontological Social Work, 64(7), 775–790. https://doi.org/10.1080/01634372.2021.1933293
- Lane, P., McKenna, H., Ryan, A. A. et Fleming, P. (2001). Focus Group Methodology. Nurse Researcher, 8(3), 45–59. https://doi.org/10.7748/nr2001.04.8.3.45.c6157
- Maltais, D. (2015). Situation de crise, de tragédie ou de sinistre : le point de vue des professionnels. Les Presses de l’Université Laval.
- Maltais, D. et Bolduc, V. (2016). Les conséquences des catastrophes technologiques sur la santé globale des individus. Dans D. Maltais et C. Larin (dir.), Lac-Mégantic: de la tragédie... à la résilience. Presses de l’Université du Québec.
- Maltais, D., Bolduc, V., Gauthier, V. et Gauthier, S. (2015). Les retombées de l’intervention en situation de crise, de tragédie ou de sinistre sur la vie professionnelle et personnelle des intervenants sociaux des CSSS du Québec. Intervention, (142), 51–65.
- Maltais, D. et Gerin, N. (2018). Intervenir en situation d’urgence sociale: les deux côtés de la médaille.
- Maltais, D., Lansard, A.-L. et Généreux, M. (2021). Les stratégies d’intervention déployées lors des inondations de 2019: le point de vue d’intervenants de première et de deuxième lignes sur les avenues prometteuses : Rapport synthèse. Saguenay: GRIR-UQAC.
- Maltais, D. et Lansard, D. (2022). Intervention de crise en contexte d’inondation : les conséquences sur la santé et la performance au travail des intervenants psychosociaux. Dans T. Buffin-Bélanger, D. Maltais et M. Gauthier (dir.), Les inondations au Québec: risques, aménagement du territoire, impacts socioéconomiques et transformation des vulnérabilités. (p. 345–365). Les Presses de l’Université du Québec.
- Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., Connors, S. L., Péan, C., Berger, S., Caud, N., Chen, Y., Goldfarb, L. et Gomis, M. (2021). Climate change 2021: the physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, 2.
- Miller, V. J., Anderson, K., Fields, N. L. et Kusmaul, N. (2022). “Please Don’t Let Academia Forget about Us:” An Exploration of Nursing Home Social Work Experiences during COVID-19 [Article]. Journal of Gerontological Social Work, 65(4), 450–464. https://doi.org/10.1080/01634372.2021.1978027
- Organisation mondiale de la santé. (2021). Changement climatique et santé. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
- Ramos, C. et Leal, I. P. (2013). Posttraumatic growth in the aftermath of trauma: A literature review about related factors and application contexts. Psychology, Community & Health, 2, 43–54.
- Raphael, B. (1986). When disaster strikes: A handbook for the caring professions. Hutchinson London.
- Robinson, N. (1999). The use of focus group methodology : With selected examples from sexual health research. Journal of advanced nursing, 29(4), 905–913. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.00966.x
- Saulnier, C. F. (2000). Groups as data collection method and data analysis technique: Multiple perspectives on urban social work education. Small group research, 31(5), 607–627. https://doi.org/10.1177/104649640003100506
- Stocker, T. F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M. M., Allen, S. K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V. et Midgley, P. M. (2014). Climate Change 2013: The physical science basis. contribution of working group I to the fifth assessment report of IPCC the intergovernmental panel on climate change.
- Tominaga, Y., Goto, T., Shelby, J., Oshio, A., Nishi, D. et Takahashi, S. (2020). Secondary trauma and posttraumatic growth among mental health clinicians involved in disaster relief activities following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami in Japan. Counselling Psychology Quarterly, 33(4), 427–447.
- Tosone, C. (2019). Shared trauma and social work practice in communal disasters. Dans International perspectives on social work and political conflict (p. 50–64). Routledge.
- Tosone, C., McTighe, J. P. et Bauwens, J. (2015). Shared traumatic stress among social workers in the aftermath of Hurricane Katrina. British Journal of Social Work, 45(4), 1313–1329.
- Trumello, C., Bramanti, S. M., Ballarotto, G., Candelori, C., Cerniglia, L., Cimino, S., Crudele, M., Lombardi, L., Pignataro, S. et Viceconti, M. L. (2020). Psychological adjustment of healthcare workers in Italy during the COVID-19 pandemic: differences in stress, anxiety, depression, burnout, secondary trauma, and compassion satisfaction between frontline and non-frontline professionals. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), 8358.
- Wu, H. (2021). Integration of the Disaster Component into Social Work Curriculum: Teaching Undergraduate Social Work Research Methods Course during COVID-19 [Article]. British Journal of Social Work, 51(5), 1799–1819. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab110
List of tables
Tableau 1
Fonction et milieu professionnel des personnes ayant participé aux rencontres de groupe