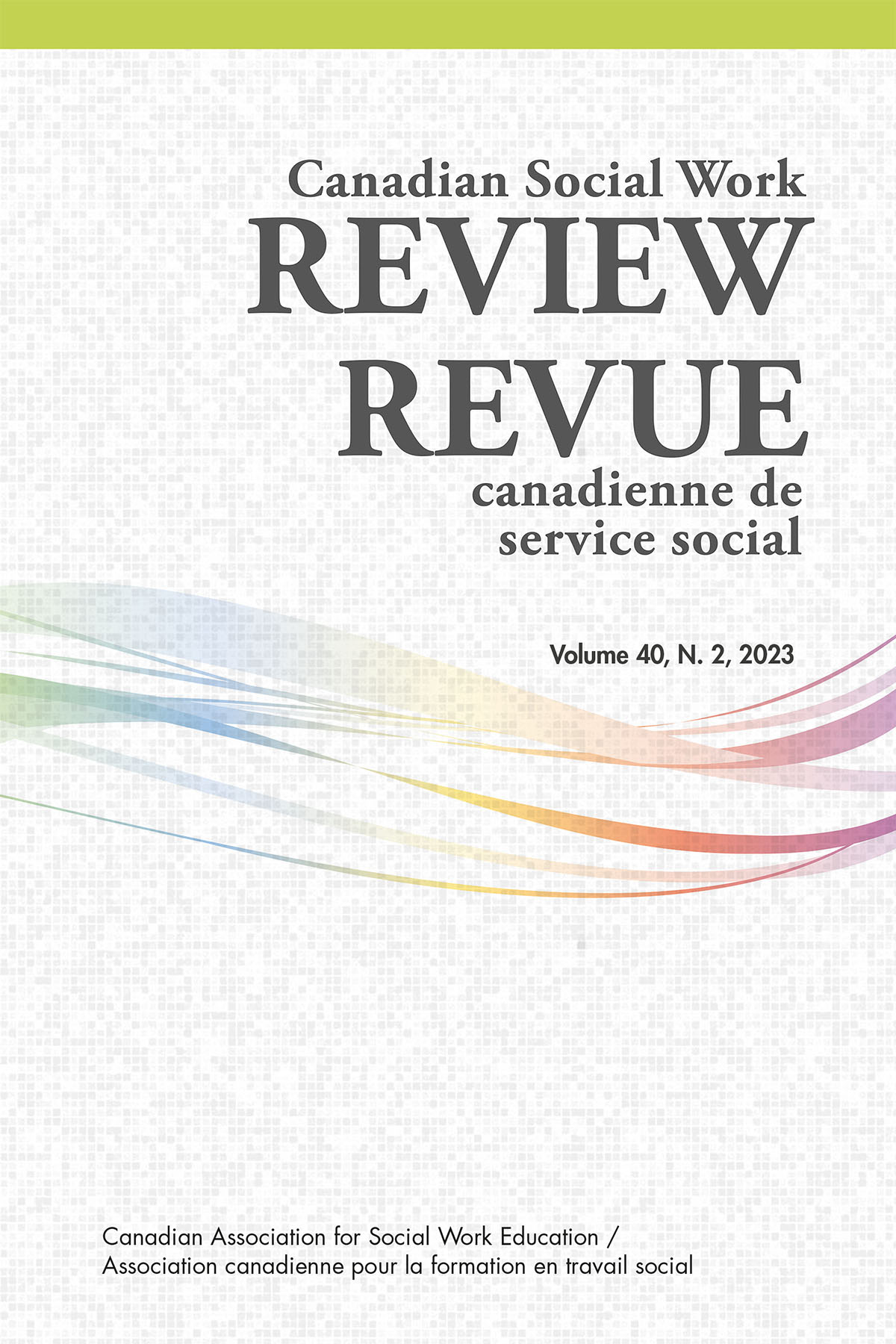Abstracts
Résumé
Devant l’urgence d’adapter et d’innover la pédagogie – en réponse à la nouvelle réalité de l’apprentissage à distance imposée à toutes les instances éducatives pendant la pandémie de COVID-19 –, les autrices de cet article, regroupant des professeures, chargées de cours, étudiantes et praticiennes affiliées à deux écoles de travail social, se sont réunies pour collaborer au développement d’une série d’épisodes sur des récits de pratique sous forme de baladodiffusion pour soutenir la formation pratique. Cette série, conçue pour faire le lien entre la théorie et la pratique dans l’intervention en travail social, soutient également les cours de formation sur le terrain en présentant divers environnements de travail social. Le but de cet article est de partager notre parcours d’apprentissage lors de la création de cette série destinée à être intégrée dans l’enseignement des futures travailleuses sociales et futurs travailleurs sociaux. Nous y abordons l’émergence et le développement de ce projet, ainsi que les défis et éléments facilitateurs que nous avons rencontrés. Les présentes réflexions sont appelées à nourrir la prise de décisions d’autres personnes oeuvrant en enseignement supérieur et qui souhaitent élaborer un tel outil.
Mots-clés :
- enseignement supérieur,
- baladodiffusion,
- travail social,
- collaboration interuniversitaire,
- formation pratique
Abstract
In response to the new reality of distance education imposed in all areas of teaching and learning during the COVID-19 pandemic and the urgency to adapt to this new reality with innovative pedagogical practices, a group comprised of university teachers, lecturers, students, and practitioners affiliated with two schools of social work in Québec developed a podcast series. It features the voices of social workers in diverse practice settings and was designed to bridge theory and practice in social work intervention, thereby supporting social work practice as well as field education courses. The purpose of this article is to share lessons learned in our co-creation journey, to discuss the emergence and development of this project as well as the challenges and facilitators we encountered. We document our reflections to inform others who might wish to develop such a tool in higher education.
Keywords:
- post-secondary education,
- podcasts,
- social work,
- inter-university collaboration,
- field education
Article body
Cet article vise à partager nos parcours d’apprentissages et nos expériences en ce qui concerne le processus de cocréation d’une série d’épisodes de baladodiffusion (podcast) à des fins pédagogiques en vue de son intégration dans des cours d’intervention individuelle au baccalauréat en travail social. Selon Anastas (2010), le corps enseignant en travail social a toujours adopté et adapté les technologies soutenant l’enseignement et l’apprentissage, notamment pour donner accès aux cours à un plus grand nombre de personnes et pour diversifier le matériel d’apprentissage. Au fur et à mesure que de nouveaux modes de transmission des matériaux sont devenus disponibles, les technologies ont été utilisées pour offrir des cours en ligne en travail social et rejoindre des personnes étudiantes vivant dans des régions éloignées. D’autres utilisent des blogues ou diverses plateformes de médias sociaux dans les activités pédagogiques pour créer des environnements d’apprentissage amusants et stimulants. Toujours selon cette autrice, les technologies sont progressivement et régulièrement intégrées aux cours à un rythme qui correspond à celui de la capacité du corps enseignant à s’adapter aux nouvelles méthodes de travail. Pour rapprocher le terrain du travail social et la salle de cours, d’autres stratégies pédagogiques, comme la participation de personnes conférencières-praticiennes invitées, offrent aux personnes étudiantes des occasions concrètes de commencer à envisager les liens entre théorie et pratique.
Cependant, la pandémie de COVID-19, débutant en 2020, a propulsé un nombre de personnes enseignantes universitaires sur le terrain peu fréquenté de l’enseignement à distance, ce qui a posé plusieurs défis. Ceux-ci incluent le besoin de mettre en ligne les contenus des cours et leurs supports, et de développer de nouvelles méthodes de travail en accéléré. Le personnel enseignant a dû trouver de nouveaux moyens pour illustrer de manière pratique les savoirs théoriques. Alors que par le passé, les travailleuses sociales et travailleurs sociaux invités en classe auraient été des personnes-conférencières invitées, plusieurs étaient mal à l’aise de parler à des groupes de personnes étudiantes par visioconférence, ou n’étaient pas disponibles pendant les heures du cours. Le personnel enseignant, quant à lui, a hésité à inviter des personnes pour des présentations virtuelles dans un contexte où on constatait que les milieux de pratique devaient s’adapter rapidement à cette nouvelle réalité et étaient débordés. Le personnel s’inquiétait de la façon dont les personnes invitées se sentiraient en parlant à des groupes de personnes étudiantes dont les caméras restaient éteintes (pour diverses raisons). À cela s’ajoutent les défis vécus par les personnes étudiantes. Pour beaucoup, les contraintes des responsabilités familiales, scolaires, professionnelles et financières (comme les frais de connexion à internet) ont rendu difficile leur participation à des classes synchrones. Ainsi, les nouvelles contraintes vécues par les personnes étudiantes et les membres du corps enseignant et professionnel et dues au contexte d’apprentissage à distance ont poussé les personnes formatrices et enseignantes à innover. Ceci est passé par l’apprentissage rapide de nouvelles méthodes, comme l’utilisation d’outils de conférence en ligne – et l’animation d’activités d’apprentissage sous cette nouvelle forme –, l’ajustement des plans de cours et la gestion de la dynamique des classes offertes en ligne, tout en offrant du contenu pertinent aidant les personnes étudiantes à progresser dans leur formation.
Dans cet article, après avoir fait un bref état des stratégies pédagogiques existantes pour la formation pratique en travail social, nous présentons l’évolution de ce projet de baladodiffusion (podcasting), les enjeux qui se sont posés et les éléments permettant de les dépasser. Nous abordons ensuite la méthode que nous avons utilisée pour documenter le projet, avant de terminer par une discussion quant à la co-construction, le co-leadership et les modèles collaboratifs qui sont au coeur de nos réflexions.
Mise en perspective
Des créations récentes dans le soutien de la formation pratique en travail social
Les membres enseignants qui participent à la préparation à la pratique des personnes étudiantes en travail social ont la responsabilité de promouvoir les connaissances, les valeurs et les compétences de la profession (Anastas, 2010 ; Law et Rowe, 2019). Pour ce faire, une série de stratégies pédagogiques sont utilisées pour soutenir les personnes étudiantes dans la réflexion sur les situations problématiques rencontrées par les individus, les familles, les groupes ou les communautés et mettre en pratique les compétences de la discipline. Au cours des 15 dernières années, des collègues en travail social ont documenté les stratégies pédagogiques en soutien à la formation pratique. À la Faculté de travail social Factor-Inwentash de l’Université de Toronto, par exemple, les personnes étudiantes peuvent participer à des ateliers de simulation pour mettre en pratique leurs compétences en matière de communication, d’entretien et d’évaluation avec un acteur (Kourgiantakis et coll., 2019 ; Craig et coll., 2017). Cette compétence est comprise par Craig et coll. comme étant « informée par les connaissances, les valeurs, les aptitudes et les processus cognitifs et affectifs qui incluent la pensée critique, les réactions affectives et l’exercice du jugement du travailleur social à l’égard de situations de pratique uniques » (Craig et coll., 2017, p. 6). Il existe un corpus croissant de littérature présentant les méthodes utilisées pour enseigner les compétences, notamment le savoir-être (régulation, émotion, réflexion, conscience de soi), les savoirs (théoriques et empiriques) et la réflexion critique (Kourgiantakis et coll., 2019). Cependant, ce corpus de littérature émerge de travaux menés avec des personnes étudiantes de deuxième cycle en travail social dont les identités professionnelles sont peut-être mieux établies que celles des personnes étudiantes de premier cycle, dont beaucoup n’ont pas encore intégré le terrain. Dans le cadre de ce projet, nous cherchions des idées pour amener le terrain à ces dernières dans leurs cours d’intervention individuelle en travail social, cours dans lesquels elles commencent à expérimenter et à mettre en pratique des compétences en travail social. Nous avons estimé qu’une série d’épisodes de baladodiffusion, mettant en vedette les voix des personnes travailleuses sociales locales, pourrait fournir aux membres étudiants un regard sur le travail quotidien de ces professionnel(le)s.
La baladodiffusion dans l’enseignement supérieur
Des recherches récentes soutiennent la nécessité d’intégrer des outils numériques qui peuvent aider à former les intervenantes et intervenants psychosociaux à mettre en oeuvre les bonnes pratiques de manière efficace (Herschell et coll., 2010). Les épisodes de baladodiffusion sont un de ces outils numériques utilisés dans les milieux universitaires (Weingardt, 2004). Ils sont offerts dans trois types de format : audios, vidéos ou mixtes (audio avec images) (McCombs et coll., 2007). Temperman et De Lièvre (2009) distinguent deux types d’utilisations possibles dans l’enseignement : un usage autonome et un usage intégré. Dans notre projet, les épisodes créés sont de type audio et ont été conceptualisés pour un usage autonome. Temperman et De Lièvre (2009, p. 183) écrivent : « L’usage autonome est le plus fréquent. Il correspond à la situation où le podcast est mis à disposition comme support complémentaire au cours présentiel et aux notes de cours fournies par l’enseignant. Dans ce contexte, il peut être utilisé librement comme support de remédiation ou d’enrichissement personnel par l’apprenant. »
Les caractéristiques des épisodes de baladodiffusion (polyvalents, réutilisables, intéressants et stimulants) sont attrayantes pour les personnes étudiantes technophiles, qui en tirent profit de plusieurs façons, et pour répondre à une panoplie de besoins, notamment en termes de temps, de contenu, et de rythme (Van Zanten et coll., 2012). De plus, « Pour l’étudiant à distance, le podcasting a un potentiel encore plus grand, car il favorise un sentiment d’inclusion et d’appartenance à la communauté d’apprentissage, et réduit l’anxiété induite par l’isolement » (Lee et Chan, 2007, cités dans Van Zanten et coll., 2012, p. 130, traduction libre). Ainsi, les épisodes de baladodiffusion sont des outils à fort potentiel en contexte d’enseignement à distance et constituent une alternative pour soutenir le processus d’apprentissage. Plusieurs études rapportent que les membres étudiants universitaires ont déclaré qu’ils tiraient des enseignements de ce mode d’apprentissage (Salloum et Smyth, 2013). Quant aux membres enseignants, ils estiment que ces types d’outils permettent une communication et une interaction directes avec les personnes étudiantes et vont au-delà de l’enseignement traditionnel en complémentant le matériel pédagogique.
La collaboration : une réponse à une situation d’urgence
Compte tenu du contexte de pandémie, la nécessité de collaborer est devenue cruciale pour relever un défi qui semble considérable pour les individus. En période de crise, les ressources d’une seule personne sont facilement dépassées lorsqu’il s’agit de créer de nouveaux outils numériques à intégrer dans l’enseignement supérieur. Par conséquent, à partir de 2020, le personnel enseignant a dû unir ses forces pour répondre au besoin pressant d’innovation en matière d’enseignement virtuel. La collaboration entre les autrices de cet article et une autre étudiante nous a permis de mettre en commun notre expertise, nos différents savoirs et nos ressources. Une tâche très importante de la collaboration concerne la prise de décisions partagées et la gouvernance collaborative (Simard, 2020). Il s’agit d’une relation de gouvernance dans laquelle les parties prenantes travaillent en partenariat, reconnaissant la nécessité de travailler de concert, sur une base égalitaire, pour relever des défis complexes (Jeanes, 2019). De toute évidence, la collaboration est une méthode de travail qui met de côté la compétitivité et respecte l’autonomie des personnes impliquées (Simard, 2020). Ainsi, l’une des forces de cette valeur réside dans la mise en commun de ressources (financières, techniques et humaines) pour faire face collectivement a une situation. Toutefois, le désir de partager le pouvoir et les ressources en vue d’atteindre un objectif commun n’élimine pas le risque de conflits au sein de l’équipe (Graham et Barter, 1999). Collard-Fortin et ses collègues (2022) en évoquent quatre potentiels qui peuvent émerger : 1) un « mur invisible » étroitement lié aux facteurs humains et à la difficulté de créer un environnement de travail favorable et propice aux échanges ; 2) un manque de ressources, notamment financières et en termes d’engagement de certaines personnes actrices, ou encore en ce qui a trait à, 3) l’organisation du travail et le partage des tâches et des responsabilités ; et 4) au maintien de la collaboration.
Après ce tour d’horizon de la place de la baladodiffusion dans l’enseignement supérieur et du besoin de collaborer dans le contexte particulier de la pandémie, il convient dorénavant de présenter notre projet.
Genèse et évolution d’un projet de co-construction d’une série de baladodiffusion
Les épisodes de baladodiffusion ont été conçus pour accompagner les cours d’intervention individuelle de premier cycle en travail social. L’objectif principal de ces cours est de préparer la rentrée éventuelle en placement en stage dans des organismes et d’appuyer la formation pratique en introduisant l’application des théories dans le processus d’évaluation et d’analyse du fonctionnement social des individus. Les personnes étudiantes y sont soutenues pour développer des compétences d’analyse critique qui les aideront à examiner des situations problèmes par l’entremise de différentes activités et différents outils, tels que des vignettes, des jeux de rôle et des journaux de bord réflexifs. En nous inspirant de ces dispositifs, nous avons conceptualisé les épisodes de baladodiffusion comme un outil supplémentaire pour soutenir l’apprentissage et la réflexion. Nous avons imaginé qu’en écoutant les personnes professionnelles en travail social décrire leur travail, les étudiantes et étudiants seraient également exposés à des idées sur la manière de « faire » du travail social et de réfléchir à des situations avec les personnes qui sont dans un processus de changement.
L’équipe de base du projet est constituée de six personnes, soit de deux professeures qui enseignent des cours d’intervention individuelle de première et de deuxième année de baccalauréat en travail social dans deux universités francophones de Montréal : l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’Université de Montréal (UdeM) ; de deux doctorantes ayant été intervenantes sociales, l’une étant chargée de cours et l’autre auxiliaire d’enseignement ; et finalement d’une travailleuse sociale clinicienne et d’une étudiante, toutes deux inscrites dans un programme de maîtrise en travail social. Cette dernière collaboratrice a contribué au projet durant la première année. C’est à la suite de discussions informelles entre les professeures et la travailleuse sociale intéressée par l’enseignement qu’est née l’idée de ce projet-pilote, auquel se sont jointes rapidement les trois autres étudiantes. À cette équipe de base se sont ajoutées d’autres étudiantes à la maîtrise et une professeure, toutes en travail social, qui se sont impliquées de manière ponctuelle pour notamment réaliser les entrevues, finaliser les fiches associées à chaque épisode ou participer au matériel pédagogique.
Les épisodes de baladodiffusion ont été envisagés sous forme d’entrevues conçues pour entrer en contact avec des travailleuses sociales ou travailleurs sociaux francophones, principalement basés et pratiquant à Montréal. Les professeures ont rapidement identifié qu’il serait important de lier le contenu des épisodes aux différents aspects de l’évaluation du fonctionnement social, un outil d’évaluation utilisé par les membres professionnels du travail social au Québec. La clinicienne participante au projet entretenait des objectifs plus personnels. En tant que superviseure clinique travaillant dans un contexte de services psychosociaux de première ligne, elle était intéressée à s’engager dans une discussion concernant la pédagogie des personnes étudiantes en formation et souhaitait également apporter son expertise à leur formation.
En considérant les préoccupations respectives, nous avons pris le temps d’identifier nos objectifs et la manière de les atteindre. Notre projet n’a pas fait l’objet d’un financement à long terme, bien que nous ayons pu obtenir un montant modeste de la part de nos départements et fonds de recherche. Nos objectifs et nos décisions ont donc été guidés par ce facteur limitatif. Parmi les premières questions que nous nous sommes posées quant à l’élaboration de nos épisodes, citons : qui seront les personnes enquêtrices, et celles interrogées ? Comment ferons-nous l’enregistrement et le montage pendant la période de pandémie ? Souhaitons-nous catégoriser nos épisodes en fonction des différents éléments d’une évaluation du fonctionnement social, ou du travail social dans divers contextes, ou encore de techniques et de compétences d’intervention ? Voulions-nous inclure des réflexions théoriques ? Qui aurait accès à ces entretiens ? Notre liste d’options était longue. Nous avons réfléchi à ces questions, et à bien d’autres, puis identifié les choix qui seraient fixes et ceux qui seraient plus « organiques », soit des choix que nous reconsidérerions avec le temps.
Processus de mise en place du projet
En réfléchissant au fonctionnement du projet, l’idée de mise en commun s’est imposée pour le partage d’informations et d’idées en dehors des rencontres au moyen de la plateforme de visioconférence Microsoft Teams, qui permettrait à toutes les membres des deux universités de collaborer, d’avoir accès aux documents et donc d’aider dans l’organisation des idées et des rencontres. Au cours des 18 mois de ce projet pilote, qui a débuté le 8 octobre 2020, 18 rencontres se sont tenues à raison d’une ou deux par mois entre les membres de l’équipe de base, auxquelles se sont jointes ponctuellement les autres membres, soit 12 la première année et six pour les six mois suivants. Elles se sont poursuivies jusqu’en janvier 2023 et ont permis le partage d’opinions, d’expertises, de points de vue et de besoins en lien avec l’enseignement ou la pratique du travail social. Lors de la première année, le contenu des rencontres portait sur la mise sur pied et le suivi du projet. À la suite de chacune, un procès-verbal était établi et déposé dans un dossier partagé pour ce projet, sur la plateforme Microsoft Teams. De plus, dès les débuts, l’équipe a réfléchi aux quatre questions clés et aux processus de prise de décision suivants :
Quels sont le rôle et la contribution de chaque personne dans l’équipe ?
Quel est le public visé par les épisodes de baladodiffusion ?
Quels éléments du projet seront fixes et lesquels seront adaptés aux réalités changeantes ?
Quelles sont les ressources financières, techniques et humaines disponibles pour assurer la durabilité du projet ?
Ces rencontres ont également permis d’envisager les manières d’intégrer des épisodes de baladodiffusion dans les plans de cours et dans l’enseignement. Des questionnements ont vite surgi quant à leur place dans les cours, tels que : faut-il qu’ils soient ajoutés aux lectures envisagées, qu’ils les remplacent, qu’ils fassent partie des évaluations des étudiantes et étudiants ?
En ce qui a trait à la réalisation du contenu des épisodes, l’équipe de base s’est entendue sur une liste de sujets variés, qui a évolué dans le temps, et de questions à poser, en se rapportant toujours aux objectifs du projet et aux différents plans de cours. Nous sommes rapidement parvenues à un consensus à l’effet de créer un guide d’entretien semi-structuré de plusieurs questions et de laisser une certaine liberté aux personnes interrogées et interrogeant. Cette liberté passe par le choix de deux à trois questions tirées de ce guide et du temps consacré à l’entretien (l’objectif étant toutefois de maintenir ce dernier à une durée de 20 à 45 minutes). Il a également été convenu que toutes les entrevues se dérouleraient en français et seraient menées avec des personnes professionnelles en travail social intervenant à Montréal ou dans les communautés autochtones du Québec. Ces personnes ont été sélectionnées à partir des contacts professionnels de membres de l’équipe du projet (une étudiante à la maîtrise, une au doctorat et une clinicienne) en mettant l’accent sur la diversité des individus, des environnements et des perspectives. Au-delà des thèmes, des personnes potentielles et du contenu identifiés, nous avons pris en considération des enjeux éthiques, soit la confidentialité et la protection des informations sur les personnes interviewées, et avons créé un formulaire d’information et de confidentialité pour les personnes participant à l’enregistrement. En parallèle, d’autres aspects ont été envisagés, tels que ceux touchant aux techniques de la production (enregistrement et montage sonores), aux méthodes de diffusion et leur utilisation à des fins pédagogiques et aux besoins financiers. Tous les documents créés, incluant ceux traitant du fonctionnement (formulaires d’information et de consentement aux entrevues, guides d’utilisation des plateformes logicielles permettant leur enregistrement, soit Zoom et Audacity) et les enregistrements eux-mêmes, ont été déposés sur le même espace de la plateforme Microsoft Teams pour les rendre accessibles à toutes les membres de l’équipe. De plus, très vite, une demande de financement a été rédigée par les professeures pour engager un ou une professionnel(le) du montage sonore.
Grâce aux échanges entre les membres de l’équipe, à la création des outils décrits plus haut et au financement minimal initial, deux épisodes ont été créés en deux mois et utilisés dans les cours d’intervention individuelle donnés aux deux universités participantes. À partir de ces deux réalisations, l’équipe a pu constater, en plus de la manière dont les deux intervieweuses ont vécu l’expérience, les éléments facilitants et les difficultés. Lors de la réalisation d’une entrevue à distance par la plateforme Zoom, l’enjeu de laisser des temps de parole à chacune des intervenantes afin de donner une meilleure qualité d’écoute, peut se poser. Ces deux premiers épisodes ont également permis d’illustrer concrètement l’utilisation possible d’un tel matériel dans un cours. Il s’est vite avéré que leur contenu, intégrant des éléments tant généraux liés à une problématique sociale, que spécifiques (par exemple dans une forme ou une habilité) liées à l’intervention sociale selon le contexte, permet de faire des liens entre le contenu théorique des enseignements et le savoir-faire et savoir-être des personnes praticiennes, permettant ainsi d’alimenter des discussions dans les cours. Durant ce projet-pilote, 14 entretiens ont été réalisés, dont 12 ont été édités par un professionnel de l’enregistrement audio et deux ont été mis de côté pour être refaits (car ils ne satisfaisaient pas les personnes interrogées, qui conservent un droit de regard sur l’enregistrement finalisé, requéraient trop de montage ou n’apportaient pas d’informations nouvelles). Nous avons recruté et interrogé des personnes professionnelles du travail social qui pratiquent notamment dans des hôpitaux, des refuges pour femmes, auprès d’hommes et de la gestion de la colère, dans des communautés autochtones, des écoles et des organismes communautaires locaux. Ces professionnel(le)s abordent des thèmes tels que l’évaluation du fonctionnement social, la posture éthique, le lien de confiance, les apports de la pratique en milieux communautaires et institutionnels, ainsi que différentes approches d’interventions sociales telles que celle informée par le traumas ou préventive pour les femme enceintes en situation de vulnérabilité.
L’archivage et la diffusion des épisodes font encore l’objet d’échanges, et ce, depuis janvier 2020. Une fiche descriptive est associée à chaque épisode, de même qu’une liste de suggestions de lectures que les personnes interrogées trouvent pertinentes à leur pratique. Toutefois, Teams requiert une gestion des accès au contenu et pourrait offrir un espace d’échanges en ligne (bien que ça n’ait pas été jugé souhaitable en raison de la charge de travail supplémentaire que son implémentation impliquerait). De plus, la possibilité d’élargir la diffusion des épisodes auprès de personnes étudiantes, enseignantes d’autres disciplines ou professionnelles en travail social est toujours en discussion par l’équipe du projet plus restreinte. Les réflexions à ce sujet se poursuivent, notamment quant à la plateforme logicielle à utiliser et au respect des conditions liées au consentement des personnes interrogées. Enfin, plus récemment, nos objectifs se sont adaptés pour répondre à la demande de personnes étudiantes qui ont eu l’occasion d’écouter les premiers épisodes et qui souhaitent que le contenu soit directement lié aux stages pratiques qu’elles effectueront. En réponse, nous avons réalisé un nouveau projet-pilote invitant deux étudiantes à partager leurs expériences de stage. Nous poursuivrons ces entretiens baladodiffusés entre membres étudiants dans la prochaine phase du projet.
Après quelques mois et une fois les premiers épisodes créés, l’équipe de base a cherché à prendre du recul et à réfléchir sur l’organisation du travail, la diffusion des épisodes et la création d’un site dédié au projet. Il s’agissait de porter un regard plus large sur ce qui avait été réalisé, sur la planification du projet et sur différentes formes envisageables. À titre d’exemple, la conception de mises en situation audio ou le fait d’interroger des étudiant(e)s en stage plutôt que des professionnel(le)s ont été envisagés. Ces réflexions ont permis de faire avancer le projet, d’élargir les possibilités et les contenus, tout en restant connectées aux besoins établis et révisés (notamment à la suite des sondages des membres étudiants).
Enjeux rencontrés au cours du projet
Au fil du projet, plusieurs enjeux ont été rencontrés. Le manque de ressources financières et humaines, qui fait partie des défis potentiels à la collaboration identifiés par Collard-Fortin et coll. (2022), était l’un des facteurs les plus critiques que notre équipe a rencontrés. Nous avons dû y faire face à deux niveaux principaux : l’instabilité du financement et la rotation rapide des employées. De plus, comme nous avons choisi de suivre un modèle de gouvernance collaborative (Simard, 202), nous avons vite été confrontées à la difficulté de l’organisation du travail et de la répartition des tâches à accomplir sous un modèle de leadership horizontal qui n’était pas exempt de défis.
Manque de ressources
Financement instable. Le financement pour ce projet n’était ni stable ni récurrent puisqu’il n’était ni le produit d’une recherche financée ni un projet formel provenant des Écoles de travail social des deux universités francophones montréalaises. Il a été obtenu par le biais de petites sommes départementales réservées pour le soutien pédagogique pendant la pandémie de COVID-19. Les montants obtenus sont restés limités et les demandes pour diversifier les sources de financement possibles – qui restent restreintes dans ce milieu – se sont avérées coûteuses en termes de temps. Le manque de financement a fait en sorte que toutes les membres de notre équipe sauf une étaient bénévoles. Cela a conduit à élargir notre comité en incluant d’autres personnes pour contribuer au développement du projet. À cela s’ajoute le fait que, faute de financement stable, la continuité dans l’embauche de personnes employées est demeurée incertaine.
Employées à contrat. Pendant notre recherche de financement, trois étudiantes ne faisant pas partie de l’équipe initiale ont été successivement engagées, notamment pour participer à la diffusion des épisodes. Cette succession de personnes a engendré des difficultés en lien avec la transmission des connaissances, l’appropriation du projet et la manière d’envisager la diffusion. Ces différents enjeux sont également liés à la structure et au fonctionnement même de l’équipe.
Organisation du travail et structure de gouvernance
Gouvernance collaborative. Depuis les débuts du comité, et bien qu’il regroupe des personnes enseignantes, étudiantes et praticiennes, les décisions sont prises collectivement, sans qu’une hiérarchie particulière (par exemple, sur la base des fonctions ou des responsabilités de chacune) intervienne. Chaque voix est considérée avec la même importance. Les personnes présentes apportent leur expertise quant aux besoins en matière d’enseignement et leur angle d’analyse, qui varient selon leur fonction. Les échanges sont ouverts. Cependant, cette structure horizontale a conduit parfois à un manque de leadership et à une profusion d’idées, d’outils pédagogiques à développer ou de directions proposées. Certains éléments revenaient d’une rencontre à l’autre, car les décisions n’étaient pas toujours tranchées ou les prises de positions claires. Nous avons réalisé que la gouvernance collaborative peut parfois donner l’impression que le projet et son élaboration ralentissent. De même, bien que les membres aient clairement valorisé le respect des opinions diverses au cours des échanges, le temps nécessaire pour arriver à des décisions consensuelles était important.
Temps. Dans le cadre de l’organisation du travail, on ne peut ignorer le temps considérable investi dans la planification des réunions et la coordination des différentes tâches liées à la production des épisodes (conceptualisation, réalisation, puis montage). Chaque phase a requis un temps considérable, depuis l’autoapprentissage technique des outils d’enregistrement jusqu’au montage et la vérification, en passant par la recherche de personnes professionnelles et l’enregistrement des entretiens eux-mêmes. Tout cela étant réalisé en co-construction, il a fallu beaucoup de va-et-vient entre les membres pour s’assurer que tout convenait à tous. À cela s’ajoutent le nombre d’épisodes réalisés (n = 12) et le développement des contenus similaires.
Toutefois, malgré ces défis, plusieurs éléments ont contribué à la réussite du projet ; nous les décrivons plus bas.
Éléments facilitateurs
Les éléments facilitateurs les plus importants de ce projet sont la base relationnelle déjà existante entre certains membres, leur investissement dans le projet et leur conviction dans les retombées bénéfiques pour la formation. Nous reconnaissons également la valeur d’une mise en commun des expertises, des ressources et des connaissances de plusieurs membres, apportant diverses perspectives pour répondre à une préoccupation commune.
Base relationnelle
Continuité. Plusieurs membres de l’équipe se connaissaient avant de débuter le projet ; leurs relations étaient donc d’ordre personnel avant d’être professionnelles. L’équipe s’est élargie à la suite des recommandations des trois premières conceptrices du projet. Les nouvelles participantes, par contre, connaissaient minimalement une des trois conceptrices. Cela a contribué à réunir des personnes partageant des valeurs communes et de maintenir une certaine continuité dans la collaboration.
Les deux professeures, provenant respectivement de l’UdeM et de l’UQAM, ont été désignées pour assurer la continuité du projet quand l’équipe de base s’est scindée en deux sous-équipes. Cette scission s’est opérée en raison des besoin des enseignantes, des intérêts à développer de nouveau outils pédagogiques et a l’ampleur des taches à réaliser compte tenu de l’arrivée de nouveaux membres de l’équipe. Il a été convenu qu’une professeure travaillerait sur le contenu et la réalisation d’épisodes, alors que l’autre s’occuperait de la création d’une trousse pédagogique. Elles ont permis de faire le lien entre les sous-équipes et de conserver une continuité quant aux différents besoins pédagogiques.
Personnes investies. Un autre élément qui a facilité nos différentes réalisations est l’engagement enthousiaste des personnes de l’équipe, qui ont travaillé bénévolement et se sont investies pleinement, autant en termes de temps que d’échange d’idées. Elles étaient motivées pour créer un nouvel outil qui soutiendrait la formation et étaient très enthousiastes à l’idée de fournir des informations sur les milieux de pratique aux personnes étudiantes qui se préparaient à un stage.
La mise en commun des ressources et des connaissances
Fonds de base. Le projet n’aurait pu être réalisé sans les contributions provenant des fonds financiers de base des deux Écoles de travail social des universités impliquées, ainsi que des fonds de recherche des professeures.
Des perspectives diversifiées. L’hétérogénéité de notre équipe a permis de diversifier les perspectives et de répondre à une variété de préoccupations. Par exemple, les enseignantes souhaitaient réduire le temps d’écran des personnes étudiantes et offrir du contenu dynamique et riche. Le souhait de la praticienne était de mettre en valeur le rôle et les réalisations des professionnel(le)s sur le terrain. Les doctorantes, quant à elles, tenaient à présenter différents milieux de pratique et différentes tâches afin d’aider les personnes étudiantes à choisir le contexte de stage le plus approprié à leurs souhaits et le plus stimulant.
En résumé, et avant de présenter la méthode de documentation du projet et les résultats préliminaires, nous proposons plus bas des exemples de tâches pour ceux et celles qui cherchent à développer des projets de baladodiffusion dans leur propre contexte éducatif.
Tâches à envisager
Dans le tableau suivant, nous exposons les traits essentiels du projet, les décisions que nous avons prises et leurs justifications.
Méthode de documentation du projet
Dès les débuts du projet, nous avons souhaité documenter cette expérience de cocréation d’une série d’épisodes de baladodiffusion, bien qu’aucune des personnes à l’origine de cette initiative n’aient d’expérience en ce type de création. En décrivant les éléments de notre processus de prise de décisions et les enjeux que nous avons rencontrés au cours de l’année, notre souhait est que ces informations puissent être pertinentes pour d’autres personnes étudiantes et enseignantes qui cherchent à développer leurs propres outils pédagogiques ou d’application des connaissances par l’entremise de la baladodiffusion. Le contenu de cet article est basé sur la relecture et l’analyse des documents créés dès les débuts du projet-pilote, ainsi que des procès-verbaux des rencontres d’équipe. L’analyse de cette documentation, en plus des discussions entre les membres de l’équipe de base, ont permis de faire ressortir différents éléments et moments marquants du projet. De plus, un sondage avec réponses à court développement a permis de recueillir et d’analyser les commentaires d’étudiantes et d’étudiants ayant eu l’occasion d’écouter les premiers épisodes de cette série. Ces différents moyens nous permettent de présenter les résultats suivants en ce qui concerne les apports sur le plan pédagogique et les appréciations des membres étudiants et professionnels.
Tableau 1
Principaux éléments constituant la planification, l’organisation et la structure du projet
Résultats préliminaires
Retombées pédagogiques
Dans deux cours d’intervention individuelle donnés au baccalauréat, les épisodes de baladodiffusion ont été utilisés en plus des lectures obligatoires. Ils permettaient de faire un retour à la séance de cours suivant l’écoute de l’épisode sur les éléments que les membres étudiants y avaient relevés et d’ouvrir plus largement la discussion sur l’intervention sociale, l’évaluation du fonctionnement social et d’autres sujets. Dans un autre cours, ils servaient de support à une réflexion en petits groupes sur le thème choisi par les étudiantes et étudiants. Un journal de bord réflexif devait être remis à la fin de la session universitaire et des sondages oraux ou écrits ont été réalisés auprès de membres étudiants ayant utilisé les épisodes de baladodiffusion.
Rétroactions préliminaires
Ce projet est apprécié tant par les personnes interrogées à qui cet espace permet de faire rayonner leur pratique et de faire part de leurs réflexions aux futur(e)s professionnel(le)s, que par les personnes étudiantes à qui des exemples de situations pratiques sont fournis. En témoignent les commentaires issus d’un sondage réalisé auprès de 47 personnes étudiantes et qui portait notamment sur la pertinence pour leur apprentissage de quatre épisodes de baladodiffusion écoutés. Il a révélé que 94 % (n = 44) des membres étudiants sondés les ont trouvés « très pertinents » ou « pertinents » à leur apprentissage. Leurs commentaires étaient liés aux perspectives et aux sujets soulevés par les professionnels, de même que sur la possibilité de découvrir différents milieux de pratique. Un membre étudiant l’exprime ainsi : « Je trouve toujours pertinent d’écouter des intervenants venant de différents milieux parler de leur pratique. Il y a des concepts que j’ai appris dans les balados auxquels je pense encore très fréquemment… C’est des concepts importants à garder en tête quand on intervient. » La baladodiffusion s’avère remplir son objectif de rendre plus concrète la pratique aux membres étudiants : « Certains balados m’ont permis d’apprendre sur la pratique, plus concrètement. J’ai aussi appris sur différentes perceptions, différentes réalités, différents domaines d’intervention. » Enfin, plusieurs ont apprécié le nouveau format médium d’apprentissage, qui respecte le rythme des apprenants (« très bonne façon d’apprendre à son rythme ») ou encore diminue la charge des lectures : « J’ai adoré écouter les balados, déjà parce que c’est un moyen simple et léger d’avoir accès à la matière, mais aussi parce qu’on a accès à plusieurs intervenants de milieux différents. » Enfin, le format de la baladodiffusion permet le mouvement des apprenants : « Pour les personnes TDAH, c’est idéal, parce qu’on peut écouter le balado en bougeant (en faisant du sport ou en marchant et ça aide beaucoup à la concentration). » Quant aux membres étudiants ayant développé moins d’intérêt (6 %, n = 3), leurs commentaires critiques étaient liés au contenu des épisodes : « J’aurais aimé qu’il y ait des balados sur des techniques d’intervention typiques et appliquées dans différents milieux de travail prisés des intervenants (centre jeunesse, CRDI (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle), école, etc.) » ; ou à la forme : « J’ai trouvé plus difficile d’utiliser les balados pour mes journaux de bord, car je suis une personne visuelle. Ainsi, il a été difficile pour moi de faire des apprentissages avec du contenu seulement auditif. » D’autres éléments soulevés ont été : la préférence pour une personne invitée, la longueur de certains épisodes et le manque de littérature sur les processus d’intervention.
Dans ce qui suit, nous discutons des défis et des éléments facilitateurs ayant joué un rôle tout au long de ce projet. Nous nous référerons à ce qui a été identifié dans la section « Mise en perspective » en analysant ce que nous avons vécu au cours de ce projet.
Discussion
Épisodes de baladodiffusion et pédagogie en travail social
Selon nos résultats préliminaires, l’utilisation d’épisodes de baladodiffusion est cohérente avec les objectifs pédagogiques en travail social : de communiquer non seulement des connaissances théoriques mais également d’inviter les personnes intervenantes à réfléchir sur leur savoir-être et leur savoir-faire. La grande majorité des membres étudiants est favorable à cette approche qui consiste à faire entrer des voix multiples dans la salle de classe, ce qui permet d’apprendre à connaître divers contextes de pratique et différents moyens d’appliquer la théorie à la pratique. Comme certains l’ont noté, le fait d’avoir ces voix multiples exprimées sous forme d’épisodes de baladodiffusion présente certains avantages pour les apprenants, comme celui de pouvoir apprendre tout en faisant d’autres activités, à son rythme et d’une manière moins « lourde » que lors des cours magistraux. Ces conclusions font écho à celles d’autres chercheurs et chercheuses (Edirisingha et coll., 2007 ; Khechine et coll., 2009) qui ont constaté que les membres étudiants apprécient l’informalité et l’indépendance offertes par la baladodiffusion, dont la forme contribue à une meilleure compréhension du matériel pédagogique. Toutefois, Khechine et coll. (2009) ont noté au sujet d’épisodes intégrés en classe dans un contexte d’apprentissage à distance que les membres étudiants déploraient le manque d’interactions et de rencontres en mode présentiel. Nous avons constaté qu’une minorité de personnes étudiantes regrettait également l’absence de contenu visuel, comme les présentations PowerPoint que les cours traditionnels incluent souvent. Dans cette optique, nous proposons que les épisodes utilisés dans le contexte des cours d’intervention en travail social soient intégrés à une approche d’apprentissage mixte (Ayala, 2009 ; De Boer et coll., 2011 ; Levin et coll., 2013) créant un environnement flexible en termes de forme et de contenu, tout en protégeant l’apprentissage d’ordinaire plus efficace « en personne » (Ayala, 2009).
Sans développer ici le contenu des entretiens, nous avons noté que, sans exception, les personnes interrogées ont spontanément fait référence à la centralité du savoir-être (utilisation de soi dans son intervention), chacune en présentant les particularités propres à elles-mêmes en fonction de leur contexte d’intervention. Cette multiplicité de voix concernant l’utilisation de soi (de ses valeurs, ses émotions, etc.) en intervention avait été intégrée dans les réflexions des membres étudiants dans leurs travaux. Nous proposons qu’en offrant des épisodes de baladodiffusion comme forme médium d’apprentissage, nous intégrons également la dimension du savoir-être dans l’approche pédagogique, car nous changeons de posture pour reconnaître les membres étudiants comme des personnes vivant aussi au-delà des murs de l’université. Ils ont leurs propres réalités de vie à négocier dans leur processus d’apprentissage, qu’il s’agisse de besoins liés aux relations familiales (Edirisingha et coll., 2007) ou des besoins de mobilité (comme l’a constaté un étudiant atteint de TDAH). Cela dit, les chercheurs et chercheuses ont constaté que les performances des membres étudiants pouvaient être compromises lorsqu’ils font de l’exercice et écoutent des épisodes de baladodiffusion en même temps (Coens et coll., 2011).
La collaboration « Inter » à plusieurs niveaux
À notre avis, notre projet se démarque à plusieurs niveaux par la co-construction et le partage. D’abord, une véritable collaboration interuniversitaire a été établie, et ce, malgré des cultures institutionnelles distinctes et des différences au niveau des budgets ou de la structure financière (Carey et coll., 2005). Ensuite, nous avons établi une collaboration entre milieu universitaire et milieu de pratique, au cours de laquelle les connaissances ont été partagées entre membres praticiens et universitaires (étudiantes et professeures). Notre collaboration interinstitutionnelle avec un groupe plutôt informel d’actrices diverses s’est fondée sur une série de points forts relationnels : des relations personnelles et professionnelles préexistantes qui ont permis de créer, assez rapidement, un climat de confiance et d’harmoniser les façons de travailler ensemble. Dès le départ, la communication continue et ouverte que nous avons entretenue a permis d’aborder des conflits potentiels, de structurer notre travail, et, de manière générale, a contribué au bon déroulement du projet. Cette synergie a favorisé le libre partage des idées ou ressources pour chaque membre de l’équipe et la liberté d’agir pour faire avancer le projet. Ainsi, en faisant de la communication et du partage ouvert un principe de base de notre collaboration, nous avons détourné le « mur invisible » auquel Collard-Fortin et coll. (2022) font référence. Par ailleurs, nous avons défini et mis en commun nos objectifs et attentes dès le départ, en gardant à l’esprit un modèle de collaboration équitable afin de permettre à chaque membre d’apporter sa part d’expertise, de connaissances et de ressources sous diverses formes (Jeanes, 2019). Nous avions donc un objectif commun, une volonté, une flexibilité et une confiance partagée pour que les décisions et les actions soient développées dans un esprit non compétitif, visant une gouvernance collaborative (Simard, 2020).
Toutefois, ce projet a aussi fait ressortir des « transactions sociales » (continuum entre conflit et coopération dans les relations sociales) (Remy et Foucart, 2013 ; Stoessel-Ritz et coll., 2011). En effet, malgré l’accord général sur notre fonctionnement (non hiérarchique, gouvernance collaborative, esprit de co-construction), les membres du projet ont fait l’expérience de la négociation de ces valeurs. Ainsi, alors que nous valorisions un modèle de leadership horizontal, la stagnation du projet à certains moments nous a parfois obligées à renégocier ces valeurs afin de trouver des moyens de distribuer les rôles de leadership d’assurer la dynamique adéquate du projet. Cela s’est fait par une communication ouverte, une confiance et une transparence. Ces éléments sont importants selon Fourdringier (2020) pour la poursuite d’innovations développées par des partenaires autrement non conventionnels.
Bien que les objectifs aient été clairs dès le départ, la structure du projet a été définie au fil du temps ; elle résidait, comme déjà mentionné, en une co-construction menée par un désir de « tester » différentes avenues. Par exemple, au début du processus, deux membres de l’équipe ont respectivement mené avec une personne interrogée différente une entrevue enregistrée, qu’elles ont ensuite envoyée aux autres membres. Ces entrevues ont été les premiers tests, qui ont mené à plusieurs discussions et décisions pour la suite. Plus tard, quand les épisodes ont été utilisés en classe, la rétroaction des membres étudiants a permis de moduler les prochaines étapes du projet.
Le contexte de la pandémie a pu contribuer à des échanges moins formels entre les membres de l’équipe. Plusieurs activités (professionnelles, institutionnelles et personnelles) ayant été annulées ou étant impossibles à réaliser à cause du confinement, il est possible que certains membres aient eu davantage de temps et d’énergie à consacrer au projet, le faisant avancer plus vite. De plus, la collaboration entre membres praticiens et universitaires, que ce soit dans la conduite des entretiens ou dans la planification et l’organisation des échanges, a été enrichissante et a permis d’apporter une complémentarité. En effet, nous avons essayé d’assurer le dialogue entre les deux mondes de l’intervention et de l’éducation. De la sorte, les enseignantes ont pu atteindre leurs objectifs pédagogiques, consistant à lier la pratique à la théorie, tout en respectant le besoin des membres étudiants d’avoir un aperçu des différents milieux de travail et des différentes tâches concrètes effectuées sur le terrain. En même temps, les membres praticiens ont eu l’occasion de partager leur expertise et leur expérience de travail, faisant ainsi reconnaître leur contribution.
Avenir
Les entretiens ont été réalisés par des étudiantes de maîtrise et de doctorat en travail social, à la fois dans le cadre d’heures de bénévolat, de contrats rémunérés et de cours. Plus récemment, deux étudiantes qui avaient chacune effectué un stage dans le contexte de la protection de la jeunesse ont enregistré une conversation entre elles dans le but de familiariser les futurs membres étudiants avec les défis de ce travail. Nous reconnaissons que de nombreuses personnes étudiantes arrivent avec des expériences de vie et professionnelles qui peuvent contribuer de manière significative au processus d’apprentissage. Nous reconnaissons également que les membres étudiants offrent des points de vue que les personnes sur le terrain ou les enseignantes ne sont pas en mesure de représenter. Lau et coll. (2010) vont dans ce sens et notent que les personnes étudiantes qui participent à l’élaboration d’épisodes de baladodiffusion pour des cours réagissent positivement lorsqu’elles reçoivent des instructions explicites, qu’elles sont autorisées à être elles-mêmes en tant qu’intervieweuses et qu’elles ne sont pas tenues de produire de longs épisodes. Elles sont plus engagées dans l’apprentissage, se sentent plus liées à la communauté d’apprentissage et obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Cela inclut des instructions qui garantissent que les épisodes de baladodiffusion répondent aux objectifs d’apprentissage et aux résultats (Phillips, 2017) et une attention à fournir des directives adéquates pour les aspects techniques de la réalisation d’épisodes (Hall et Jones, 2021). C’est à la lumière de ces différents apprentissages et constats réalisés qu’une partie de l’équipe de base poursuit le développement de ce projet.
Conclusion
Par conséquent, contraintes par le contexte de pandémie, les personnes enseignantes en travail social ont dû apprendre à rendre vivantes la théorie et la pratique en travail social, tout en donnant les cours en ligne. Pour relever ce défi, nous avons monté, sans expérience préalable, un projet de conception d’épisodes de baladodiffusion. La collaboration interuniversitaire et interstatutaire nous a permis d’affronter la courbe d’apprentissage ensemble et de mettre en place des outils qui répondaient aux besoins des personnes étudiantes, futures stagiaires. Nous avons constaté que les échanges entre nous et avec les personnes participant aux épisodes ont permis à ces multiples voix de partager leurs perspectives liées au savoir, au savoir-être et au savoir-faire en travail social. En dépit de notre manque d’expérience, nous avons découvert que les membres étudiants ont répondu favorablement à la richesse du contenu des épisodes de baladodiffusion et à la souplesse inhérente à cette manière d’apprendre. Dans cet article nous avons offert un portrait de notre processus de création afin d’inviter nos collègues qui préparent les personnes étudiantes au travail sur le terrain à mieux comprendre les étapes pour réaliser un tel projet.
Appendices
Note biographique
Isabelle Raffestin est actuellement doctorante à l’École de travail social de l’Université de Montréal et chargée de cours. Berna Elias est actuellement candidate au doctorat à l’École de travail social de l’Université de Montréal. Fannie Dulude est spécialiste en activités cliniques au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, à la Direction des Services intégrés en première ligne. Aline Bogossian est professeure agrégée à l’École de service social de l’Université de Montréal et professeure responsable de la formation depuis 2022.
Shawn-Renée Hordyk, MSW, PhD, est psychothérapeute et professeure à l’école de travail social de l’Université du Québec à Montréal.
Bibliographie
- Anastas, J. W. (2010). Teaching in social work: An educators’ guide to theory and practice. Columbia University Press.
- Ayala, J. S. (2009). Blended learning as a new approach to social work education. Journal of Social Work Education, 45(2), 277–288. http://www.jstor.org/stable/23044310
- Carey, T. S., Howard, D. L., Goldmon, M., Roberson, J. T., Godley, P. A. et Ammerman, A. (2005). Developing effective interuniversity partnerships and community-based research to address health disparities. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 80(11), 1039. https://doi.org/10.1097/00001888-200511000-00012
- Coens, J., Degryse, E., Senecaut, M. P., Cottyn, J., et Clarebout, G. (2011). Listening to an educational podcast while walking or jogging: Can students really multitask? International Journal of Mobile and Blended Learning, 3(3), 23–33. https://doi.org/10.4018/jmbl.2011070102
- Collard-Fortin, U., Gagné, A., Coulombe, S., Cody, N., Rajotte, T., et Doucet, M. (2022). Plateforme numérique d’accompagnement professionnel en enseignement : défis liés à son élaboration, à sa mise en oeuvre et aux stratégies collaboratives déployées. Revue hybride de l’éducation, 5(2), 106–126. https://doi.org/10.1522/rhe.v5i2.1250
- Craig, S. L., McInroy, L. B., Bogo, M., et Thompson, M. (2017). Enhancing competence in health social work education through simulation-based learning: Strategies from a case study of a family session. Journal of Social Work Education, 53(suppl. 1), 547–558. https://doi.org/10.1080/10437797.2017.1288597
- De Boer, C., Campbell, S., et Hovey, A. (2011). When you come to a fork in the road, take it: Teaching social work practice using blended learning / Si une deuxième voie s’offre à vous, prenez-la ! Enseigner la pratique en travail social à l’aide d’apprentissages mixtes. Canadian Journal of Learning and Technology / La revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie, 37(3), 1–17. https://cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/26352/19534
- Edirisingha, P., Salmon, G., et Fothergill, J. (2007). Profcasting – A pilot study and guidelines for integrating podcasts in a blended learning environment. Dans U. Bernath and A. Sangrá (dir.), Research on competence development in online distance education and e-learning: Selected papers from the 4th EDEN Research Workshop in Castelldefels, Spain, October 25–28, 2006 (p. 127–140). Studien und Berichte der Arbeitsstelle Fernstudienforschung der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 13. http://www.c3l.uni-oldenburg.de/publikationen/volume13.pdf
- Fourdrignier, M. (2016). Les coopérations, de nouvelles transactions dans le travail social ? Pensée plurielle, 3(43), 23–35. https://doi.org/10.3917/pp.043.0023
- Graham, J. R., et Barter K. (1999). Collaboration: A social work practice method, Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 80(1), 6–13. https://doi.org/10.1606/1044-3894.634
- Hall, N. M., et Jones, J. M. (2021). Student-produced podcasts as a teaching and learning tool. American Journal of Distance Education, 37(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/08923647.2021.1995256
- Herschell, A. D., Kolko, D. J., Baumann, B. L., et Davis, A. C. (2010). The role of therapist training in the implementation of psychosocial treatments: A review and critique with recommendations. Clinical Psychology Review, 30(4), 448–466. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.02.005
- Jeanes, E. (2019). Collaboration. Dans A Dictionary of Organizational Behaviour. Oxford University Press, coll « Oxford Quick References ». https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191843273.001.0001/acref-9780191843273-e-32
- Khechine, H., Lakhal, S., et Pascot, D. (2009). Efficacité du podcasting en enseignement et apprentissage : résultats empiriques pour un cours donné en formule mixte. Systèmes d’information & management, 14(1), 103–130. https://doi.org/10.3917/sim.091.0103
- Kourgiantakis, T., Bogo, M., et Sewell, K. M. (2019). Practice Fridays: Using simulation to develop holistic competence. Journal of Social Work Education, 55(3), 551–564. https://doi.org/10.1080/10437797.2018.1548989
- Lau, R. Y., Ip, R. K. F., Chan, M. T., Kwok, R. C. W., Wong, S. W., So, J. C., et Wong, E. Y. (2010). Podcasting: An internet-based social technology for blended learning. IEEE Internet Computing, 14(3), 33–41. https://doi.org/10.1109/MIC.2010.74
- Law, K. L., et Rowe, J. M. (2019). Promoting self-awareness: An undergraduate in-class activity and its value. Journal of Teaching in Social Work, 39(1), 92–104. https://doi.org/10.1080/08841233.2018.1555199
- Levin, S., Whitsett, D., et Wood, G. (2013). Teaching MSW social work practice in a blended online learning environment. Journal of Teaching in Social Work, 33(4–5), 408–420. https://doi.org/10.1080/08841233.2013.829168
- McCombs, S., Liu, Y., Crowe, C., Houk, K., et Higginbotham, D. (2007). Podcasting best practice based on research data. Dans R. Carlsen, K. McFerrin, J. Price, R. Weber et D. Willis (dir.), Proceedings of SITE 2007 – Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2007, No. 1, p. 1604–1609). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/24794/
- Phillips, B. (2017). Student-produced podcasts in language learning: Exploring student perceptions of podcast activities. IAFOR Journal of Education, 53(3), 158–171. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1162673.pdf
- Remy, J., et Foucart, J. (2013). La transaction : une manière de faire de la sociologie. Pensée plurielle, 2–3(33–34), 35–51. https://doi.org/10.3917/pp.033.0035
- Salloum, A., et Smyth, K. (2013). Clinicians’ experiences of a podcast series on implementing a manualized treatment. Journal of Technology in Human Services, 31(1), 71–83. https://doi.org/10.1080/15228835.2012.738382
- Simard, M. (2020). FADIO, un modèle inspirant pour le partage d’expertise / FADIO: An innovative initiative to share expertise in distance education. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education, 17(1), 84–87. https://doi.org/10.18162/ritpu-2020-v17n1-15
- Stoessel-Ritz, J., Blanc, M., et Grodwohl, M. (2011). Dans la cuisine du partenariat : retour sur les obstacles interculturels et institutionnels dans un projet de coopération universitaire franco-algérienne / In the Kitchen of the Partnership: A reflexive look at intercultural and institutional obstacles in a Franco-Algerian project of academic co-operation. Revue Interventions économiques / Papers in Political Economy, 43. https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.1412
- Temperman, G., et De Lièvre, B. (2009). Développement et usage intégré des podcasts pour l’apprentissage. Distances et savoirs, 7(2), 179–190. https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2009-2-page-179.htm
- Van Zanten, R., Somogyi, S. et Curro, G. (2012). Purpose and preference in educational podcasting. British Journal of Educational Technology, 43(1), 130–138. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01153.x
- Weingardt, K. R. (2004). The role of instructional design and technology in the dissemination of empirically supported, manual-based therapies. Clinical Psychology: Science and Practice, 11(3), 313–331. https://doi.org/10.1093/clipsy.bph087
List of tables
Tableau 1
Principaux éléments constituant la planification, l’organisation et la structure du projet