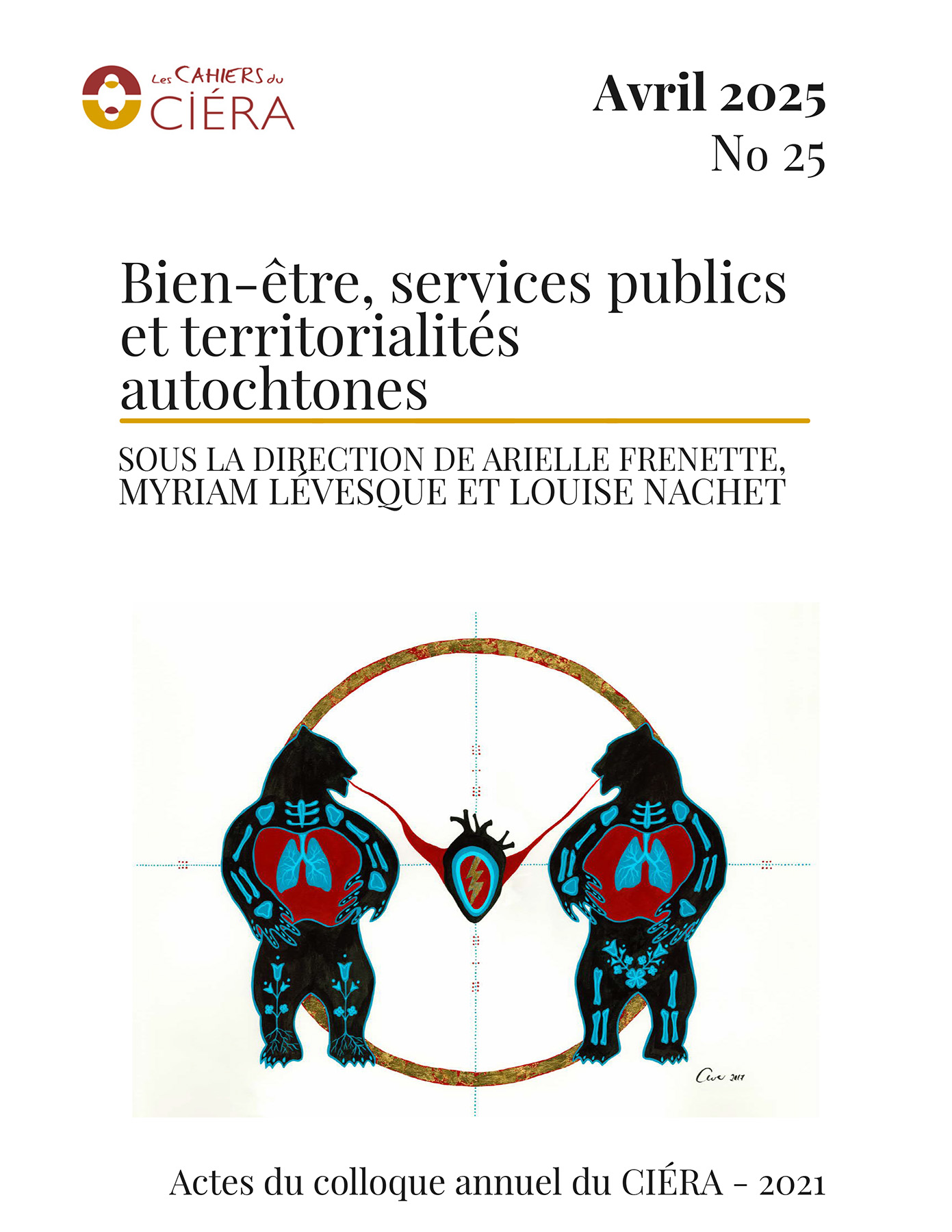Article body
Depuis une quarantaine d’années, de nombreuses démarches ont été entreprises par le gouvernement du Canada dans un objectif de (ré)conciliation avec les différents peuples autochtones des territoires sur lesquels le pays a été fondé. Bien qu’il reste encore énormément de progrès et de changements à réaliser jusqu’à l’achèvement du processus de (ré)conciliation en soi, une place toujours plus importante est laissée aux Autochtones et à leurs représentants lors d’événements publics. Il s’agit d’une présence qui peut être d’ores et déjà considérée comme un premier pas vers cette susdite (ré)conciliation. C’est justement le cas des membres du groupe musical wolastoqiyik Pokuhulakon Witsehkehsu (Sisters of Drums), qui ont donné une prestation sur scène aux tambours à main, lors du 43e discours sur l’état de la province du Nouveau-Brunswick livré en 2017.
Le présent article vise donc, d’une part, à décrire la prestation du groupe aux tambours autochtones Pokuhulakon Witsehkehsu et, d’autre part, à décrire les circonstances de sa présence lorsque cet important discours a été prononcé le 26 janvier 2017 par le premier ministre Brian Gallant. Enfin, il sera expliqué comment, à mon sens, cette prestation est perçue par les autres communautés autochtones au pays et en quoi elle peut être considérée comme un acte de résurgence autochtone.
Pokuhulakon Witsehkehsu : une prestation musicale livrée au discours sur l’état de la province du Nouveau-Brunswick
Le groupe Pokuhulakon Witsehkehsu fondé par Krista Paul est composé de neuf femmes wolastoqiyik (malécites), qui jouent du tambour à main traditionnel (Bordeleau 2019). Kelsey Nash-Solomon, Aaron Hatty, Cole Hatty, Jessica Paul, Emily Paul, Jenny Perley-Martin, Rosanne Clark, Nisha Nicholas et Krista Paul se rencontrent les mardis de chaque semaine pour pratiquer les morceaux de leur répertoire, le tout interprété au tambour et accompagné de leurs voix (Musique nomade 2018). Ces musiciennes sont issues de la communauté St Mary’s; elles se joignent aux quelque 4 000 Wolastoqiyik qui habitent la province du Nouveau-Brunswick (gouvernement du Nouveau-Brunswick s.d.). Depuis 2017, le groupe se produit fréquemment à des événements publics pour le plaisir, mais surtout dans l’optique de faire rayonner la langue, la culture et les traditions de ses membres. Dans une entrevue avec VOIR, Cole Hatty affirme que, bien que le groupe ait été créé dans un désir de « garder la langue vivante » (Bordeleau 2019), il a été constaté que celui-ci a un effet tout aussi important sur la vie de chacune de ses membres et sur celle des femmes au sein de leur communauté. En outre, elle s’explique en ces termes : « Le groupe les fait se sentir plus puissantes, leur remonte le moral, les fait reconnecter avec leur culture traditionnelle. […] C’est notre temps de guérison qui nous permet de nous sentir mieux et de grandir ensemble en tant que femmes » (Bordeleau 2019).
Chaque année au Nouveau-Brunswick, organisé par la Chambre de commerce de Fredericton, le premier ministre fait un discours visant à mettre à jour les citoyens et citoyennes sur divers points importants et à leur faire part d’autres nouveautés concernant la province (gouvernement du Nouveau-Brunswick 2021). En 2017, au début de ce discours provincial, huit membres[13] du groupe Pokuhulakon Witsehkehsu ont interprété les chants Wolastoq et Warrior Woman, positionnées sur scène en demi-lune et portant chacune leur tambour à la main (voir Figure 1). Celles-ci ont été invitées par le gouvernement provincial à faire l’ouverture de cet événement politique. Comme Pokuhulakon Witsehkehsu est le seul groupe dans la région de Fredericton qui soit composé de femmes des Premières Nations joueuses de tambour, elles sont la référence de premier plan pour une présence autochtone à divers événements publics dans la région.
Figure 1
Le groupe Pokuhulakon Witsehkehsu qui se produit lors du discours sur l’état de la province du Nouveau-Brunswick de 2017
La division genrée traditionnelle dans la pratique musicale autochtone
Les tambours à main et les tambours collectifs
Les tambours à main utilisés par le groupe Pokuhulakon Witsehkehsu sont en fait des entités vivantes, bien plus que des instruments de musique (Delamour 2019), qui occupent une place très importante dans les traditions spirituelles de multiples nations autochtones notamment en Amérique du Nord. Laurent Jérôme explique dans sa thèse intitulée Jeunesse, musique et rituels chez les Atikamekw (Jérôme 2010) que la forme du tambour traditionnel change en fonction des contextes et des différentes nations autochtones. Plus encore, la principale distinction entre les multiples formes des tambours est établie entre les tambours à main et les tambours collectifs. D’abord, le tambour à main est un [il faudrait ici une description plus générale]. Delamour décrit d’ailleurs le teuehikan (tambour) des Ilnuatsh en ces termes particuliers : « […] cadre circulaire qui possède deux membranes sur lesquelles sont disposés des timbres de résonance en os d’animaux ou en plumes d’oiseaux » (Delamour 2019 : 798). Il est utilisé de manière individuelle, mais peut être aussi pratiqué dans un contexte de prestation collective (Jérôme, 2010 : 220). Cependant, il existe une relation intime entre l’interprète et son tambour ainsi qu’un cadre précis dans lequel il est pratiqué (Jérôme 2010 : 220). Par exemple, traditionnellement, le tambour à main était entre autres utilisé dans des contextes de chasse; il est notamment une « […] entité animée d’une force particulière, […] capable de communiquer avec les non-humains » (Delamour 2019 : 799). Pour sa part, Carole Delamour (Delamour 2019) précise que chez les Pekuakamiulnuatsh, le lien entre l’humain et le tambour est une relation basée sur le respect et la responsabilité. Ainsi, pendant la chasse, le tambour, grâce à « sa capacité de médiation entre le monde des humains et des non-humains » (Delamour 2019 : 800), sert à créer une communication entre les humains et les animaux ainsi que leurs esprits. À l’aide du tambour à main, les chasseurs peuvent(pouvaient) ainsi géolocaliser le gibier qui s’offre(ait) à eux et, par conséquent, respecter la responsabilité de l’abattre avec respect.
Ensuite, le tambour collectif, comme l’explique Jérôme, se sépare en deux catégories : 1) les tambours contemporains, qu’on retrouve davantage de nos jours dans les pow-wow et 2) les tambours sacrés, qui sont utilisés dans des pratiques plus traditionnelles (Jérôme 2010 : 221). Dotés d’une superficie d’environ 150 centimètres de diamètre, ces tambours (contemporains et sacrés)[14] sont d’ailleurs beaucoup plus gros que les tambours à main. En raison de leurs dimensions importantes, jusqu’à douze musiciens peuvent jouer en même temps; c’est entre autres pour cette raison qu’ils sont aussi présents dans les pow-wow. Ainsi, que ce soit dans un contexte individuel, collectif, contemporain ou traditionnel, le tambour représente un objet d’une grande valeur et possède une dimension sacrée. Bref, sa pratique est importante et précieuse non seulement pour promouvoir les cultures autochtones, mais également pour préserver ces traditions et en assurer la continuité.
Quand la pratique du tambour par les femmes autochtones ne fait pas l’unanimité
Le contexte des pow-wow contribue à bien comprendre les divisions genrées dans la pratique du tambour, puisque, lors de ces événements, on retrouve une distinction entre les rôles des femmes et ceux des hommes. Comme Anna Hoefnagels l’explique, les femmes ont un rôle qui s’exerce davantage « dans les coulisses » (Hoefnagels 2012); elles ont des tâches qui comprennent le choix des dates, la gestion du budget, la planification des prestations, etc., tandis que les hommes ont un rôle beaucoup plus public, soit celui de jouer le tambour collectif (ibid.). Toutefois, cette division genrée se doit d’être comprise comme une relation de complémentarité, qui facilite le bon fonctionnement des événements. À cet égard, Anna Hoefnagels précise que :
Complementarity is not to be viewed as equality or « sameness » in terms of roles and responsibilities of Native women and men; rather, it should be viewed as the division of labor and responsibilities so that required tasks and duties are accomplished, with roles filled according to people’s abilities and strengths.
Hoefnagels 2012 : 1
En d’autres mots, la division des tâches dans l’organisation des prestations de tambours entre les genres crée un équilibre et une stabilité dans l’ordre social, qui rend possible une continuation efficace de la vie. En revanche, ce contexte fait en sorte qu’il n’est pas toujours bien accepté pour une femme de pratiquer du tambour, que ce soit dans un contexte individuel avec le tambour à main ou dans un contexte plus collectif comme les pow-wow. Hoefnagels (2012) montre alors que le concept de « tradition » est souvent utilisé pour contester la participation des femmes à ces prestations. En effet, traditionnellement, les hommes battaient du tambour dans des contextes de chasse ou de fête, tandis que les femmes réservaient plutôt leur tambour à la sphère privée avec la famille et les enfants (ibid.). Véronique Audet indique en revanche que certaines femmes pouvaient, en quelques rares occasions, battre du tambour dans des contextes similaires à ceux réservés normalement aux hommes, « […] notamment lorsqu’il n’y avait pas d’hommes habilités à le faire dans le groupe familial et, généralement, c’était après leur ménopause » (Audet 2012 : 178). Ceci dit, pour certaines personnes autochtones, le maintien de la tradition dans la pratique d’aujourd’hui est une forme de résistance contre le colonialisme en soi. Comme le contextualise Anna Hoefnagels :
For many participants, young and old, reinforcing the traditional teachings that explain these distinct roles is one way to respect Aboriginal ways of being and doing while resisting colonial and patriarchal paradigms.
Hoefnagels 2012 : 22
Par conséquent, le maintien de la tradition comme forme de résistance fait partie du quotidien des femmes autochtones pratiquant le tambour, puisque ce n’est pas toujours accepté par l’ensemble des communautés autochtones. De ce fait, la prestation de Pokuhulakon Witsehkehsu au discours de l’état de la province du Nouveau-Brunswick ne fait pas nécessairement l’unanimité au sein des communautés.
Les femmes au tambour : une forme de résurgence?
Pendant la période coloniale, de nombreux facteurs dont les politiques d’assimilation ont affecté considérablement la pratique du tambour (Delamour 2012 : 803 ; Jérôme 2010 : 224). Il y a quelques années, Taiaiake Alfed, un politicologue mohawk, a présenté un nouveau concept particulièrement intéressant pour analyser les actions entreprises par les communautés autochtones animées d’un désir d’autonomisation et de transformation, soit celui de la résurgence. La résurgence représente
[u]ne révolution spirituelle par laquelle les descendants des premiers occupants de ce que l’on nomme aujourd’hui le Canada seraient à même de retrouver leur identité et leur dignité, et ce malgré les impacts vifs d’un colonialisme de peuplement.
Paquet 2016 : 79
La notion d’autonomisation est très importante pour comprendre la résurgence, puisque les actions sont posées dans un désir de (re)prise de possession de son identité personnelle et collective, afin que cette identité double puisse être exprimée dans l’espace public. Comme l’explique Paquet, « la lutte doit prendre la forme d’une "praxis transformatrice" par laquelle le "colonisé" se défait de cette identité exogène qu’il a intériorisée » (2016 : 85). Ainsi, la prestation de Pokuhulakon Witsehkehsu peut être comprise comme une forme de résurgence sur deux niveaux, soient des actes 1) de résistance et 2) d’affirmation culturelle. Ces deux principes se retrouvent donc à la base des transformations que l’on retrouve dans le paradigme de la résurgence (Paquet 2016 : 85).
Par conséquent, la prestation de Pokuhulakon Witsehkehsu peut être comprise comme un acte de résistance politique et identitaire : politique, dans le sens où elle rappelle, lors d’un discours adressé aux Néo-Brunswickois, que les peuples autochtones habitant ces terres sont présents et forts et qu’ils font partie de la vie politique de la province; identitaire, dans le sens où la prestation a donné aux musiciennes une plateforme pour s’exprimer en tant que femmes, en tant qu’Autochtones et en tant que Wolastoqiyik du Nouveau-Brunswick. En battant du tambour à un événement aussi public et important, ces femmes autochtones ont démontré une résistance face aux divisions genrées qui les restreignent à une position plus « en coulisse », en plus de résister politiquement à l’État canadien, qui a notamment invisibilisé leur peuple pendant si longtemps.
Cette prestation peut aussi représenter un acte d’affirmation culturelle dans le sens où, en transformant une pratique qui est normalement réservée aux hommes, ces femmes démontrent non seulement que la tradition existe toujours, mais qu’elle a également été adaptée à la contemporanéité. En se produisant le 26 janvier 2017 au Fredericton Convention Centre, le groupe Pokuhulakon Witsehkehsu s’est (ré)approprié son histoire; cette manifestation représente en soi une démarche de guérison de même qu’une occasion de raconter l’histoire de leur peuple au reste du monde et d’affirmer que leur culture est bel et bien toujours présente. Autrement dit, en pratiquant le tambour à main, ces femmes autochtones
[…] cherchent à s’émanciper des dominations de la société en valorisant ce qui leur est propre, soit leur identité, leurs pratiques et héritages culturels, leur langue, leur territoire ancestral, en se définissant par [elles]-mêmes et pour [elles]-mêmes.
Delamour 2019 : 806
Sous cet angle, la prestation de Pokuhulakon Witsehkehsu peut en effet être un acte de résurgence autochtone. Toutefois, il est important de nuancer et de garder en perspective que la place publique offerte aux Autochtones demeure limitée. Cette place est d’ailleurs souvent réduite au divertissement ou au protocolaire où, par exemple, des artistes autochtones présenteront leurs prestations musicales avant un événement politique important, mais très rarement ceux-ci auront une place au sein même de l’événement. Il est ainsi légitime de se questionner si les Autochtones ont même été mentionnés à juste titre dans le discours sur l’état de la province du Nouveau-Brunswick de 2017. Il serait alors plus réaliste, dans ce cas-ci du moins, de parler d’une place limitée offerte à la résurgence autochtone.
Conclusion
À première vue, la prestation de Pokuhulakon Witsehkehsu au discours de l’état de la province du Nouveau-Brunswick de 2017 peut sembler banale. Toutefois, en effectuant un pas de recul et une analyse plus profonde du contexte, il est possible de concevoir cette prestation comme une forme de résurgence eu égard à son caractère militant. Cela suppose que l’on doit tenir compte, entre autres choses, de la place limitée qui est laissée aux Autochtones sur la scène publique en plus de leur faible visibilité médiatique, ce qui a pour conséquence de limiter la portée de cet acte de résistance et d’affirmation culturelle. Malgré tout, à travers cette pratique musicale, ces femmes autochtones résistent aux ravages du colonialisme et aux conditions restreignantes qui sont attribuées à leur sexe, en plus de contribuer à instaurer un certain retour de balancier et l’établissement d’une relation d’égal à égal entre les Autochtones et les allochtones. Justement, Ed Doherty, ministre de Service Nouveau-Brunswick et également ministre responsable des Affaires autochtones, a affirmé que : « [la prestation] nous a tous transmis le message qu’il fallait prendre conscience de ce que nous pouvons réaliser ensemble pour les bienfaits de notre province » (gouvernement du Nouveau-Brunswick 2017). Soutenir les femmes autochtones à prendre part à la pratique du tambour, c’est encourager des transformations sociales et culturelles qui facilitent le maintien et la transmission des traditions, tout en encourageant les Autochtones, les gouvernements provinciaux et le Canada à faire un pas de plus dans le processus de (ré)conciliation. Mais pour aller plus loin dans cette voie, il sera nécessaire d’élargir la place publique offerte aux Autochtones pour être vus, entendus et reconnus hors de la sphère du divertissement.
Appendices
Note biographique
Judien Lupien a complété son baccalauréat en anthropologie à l’Université de Montréal à l’hiver 2022 et elle a entamé une maîtrise en anthropologie de la musique en septembre 2023.
Notes
-
[13]
Les membres du groupe s’étant produites à cet événement sont Kelsey Nash-Solomon, Aaron Hatty, Cole Hatty, Jessica Paul, Emily Paul, Jenny Perley-Martin, Nisha Nicholas et Krista Paul.
-
[14]
La peau utilisée pour les membranes de ces tambours est pour la plupart celle d’un cervidé : orignal, daim, wapiti, caribou (teuehikan), etc.]. Elle a été grattée, rasée, huilée, puis séchée avant son application sur le cadre de bois du tambour.
Bibliographie
- AUDET, Véronique, 2012, Innu nikamu – L’Innu chante : Pouvoir des chants, identité et guérison chez les Innus. Québec : Les Presses de l’Université Laval.
- BORDELEAU, Antoine, 2019, « Pokuhulakon Witsehkehsu (Sisters of Drums) ». VOIR, 3 juin 2019. En ligne : https://voir.ca/musique/artiste-nikamowin/2019/06/03/pokuhulakon-witsehkehsu-sisters-of-drums/, [consulté le 14 février 2022].
- DELAMOUR, Carole. 2019. « Les multiples résonances du teuehikan (tambour) des Ilnuatsh de Mashteuiatsh dans le renouvellement d’une éthique de l’attention », Revue d’anthropologie des connaissances, 13(3) : 793-816.
- Gouvernement du Nouveau-Brunswick, s.d., « Wolastoqiyik – Portrait d’une nation », Nouveau-Brunswick : Tourisme, Patrimoine et Culture. En ligne : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/tpc/patrimoine/content/archeologie/Wolastoqiyik.html, [consulté le 14 février 2022].
- Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2021, « Discours sur l’état de la province 2021 », Nouveau-Brunswick : Cabinet du premier ministre. En ligne : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/premier_ministre/promo/sop2021.html, [consulté le 14 février 2022].
- Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2017, « Prestation d’un groupe de femmes autochtones jouant du tambour à l’occasion du discours sur l’état de la province », Nouveau-Brunswick : Secrétariat des affaires autochtones. En ligne : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/affaires_autochtones/nouvelles/communiques.2017.01.0110.html, [consulté le 14 février 2022].
- HOEFNAGELS, Anna, 2012, « Complementarity and Cultural Ideals: Women’s Roles in Contemporary Canadian Powwows », Women and Music: A Journal of Gender and Culture, 16 : 1-22.
- JÉRÔME, Laurent, 2010, Jeunesse, musique et rituels chez les Atikamekw (Haute-Mauricie, Québec) : Ethnographie d’un processus d’affirmations identitaire et culturelle en milieu autochtone (thèse de doctorat), Université Laval. En ligne : https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/22140, [consultée le 14 février 2022].
- Musique nomade, 2018, « À la rencontre de Pokuhulakon Witsehkesu (soeurs de tambours) : Musique nomade à Fredericton », La fabrique culturelle, 4 mars 2018. En ligne : https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10746/a-la-rencontre-de-pokuhulakon-witsehkehsu-soeurs-de-tambour-musique-nomade-a-fredericton, [consulté le 14 février 2022].
- PAQUET, Nicolas, 2016, « La résurgence autochtone, un passage nécessaire vers une réconciliation : l’exemple de l’alimentation traditionnelle », Les Cahier du CIÉRA, (13) : 79-99. En ligne : https://www.ciera.ulaval.ca/sites/ciera.ulaval.ca/files/article_5.pdf, [consulté le 14 février 2022].
List of figures
Figure 1