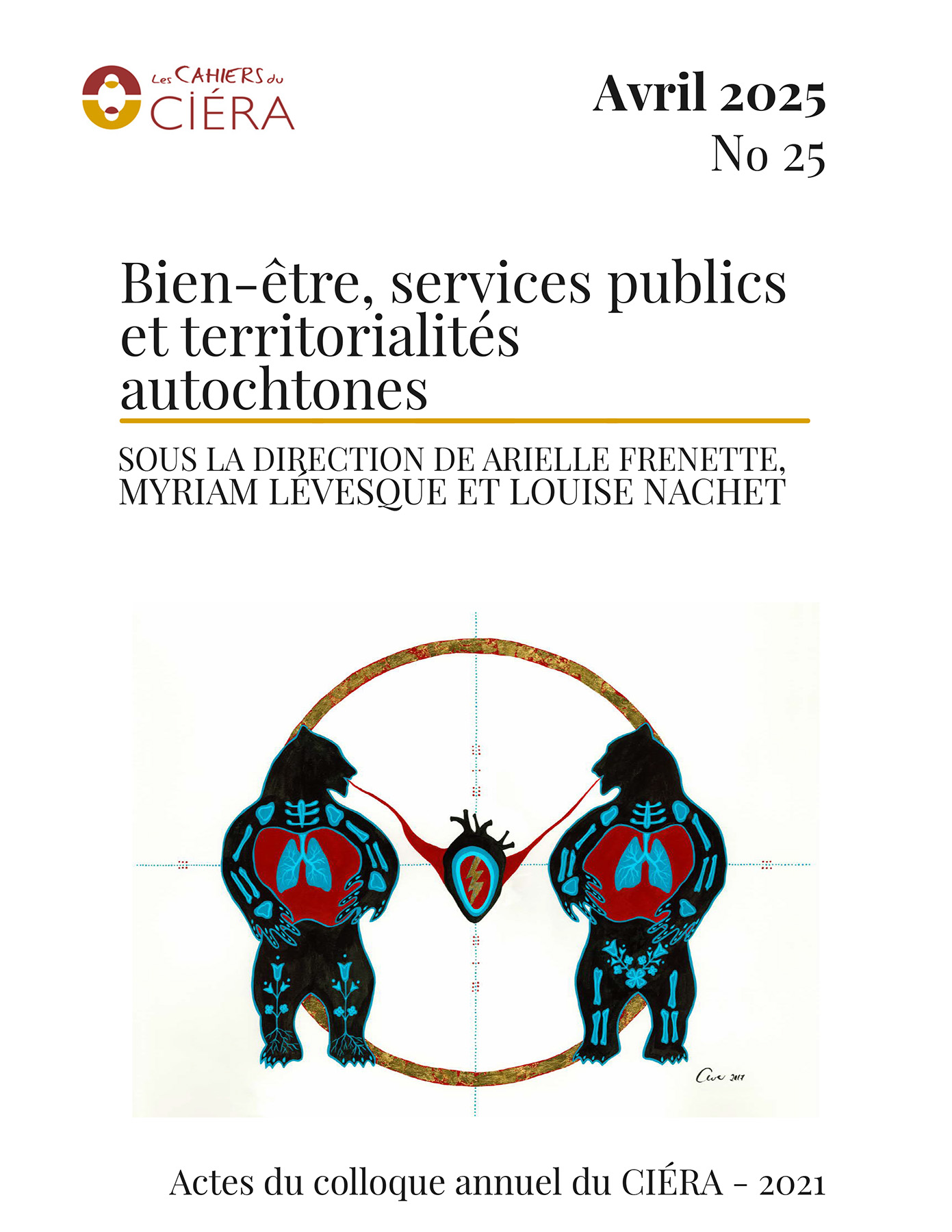Article body
Geneviève Motard (GM) : Bonjour à tous et à toutes, je suis Geneviève Motard, directrice du CIÉRA pour l'Université Laval depuis septembre 2020. Avant de commencer, permettez-moi de reconnaître les territoires traditionnels de différentes nations, dont les Wendats, les Innus et les Atikamekw, sur lesquelles les universités partenaires du CIÉRA se situent et à partir desquelles nous nous rencontrons aujourd'hui.
La thématique de cette 19e édition du colloque annuel du CIÉRA a été, vous vous en doutez, largement inspirée de l'actualité pandémique, qui nous rappelle durement et quotidiennement l'importance de la santé, du bien-être et des relations à nos familles et à nos communautés. La pandémie a aussi permis de relever l'importance de l'autonomie et de l'autodétermination afin d'assurer le bien-être de la population. Pour les premiers peuples, le colonialisme a grandement affecté cette capacité décisionnelle, tout comme les relations à la famille, à la communauté ou encore à la terre, lesquelles sont pourtant gages de bien-être et de santé.
Le colloque sera l'occasion de proposer un état des lieux de la recherche menée au CIÉRA et par d'autres chercheurs, acteurs ou étudiants sur les services publics, le bien-être ou les territorialités autochtones, que l’on pense ici au rapport à la mobilité, à l'itinérance ou encore au Nord.
Nous aurons dans quelques minutes la chance d'accueillir des intervenants de grande qualité pour une table ronde sur les réalités pandémiques qui s'annoncent les plus pertinentes. Les trois panels qui suivront, aujourd'hui et demain, permettront de réfléchir à la santé et aux services publics, au rapport entre la mobilité, l'urbanité, l'itinérance et le bien-être et finalement la recherche même comme institution au service du ou des formes de bien-être autochtones.
Mais avant je vous prie d'accueillir Madame Michèle Audette qui prononcera le mot d'ouverture de ce colloque. Michèle Audette est une figure incontournable des luttes autochtones au Canada. Tout au long de son parcours d'une richesse exceptionnelle, Michèle Audette s’est inlassablement mobilisée pour améliorer la condition autochtone et notamment celle des femmes autochtones, que ce soit en tant que sous-ministre associé au Secrétariat à la condition féminine, de présidente de l'association des Femmes autochtones du Québec (FAQ) ou de présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC). Entre 2016 et 2019, elle a agi à titre de commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA), dont le Rapport [final (2019)] a permis d'insister sur le caractère systémique des violences faites aux femmes et filles autochtones du Canada. Depuis 2019, elle occupe le poste d'adjointe au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes et de conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'Université Laval. Madame Audette, merci d'être avec nous aujourd'hui, à vous la parole.
Michèle Audette (MA) : Anumat tshinashkumitin Shanipiap! Kue kassinu etashieku, tshipushukatitinau kie anitshenat innuat ka-tautshenat Jimmy, Jason mak Sipi[3]. Un gros gros merci Geneviève ! Je me permets là d'avoir cette relation et ce respect envers toi, chère collègue, chère amie aussi pour t'avoir accueilli là sur le territoire [ancestral] du Mushau Nipi.
Et je veux aussi saluer tous ceux et celles qui ont marché pendant des millénaires sur le territoire qu'on appelle Québec, ou ville de Québec, qui est aussi un beau mot innu, en langue algonquine, qui dit « vous pouvez débarquer de vos bateaux ». Donc peuple accueillant, peuple tripant, mais généreux aussi, au même titre que la nation huronne-wendat, la nation atikamekw, la nation malécite et abénaquise, qui depuis toujours vont aussi faire partie de ce grand paysage. Alors, dans cette mosaïque virtuelle, je veux saluer ceux et celles qui sont présents, qui vont faire partie des débats, qui vont faire partie des échanges et, je nous souhaite, faire partie des changements aussi. Changer, ce n’est pas toujours facile, ce n’est pas toujours évident. Et cette semaine, on parle de bien-être, on parle de services publics, on parle du Nitassinan[4] dans son ensemble et dans son intégralité. Je pense qu'il faut prendre aussi quelques secondes à un moment donné dans la semaine ou à un moment donné dans la journée pour se rappeler que pour la famille Dubé, la famille Echaquan, cette semaine va être un moment très, très, très difficile, au point où elles vont rencontrer l’une après l'autre la coroner qui, elle, va inviter des experts, des gens, des individus pour comprendre ce qui s'est passé lors du décès et les circonstances et les causes qui ont amené cette tragédie-là, que tout le monde a été témoin dans les minutes qui ont suivi, de notre soeur Joyce Echaquan[5].
Plusieurs d’entre nous, on va être à côté de ces gens-là. Mais je vous invite aussi, par un message virtuel, ou une prière, ou une pensée, d’accompagner la famille de Joyce et la famille de Carole et de sa communauté. Un départ, vous savez, dans nos nations, un décès, un suicide… c’est… oui, les parents, les amis… mais c’est aussi tout le monde qui en est affecté et c’est le territoire au complet. Faut se rappeler aussi que cette semaine aussi, cette semaine, c’est une semaine spéciale. Cette grande mobilisation-là va être importante pour vous, d’avoir aussi une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un être cher, un bébé lors d’une hospitalisation ici au Québec et un projet de loi est en cours. Et elles ne sont plus seules, ces familles-là, parce que certaines expertises, certains individus ou groupes marchent à côté des familles et ça je vous dis : « merci ! ». Devant un Parlement, devant une assemblée donc, des fois ça peut être intimidant, mais c’est pour le bien-être de nos nations, c’est le bien-être d’un certain passé, mais aussi d’un avenir.
Et pour terminer, juste pour vous dire comment les choses se passent au quotidien dans la peau d'un Atikamekw, d'un Innu, d'une Malécite ou d'une Mohawk, c'est du moment de la naissance, jusqu'au moment où on a ces rencontres, que ce débat de cette promotion ou de cette revendication-là, elle est omniprésente.
Le 17 mai prochain, on nous annonce que la tente Raphaël [André][6] à Montréal au square Cabot va être retirée. Des milliers de personnes vont passer là et on va leur donner une sécurité. Je pense surtout aux femmes et aux filles, peu importe la culture, notamment les Inuit et les Premières Nations, elles vont faire quoi après que la tente soit retirée ? Alors quand on parle de service public et qu'on parle de territoire, ce n'est pas de l’itinérance ici pour moi, mais un nomadisme dans un contexte contemporain dans lequel les systèmes vont avoir abandonné ces gens au point de les rendre invisibles. Alors merci à ceux et à celles qui marchent à côté de ces visages trop souvent invisibles.
Nos aspirations ne datent pas d'hier. Ce qu'on fait aujourd'hui, soit avec Médecins du monde ou comme élu dans une communauté ou [lorsqu'on est] impliqué dans une organisation, ce sont les mocassins de nos ancêtres et de ceux et celles qui étaient là avant nous [sic]. Et on ne fait que continuer ce portage. Un portage parfois difficile, mais un portage qui peut faire en sorte que pour ma part, d'où je suis, je n'ai plus l'impression d'être seule, je n'ai plus l'impression de faire de la rhétorique ou de me répéter. J'ai l'impression de voir de nouveaux visages à travers cette mosaïque virtuelle, on s'entend, mais de nouvelles plumes et de nouveaux militants leaders, de nouvelles alliances qui fait que notre voix va s'élever. S'élever à un niveau où la reddition de comptes devient stressante, devient plus importante ou nécessaire, peu importe l'institut, le milieu ou la nation.
L'Université Laval va avoir pendant longtemps, comme plusieurs universités, fait des efforts, [avoir] fait des erreurs, [avoir] appris, [s'être] améliorée, [avoir] grandie, ou, à certains endroits, [avoir] maintenu le statu quo, pour les questions qui vont toucher les peuples autochtones. Et depuis plusieurs lunes, ça fait un an, un an et demi que je veux être conseillère là-bas à la réconciliation, je vous dirais que je reviens chaque jour (après très peu de trafic parce qu'on est très, très sédentaires maintenant, pour une nomade c'est difficile) de réaliser à quel point il y a du monde à travers le Québec et au Canada qui ont développé des expertises sur nous et qu'aujourd'hui ces expertises-là elles vont nous servir, nous, pour atteindre le droit à l’autonomie gouvernementale. Mais en même temps, c’est une relation de réciprocité, d’interdépendance et de respect qu’on doit maintenir.
C'est difficile d'avoir des gens qui sont titulaires de chaires du Canada ou de chaires en leadership. C’est difficile d'avoir nos nations à la tête. C’est sûr que quand on a une Mme Suzie Basile ou un M. François Gros-Louis qui sont titulaires de chaires du Canada on se dit « ouais ! On a réussi ! ». Mais en attendant, l'exercice que moi je me donne avec mes collègues à l'Université Laval, c'est comment faire en sorte que la réussite scolaire, et surtout l'accompagnement scolaire, soit adéquat, soit important et agréable pour qu'on en ressorte comme étant ceux et celles qui vont atteindre l'aspiration de l'autonomie gouvernementale. Où les rêves de faire en sorte que nous sommes au-devant quand on pagaie, on est plus à l'arrière en train d'attendre. Ça pour moi c'est un très grand rêve que je vais juste continuer à travers ceux et celles qui l'ont déjà rêvé avant moi.
Ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que nos nations, à travers ces grandes institutions-là, le milieu universitaire pour mon cas, puissent être au rendez-vous, puissent faire en sorte que le monde de la recherche, le monde de l'innovation, le monde du savoir puissent réellement et sincèrement nous inclure. Il y a des lignes directrices avec l'Institut nordique [du Québec] qui ont été d'ailleurs écrites par la plume de Suzy Basile, une Attikamekw, et aussi quatre grandes nations : les Naskapis, les Innus, les Cris et les Inuit ; pour dire « tu veux faire la recherche avec nous et sur nous ? Ben dès le départ faut qu'on soit considéré ». Et en même temps, mon rêve c'est de faire en sorte qu’on puisse s'assurer qu'il y a une présence très tôt à l'arrivée du primaire jusqu'au secondaire d’un mieux vivre ensemble, d'une meilleure connaissance, qu'on refasse l'Histoire. Et qu’on ne dise pas à mes enfants, j'en ai cinq-là, puis les deux générations que j'ai dans ma famille, les deux ont appris : « il y a des maisons longues, des nomades et des sédentaires ». Alors que c'est beaucoup plus que ça la richesse des peuples, la richesse des nations.
Évidemment, l'université a un rôle important, un rôle majeur. Et si nous avions un jour une réelle collaboration entre les savoirs des nations et les savoirs du monde québécois, canadien, nord-américain ou du reste de la planète, pour nous accompagner à avoir un Kiuna[7] universitaire, pour avoir un endroit où je peux dire à mes enfants : « cette université [située au Québec], la maison du savoir des premiers peuples, nous l'avons coconstruit ensemble, nous l’avons rêvé ensemble et, oui parfois c'était difficile, mais on l’a fait pour le bien-être. Pour faire en sorte qu’on va reconnaître mon identité culturelle, qu’on va protéger ma langue, qu’on va reconnaître que j'ai moi aussi mes héros et mes héroïnes, que j’ai moi aussi des droits propres à mon peuple, propre à ma relation avec le territoire. Mais des droits aussi… comment je dois gérer cette gouvernance atikamekw, malécite ou abénaquise ? Et tout en étant ouverte sur le monde dans cette collaboration-là, où vous avez cette expertise-là pour dire : « en effet, ça n’a pas marché [sic], c'est tout le temps des échecs, des abandons et des retours plus tard, eh bien refaisons les choses différemment cette fois-ci ».
Le temps que je vais [sic] chausser les mocassins à l'Université Laval, eh bien, je dis merci aux gens parce que ça me fait rencontrer toutes sortes de gens dans d'autres universités qui ne sont pas Innus, qui ne sont pas Mohawks, qui ne sont pas Atikamekws, ni Anishinaabes, mais qui ont cette volonté de faire mieux et de faire plus.
Alors les rencontres comme celles-ci qui vont parler de bien-être, qui va parler de services publics, qui va parler de comment nous vivons le territoire, comment nous l’honorons ce territoire, ben j'espère que ça va amener des gens à dire : « c’est à mon tour de prendre le guidon, le volant et ainsi de suite ».
Alors rêvons ensemble, rêvons toute la semaine, puis partageons nos savoirs, moi c'est comme ça que je le vois. Souvenons-nous ceux et celles qui sont venus à la rivière Georges, 10 000 ans d'occupation, sans Canada Goose. C'est qu’on l’a, la science. Iame[8], bonne rencontre !
Geneviève Motard (GM) : Tshinashkumitin[9] Michèle ! Merci Michèle Audette pour ces sages paroles qui nous porteront dans les deux prochaines journées. Avant de céder la parole à la professeure Marie-Pierre Bousquet, qui animera la table ronde dans quelques instants, permettez-moi de prendre quelques secondes pour traiter des aspects, ou du volet technique. Je pense que ces instructions vous seront répétées dans les prochaines minutes, mais je prends quand même ces précieuses secondes pour les dire, pour vous offrir peut-être plus de clarté. D'abord, pour les périodes de questions, il sera possible au public de poser ces questions de deux manières : soit en écrivant votre commentaire ou votre question dans le fil de questions et réponses, soit le Q & R en français ou en anglais, ou encore en levant la main pour poser votre question à l'oral. Dans ce dernier cas, il faudra allouer quelques secondes au technicien pour leur permettre de vous admettre dans la salle de discussion et vous pourrez par la suite, donc, poser votre question ou [émettre] votre commentaire. Enfin, je l'ai déjà mentionné, mais notez que le CIÉRA offre la traduction simultanée. Il vous est donc possible de sélectionner cette traduction en appuyant ou en sélectionnant l'icône interprétation qui se trouve au bas de votre écran. Notez, pour finir, que des liens Zoom distincts ont été prévus pour chaque panel ou atelier là de manière à faciliter les transitions. Voilà donc pour ces quelques petites instructions de nature technique qui vous seront très certainement répétées !
Marie-Pierre Bousquet est professeure au département d'anthropologie et directrice du programme en études autochtones de l'Université de Montréal. Elle est spécialiste des questions autochtones canadiennes et s'intéresse principalement aux réalités contemporaines et historiques des Anicinabek. Ses [champs d']intérêts de recherche sont diversifiés et touchent notamment la scolarisation et les pensionnats autochtones, plus particulièrement au Québec, la santé et les questions qui découlent des épidémies qui ont frappé les Autochtones, ainsi que l'écriture de l'Histoire. Chère collègue, je vous cède la parole pour l'animation de la table ronde, un grand merci d'être parmi nous.
Marie Pierre Bousquet (MPB) : Migwetch[10], merci beaucoup, Kwe Kakina[11], bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir été invitée par le comité du CIÉRA.
Donc, je vais avoir le plaisir d'animer une table ronde avec quatre participants que je vais commencer par vous présenter brièvement et après, avant chaque présentation d'entre eux, je les présenterai de façon un peu plus large.
Alors, notre table ronde est extrêmement d'actualité puisqu’elle s'appelle réalités autochtones en temps de pandémie… parce que nous sommes toujours dans cette pandémie et elle nous concerne absolument tous. En fait, je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été aussi concernés tous par un même problème, et on va avoir donc une table ronde sur les regards, sur les services publics et le bien-être.
Alors, je vais vous présenter brièvement chacun de nos participants et ensuite chacun d'entre eux plus à fond. Donc, nous avons avec nous Sipi Flamand qui est vice-chef[12] au Conseil de la nation atikamekw de Manawan, Lisa Westaway, qui est directrice du Kateri Memorial Hospital Centre, Jimmy Siméon, navigateur autochtone pour Médecins du monde et Jason Coonishish, qui est coordinateur des services préhospitaliers et des mesures d'urgence au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ). Donc, une grande bienvenue à vous quatre, ça me fait très plaisir, c'est sûr qu'on aimerait tous être dans une salle tous ensemble pour pouvoir mieux discuter, mais on va faire le mieux qu'on peut avec les moyens de la technologie pour apprendre à mieux connaître la réalité dans laquelle vous êtes, vous, et sur laquelle vous avez un regard particulier.
Alors je vais suivre l’ordre des présentateurs qui sont le programme, ça va être plus simple et je vais donc commencer par donner la parole à Sipi Flamand qui est candidat à la maîtrise en études autochtones, gouvernance autochtone à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et plus brièvement donc à l’UQAT, qui est également vice-chef au Conseil des Atikamekw de Manawan et analyste politique de formation avec un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval et coauteur du Principe de Joyce[13]. Sipi se concentre principalement sur la résurgence de la gouvernance autochtone, l'autodétermination, la philosophie politique autochtone et la tradition juridique autochtone plus spécifiquement au sein de la nation atikamekw. Donc bienvenue Sipi et je te passe tout de suite la parole.
Sipi Flamand (SF) : Kwei kwei kaskina ki itinawaw ohe ka ntotomekw anotc ka nakickotataniok otci pamitonertcikatek kitci kiskinomasowinik itekera[14]. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter des enjeux que nous rencontrons au sein de nos communautés dans nos relations avec l'État, avec la société en général, donc je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui dans cette discussion. Mikwetc[15].
MPB : Un grand merci, alors tout de suite je veux aussi donner la parole à Lisa Westaway, qui est directrice générale du Kateri Memorial Hospital Centre depuis septembre 2019. Lisa travaille comme gestionnaire dans le réseau de la santé depuis 2008, au sein de plusieurs programmes et services du réseau public. Depuis mars 2020, conjointement avec Lloyd Phillips, le commissaire de la sécurité publique de la communauté de Kahnawà:ke, elle dirige un groupe de travail contre la COVID-19 pour gérer la réponse communautaire face à l'urgence sanitaire.
Lisa Westaway (LW) : Bonjour, [c'est] un plaisir aussi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager et entendre les obstacles qu'on a encourus à travers la pandémie, mais en général aussi par rapport à l'équité d'accès aux services de santé. Mon expérience dans les réseaux publics m’a offert beaucoup de connaissances dans mon poste actuel pour être capable d'identifier rapidement les iniquités dans les services dans notre communauté, comparée à ce qui s'est passé, le développement je dirais dans le réseau public à travers les années récentes donc ça va être une discussion intéressante, merci de l'invitation.
MPB : Ensuite j’ai le plaisir de vous présenter Jimmy Siméon que moi je connais un peu, je vais quand même faire un petit deux min [de description] qui n’est pas dans sa bio[graphie], mais bon il est également diplômé de l'Université de Montréal. Il a fait le programme en études autochtones, entre autres, lors de ses études, donc je tiens à souligner cela parce que, bon voilà, c'est mon petit côté… c'est un peu son alma mater et, aussi, mon université. Donc Jimmy, à part ça, est navigateur autochtone en santé depuis 2 ans à Médecins du Monde. Il est originaire à la communauté innue de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean. Il travaille auprès des personnes autochtones vivant en situation d'itinérance à Montréal afin de les accompagner dans la prise en charge de leur santé en créant des ponts avec le monde médical. Alors, qu'est-ce que c'est un navigateur autochtone en santé ? C'est d'abord de respecter les réalités identitaires et culturelles de chaque personne qu'on a accompagnée afin de rendre l'expérience de soi plus humaine et culturellement sécuritaire, donc bienvenue Jimmy !
Jimmy Siméon (JS) : Merci Marie-Pierre ! Kuei kassinu etashieku[16] ! Ça fait vraiment plaisir d'être là, c'est vraiment un honneur de pouvoir partager cet espace-là avec vous pour réfléchir collectivement à ces enjeux-là, ces réalités dans lesquelles je suis confronté constamment dans mon travail, que je vis de plein de façons sur le terrain pour mon travail, beaucoup sur le terrain, puis dans les services de santé.
Je travaille avec des personnes autochtones qui viennent de toutes les communautés, qui ont des histoires aussi riches et différentes les unes que les autres, ce sont des personnes magnifiques avec qui j'ai eu la chance d'accompagner dans la prise en charge de leur santé afin de répondre à leurs besoins au niveau de la santé, de les accompagner vers le système, vers le réseau de la santé. C'est un honneur pour moi de faire ça, puis d'être ici aujourd'hui, puis de pouvoir apporter un petit peu une partie de leur message, une partie de leur réalité pour qu'on se transforme sans action concrète dans la recherche de solutions, puis dans la création de solutions… donc merci de me recevoir ici !
MPB : Merci Jimmy. Et, donc, en quatrième : Jason Coonishish. Jason coordonne les interventions d'urgence dans les situations qui menacent la prestation des services cliniques à la population d’Eeyou Etschee[17], région [sociosanitaire] No 18 dans le Nord-du-Québec. Fort de plus de 10 ans d'expérience, Jason a assuré le leadership lors d'interventions d'urgence en cas de pandémie, pas uniquement durant la COVID-19, mais déjà lors de la H1N1 (influenza de type A), de l’évacuation de communautés en raison de feux de forêt, de recherche et de récupération, de sauvetage et de situations de type « code rouge » et « gris »… et Jason gère un service qui reçoit plus de 3 000 appels d'ambulances par an, le tout réparti à travers les 9 communautés cries sur un territoire qui s'étend sur une zone géographique plus grande que la France ; ce qui me touche particulièrement vu mes origines.
Jason aime le hockey, la chasse et la pêche il pratique également la médecine traditionnelle et il est le co-auteur de quatre thèses sur l'utilisation de la médecine traditionnelle dans le traitement du diabète [de type 2], donc bienvenue Jason !
Jason Coonishish (JC) : Bonjour ! L’année qui s’est écoulée s’est révélée une longue et difficile année de travail en collaboration avec les responsables de la sécurité publique [RSP] de toutes les communautés et en raison de ce qui se passe au sein de nos milieux, dans les régions, lorsqu’elles sont durement touchées, en particulier, plus récemment, par les variants. Alors je vous remercie de votre invitation et je ferai de mon mieux pour vous fournir les renseignements dont vous avez besoin. Merci, Mîkwec[18]
MPB : Merci beaucoup ! Alors, qui aurait envie de commencer à prendre la parole de façon plus large pour nous parler justement de ces obstacles, de ces iniquités que vous avez remarquées dans le cadre de votre travail ?
SF : Par rapport à la pandémie ?
MPB : Oui, par rapport à la pandémie.
SF : Évidemment, c'est une situation exceptionnelle que nous vivons présentement depuis 2020 avec cette pandémie-là, puis comment on doit intervenir dans nos communautés, puis surtout comment mettre en valeur aussi les savoirs traditionnels reliés à la médecine. Je crois que ça a été un enjeu spécial qu'on a rencontré dans nos communautés, de devoir se mobiliser face à une pandémie mondiale, quand on sait que l'histoire nous a montré que les peuples autochtones ont été touchés par des épidémies, des pandémies, puis pourquoi il fallait agir rapidement.
Évidemment, c'est par la mobilisation, créer une communication aussi entre les communautés qui nous entourent, et les municipalités, pour travailler ensemble pour se protéger collectivement.
Évidemment, il a fallu mettre de l'avant des mesures qui répondaient à notre identité aussi, qui répondaient, par exemple, à permettre aux familles d'aller en territoire, de pouvoir se protéger et, aussi, d’aller chercher de la médecine traditionnelle. C’est un point que je voulais souligner, car c’est aussi grâce aux savoirs traditionnels qu’on peut se protéger.
MPB : Merci Sipi ! Lisa ?
LW : Alors je vais essayer de suivre vos trois points dans la structure [conversationnelle]. Ça a été très rapide et tout a été fermé dans la communauté. On a mis en place un comité avec des représentants des différents organismes de la communauté, ce qui a beaucoup aidé à établir un sentiment de confiance dans la communauté envers ce comité stratégique, ou de gouvernance, pour vraiment aider à éduquer et à communiquer avec la communauté pour qu’elle puisse prendre des décisions personnelles pour la protection de leurs familles à tous les jours. Donc ça a été probablement ce qui a été le plus important dans notre réponse à la pandémie c'est la communication pour la mobilisation collective des gens et pour la compréhension. Pour avoir une compréhension de chacune des décisions, de chacune des mesures sanitaires, parce que cette compréhension-là aidait pas juste à renforcer la confiance, mais comme je l'ai dit, [elle] a contribué au développement de la mobilisation collective, puis la responsabilisation de chaque individu envers la communauté en général, dans son entièreté.
Mais cette seconde vague de la pandémie[19] a créé vraiment une crise de santé mentale, parce que la première vague (mars à juin 2020) a été tellement rapide, puis il y avait eu un focus seulement sur la santé physique et donc c'est là, appuyée par toute la pensée traditionnelle, que l’on a vraiment dû modifier notre approche pour regarder la personne dans son entièreté, donc de vraiment focuser sur la santé physique bien sûr, mais spirituelle également, vraiment holistique et traditionnelle. Vraiment, on a essayé de suivre le nombre d'agressions, de surdoses, de suicides, parce qu’on a eu des augmentations. Donc, même si on a été assez chanceux de ne pas avoir de décès reliés spécifiquement à la COVID-19 dans notre communauté, nous avons quand même noté des impacts sociaux, économiques, psychosociaux et financiers, de la violence conjugale, etc. On a eu des impacts assez majeurs, comme probablement plusieurs autres communautés, mais ça fait en sorte qu’en focusant sur ces choses-là, on a pu vraiment aussi avoir une meilleure… avoir cette collectivité mobilisée pour assurer la protection de la communauté dans son entièreté.
Alors, ça a amené beaucoup une modification, au cours de la pandémie, de comment on a amené des changements ou des mesures sanitaires et ce qui était vraiment important au niveau de l'autonomie de notre communauté, c'est de, dès le début de la pandémie, de statuer avec le ministère de la Santé [et des Services sociaux] (MSSS) qu'on était autonome et qu'on a pu adapter les mesures sanitaires en lien avec les besoins de notre communauté.
Donc, les directives qui sortaient à chaque 5 minutes, on a pu les modifier en lien avec nos besoins très spécifiques. Donc, par exemple, pour couvrir des besoins de santé mentale, mais, même si au Québec, ou en Montérégie, par exemple, on a pas pu avoir des rencontres avec deux domiciles chez nous, on a modifié [notre stratégie] pour pouvoir avoir des rencontres avec ces deux domiciles, mais [tout] en s’assurant de bien communiquer les mesures et de le faire de façon sécuritaire et aussi en lien aux besoins de chaque famille et chaque individu.
On a réalisé très, très, très rapidement qu’il y a comme un continuum d'acceptation d’un niveau de risque dans la communauté donc vous avez ceux qui n'acceptent aucun risque du tout et ceux qui sont très à l'aise avec un niveau de risque.
Et donc il fallait offrir des mesures pour respecter où se situait chaque individu ou chaque famille dans leur parcours au courant de la pandémie, c’était quelque chose qu'on a essayé de faire à travers la communication et l'éducation.
On était beaucoup à l'écoute aussi, donc souvent lorsqu’on prenait une décision ou qu’on mettait une mesure en place en place, la réaction de la communauté. En étant à l’écoute, ça nous donnait les moyens de modifier les mesures mises en place et de respecter aussi chaque individu donc cela nous a permis de parfois faire un recul en arrière, ou parfois d'aller un petit peu plus à l’avant plus rapidement parce qu’en étant à l'écoute de chacun individu [sic].
On a fait des surveys aussi, pour avoir l’avis de chaque individu, et on a fait des appels téléphoniques à chaque domicile. Très simple, avec l’annuaire téléphonique, puis on a donné l'opportunité aux individus d'offrir leur point de vue sans avoir le regard de tout le monde dans la communauté.
Si on parle d'obstacles, les médias sociaux ont été vraiment un grand obstacle pour nous soit pour l'adhésion à la vaccination ou aux mesures sanitaires, ou encore avec le partage d'informations non scientifiques et non fiables. Et il a fallu vraiment suivre les médias sociaux continuellement pour pouvoir contourner cette vague négative.
Puis, dans les médias sociaux, ça partageait dans la négativité et ça a joué contre nous pour… on essayait de travailler vraiment avec la collectivité, le sens du travail d'équipe, parce qu'en fait il fallait avoir toute la communauté ensemble durant la dernière année, ce qui est vraiment une force motrice dans les moments difficiles. Par contre, les médias sociaux nous tiraient vers la négativité, vers le stigma, vers la violence latérale entre nous. Donc il a vraiment fallu travailler cette violence-là, à travers les médias sociaux, pour générer de la positivité et de l'acceptation… d'où on était d'être capable de voir aujourd'hui le positif, puis comment apprendre d'une façon positive à travers la pandémie. On a essayé vraiment d'identifier comment la pandémie nous a aidés à retourner vers notre médecine traditionnelle, la food-security. On a vraiment maintenu beaucoup de focus sur nos apprentissages et [sur] comment tourner le négatif de la pandémie vers des aspects positifs. Je pense que j'ai fait mon 5 minutes. Je ne veux pas trop prendre du temps puis, peut-être, durant la période de questions je peux en dire plus, voilà, je vais arrêter pour l’instant.
MPB : C’est très intéressant Lisa ! Alors, on en écouterait plus, mais on va y revenir sans doute tout à l'heure. Donc je vais céder tout de suite la parole à Jimmy sur ces obstacles et ces iniquités. Forcément, j'imagine qu’en contexte d'itinérance, il doit y avoir certains enjeux particuliers.
JS : Ouais [sic], en effet on est beaucoup dans la précarité, puis la pandémie est venue accentuer la précarité des personnes autochtones vivant en situation d'itinérance, fortement, c'est venu complexifier leur mode de vie, leurs habitudes, l’accès aux différentes offres de services que ce soit en santé, mais dans toutes les autres sphères aussi… c'est devenu beaucoup plus difficile d'accéder aux services.
Pour imager un peu, dans le début de la pandémie, on ne pouvait plus se rendre physiquement dans plusieurs lieux de services que les personnes allaient de façon régulière, quotidiennement, pour avoir des services de base essentiels. Souvent, il fallait appeler pour prendre rendez-vous, donc déjà là c’est un obstacle important, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un téléphone en permanence, puis d'avoir accès à ce mode de communication là, puis de planifier les rendez-vous. Quand ce sont des besoins de base, souvent tes besoins de base c'est dans l'immédiat qu’il faut agir, tu en as besoin maintenant ! Ce n’est pas [logique] de planifier un rendez-vous pour attendre que ce soit le bon moment, puis toute réorganiser ta vie (de la journée et de la semaine) en fonction de combler ces besoins de base là. La vie a été beaucoup plus complexe, parce qu'il faut comprendre qu'en… je travaille spécifiquement avec les personnes autochtones en itinérance, donc je connais beaucoup cette réalité-là, mais en comparaison aux autres groupes qui vivent dans l'itinérance, c’est une itinérance que je considère vraiment complexe et riche aussi, dans le sens où il y a beaucoup de liens autres à faire que le coin de la rue où on les voit constamment : ben [sic] dans une journée, ils peuvent s’en aller à une ressource, s’en aller chez un ami. On peut également ne pas les voir pendant quelques jours parce qu’ils sont partis à l'extérieur de Montréal afin de retourner dans leur communauté. Ils y ont des liens très forts, puis c'est une itinérance qui se vit plus collectivement, plus de façon communautaire, très serrée, où les gens se supportent beaucoup.
Donc, avec la pandémie, dans le début de la pandémie, le fait que certaines communautés ferment [leurs frontières pour limiter la propagation de la COVID-19], que les compagnies de transport suspendent leurs services, que les moyens de communication soient plus difficiles, que les services de base à laquelle les populations itinérantes avaient accès ont été restreints, certains n'étaient plus accessibles et pour d’autres c’étaient plus compliqué d’y accéder. Puis, mon travail à la base c'est d'accompagner, de les accompagner vers le système de santé pour recevoir des soins médicaux, mais je ne pouvais plus rentrer dans aucun établissement pour des raisons sanitaires, donc je devais accompagner la personne jusqu'au lieu et l’attendre à l’extérieur, ou simplement annuler l’accompagnement parce que la personne avait vraiment besoin d'un accompagnement lié à des traumatismes, lié à toutes sortes de choses qui font qu'elle ne veut pas se retrouver dans un rendez-vous médical, ou dans un certain hôpital, chez le dentiste, toute seule puisque c'est juste insupportable.
À mon niveau à moi, au niveau de l'organisme, en fait de Médecins du monde, la façon qu'on avait de procéder, ça a été d'arrêter nos services pendant les deux premières semaines pour se réorganiser, pour être capable de continuer d’offrir nos services de façon sécuritaire, c'est-à-dire qu’on a une clinique mobile, donc c'est un camion avec une clinique médicale à l'intérieur, puis on se déplace un peu partout dans la ville de Montréal, où les gens sont, pour aller offrir des services. Il y a toujours des infirmières qui sont présentes puis, avant la pandémie, on avait à l'occasion un médecin bénévole qui était présent avec nous, donc ça permettait d'offrir des services de santé, de soins de proximité on the spot, où les gens sont, donc ça permet d'éviter beaucoup, beaucoup de problèmes du fait de devoir aller vers le réseau de la santé directement. Puis, après ça, une fois que les soins ont été reçus, on peut réorienter. On peut réorganiser un suivi de soins avec les personnes selon leur demande, parce que l’objectif c’est surtout de répondre à leur demande. Qu'est-ce qu'ils dont besoin puis, qu'est-ce qu'ils vont nous demander. Puis là, après ça, on met tout en oeuvre pour essayer de répondre à ces demandes-là, puis que la personne soit impliquée dans son processus de soins dans la façon dont elle veut que ça se passe aussi. Donc, on avait arrêté pendant deux semaines le temps de se réorganiser. Quand on a recommencé, tous les soins, l’offre de service se faisaient à l'extérieur de la van [sic], d’où le concept d'avoir une van [sic], d'avoir un lieu sécuritaire où les gens peuvent recevoir des soins, eh bien, ça c'est complètement transformé !
Il a fallu organiser un setup avec des bâches à l'extérieur, des tables, qu’il y ait une certaine intimité même si on est à l'extérieur, puis que les soins puissent se faire de façon sécuritaire, parce que notre but c'est d'aider les gens avec leur santé, mais on le sait dans plusieurs milieux de travail, dans plusieurs organismes, dans plusieurs ressources en soins, le virus a été apporté par les employés, donc malgré toutes les mesures en place souvent c'était impossible que le virus ne se mette pas à circuler. Donc, nous, on avait la chance de pouvoir travailler à l'extérieur, de pouvoir s'adapter, puis de faire… d’offrir les soins à l’extérieur. Puis même la façon dont les infirmières donnaient les indications aux personnes… en fait pour qu'ils se fassent de l'autosoin, par exemple, pour une plaie, donc pour éviter le contact… donc on se rend compte dans tout ça que la relation humaine, que la relation de soin ou la relation avec la santé et le bien-être où… moi, je considère que c'est le contact humain avant tout que l’on doit privilégier, c'est la relation qu'on crée avec la personne qui est en avant de nous en se voyant, en se reconnaissant, en riant ensemble. Tout ça était rendu beaucoup plus difficile, puis s'enlevait, ça transformait vraiment nos pratiques, puis comment on pouvait faire notre travail. Donc, un autre de nos rôles, ça a été beaucoup d'avoir les bonnes informations. On a parlé… Lisa tantôt parlait un peu de communication, puis le fait qu'on travaille beaucoup en partenariat avec le réseau québécois de la santé, mais avec plusieurs autres organismes aussi, ça a été d'aller… pis [sic] avec l’Agence de la santé publique du Canada évidemment… d'aller chercher la bonne information qui changeait constamment pour pouvoir bien orienter les gens donc que ce soit pour accompagner des personnes vers le site de testing pour la COVID-19. Donc il y avait tout un processus, il y avait un processus d’isolement aussi qui est hyper complexe, que nous-mêmes on avait besoin d’accompagnement pour comprendre comment tout organiser ça, tout planifier ça. On avait ce rôle-là de pouvoir porter le message un peu des réalités que vivaient les gens qu'on accompagne pour que les services réussissent à s'adapter, puis qu’ils comprennent leur réalité, puis aussi, à l'inverse, qu’on puisse porter le message de la santé publique, des services, des organismes, des services au niveau du réseau de la santé, qu'est-ce qui est accessible, puis comment on pouvait y accéder. Donc ça a été une année… une grosse année d'adaptation… c’est encore beaucoup d’adaptation en ce moment… puis on en parlera peut-être tantôt, mais dans le début de la pandémie, pendant tout l'été jusqu'à l'automne, les gens en situation d’itinérance ont été quand même très préservés. Il y a eu très peu d'éclosions dans les organismes aussi. Sauf que ça a changé avec l'arrivée du froid, de l'hiver, du fait que les gens se retrouvaient beaucoup plus à l’intérieur, dans les ressources, et du manque de ressources d'urgence adaptées et, puis là, le virus s'est répandu. puis ça l’a été, durant la période des Fêtes, où beaucoup de travailleurs étaient en congé, donc nous on était en congé. On avait donc arrêté nos services, puis quand on est revenu au travail c'était une autre réalité, celle où l’on savait que la vaccination s’en venait, mais on n’en était pas encore rendu-là. Puis là, ben [sic] il fallait encore une fois toute réadapter les services. Il y a même une ressource de jour qui a été obligé de fermer complètement, de déplacer tous les gens dans un hôtel temporairement pour faire la quarantaine parce qu’il y a eu une éclosion trop importante dans l’organisme.
Donc, on peut imaginer comment pour plusieurs qui sont déjà dans une vie qui est précaire, dans une situation précaire, que s'adapter en plus à toutes ces nouvelles réalités, c'est venu affecter leur santé, comment c'est venu affecter leur confiance aux organismes, au système de santé, aux gens qui sont là normalement pour les aider, les accompagner. Puis qu’il n’y avait pas d'autre porte de sortie vraiment, dans le sens que… ouais [sic], plusieurs étaient pris à Montréal, plusieurs étaient pris dans ces situations-là, puis ils n’arrivaient pas à trouver d'autres options, puis d’issues-là. Donc, heureusement, il y a eu des mesures d'urgence qui ont été mises en place à un certain point. De notre point de vue, évidemment, ça arrive tout le temps trop tard, puis on se dit : « mais comment ça se fait que ça n’ait pas été réfléchi avant, puis que c'était pas déjà préparé ». Puis là, il y a une urgence puis on fait juste appliquer des mesures d'urgence. Donc oui, il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de colère générée aussi à ce niveau-là du fait qu’on n’était pas prêts… on n’était pas prêts puisqu’on répondait déjà, quand même, à des crises importantes, des crises sociales importantes… puis là il y a cette crise qui est venue exacerber toutes les autres crises qu'on essayait de régler ou de combler en prépandémie. Merci !
MPB : Merci Jimmy, on voit vraiment à quel point ça a affecté les relations humaines. Je vais tout de suite donner la parole à Jason.
JC : Il y a quatre ans, nous avons créé un groupe central d’action régionale pour les urgences. Le ministère de la Justice y avait intégré des directeurs, des membres de la police Eeyou, les chefs des services d’incendie et des responsables de la sécurité publique, ainsi que les dirigeants de nos cliniques dans toutes les communautés. L’année dernière, à la fin du mois de janvier, nous avons tenu une rencontre avec la direction de la santé publique de la région 18 du moment, en présence du médecin et de tous nos RSP, afin de nous préparer précisément à l’émergence d’un nouveau virus en Chine et à des mesures que nous pourrions être appelés à prendre, en fonction de ce que l’OMS annonçait. Tous commençaient à être sur un pied d’alerte à cette période, à la fin du mois de janvier. Nous avons donc prévu des échelons de coordination, de planification et de suivi. Au début de la période en question, nous nous sommes penchés sur la Loi sur les mesures d’urgence, ainsi que sur la Loi sur la santé publique, car, à vrai dire, c’est cette dernière qui entrait en vigueur.
Alors à ce moment, je travaillais en étroite collaboration avec notre direction de la santé publique. Huit piliers ont été établis, dont la coordination, la planification et le suivi ; puis, en second lieu, la communication concernant les risques et l’engagement communautaire. En outre, il y avait trois volets à cet échelon, dont la table des dirigeants, comprenant le grand chef et tous les chefs, le volet local comprenant les groupes centraux d’action locale pour les urgences dans chaque communauté et, enfin, le troisième volet comprenant le groupe central d’action régionale pour les urgences, le tout pour faciliter la gestion de ce qui se passe dans nos territoires. Nous avons ensuite renforcé la surveillance avec l’équipe de la santé publique, les enquêtes, les interventions rapides et les enquêtes de cas. Nous avons dû travailler en étroite collaboration avec les responsables de la sécurité publique, puisqu’ils savent où tout le monde vit dans les communautés et ils savent si les maisons sont surpeuplées ou non. Ils sont d’ailleurs en mesure de reconnaître les unités d’isolement. Il y avait aussi un autre pilier : le point d’entrée. En mars, lorsque la pandémie a été déclarée par l’OMS, nous avons immédiatement vérifié un point d’entrée particulier. Nous avons alors appelé toutes les entités pour vérifier si elles avaient des personnes à l’extérieur du pays. Avant que ces dernières ne puissent revenir dans nos communautés, elles devaient s’isoler pendant 14 jours. J’étais de retour au travail, au moins. Elles sont restées en isolement 14 jours ; nous avons pris les mesures nécessaires pour prendre soin d’elles pendant ces 14 jours, parce que nous ne savions pas à quoi nous avions affaire. Au fur et à mesure, nous nous sommes rendu compte que les laboratoires devaient eux aussi renforcer leurs mesures. Nous avons donc dû nous préparer à effectuer beaucoup de tests et d’analyses et tout le travail de laboratoire qui s’imposait. De même, la santé publique et tous les dirigeants des cliniques, la prévention des infections et toutes les mesures à prendre dans les cliniques, dont le lavage des mains et la distanciation sociale. Toutes ces mesures devaient être mises en place, afin d’assurer une bonne gestion de ces établissements de santé. Ensuite, une fois que nous avons eu des cas positifs, nous avons dû établir un bon plan de gestion des cas, ainsi qu’un soutien opérationnel et logistique. J’aborderai les détails à ce sujet un peu plus loin, parce que cela touche et a affecté beaucoup de personnes sur le plan de la santé mentale au cours de cette année, notamment de nombreuses fois en raison de l’isolement et de toutes ces règles qu’il fallait respecter. Nous avons donc travaillé en étroite collaboration avec les responsables de la sécurité publique, la commission scolaire et le ministère de la Justice, car nous avons beaucoup de personnes dans chaque groupe ou entité similaire. Je vous remercie !
MPB : Thank you Jason ! On voit bien dans les témoignages de chacun d'entre vous à quel point ça a pu d'abord soulever des questions au niveau de l'accès à des services, la communication, la transmission de savoirs aussi et la prochaine question que j'ai envie de vous poser c'est quelle leçon à votre avis devrait-on tirer déjà de cette pandémie qui n’est pas encore finie, alors des leçons-là qui pourraient être au niveau… Vous avez parlé de la sécurité alimentaire pour certains d'entre vous, des leçons au niveau organisationnel, des leçons au niveau de la redéfinition des priorités dans vos communautés ou vos milieux de travail donc voilà, quelles seraient les leçons qui devraient être retenues déjà de ce contexte si particulier. Sipi ?
SF : D'abord avec ce qui se passe présentement avec la pandémie, puis le contexte dans lequel nous sommes dans les communautés autochtones avec la surpopulation dans les logements, on voit que la problématique… on a vu… On connaissait déjà ce qui se passait avec la problématique de pénurie de logements, pis [sic] comment répondre à ce besoin-là c’est… évidemment, il y a des mesures qui ont été prises telles qu’éviter les rassemblements, mais quand il y a plusieurs familles dans une maison, c'est une problématique qu’on a observée et à laquelle on doit répondre en tant qu’élu, mais aussi en tant que collectivité. Et je pense que c'est important de considérer cet enjeu-là d'autant plus que c'est partout au Canada qu’il y a cette problématique-là, qu’il y a un besoin criant que le gouvernement fédéral agisse pour assurer des logements convenables aux familles situées dans les communautés autochtones.
Ça viendrait éviter des problèmes de crises supplémentaires qu'on a connus au courant de la pandémie. Par exemple, des crises sociales, des problèmes qui engendrent dans les communautés. Pis [sic] je pense que c'est avec cette pandémie-là qu’on peut faire des recommandations. On sait qu'il y a une élection fédérale qui s'en vient, pis [sic] je pense qu’il faut utiliser ces argumentaires-là pour faire connaître, pour faire réagir au gouvernement… qu’il y a un besoin criant dans les communautés.
Puis en plus de ça, quand on parle de logement on parle aussi d'autres problèmes, par exemple l'éducation et le décrochage scolaire, ça c'est un enjeu que nous rencontrons.
On a dû développer des formations en ligne pour les jeunes dans les écoles, pis [sic] encore là il y a un désintérêt chez les jeunes, chez les enfants, de faire des cours en ligne, à cause que ce n’est pas dynamique, à cause que la relation avec leurs enseignants, ce n’est pas pareil. Puis, je crois que cette pandémie-là nous a montré beaucoup de choses, mais elle nous a aussi démontré qu’il faut aussi qu'on s'adapte avec cette réalité-là, en espérant que dans les prochaines années, les prochains mois, on maintient ces leçons-là pour améliorer nos sociétés, nos communautés. Mikwetc[20] !
MPB : Merci Sipi ! Je passe tout de suite la parole à Lisa.
LW : Des leçons… Il y en a tellement ! Je vais en nommer quelques-unes. La première, comme j'ai mentionné, cela a été vraiment de focusser sur la personne dans son entièreté. Donc ce n'est pas juste le physique, mais le spirituel, la santé mentale. Tous les déterminants de la santé sont extrêmement importants dans les mesures à mettre en place. On a appris aussi beaucoup, en fait une leçon sur l'éthique durant la pandémie, par rapport aux décisions prises pour la communauté et la nécessité de l’implication de la communauté dans ces prises de décisions. Donc, on sait que les mesures sanitaires sont très top-down et peuvent amener ou ramener beaucoup de peurs, de craintes et de méfiance déjà existantes dans le système de santé, parce qu’il n’y a pas beaucoup de place pour la prise individuelle de décision. Cette émancipation que nous essayons de redonner à la communauté a été perdue pendant la période de la COVID-19. Alors, vraiment… cet apprentissage de vraiment avoir l'aval et l'implication de la communauté dans les prises de décisions et même parfois quand ça nous met à risque parce que je crois que ce que l'on a oublié durant la pandémie c’est que… par exemple, ici à l’hôpital on abrite un CHSLD, donc dans notre objectif était de protéger tous les résidents. On a oublié le fait que c'est aux résidents et à leurs familles de prendre des décisions de ce qui est mieux pour eux et que cela n’était pas à nous de prendre des décisions pour eux. Et donc sur le temps éthique, ça nous a amenés à beaucoup de discussions et communications, et d’implication de tous dans la façon qu'on actualise les mesures à l'intérieur de nos murs par exemple. Ce qu'on a appris aussi, ce que ce qui a été mit vraiment en lumière, c'est le lien direct qu'on a avec le ministère [de la Santé et des Services sociaux] (MSSS), le lien direct qui n'existait pas du tout et ça a été vraiment très évident au début de la pandémie, quand on ne recevait rien. Aucune directive. Les communautés ont été vraiment en retard pour aller de l'avant à la mise en application des mesures à cause de ce manque de communication directe avec le Ministère et on sait que ce n’est pas le fédéral qui a géré la pandémie à Québec, c'est vraiment le ministère de la Santé [et des Services sociaux] (MSSS). Le fait [est] que chez nous, on a une entente nation à nation avec le ministère de la Santé [et des Services sociaux] (MSSS). Par contre, depuis plusieurs années, on voit que cette entente-là ne fonctionne pas en réalité et donc ne pas avoir un lien direct avec le MSSS nous a donné la leçon qu'il faut retravailler cet aspect politique. Et quand on parle d'accessibilité, qu'on doit vraiment continuer la lutte pour avoir accès à la documentation dans la langue qu'on a besoin, donc chez nous en anglais. Donc ça, c’était une leçon difficile à apprendre au début de la pandémie. Donc, [c'est] quelque chose qu'on sait qu'on doit continuer à travailler fortement. Ce qu'on a vu aussi, ce qu'on a appris rapidement à travers les actions qu'on a mises en place. Par exemple, on a créé notre propre équipe de santé publique locale. Donc, oui, on avait une communication avec celle de la santé publique régionale, mais notre santé publique locale était formée d’infirmières de la communauté. Donc ce sont des gens qui faisaient le contact-tracing, qui s’occupaient de tous les aspects de la santé publique, mais par le biais de la communauté elle-même. Donc ce sont nos enfants, nos parents, nos tantes, nos grands-parents, qui se connaissent tous, qui avaient ce lien-là avec la communauté, et donc en connaissant notre communauté et en connaissant les individus. Donc ça nous ramenait cet aspect personnel et humain dans les contacts. Donc, ce n’est pas juste quelqu'un de n'importe où là qui dit « ben [sic], oui » et qui n'avait pas beaucoup de connaissances de c'est quoi les besoins de communication, comment on doit communiquer pour s'assurer que cette information-là soit bien comprise. C'est en utilisant nos propres résidents de la communauté dans l'approche communicationnelle avec la communauté. Et ça, qu'on a fait ce changement-là dans notre approche, ç’a eu un impact immense dans la confiance de la communauté envers les mesures mises en place, donc cela a été un grand apprentissage aussi. Et tous ces apprentissages-là vont pouvoir se traduire, je crois, dans les pistes de solutions pour formuler une offre de services sécuritaires en général et pas juste pour la COVID-19, voilà !
MPB : Merci Lisa ! Je vais tout de suite passer la parole à Jimmy. J'imagine que certaines leçons aussi sont un peu similaires dans d'autres endroits donc je te laisse la parole.
JS : Ouais [sic], ça fait beaucoup écho à ce qui vient d’être partagé. De notre côté, on travaille beaucoup en partenariat avec d’autres instances, puis c’est une des choses qui s’est révélée encore plus importante depuis le début de la pandémie : quand une ressource n’est plus capable d’offrir son service, ça prend une autre ressource qui est en place ou qui prend le relais. Malheureusement, en itinérance, souvent les ressources sont rares, difficiles d'accès, ciblées pour des groupes particuliers avec chacun une approche différente. Donc quand ça ne fait pas avec une ressource, c'est difficile d'aller vers autre chose ou de trouver celle qui est adéquate pour la personne avec ses propres réalités, surtout lorsqu'on parle de réalités culturelles autochtones. Donc, d'avoir en place… On a le réseau de la santé, on a Médecins du Monde, qui est comme un organisme qui fonctionne un peu en parallèle, pas en partenariat, qui vient combler d'autres services que le réseau au Québec a de la misère à combler, puis ça s’avère être une solution qui fonctionne depuis plusieurs années, puis qui va continuer de fonctionner encore pour plusieurs années parce qu’on réussit à s’adapter aux besoins changeants. On réussit à s’adapter rapidement en fait, puis on réussit à compter sur nos partenaires, les autres organismes partenaires qui viennent nous supporter, qui viennent nous aider. Puis, avec la pandémie, ça a été quelque chose d'essentiel de se dire « bon ben [sic], vers qui on se tourne ? Comment on peut apporter de l’appui avec les ressources limitées qu'on a nous-mêmes ? Et comment on peut travailler ensemble dans ces nouvelles conditions-là, dans ces nouvelles réalités ? ».
Mais s'il y a déjà plusieurs choses qui sont en place, bien différentes, pour répondre à de mêmes besoins, le jour où il y arrive une nouvelle crise, s’il arrive une pandémie, puis que toutes ces choses-là qui sont en place viennent à être ébranlées, à être limitées dans ce qu'elles peuvent faire, ben [sic] le fait d'avoir un filet de sécurité ou un réseau qui est déjà en place permet aux personnes de naviguer à travers ça, d'aller vers d'autres ressources, puis d’être capables d'aller chercher les services essentiels qu’elles ont besoin. Tandis que si tout est centralisé vers une même place, chaque organisme est vraiment limité dans un rôle restreint, précis, et à ne pas obtenir les connaissances nécessaires pour intervenir avec des personnes autochtones qui ont des réalités culturelles super complexes, super différentes d'une communauté à l'autre, mais qui ont des réalités communes, des réalités historiques, qui doivent être connues à la base pour pouvoir servir adéquatement des personnes qui vont utiliser leurs services qui sont d'origine autochtone.
Donc ça m’amène, au niveau de la formation… J'ai participé à différents ateliers, à différentes présentations où on offrait une certaine sensibilisation aux réalités culturelles autochtones à travers notre travail, puis on essayait d'apporter un peu les réalités des personnes que l'on rencontre à travers notre travail. Puis c'est quelque chose qui est pas assez présent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez parce qu’on est pris beaucoup dans le fait de répondre aux urgences immédiates, donc quand c'est le temps de passer à des tables de concertation, offrir de la formation, faire un évènement comme aujourd'hui, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qu'on n'est pas sur le terrain, donc on est limité dans notre équipe, dans les ressources qu'on a de disponibles, donc c'est tout le temps de choisir où on met ce temps-là. Puis les besoins sont tellement grands, les ressources tellement limitées, qu'on doit couper sur le service qu'on offre directement au niveau de l'accompagnement pour agir au niveau du plaidoyer et agir au niveau de la sensibilisation, puis de réfléchir à trouver des solutions. Malheureusement, les personnes qu'on accompagne, qui sont les principaux concernés, ne sont pas assez présentes. On est tout le temps en train de parler, puis de réfléchir pour eux, puis on partage certaines réalités, mais ce n’est pas nous qui vivons en situation d'itinérance, ce n’est pas nous qui avons l'histoire de la personne, puis les espaces où on peut justement avoir ce lien direct là et puis, où ils peuvent avoir la même place que nous on a en ce moment, ben c'est très, très rare. Parce que nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est d'impliquer les personnes dans leur prise en charge de leur santé, donc ils sont concernés par leurs besoins, c’est eux autres les mieux placés pour savoir qu’est-ce qu’ils ont besoin. Puis nous, après ça, on est en appui pour les aider. Donc c’est la même chose pour les réalités, l’ensemble des défis qu’ils vivent, ce sont eux qui sont les experts de leur réalité, puis on doit leur faire de la place, c’est nécessaire de porter leur message, c’est nécessaire de faire du plaidoyer en leur nom, mais y’a [sic] personne de mieux placé que les personnes concernées pour porter leurs propres messages, puis réfléchir à des solutions aussi.
MPB : Merci Jimmy ! On voit vraiment l'importance d'impliquer les gens dans tous vos témoignages, d'impliquer les premiers concernés dans la prise en charge de cette pandémie qui quelque part nous échappe tous, mais qui est une manière aussi de regagner, peut-être, un peu de contrôle sur tout ça, en tout cas de gouvernance. Je cède la parole maintenant à Jason.
JC : Je vous remercie. Plus tôt, en ce qui concerne le point d’entrée que j’ai mentionné : nous avons vérifié au sein de notre réseau de santé à savoir si des employés se trouvaient à l’étranger. Nous en avons trouvé deux qui étaient en voyage en Chine et, à leur retour au Canada, nous avons été les premiers au pays à procéder à l’isolement de 14 jours. C’est ce que nous avons fait pour deux de nos employés. Ensuite, lorsque la pandémie a été déclarée, nous avons vérifié auprès d’autres entités et de membres de la communauté qui étaient à l’étranger. Nous avons trouvé quatre personnes qui se trouvaient dans le Sud, en vacances. La pandémie n’avait pas encore été déclarée pendant qu’elles se trouvaient là-bas ; mais le jour suivant la déclaration de la pandémie, elles sont rentrées au Canada. Nous avons donc dû les isoler pendant 14 jours. Or, sur la route du retour depuis Montréal après leur arrivée à l’aéroport, ils ont eu un accident de voiture à l’extérieur de Matagami. Les ambulanciers qui sont venus à leur aide ne portaient pas d’équipement de protection, ce qui a eu une incidence sur cette ville. L’ambulance de la collectivité a perdu deux répondants ; ils ont dû être isolés, parce qu’ils avaient possiblement été en contact avec l’une des personnes qui venaient de quitter un pays étranger. Ces quatre voyageurs ont donc été testés. Une autre personne crie d’une autre communauté a été impliquée dans l’accident ; nous avons dû l’isoler également, portant le nombre de personnes à isoler à cinq. C’était nouveau pour nous, nouveau pour la communauté ; nous nous demandions ce qui se passait. Alors c’est ce qui s’est passé au début. Une fois ces quatre personnes isolées, deux d’entre elles ont reçu un résultat positif. Au début, lorsque nous les avons séparées, nous les avons placées dans deux foyers ; elles ont choisi chez qui séjourner. Des deux personnes dont le test était positif, l’une séjournait chez quelqu’un qui ne l’était pas et l’autre, chez quelqu’un qui ne l’était pas non plus. Nous avions donc deux personnes hébergées chacune dans une maison distincte, où une personne était positive et l’autre, non. De plus, il s’agissait de travailleurs de la santé, ce qui a eu une incidence sur les ressources humaines de nos cliniques. C’est ce qui s’est passé au début quant à ce seul pilier, en ce qui concerne le point d’entrée. Cela concerne également les RSP, en raison de l’isolement qu’ils établissent dans les communautés. Ce fut une grande expérience d’apprentissage. De plus, tout au long de l’année, nous avons eu quelques décès, non pas des personnes dans notre territoire, mais des membres de la communauté qui vivaient au Sud, dans le CHSLD. Comme vous le savez, la province a été très durement touchée dans les CHSLD au début de la pandémie. Nous avons eu beaucoup de décès ; beaucoup d’aînés sont décédés. Nous avons donc été éprouvés par cette situation, et nous avons dû… lorsque nous devions ramener les corps dans le Nord, il fallait planifier avec le transporteur aérien ; lorsque le cercueil d’un défunt arrivait à la communauté par avion, on l’emmenait directement au cimetière. Seule la famille pouvait l’y accompagner, et tout le monde devait porter un équipement de protection. Toute la logistique de la planification des funérailles était donc en place. Le plus triste, c’est que, en raison des règles sanitaires de cette période, certains petits-enfants n’ont pas pu voir leur grand-père qui était dans le CHSLD au Sud et qui est revenu dans un cercueil. Cette réalité a donc eu un effet important sur la santé mentale des communautés, en raison de ces enterrements et de la perte de nos aînés dans les CHSLD du Sud. Voilà donc quelques-unes des expériences que nous avons vécues en tant que communauté concernant les funérailles et la planification des funérailles. C’était difficile, c’était vraiment difficile pour la communauté, c’était difficile pour les gens. Je vous remercie !
MPB : Thank you Jason ! Alors, moi, pendant que je vais poser encore une question, j’aimerais encourager vraiment les gens qui nous écoutent à commencer eux-mêmes à poser des questions, n’hésitez pas. Soit vous la posez dans la petite rubrique questions-réponses du Zoom, soit vous pouvez lever la main, mais, alors là, ça va être les organisateurs qui vont vous voir parce que moi je ne suis pas sûre que je pourrais vous voir et vous pouvez également poser des questions sur la page Facebook [du CIÉRA]. En dessous de la retransmission en direct de la table ronde il y a un coin pour publier vos questions, donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez à nos participants concernant le thème de cette table ronde. Moi, la question que j'avais envie de poser c’est que vous avez beaucoup parlé, tous, de la qualité des relations humaines, le fait que ça a affecté le lien social. On connaît tous, par exemple, l'importance de l'humour dans les communautés autochtones, et en milieu autochtone en général, le fait d'être proche les uns des autres, l’importance de la parenté, et forcément la pandémie, elle a affecté les évènements collectifs. Il y a eu les pow-wow qui ont été annulés, puis il y a des évènements collectifs qui sont beaucoup moins drôles, je pense évidemment aux funérailles, les funérailles ne pouvaient pas avoir lieu comme d'habitude avec tout le monde. Il y a aussi les mariages, pleins d'autres choses… Donc quelles ont été les manières de compenser ces atteintes au collectif et qu'est-ce que ça a pu faire émerger comme idées pour maintenir le lien social le plus possible ?
SF : Eh bien, il y a eu une interdiction de rassemblements évidemment, mais il y a eu un pow-wow local dans la communauté, avec toutes les mesures sanitaires évidemment, puis ça a permis de partager aussi pendant ce moment-là avec les membres de la communauté, comment ils vivaient. Puis on l'a fait quand même assez tardivement dans l'été donc il faisait froid, une chance qu'on n'a pas eu d'éclosion à ce moment-là. Ça a permis aussi aux familles et aux danseurs de pow-wow de pouvoir sortir de leurs maisons. Il y a eu aussi des rencontres en territoire, mais ça c'était des familles qui s'organisaient des rencontres pour pouvoir sortir de la communauté parce que souvent déjà qu'on est dans une Loi, par exemple la Loi sur les Indiens (1876), puis dans une réserve, puis en plus de ça de devoir vivre en isolement, confinés selon les mesures sanitaires, ce n’était pas évident. Puis avec les activités familiales, c’était permis de le faire, mais avec des mesures sanitaires. Puis je pense que c’est avec ces moyens-là aussi qu’on a pu aider les gens à pouvoir réapprendre comment se rencontrer en public.
MPB : Merci Sipi ! Lisa ?
LW : Nous aussi on a eu un petit pow-wow local, en fait, juste devant le CHSLD pour les résidents durant l'été, ça a vraiment amené beaucoup de positivité dans la communauté. On a aussi des musiciens locaux ou des DJ qui faisaient des petits concerts dehors, mais sans regroupements, soit par [visioconférence] Zoom, ou toujours devant la résidence, mais pour les familles aussi pour essayer de se rapprocher, amener la musique, la musique est très importante.
On a eu une parade aussi qui a rapproché les gens, une parade de remerciement pour tous les travailleurs, une parade d'automobiles, donc tout le monde reste dans leurs automobiles donc, en fait, toutes les choses qu'on a mises en place venaient avec beaucoup d'éducation, de communication, de comment le faire d'une façon sécuritaire, mais avec le but de rassembler les gens d'une façon sécuritaire, en fait. Durant l'Halloween, par exemple, on a eu des petits concours de décorations des maisons. Donc c'est très individuel, juste votre famille, mais c’est quelque chose qui amenait un petit peu le rassemblement.
Pour les choses plus difficiles : la fin de vie, les soins palliatifs, les funérailles… On essayait de prendre les directives de Québec, soit les mesures sanitaires, puis on les a modifiées pour répondre un petit peu plus aux besoins de la communauté. Par exemple, pour la fin de vie, on est habitués à 50 personnes dans notre CHSLD, on a des chambres familiales pour que tout le monde puisse se réunir et être avec la résidente 24 h sur 24 jusqu'à son décès, et après. Alors on essayait de trouver des façons sécuritaires, peut-être ce n’était pas 50 personnes, c'est beaucoup moins, mais comment s'assurer que la famille soit en mesure de dire au revoir d'une façon qui était propre à eux, en respectant leurs besoins ?
On a eu beaucoup aussi de connexions [humaines] par Zoom et on a essayé de créer aussi… dans notre CHSLD, on a créé un compte sur la plateforme utilisée dans les écoles, ClassDojo, afin de faciliter la communication au jour le jour des résidents avec leurs familles, et ce, d'une façon sécuritaire. Donc il n’y avait aucun transfert d'informations médicales, c'était vraiment juste du social, donc une façon sécuritaire d’envoyer des photos, de communiquer avec nos éducatrices qui travaillaient dans les CHSLD. Et nos éducatrices ont fait des communications dans la communauté aussi, donc ceux dans les résidences avaient des activités journalières pour s’assurer de leur stimulation et mitiger les impacts de l’isolement, mais on a essayé d'amener ça à nos aînés dans la communauté qui habitent seuls. Donc soit par des appels téléphoniques, pour ceux qui n'utilisent pas beaucoup Zoom, donc des appels téléphoniques réguliers par notre équipe de soins à domicile, vraiment pour essayer de garder la stimulation. On a aussi fait des Facebook Live, donc des présentations sur Facebook ou YouTube, pour ceux qui y avaient accès, et dans les journaux avec des thèmes spécifiques ou des invités qui répondaient à des sujets variés là, pas juste pour donner les informations sur la COVID, mais aussi pour donner d'autres informations ou répondre un petit peu plus aux besoins en santé mentale, donc différents intervenants qui venaient donner des conseils ou des vidéos de personnes dans la communauté qui voulaient offrir un message à tous, donc on a essayé de trouver des façons comme ça de rassembler les gens.
Donc ce sont quelques exemples qu'on a utilisés, mais peu importe tout ce qu'on a fait, on est pris aujourd'hui, quand même, dans une situation difficile où les gens sont fatigués, ont été en isolement trop longtemps, où les impacts en santé mentale sont tellement grands que ce que l'on sait que… On est en train de développer un plan vraiment pour les cinq prochaines années, comprenant le décrochage scolaire, une grande proportion de jeunes n'ont pas fini leurs études secondaires ou n'iront pas plus loin que le secondaire à cause de la pandémie, donc peu importe les mesures prises, l'impact va se sentir pendant plusieurs années. Donc il est encore plus important de développer des offres de service pour répondre à ces besoins, pour éviter tout ce qui peut venir à cause de la pandémie, voilà !
MPB : Merci Lisa ! Je passe la parole à Jimmy.
JS : Ouais, bah, [sic] je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'adaptation. L'adaptation, ça a été un peu la clé, je pense. C'est encore la clé de comment on s'adapte à ces nouvelles réalités, à ces nouvelles urgences-là, à cette nouvelle crise, comment on transforme notre pratique. Mon travail c'était d'accompagner les personnes vers le réseau de la santé, c'est devenu souvent de juste être présent et d’offrir de l'écoute. Quand je croisais les gens sur le coin de la rue où ils étaient, j'allais les visiter de temps en temps, peut-être plus régulièrement à certains moments. Puis, justement, on a parlé des décès, il y a eu quand même beaucoup de décès, et ici et dans les communautés, plusieurs ont perdu des parents, des proches, et ne pouvaient pas retourner vivre le deuil en communauté, donc c'est quelque chose qui… qui se portait à plein de niveaux parce qu’un deuil c'est complexe puis ça prend du temps. Il y a des étapes qui doivent se faire, il y a des actions qui doivent se faire… Puis seulement pour rendre hommage à une personne qui était décédée, vivant en situation d'itinérance, c'était beaucoup plus complexe d'organiser un petit rassemblement, tu sais faire un minimum pour souligner la perte de cette personne-là.
Puis, il y avait plusieurs choses spontanées qui se sont organisées, que ce ça soit de faire un genre de mémorial avec des photos, avec des messages, sur le coin d'un parc où la personne se tenait ou dans une ressource où elle allait fréquemment. Donc il y a eu cet esprit de communauté là qui s'est manifesté d'une belle façon à travers ces autres crises-là, à travers ces autres défis-là, tout au long de la pandémie, puis nous notre rôle ça a été vraiment de s'adapter pour continuer d'être présents. Plusieurs organismes ont dû arrêter leurs services pendant un certain moment pour plein de raisons. Il y a eu plusieurs départs, plusieurs bouleversements dans plusieurs services, mais je pense… Ce réseau de partenariat là, ce réseau de complicité là à travers les différents services, à travers les différents organismes, avec le réseau de la santé, avec la santé publique, ben [sic] c'est ce qui fait qu'on réussit à se réorganiser, puis qu’on ne laisse pas les gens dans l'oubli.
Une des choses que je retire beaucoup, c'est d’avoir renforcé les partenariats existants, d’en créer de nouveaux, puis de se permettre de mettre en place des initiatives qui n’ont jamais été faites, d'en faire l'expérience, de voir si c'est un projet qui peut fonctionner ou non puis sinon comment ça peut se transformer, qu'est-ce qu'on retire de cette expérience-là, mais on ne peut pas simplement continuer les choses comme elles sont depuis trop d'années. Faut se permettre de s'arrêter, de réfléchir puis de créer de nouvelles choses. Merci !
MPB : Merci Jimmy ! Jason ?
JC : Pour nous, c’est la saison du « Goose Break[21] ». Lors de cette période, une grande part des communautés partent dans les bois pendant de deux à six semaines ; ce qui représente pour eux un deuxième printemps d’affilée, en quelque sorte. Beaucoup de nos membres n’ont pas pu aller chasser dans le Sud, comme près d’Ottawa, dans les champs. Ils aiment ce genre de chasse, parce qu’ils peuvent abattre beaucoup d’oies pendant cette période. Notre association de trappeurs cris a donc dit aux gens de rester dans le Nord et de ne pas aller dans le Sud, en raison des variants qui arrivaient de toute façon cette année. L’année dernière, c’était le COVID-19, n’est-ce pas ? C’est donc ce qu’ils ont fait ; nous aussi. Nous n’avons pas permis à nos chasseurs d’aller chasser dans le Sud. Pour le « Goose Break », nous avons une société appelée Niskamoon Corporation. Cette corporation fait partie de l’accord avec Hydro-Québec. Nous avons investi près de 1,7 million de dollars, afin que tous nos chasseurs puissent se rendre dans les bois avec toutes leurs familles et sur leurs terres, à bord d’hélicoptères ou d’avions tous frais payés. En outre, l’essence des véhicules de certaines personnes est payée, parce que ces dernières ont accès à leurs terres par la route. Enfin, certaines des personnes les plus nécessiteuses reçoivent également de la nourriture, afin qu’elles puissent continuer à exercer ces pratiques traditionnelles ; c’est le moment de l’année où un enfant abat sa première oie et où une cérémonie est organisée pour lui à cet égard ; puis les gens tiennent également la cérémonie du « Walking Out[22] ». Nous avons donc besoin de cela. Le chef, le grand chef et tous les membres du conseil d’administration de Niskamoon [Corporation]en sont donc très heureux. Ils font cela deux années d’affilée, en investissant dans nos programmes ancrés dans le territoire et nos activités culturelles, car c’est ce qui nous rend forts et qui contribue à améliorer notre bien-être mental. Je vous remercie !
MPB : Thank you Jason ! Alors, on commence à avoir des questions qui rentrent des membres du public. Si c'est possible aux personnes qui ont posé des questions de se connecter et d’allumer leur caméra ça sera plus sympathique si vous pouvez si vous avez une connexion Internet assez stable. La première question venait de Christina Conelli et c'était une question pour Sipi. Je ne sais pas si Christina peut se connecter ? Je ne vois pas Christina, mais je vais sinon poser la question pour elle et peut-être pourra-t-elle se connecter à ce moment-là… Ah ! On me dit qu’elle arrive, on va attendre quelques petites secondes, parfois les connexions, même si on est dans une ère technologique où tout se fait dans l'instantané, on n’en revient pas quand ce n’est pas immédiat, dans la seconde. Bon, pour être trop stressante non plus, je vais peut-être passer la parole à une autre personne qui a posé une question. Je vais passer la parole à Christopher Fletcher.
Christopher Fletcher (CF) : Bonjour, hello everyone, j'ai écrit une question dans le Q & A et là elle a disparu donc je ne la vois plus donc je vais essayer de me souvenir de la question.
MPB : Moi, je l'ai, par contre, si tu veux… !
CF : Oh, non, ça va ! Je vais tenter quelque chose et le dire dans les deux langues, en même temps. Merci à tous et à toutes ! Tout d’abord, permettez-moi de dire que j’ai trouvé toutes ces présentations vraiment très intéressantes. C’est très intéressant de constater l’ampleur de la mobilisation dans les différentes communautés et nations et de réaliser à quel point les communautés autochtones au Québec ont réussi à se protéger contre la COVID-19 et à répondre aux contre-mesures imposées par le gouvernement. C’est également intéressant de réaliser à quel point de nombreuses communautés avaient une longueur d’avance par rapport au reste du Québec. Une question me vient donc à l’esprit : avez-vous l’intention de partager plus tard les enseignements tirés de ce processus avec les communautés et les nations, afin de renforcer davantage les capacités en matière de santé publique au sein des communautés et des nations, une fois que les circonstances seront un peu plus normales ?
MPB : Juste pour nous faire un petit plaisir de faire une très rapide traduction, en fait est-ce qu'il y a des plans si j'ai bien compris pour partager les leçons qui ont été apprises entre les communautés et les nations une fois que les choses sont revenues un petit peu plus à la normale, c'est bien ça Christopher ?
CF : Oui, merci !
SF : Ah, ça serait une nécessité de partager ces connaissances-là, ces informations-là, pour éventuellement mieux s’équiper, mieux s’outiller si on devait faire face à une autre pandémie. Mais aussi ces outils-là pourraient être utiles dans la gouvernance de tous les jours, dans les communautés autochtones, et je crois que ce serait bon de développer un mécanisme de partage entre les communautés par rapport à la gestion de cette pandémie, ce serait une nécessité.
LW : Je suis tout à fait d’accord. Je pense que nous avons l’obligation de partager les leçons tirées de cette expérience pour aller de l’avant, ainsi que les nombreux débats que nous avons eus ici aujourd’hui, les obstacles que nous avons constatés et les éléments qui ont vraiment eu un effet sur l’accès à des services équitables, sûrs et sécuritaires. Nous devons nous pencher sur les moyens de faire en sorte que ces circonstances ne se reproduisent pas, d’améliorer nos services de santé et notre offre de services et de faire en sorte que notre offre de services corresponde réellement aux besoins quotidiens de notre communauté. Si nous ne partageons pas ces apprentissages, vous savez, ce sera une énorme occasion gâchée. Je souhaiterais que quelqu’un en assure un suivi en rétrospective. Il aurait été utile que quelqu’un nous suive lors de nos discussions et prenne toutes ces dernières en note, parce qu’il y a tellement d’information. Vous savez, maintenant nous réfléchissons sur les événements passés et nous discutons de généralités, mais le quotidien que nous avons vécu, j’espère qu’il ne sera pas perdu. Nous allons vraiment devoir prendre le temps de presque revivre chaque aspect et ce que nous avons appris de ces aspects, que ce soit dans nos établissements de soins de longue durée, au sein de la communauté en général, dans chacune de nos familles. Nous devons analyser cette situation sous tellement de différents plans : ce qui s’est passé, ce que nous avons fait, ce que nous aurions pu faire différemment, ce que nous voulons apprendre et changer à l’avenir. Et j’espère que nos gouvernements sont disposés à faire cette réflexion avec nous, car l’apprentissage ne prend pas uniquement place en nous-mêmes et entre nous, quant à notre propre réponse à des éléments de cette nature, mais l’apprentissage contribue vraiment à améliorer notre relation avec les gouvernements et le secteur public. Nous n’avons d’ailleurs pas beaucoup discuté de cet élément aujourd’hui, mais il faut parler de cette raison pour laquelle les communautés sont si à part du secteur public et des services qui sont offerts, ainsi que du moyen de les rapprocher sous une forme sûre, équitable et accessible. Et c’est grâce à des échanges comme ceux-ci que nous avons la possibilité d’apprendre et de grandir ; donc, oui, sans aucun doute. Je ne suis pas vraiment certain de savoir comment nous allons y parvenir, mais il le faut.
MPB : Merci Lisa ! Jimmy ?
JS : Ouais, bah, [sic] tantôt j'ai parlé un peu de l'importance de conserver le lien avec les communautés. Par exemple, ici à Montréal où ce sont des réalités qui sont différentes, évidemment, il y a des gens qui font la navette entre leur communauté, la communauté de leurs conjoints, qui vont voir des amis dans d'autres communautés puis, entre-temps, reviennent à Montréal, transportant leur réalité avec eux, la réalité des communautés, la réalité de Montréal, dans ces mouvements-là. Puis souvent, ce qu'on remarque, ce qui manque, c'est ça, c'est qu’il y a une déconnexion qui se fait entre le moment où la personne quitte Montréal pour retourner dans sa communauté parce que notre mandat, souvent, ou la connaissance ou les capacités d'un organisme ou d'une communauté c'est d'agir localement, c'est d'agir selon ce qu'elle connaît puis dans l'immédiat avec les personnes quand elles sont présentes. Mais souvent, il y a des personnes qui vont quitter Montréal, ils vont nous dire « Je retourne dans ma communauté, je reviens dans ? mois, six mois », il y en a qui vont venir passer seulement les étés à Montréal. Ils font ça depuis des années. Chaque année, ils vont vivre en situation d'itinérance ou vont vivre dans des ressources, dans les organismes… Mais je pense qu’on a un rôle de faire le pont aussi, bien entendu, si c'est la demande des personnes. Puis, s’ils veulent être accompagnés là-dedans, mais pas juste de les accompagner quand ils sont physiquement ici, mais de pouvoir faire le lien avec les communautés, puis de pouvoir établir un corridor. Puis éviter tous les imprévus de telles migrations, tu sais, de mouvements qui impliquent de gros changements dans la vie d'une personne parfois… puis qui les placent à beaucoup, beaucoup d'imprévus. Fais que je pense qu'on a un rôle à ce niveau-là, puis je pense que la pandémie justement a mis ça vraiment on the spot.
Puis, peut-être, l'autre chose dans les outils de communication, puis comment on peut rendre notre expérience de la pandémie utile. Nous, ce qu'on est en train de faire à Médecins du Monde, c’est qu'on est dans un processus de documentation du projet. Le projet a deux ans et demi, à peu près trois ans. Il reste une dernière année avant qu'on transfère le projet « navigateur », donc d’accompagnement, à un organisme autochtone et puis ça va continuer sous une autre forme à Médecins du Monde, mais le but c'était vraiment de mettre en place un projet d'accompagnement en santé pour les personnes autochtones en situation d'itinérance, puis qu’après ça ce soit porté par un organisme autochtone.
Donc, c'est important pour nous de documenter, spécialement avec la pandémie, puis tout ce qui a été vécu dans les dernières années, de documenter le projet, puis de rendre accessible l’information que ce soit pour l'organisme qui va continuer ou que ce soit pour le réseau de la santé, pour les hôpitaux, pour ceux qui veulent implanter des services d'accompagnements, pour les personnes autochtones à l'intérieur même de leurs services, puis c'est quelque chose qui peut servir autant pour les communautés. Donc, on peut utiliser des outils. Nous, on va le faire à travers une recherche scientifique, mais vraiment dans une optique de rendre quelque chose de pratique, de tangible qui va être accessible, puis qui va pouvoir être appliqué rapidement et efficacement puis… Ouais [sic], dans l’optique d’un transfert des connaissances, puis de s’enrichir aussi, de se dire « regardez, c'est ce qui s'est produit durant toutes ces années du projet, c'est ce qu'on en retire », puis en le partageant, il y a un échange et un partage qui va se faire dans les deux sens, puis pour un organisme allochtone comme Médecins du Monde, je pense que c’est essentiel, c’est important de dire « Regardez ! Voici les réalités qu’on a connues. Voici ce qui s'est passé. Qu'en pensez-vous ? Comment on peut aller encore plus loin ? » Puis travailler encore mieux avec notre réseau de partenaires, puis en continuant d'impliquer, puis de faire une place aux personnes autochtones que ce soit dans la réflexion, dans l'action puis dans la suite des choses.
MPB : Merci Jimmy ! Jason ?
JC : Il y a plusieurs tables. L’une d’entre elles, celle de Services aux Autochtones Canada (SAC), propose un groupe de travail qui partage l’information. Tout au long de la pandémie, disons, au moins deux fois par mois ou toutes les deux semaines, nous avons tenu cette table et toute l’information a été fournie concernant ce qui se passait dans chaque communauté de la province. De même, à l’échelle régionale, dans les communautés cries, nous avions des réunions hebdomadaires. Au début, c’était trois fois par semaine, puis deux fois par semaine ; et maintenant, c’est seulement une fois par semaine. Ainsi, toute l’information est transmise à cette table, ce qui nous aide à mieux planifier les services qui sont nécessaires dans chaque communauté. Tous ces services centraux doivent d’ailleurs continuer à être offerts dans l’ensemble de la communauté. Je vous remercie.
MPB : Alors, merci Jason, merci Christopher ! Nous avions aussi une question de Christina Connelli.
Christina Connelli (CC) : Allô, est-ce que l'on m'entend ?
MPB : Oui.
Christina Connelli (CC) : Ah, bonjour, merci ! Oui, j'avais une question. Elle s'adresse plutôt à Sipi. J’étais allé à Manawan en 2019 pour une activité avec Femmes Autochtones [du Québec] (FAQ) puis on avait été dans un site un peu spécial, je pense que c'est un site de thérapie. J'aimerais ça qu'il me parle un peu des démarches qui avaient été entreprises pour sa création, puis peut-être savoir aussi s'il y a eu des activités pendant la pandémie.
Sipi Flamand (SF) : Mikwetc[23] ! On appelle ça le site Mirerimowin[24], ça a été financé, puis planifié par le programme de santé mentale de de la communauté, donc c'est un site pour pouvoir développer un travail collectif entre l'individu, puis son environnement, puis évidemment ce site-là a été utilisé pour notamment la transmission des savoirs reliés à la médecine traditionnelle. Puis il y a certaines personnes aussi qui sont venues, dont un itinérant qui vivait à Joliette, et aujourd'hui il y a été au site, puis il s’est socialisé avec ce site-là. Puis je pense que c'est un bon site pour pouvoir apprendre notre identité culturelle, apprendre qui nous sommes. Puis je pense c'est un bon moyen de privilégier aussi l'aspect territorial, l'aspect culturel dans cette période de la pandémie. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter à Manawan pour savoir comment ça a été organisé.
MPB : Merci Sipi ! Alors, on va terminer avec cette question-là, mais je vais en profiter pour la relayer à nos autres panélistes parce que le temps a filé, même si on a appris beaucoup de choses et on serait bien resté encore un peu plus, mais donc j'aimerais savoir si, chez nous autres intervenants, est-ce qu'il y a des sites similaires qui ont été utilisés ? Quelle a été la place accordée aux thérapies traditionnelles et à ce genre de moyens de rencontre pour renouer avec son identité en temps de pandémie ? Lisa ?
Lisa Westaway (LW) : On a différentes façons petites rencontres à plusieurs, soit à l'intérieur des hôpitaux ou des organismes. On a trouvé des façons de rejoindre les employés, telles que par Zoom, donc on a vraiment… Jimmy l'a dit tantôt, il faut être innovateur, penser à de nouvelles façons. On a aussi eu des rencontres dans des maisons longues. On a quand même eu des rencontres, mais à plus petite échelle où l’on est resté dehors… donc on a trouvé des façons innovatrices de pouvoir continuer nos traditions.
MPB : Merci Lisa ! Jimmy ?
Jimmy Siméon (JS) : Malheureusement, on est beaucoup dans les besoins essentiels puis notre rôle… nous, on travaille beaucoup au niveau de la santé médicale. C'est un peu la limite qu'on s’était fixée à travers ce projet-là. Une des premières choses qu'on s'est rendu compte, c'est que ça devait s'ouvrir à un niveau beaucoup plus large, puis c'est là-dessus qu'on veut travailler pour la suite. Donc d'aller au-delà de juste un accompagnement en santé médicale, puis de pouvoir connecter avec les communautés, de pouvoir connecter avec des centres de guérison, des centres d'aide, des intervenants qui sont à l'extérieur, qui sont en communauté, mais qui peuvent offrir ce type de services là avec des personnes qui sont physiquement à Montréal ou qui sont prêtes à sortir de Montréal pour quelques semaines, quelques mois pour aller chercher d'autres ressources.
Donc nous ce qu'on a essayé de faire… ça a été vraiment de connecter avec nos organismes partenaires qui, eux, avaient plus le mandat, les ressources et les connaissances pour orienter les personnes. C'est très rare, tu sais, qu’on a ces demandes précises. Les gens sont beaucoup dans : « bon ben [sic], j'ai besoin de manger aujourd'hui. J’aurais besoin d'une nouvelle place où dormir. Il faut que j'aille à l'hôpital pour une urgence ». Cela fait que les gens sont beaucoup là-dedans, puis l'idéal ce serait d'avoir un service qui est disponible de façon ponctuelle, qu'on peut offrir aux gens, puis de dire : « Regardez ! Il y a ce service-là qui existe ». À l’occasion, on a fait appel à un aidant autochtone qui offrait un support psychosocial culturellement adapté, puis cette personne-là a arrêté au début avec la pandémie après ça, ça s’est fait par Zoom, donc c'était vraiment compliqué de référer vers cette ressource-là. Puis c'est ça, en fait, c'est qu’à travers notre projet, on s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin. On avait fait une demande de financement au niveau de la Ville de Montréal pour engager une nouvelle personne qui ferait de la navigation, mais en santé autochtone spécifiquement, donc qui pourrait faire partie de l'équipe, puis son mandat serait seulement aller vers des ressources en santé autochtone. Malheureusement, ça n’a pas passé, c'est un projet qui a eu beaucoup d'écho. Les gens étaient très intéressés, sauf qu’on n'a pas eu la subvention, donc c'est une autre chose, une autre nouvelle chose qu'on s'est donné la possibilité de réfléchir, puis d'imaginer un peu puis de se dire « bon, on voit que c'est un besoin, essayons de le mettre en application. » Puis l'expérience nous a montré que oui ça répondrait à un besoin, puis que c'est nécessaire de travailler beaucoup plus sur cet aspect-là qui est beaucoup… beaucoup ignoré dans le monde médical, mais de plus en plus reconnu aussi. Par exemple, l'hôpital Notre-Dame, qui travaille depuis un certain temps pour un projet pour avoir justement une ressource, une personne autochtone qui vient pour offrir des services spirituels à l'intérieur des murs de l'hôpital, puis la possibilité aux gens de sortir d'aller au parc ou de faire des cérémonies à l'extérieur de l'hôpital lorsqu'ils sont hospitalisés. Donc l'idée fait son chemin, les besoins sont là, c'est reconnu, donc il suffit de continuer de mettre un peu un peu plus de pression encore.
MPB : Merci beaucoup Jimmy ! On encourage tous moralement ce projet-là. Jason ?
Jason Coonishish (JC) : Nous disposons d’un service appelé le service de santé mentale Maanuuhiikuu. Nous avons conçu une plateforme servant à la conférence virtuelle Maanuuhiikuu sur la santé mentale, qui a eu lieu il y a environ deux semaines pour notre région et qui se poursuivra tout au long de l’année, en vue d’assurer le mieux-être de notre peuple. Notre équipe de soutien psychosocial oeuvre selon des pratiques traditionnelles, et des services sont fournis par des psychologues et des psychothérapeutes spécialisés. Voilà ce que nous réalisons en matière de santé mentale. Nous avons d’ailleurs des patients vulnérables qui consultent un spécialiste à Montréal et qui restent parfois pendant quelques mois dans le Sud. Nous leur fournissons des tipis, ainsi que de la nourriture traditionnelle, comme des repas à base d’oie. Nous avons également engagé des chasseurs de Kahnawake, afin qu’ils nous fournissent des oies pour nos patients. Tout cela semble avoir contribué à leur bien-être durant leur séjour dans le Sud ; mais je sais qu’il est difficile pour eux de voir les oies s’envoler vers le Nord, ce qui a un effet réellement important sur leur santé mentale. Je vous remercie.
Marie-Pierre Bousquet (MPB) : Merci beaucoup, thank you, Jason ! Merci beaucoup à vous tous ! On arrive à la fin de cette table ronde. On aurait pu rester encore et vous poser des tas de questions, mais on va devoir s'arrêter là pour rester dans le temps qui nous est imparti. J'aimerais vraiment… beaucoup…. beaucoup vous remercier, remercier les organisateurs du CIÉRA et vous remercier spécialement vous quatre. Ça a été très agréable et instructif de vous entendre et bien sûr on ne peut pas applaudir de la même manière que quand on est dans une salle, mais je me permets, au nom de tous ceux qui vous écoutent sur Facebook et en direct sur Zoom, de vous remercier chaleureusement et de vous applaudir même si c'est relativement silencieux. Merci beaucoup !
Appendices
Notes biographiques
Michèle Audette
Michèle Audette est une leader autochtone reconnue.
Née d'un père québécois et d'une mère innue, Mme Audette est originaire de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam au Québec. Elle joue un rôle clé dans la transformation des rapports entre les peuples autochtones et la société québécoise et canadienne depuis les années 1990. À seulement 27 ans, elle a été élue présidente de l’association Femmes autochtones du Québec. En 2004, elle a été nommée sous-ministre associée du Secrétariat à la condition féminine du Québec. Elle a servi à titre de présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada de 2012 à 2015. En 2015, elle aide à la création d’un programme innovateur de deuxième cycle en administration publique autochtone pour l’École nationale d’administration publique.
Mme Audette a été nommée parmi les cinq commissaires chargés de mener l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Depuis 2019, elle occupe le poste d’adjointe au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes et de conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone de l’Université Laval.
En reconnaissance de ses contributions importantes, Mme Audette a reçu le Prix Femmes de mérite 2018 dans la catégorie Prix Inspiration de la Fondation Y des femmes de Montréal, le titre Femme de l’année du Conseil des femmes de Montréal en 2014 et la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012. L’Université de Montréal lui a également conféré un doctorat honoris causa afin de souligner l’envergure de son engagement pour la cause des femmes autochtones et son inépuisable travail pour la réconciliation entre les peuples.
Mme Audette a fait des études en arts visuels à l’Université du Québec à Montréal et en enseignement des beaux-arts à l’Université Concordia.
Marie-Pierre Bousquet
Marie-Pierre Bousquet, Ph. D. en anthropologie (Université Laval, 2002) et doctorat d’ethnologie (Université Paris X-Nanterre), est directrice du programme en études autochtones et professeure titulaire du département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Elle se passionne pour toutes les cultures algonquiennes et particulièrement pour la société et la culture anicinape, dans l’ouest du Québec (Abitibi-Témiscamingue et Outaouais). Ses recherches sont axées sur le changement (religieux, social, etc.) depuis le passage à la sédentarité. Elle est l’auteure du livre Les Anicinabek, du bois à l’asphalte. Le déracinement des Algonquins du Québec (Éditions du Quartz, 2016) et a codirigé avec Karl Hele La blessure qui dormait à poings fermés. L’héritage des pensionnats autochtones au Québec (Société Recherches Amérindiennes au Québec, 2019). Ce livre a reçu le prix du meilleur livre francophone de l’association canadienne d’histoire de l’éducation pour 2018 à 2020. Ses dernières recherches en cours portent sur les relations entre Autochtones et allochtones, au Québec, mais aussi dans l’ensemble du pays, avec le développement des moyens de communication.
Jason Coonishish
Jason Coonishish is the Coordinator of the Pre-Hospital and Emergency Measures at the Cree Health Board of Health and Social Services of James Bay (CBHSSJB). He and his team work with the Cree Nation Government and all nine Cree communities. He is also a member of the ORSC-Nord du Quebec to ensure a prompt and safe response to emergencies while considering the Cree territory, population, and culture.
Geneviève Motard
Geneviève Motard, LL.B (Montréal, 2000), LL.M. (Laval, 2008), LL.D. (Laval, 2013) enseigne le droit constitutionnel et les droits des peuples autochtones à la Faculté de droit de l'Université Laval depuis 2009. Ses recherches portent sur les droits politiques et territoriaux des peuples autochtones et les interactions entre les ordres juridiques autochtones et étatiques. Elle est membre du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP) ainsi que du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIÉRA), dont elle assume la direction depuis septembre 2020.
Sipi Flamand
Sipi Flamand, dont le nom traditionnel, Miaskom Sipi, signifie « à la rencontre de deux rivières », est un Atikamekw Nehirowisiw et l'actuel chef de la communauté de Manawan.
Jimmy Siméon
Originaire de la communauté Ilnu de Mashteuiatsh, Jimmy Siméon était navigateur autochtone et co-coordonnateur à Médecins du monde depuis 6 ans (en congé). Le rôle de navigateur autochtone consiste d’abord à accompagner dans leur santé les personnes autochtones vivant en itinérance à Montréal. Jimmy a choisi de rejoindre le milieu communautaire après 6 années d’un parcours multidisciplinaire à l’université. Ses tâches de coordination du projet se sont d'ailleurs concentrées sur la recherche et la documentation, ainsi que sur la co-création d’un projet de formation sur la navigation. Il est maintenant de retour dans sa communauté, puisqu'il est devenu le proche aidant d'un membre de sa famille.
Lisa Westaway
After nearly three-and-a-half years as the Executive Director of the Kateri Memorial Hospital Center (KMHC), Lisa Westaway has now taken the role of Ontario Regional Executive of the First Nations and Inuit Health Branch (FNIHB-ON) at Indigenous Services Canada (ISC).
Notes
-
[1]
Cette table ronde s’est tenue le 10 mai 2021 lors du 19e colloque du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIÉRA) : Bien-être, services publics et territorialités autochtones.
-
[2]
Depuis 2023, Lisa Westaway occupe un nouveau poste à la fonction publique fédérale.
-
[3]
« Je remercie Geneviève et je souhaite la bienvenue aux trois personnes autochtones, Jimmy, Jason et Sipi », en innu-aimun.
-
[4]
« Notre terre », en innu-aimun. Il s’agit d’ailleurs du territoire ancestral traditionnel occupé par les Innus.
-
[5]
Les circonstances troublantes de la mort de Madame Joyce Echaquan, Atikamekw de Manawan, au Centre hospitalier régional de Lanaudière ont mis en lumière le racisme dans les milieux de la santé au Québec.
-
[6]
Située dans le square Cabot, au centre-ville de Montréal, la tente Raphaël André est une installation éphémère, où les personnes sans-abri pouvaient obtenir un repas chaud et quelques heures à l’abri du froid. Elle avait été inaugurée en février 2021 à la suite du décès tragique de Monsieur Raphaël Napa André, Innu de Matimekush-Lac John, en situation d’itinérance qui avait été retrouvé mort d’hypothermie.
-
[7]
Kiuna, qui veut dire « À nous » en aln8ba8dawaw8gan, réfère ici à l'Institution Kiuna (Odanak, Québec), premier centre d'études collégiales consacré à l'éducation des Autochtones depuis la fermeture du collège Manitou (La Macaza, Québec) en 1976.
-
[8]
« Au revoir », en innu-aimun.
-
[9]
« Merci », en innu-aimun.
-
[10]
« Merci », en anishinaabemowin.
-
[11]
« Bonjour à toutes et à tous », en anishinaabemowin.
-
[12]
Sipi Flamand a été élu nouveau chef de Manawan en août 2022.
-
[13]
Pour plus de détails, veuillez consulter le lien URL suivant : https://principedejoyce.com/fr/index.
-
[14]
« Bonjour à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui lors de cette rencontre pour réfléchir aux enjeux rencontrés dans les études supérieures », en atikamekw nehiromowin.
-
[15]
« Merci », en atikamekw nehiromowin.
-
[16]
« Bonjour tout le monde ! », en innu-aimun.
-
[17]
Terres-Cries-de-la-Baie-James.
-
[18]
« Merci », en iiyiyuu ayimuun.
-
[19]
La deuxième vague de la pandémie de COVID-19 au Québec s’est étendue de septembre 2020 à octobre 2021.
-
[20]
« Merci », en atikamekw nehiromowin.
-
[21]
Chasse à l’oie en halte migratoire.
-
[22]
Cérémonie traditionnelle de la culture crie au cours de laquelle on célèbre le premier contact d'un jeune enfant avec le sol.
-
[23]
« Merci », en atikamekw nehiromowin.
-
[24]
« Se sentir bien », en atikamekw nehiromowin. Il s’agit d’une clinique de proximité au sein du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière.