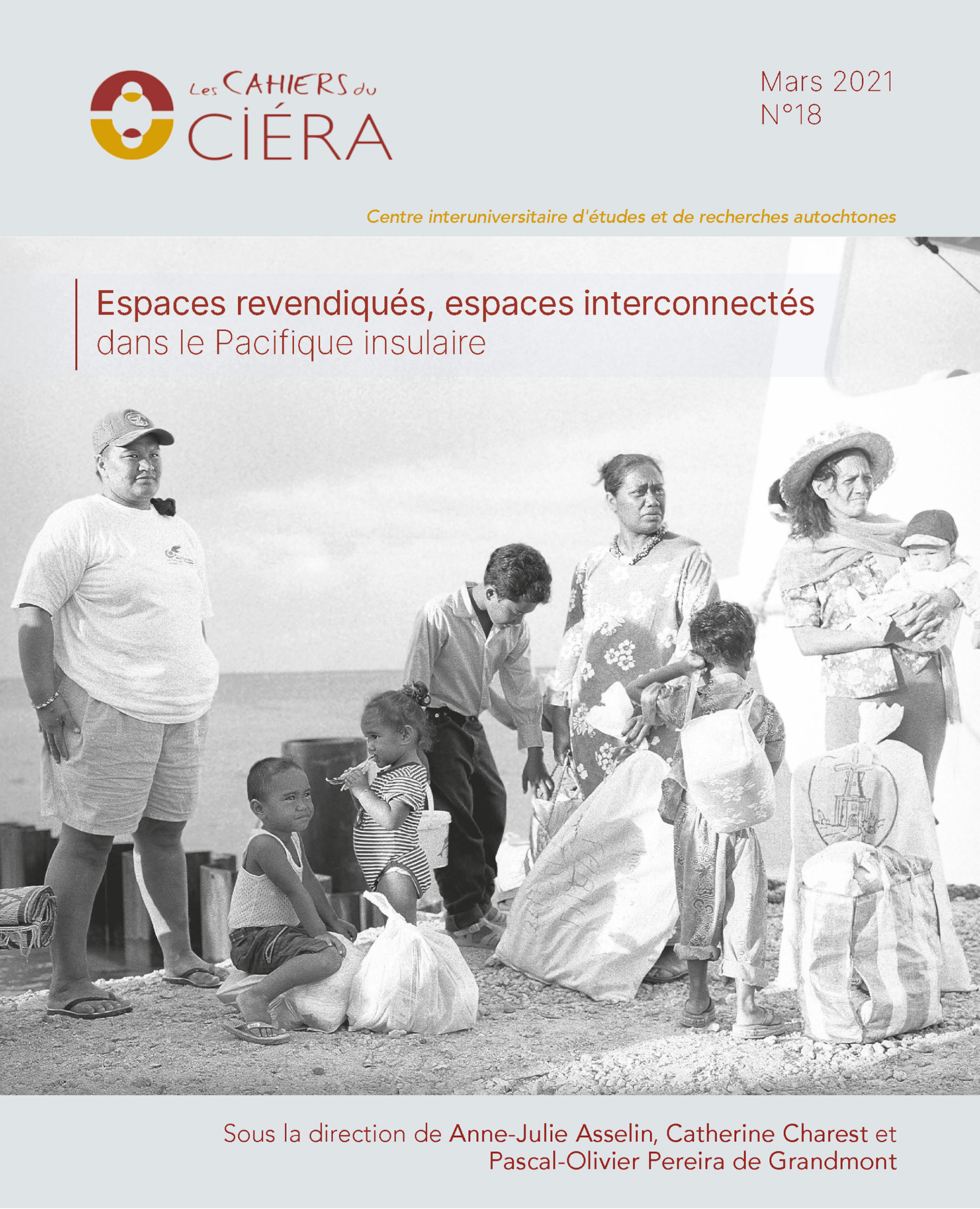Ce dix-huitième numéro des Cahiers du CIÉRA propose six textes – cinq articles scientifiques et un entretien – se penchant sur différents enjeux autochtones dans le Pacifique insulaire. Publication canadienne multidisciplinaire, Les Cahiers du CIÉRA se sont concentrés le plus souvent sur les questions autochtones au Canada et dans les Amériques, proposant ponctuellement des réflexions sur le reste du monde à l’occasion de numéros thématiques. Si l’influence monumentale de l’Océanie dans la constitution de modèles, théories et concepts fondateurs des sciences humaines et sociales – notamment en anthropologie – est indéniable (Dousset et al. 2014 ; Robbins 2017), l’intérêt pour cette région paraît demeurer limité en Amérique du Nord francophone. L’actualité vibrante des luttes autochtones dans le Pacifique et les questions qu’elles soulèvent – il n’y a qu’à penser aux implications des référendums de 2018 et 2020 sur l’indépendance en Nouvelle-Calédonie ou aux défis posés par la vulnérabilité accrue de la région dans le contexte actuel d’urgence climatique – nous paraissent pourtant mériter que l’on consacre un numéro entier aux réalités autochtones dans cette région du monde. Cette mise à distance promet d’offrir des points de fuite fertiles pour réfléchir aux enjeux autochtones et faire ressortir des airs de famille (Bosa 2015 ; Wittgenstein 1953 : § 65-71) avec les réalités et les enjeux soulevés au Canada et dans le cadre d’autres situations (post)coloniales dans le monde. Parler d’autochtonie dans le Pacifique pose pourtant certaines difficultés, car l’identification à cette catégorie varie selon les différentes populations locales. Au regard du critère d’auto-identification, qui est notamment central dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007), plusieurs des peuples concernés par les articles de ce numéro ne peuvent être rangés résolument sous le vocable « peuples autochtones ». S’identifier comme Autochtone apparaît, dans certains cas, d’autant plus difficile que le terme peut revêtir des connotations plutôt négatives (Gagné 2016 ; Saura 2004). C’est le cas en Polynésie française, où ce dernier se voit associé à une infériorité statutaire, à une citoyenneté de seconde zone, et où la mobilisation de la catégorie apparaît confinée au champ culturel, occupant une place plutôt marginale dans le champ politique (Gagné 2016). La revendication et la mobilisation de cette catégorie dans les mouvements de décolonisation ont été plus fréquentes – et antérieures – dans les territoires où les populations autochtones ont été mises en minorité démographique (Gagné et Salaün 2013, 2020 ; Gagné 2016). Ce fut le cas en Nouvelle-Zélande, en Australie ou à Hawaiʻi, où la « stratégie autochtone » (Gagné 2016) a été employée très tôt. Des leaders maori, aborigènes et hawaiiens ont participé dès les années 1970 à la mobilisation et à des rencontres qui ont contribué à la construction d’un mouvement international des peuples autochtones. La mobilisation autour de la catégorie « autochtone » est beaucoup plus récente dans les territoires d’Océanie où les luttes pour la décolonisation se sont d’abord articulées autour de revendications indépendantistes et autonomistes. Tel que l’ont bien souligné Natacha Gagné et Marie Salaün (2013), les luttes pour la décolonisation en Océanie présentent en effet une impressionnante variabilité et complexité, offrant aux sciences sociales des « conditions proches de celles d’un laboratoire » (Friedman 2003 ; Gagné et Salaün 2010, 2013). La « stratégie autochtone » côtoie aujourd’hui, dans certains de ces territoires, les revendications indépendantistes, autonomistes ou régionalistes. Le caractère relativement récent des constructions nationales et l’impressionnante diversité linguistique et culturelle qui caractérise la région posent d’ailleurs des questions brûlantes sur la construction d’États-nations en contextes pluriethniques et pluriculturels et sur les rapports entre majorités et minorités en situation (post)coloniale (Dousset et al. …
Appendices
Bibliographie
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, 2007, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, A/RES/61/295, 2 octobre. New York : Assemblée générale des Nations Unies.
- BARBE, Dominique, et Renaud MELTZ, 2013, « Le monde Pacifique dans la mondialisation », Hermès. La Revue, 65(1) : 13‑20.
- BOSA, Bastien, 2015, « C’est de famille ! L’apport de Wittgenstein au travail conceptuel dans les sciences sociales », Sociologie, 6(1) : 61‑80.
- CEPLEANU, Spiridon Ion, 2012, Carte du Pacifique insulaire. Consulté sur Internet (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Oceanie.jpg), le 4 novembre 2020.
- CHAREST, Catherine, 2018, (E)ncrer son identité : les femmes et le tatouage à Tahiti. Mémoire de maîtrise, Département d’anthropologie, Université Laval.
- CLIFFORD, James, 2013, « Indigenous Articulations », inReturns: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century, Cambridge et Londres : Harvard University Press, pp. 50-67.
- COOPER, Frederick, 2005, Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History, Berkeley, Los Angeles et Londres : University of California Press.
- COQUERY-VIDROVITCH, Catherine, 2009, Enjeux politiques de l’histoire coloniale, Marseille : Agone.
- DANIELSSON, Benght, 1988, « Under a Cloud of Secrecy: The French Nuclear Tests in the Southeastern Pacific », in Nancy J. Pollock et Ron Crocombe (Dirs), French Polynesia, Suva : Institute of Pacific Studies of the University of the South Pacific, pp. 260-274.
- DOUAIRE-MARSAUDON, Françoise, 2004, « L’invention de la tradition. La construction du lien au passé et l’ancrage dans l’histoire », Cahier des thèmes transversaux ArScAn, CRNS–UMR 7041 (Archéologie et Sciences de l’Antiquité – ArScAn) : 73-79.
- DOUMENGE, Jean-Pierre, 2010, « Le Pacifique insulaire en 2010, un monde éclaté en grande mutation, tiraillé entre traditions “autochtonistes” et valeurs de “métissage” », Les Cahiers d’Outre-Mer, 252 : 499-524.
- DOUSSET, Laurent, Barbara GLOWCZEWSKI, et Marie SALAÜN, 2014, « Introduction », in Laurent Dousset, Barbara Glowczewski et Marie Salaün (Dirs), Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud : terrains, questions et méthodes, Marseille : pacific-credo Publications, pp. 7‑18.
- DUSSY, Dorothée, et Éric WITTERSHEIM, 2013, « La question urbaine en Océanie », in Éric Wittersheim et Dorothée Dussy (Dirs), Villes invisibles. Anthropologie urbaine du Pacifique, Paris : L’Harmattan, pp. 13-43.
- ELEGINO-STEFFENS, Diane U., Clifton LAYMAN, Ferdinand BACOMO, et Gunther HSUE, 2013, « A Cause of Severe Septicemia Following Traditional Samoan Tattooing », Hawaiʻi Journal of Medicine & Public Health, 72(1) : 5-9.
- FRIEDMAN, Jonathan, 2003, « Globalizing Languages: Ideologies and Realities of the Contemporary Global System », American Anthropologist, 105(4) : 744-752.
- FRIEDMAN, Jonathan, 2004, « Culture et politique de la culture : une dynamique durkheimienne », Anthropologie et Sociétés, 28(1) : 23-34.
- GAGNÉ, Natacha, 2016, « Identité et stratégie autochtones : leurs complexités et (im)possibilités en Polynésie française », Cahiers du CIÉRA, 13 : 6‑33.
- GAGNÉ, Natacha, et Marie SALAÜN, 2013, « Les chemins de la décolonisation aujourd’hui : perspectives du Pacifique insulaire », Critique internationale. Revue comparative de sciences sociales, 60(3) : 111‑132.
- GAGNÉ, Natacha, et Marie SALAÜN, 2020, « Sortir du colonial en Océanie ou comment reconquérir sa souveraineté en situation de minorisation », in Natacha Gagné (Dir), À la reconquête de la souveraineté : mouvements autochtones en Amérique latine et en Océanie, Québec : Presses de l’Université Laval, pp. 27-51.
- GRAILLE, Caroline, 2016, « 1975-2015 : retour sur Mélanésia 2000, symbole de la renaissance culturelle kanak », Journal de la Société des Océanistes, 142-143 : 73-98.
- HAU’OFA, Epeli, 1987, « The New South Pacific Society: Integration and Independence », in Antony Hooper (Dir), Class and Culture in the South Pacific, Auckland : Centre for Pacific Studies, University of Auckland ; Suva : Institute of Pacific Studies, University of the South Pacific, pp. 11-23.
- HAU’OFA, Epeli, 1993, « Our Sea of Islands », in Vijay Naidu, Eric Waddell et Epeli Hau‘ofa, A New Oceania: Rediscovering Our Sea of Islands, Suva : School of Social and Economic Development, The University of the South Pacific, pp. 2-16.
- HAU’OFA, Epeli, 2008 [1987], We Are the Ocean: Selected Works, Honolulu : University of Hawaiʻi Press.
- HOBSBAWM, Eric et Terence RANGER (Dirs.), 2006, L’Invention de la tradition, Paris : Éditions Amsterdam.
- JOLLY, Margaret, et Nicholas THOMAS, 1992, « The Politics of Tradition in the Pacific », Oceania, 62(4) : 241-248.
- JOURDAN, Christine, 1995, « Stepping-Stones to National Consciousness: The Solomon Islands Case », in Robert J. Foster (Dir), Nation Making. Emergent Identities in Postcolonial Melanesia, Ann Arbor : University of Michigan Press, pp. 127-149.
- LARGY HEALY, Jessica de, et Barbara GLOWCZEWSKI, 2014, « Chapitre 9. Valeurs et réappropriations patrimoniales, des musées à Internet : exemples australiens et polynésiens », in Laurent Dousset, Barbara Glowczewski et Marie Salaün (Dirs), Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud : terrains, questions et méthodes, Marseille : pacific-credo Publications. Consulté sur Internet (https://books.openedition.org/pacific/486), le 27 avril 2020.
- LINNEKIN, Jocelyn, 1990, « The Politics of Culture in the Pacific », in Jocelyn Linnekin et Lin Poyer (Dirs), Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific, Honolulu : University of Hawaii Press, pp. 149-173.
- LINNEKIN, Jocelyn, 1992, « On the Theory and Politics of Cultural Construction in the Pacific », Oceania, 62(4) : 249-263.
- MACLELLAN, Nic, 2005, « The Nuclear Age in the Pacific Islands », The Contemporary Pacific, 17(2) : 363‑372.
- PÉREZ, Michel, 2013, « Langues océaniennes : une grande diversité », Hermès. La Revue, 1(65) : 95-96.
- PLANT, Byron King, 2008, « Secret, Powerful, and the Stuff of Legends: Revisiting Theories of Invented Tradition », The Canadian Journal of Native Studies, 28(1) : 175-194.
- POIRIER, Sylvie, 2004, « La (dé)politisation de la culture ? Réflexions sur un concept pluriel », Anthropologie et Sociétés, 28(1) : 7-21.
- PORTER, Christopher J. W., Jeremy W. SIMCOCK, et Craig A. MACKINNON, 2005, « Necrotising Fasciitis and Cellulitis After Traditional Samoan Tattooing: Case Reports », Journal of Infection, 50 : 149-152.
- REGNAULT, Jean-Marc, 2005, « The Nuclear Issue in the South Pacific: Labor Parties, Trade Union Movements, and Pacific Island Churches in International Relations », The Contemporary Pacific, 17(2) : 339-357.
- RIGO, Bernard, 2005, « Préface », Bulletin du Laboratoire de recherche en sciences humaines de Polynésie française (LARSH), 2 : 3.
- ROBBINS, Joel, 2017, « L’anthropologie entre l’Europe et le Pacifique », L’Homme, 2(222) : 131‑154.
- SAURA, Bruno, 2004, « Dire l’autochtonie à Tahiti », Journal de la Société des Océanistes, 119 : 119-137.
- TURPEL, Mary Ellen, 1989-1990, « Aboriginal Peoples and the Canadian Charter: Interpretive Monopolies, Cultural Differences », Canadian Human Rights Yearbook, 6 : 21.
- WITTGENSTEIN, Ludwig, 1961 [1953], Investigations philosophiques, Paris : Gallimard.