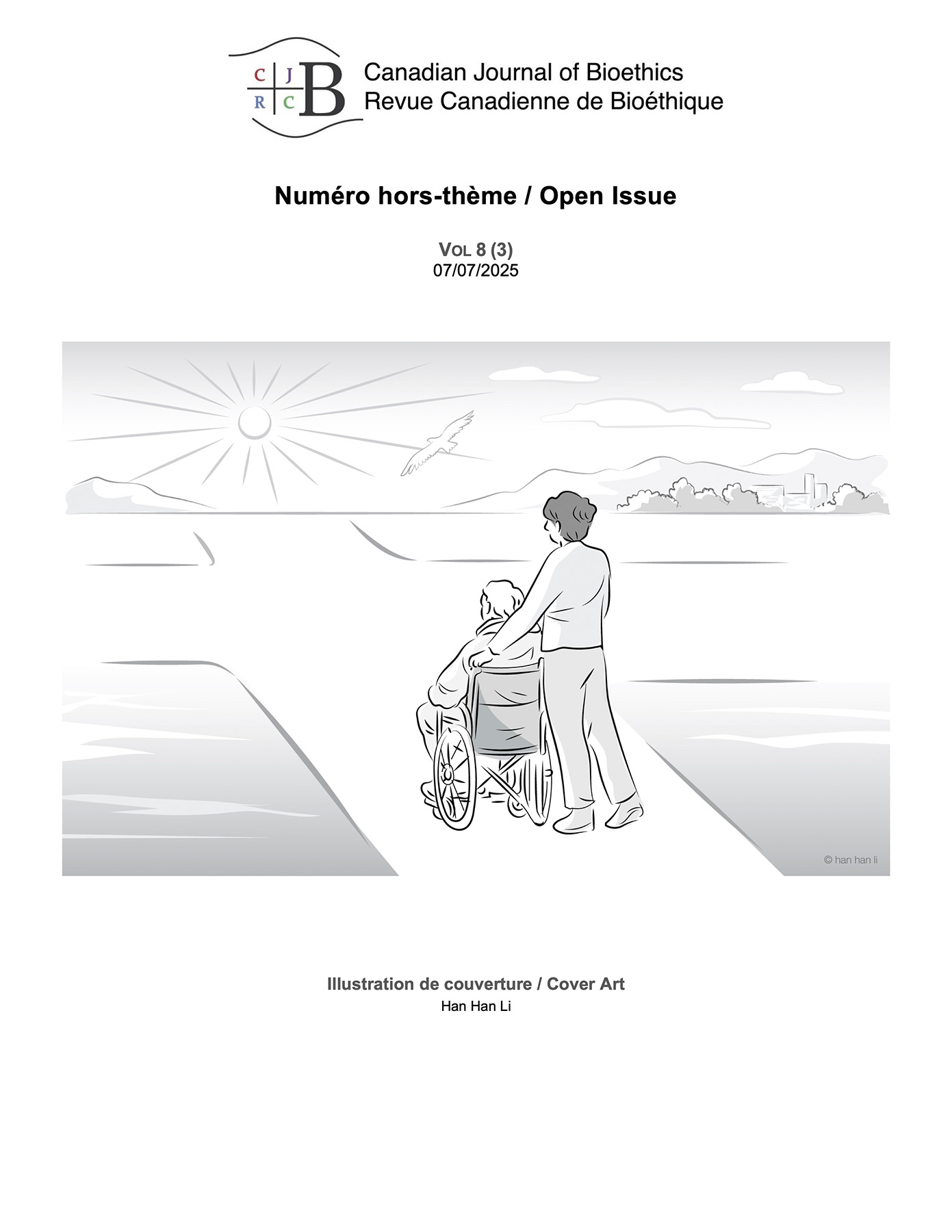Abstracts
Résumé
Les tests génétiques en libre accès sont interdits en France. Le cadre légal prévoit en effet que les analyses des caractéristiques génétiques (ACG) à des fins médicales soient prescrites par un médecin et que les patients bénéficient d’un accompagnement avant et après l’analyse, garantissant une interprétation correcte des résultats et un suivi approprié. Cependant, les tests génétiques en libre accès peuvent être achetés sur internet, notamment par les personnes résidant en France. Cela présente des enjeux majeurs sur le plan éthique, tel que l’illusion d’autonomie, des inégalités d’accès aux soins, ainsi que des conséquences potentielles : surdiagnostic, mesures prophylactiques non nécessaires, y compris pour les apparentés des personnes y ayant recours. Si le cadre légal français sur le sujet des ACG est aligné avec les principes fondamentaux de l’éthique médicale, il ne protège pas pleinement les personnes qui ont recours à un test génétique en libre accès.
Mots-clés :
- tests génétiques,
- cancer,
- autonomie,
- tests en libre-accès,
- loi Française,
- analyses des caractéristiques génétiques
Abstract
Open access genetic tests are prohibited in France. The legal framework stipulates that analyses of genetic characteristics (AGC) for medical purposes must be prescribed by a doctor and that patients must be accompanied before and after the analysis, to ensure that the results are correctly interpreted and that appropriate follow-up is provided. However, freely available genetic tests can be purchased over the Internet, particularly by people living in France. This presents major ethical challenges, such as the illusion of autonomy, inequalities in access to care, and potential consequences: overdiagnosis, unnecessary prophylactic measures, including for the relatives of people who have recourse to them. Although the French legal framework on the subject of genetic testing is in line with the fundamental principles of medical ethics, it does not fully protect people who have recourse to an open-access genetic test.
Keywords:
- genetic tests,
- cancer,
- autonomy,
- direct-to-consumer tests,
- French law,
- analysis of genetic characteristics
Article body
INTRODUCTION
L’avancée rapide des technologies de séquençage génétique, telles que le “Next-Generation Sequencing” (NGS), a révolutionné le domaine de la médecine, ouvrant la voie à des diagnostics plus précis et à des traitements personnalisés. Depuis le début des années 2000, le coût du NGS a baissé de façon exponentielle, permettant à certaines entreprises comme 23andme de se lancer en 2006 dans la commercialisation de tests génétiques en libre accès (appelés aussi « Direct-to-Consumer » ou désignés comme « tests génétiques » uniquement lorsque proposés en libre accès). Bien que ces tests soient illégaux en France (1,2), ils sont largement accessibles au public, car peu onéreux et peuvent être commandés directement en ligne. Les consommateurs reçoivent un kit de prélèvement salivaire qu’ils renvoient par voie postale et reçoivent les résultats environ 15 jours plus tard (3). En plus de découvrir des informations sur son héritage génétique, la majorité de ces tests proposent aussi d’identifier des variants génétiques prédisposant à certaines maladies, dont certains cancers.
En France, le cadre légal n’autorise pas la commercialisation de tests génétiques et il est illégal pour un particulier de réaliser un tel test à des fins personnelles, récréatives ou commerciales, sans prescription médicale. Cette interdiction est définie par l’article 16-10 du Code civil (2). Le diagnostic de variants génétiques, dont ceux prédisposant au cancer, est défini dans un cadre bien précis, l’article L.1131-1 du CSP (1), qui encadre strictement l’usage des analyses des caractéristiques génétiques (ACG) à des fins médicales et impose une prescription médicale ainsi qu’un conseil génétique obligatoire.
L’intérêt clinique des ACG pour identifier une prédisposition au cancer est significatif. La détection précoce de variants génétiques, comme ceux sur les gènes BRCA1/2 (prédisposition aux cancers du sein et de l’ovaire) par exemple, permet la mise en place de stratégies de surveillance spécifiques ou de réduction des risques (chirurgies prophylactiques pouvant aller jusqu’à la mastectomie ou ovariectomie). Lorsqu’un médecin prescrit une ACG dans ce contexte, le patient suit un parcours défini : consultation initiale pour évaluer la pertinence de l’analyse, consentement éclairé, réalisation de l’analyse dans un laboratoire agréé, et consultation de rendu des résultats avec un médecin généticien ou un conseiller en génétique pour expliquer les implications personnelles et familiales (4,5). En cas de variant pathogène identifié, une information doit être délivrée aux apparentés potentiellement concernés pour qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, bénéficier eux-mêmes d’une consultation et éventuellement d’une analyse (1,4,5).
À l’inverse, lorsqu’une personne reçoit les résultats d’un test génétique (illégal en France), elle se retrouve souvent démunie, sans l’accompagnement médical et psychologique nécessaire pour interpréter des informations complexes et potentiellement anxiogènes. Ces résultats peuvent pousser la personne à consulter un professionnel de santé pour confirmation, générant stress et examens potentiellement inutiles (5). Les conséquences s’étendent aux apparentés, qui peuvent être informés de risques génétiques par des voies non médicales, sans préparation ni suivi adéquat. Cet article se focalise sur les enjeux éthiques liés aux variants de prédisposition au cancer, car ces informations ont des implications directes et souvent graves en termes de surveillance médicale, de décisions prophylactiques et d’impact psychologique, tant pour l’individu que pour sa famille. Cela illustre particulièrement les tensions entre l’accès non régulé à l’information génétique et les principes éthiques fondamentaux (6).
Dans la première partie, nous étudierons le cadre légal des ACG en France, notamment pour identifier les gènes prédisposant au cancer, et en quoi la commercialisation et l’utilisation des tests en libre accès est illégale. La deuxième partie abordera les différents enjeux éthiques soulevés par les tests génétiques, en se concentrant sur les principes d’autonomie, de justice, de bienfaisance et de non-malfaisance (6), avec une attention particulière portée aux implications en oncogénétique. Nous utiliserons un cas publié en 2020 (5) pour illustrer les enjeux légaux et éthiques des tests en libre accès, notamment pour le diagnostic de variants génétiques prédisposant au cancer.
LE CADRE LÉGAL DES ANALYSES DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES (ACG)
Cadre légal en France
En France, les ACG à des fins médicales sont strictement encadrées par plusieurs réglementations visant à protéger les patients. Selon la loi de bioéthique de 1994, révisée en 2004, 2011, et plus récemment en 2021, ainsi que le CSP (article L1131-1), les ACG doivent être prescrites par un médecin et réalisées par des laboratoires agréés (1). Cela signifie que toute personne souhaitant réaliser une ACG doit d’abord consulter un médecin ou un conseiller en génétique qui évaluera la pertinence de l’analyse en fonction de son historique médical et familial (1,4,5). Il convient de souligner que l’ACG ne sera prescrite que si elle présente une utilité clinique pour le patient, que ce soit pour adapter un traitement, réaliser un diagnostic présymptomatique, évaluer une prédisposition ou une susceptibilité afin de prévenir l’apparition d’une pathologie, préparer psychologiquement le patient ou le rassurer (4,7). La prescription d’une ACG « peut être [effectuée] : — un médecin généticien ; — un médecin non généticien connaissant la situation clinique (maladie, prise en charge thérapeutique) et les conséquences familiales et capable d’en interpréter le résultat » (8).
Ces analyses doivent également être accompagnées d’un conseil génétique, obligatoire avant et après, pour expliquer les résultats et guider les décisions des patients (4,7,9). Le rôle du conseiller en génétique ou du médecin généticien est de fournir des informations complètes et compréhensible sur les implications médicales, psychologiques et sociales des résultats (4,9). Ce suivi permet d’éviter les interprétations erronées et de prévenir l’anxiété (4,5,9), par exemple liées à la découverte de variants génétiques potentiellement pathogènes.
Plusieurs textes encadrent ces pratiques et interdisent la commercialisation des tests génétiques. L’article 16-10 du Code civil (2), introduit par la loi de bioéthique (loi n° 94-653 du 29 juillet 1994), garantit que les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ne peuvent être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique et avec le consentement de l’individu concerné.
Concernant les ACG médicales identifiant une anomalie génétique grave, l’article L1131-1 du CSP instaure une obligation d’information pour la personne testée envers les membres de sa famille potentiellement concernés, si des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées (1). La personne peut choisir d’informer elle-même ses apparentés ou de déléguer cette tâche au médecin prescripteur :
Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.
Or, les tests génétiques court-circuitent complètement cette dimension familiale encadrée par la loi. Une personne recevant un résultat via un test en libre accès se retrouve seule avec cette information, sans le soutien médical pour comprendre comment et à qui la transmettre de manière appropriée, ce qui peut générer des conflits ou des angoisses familiales importantes (4). On note également dans ce même article L1131-1 du CSP que la personne peut « exprimer par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic » (1), droit qui est souvent bafoué par les tests génétiques où les résultats sont divulgués sans précaution particulière (5). Enfin, selon l’article 226-28-1 du Code pénal :
Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d’amende
10
Une dimension économique importante découle de l’utilisation des tests génétiques. Les personnes y ayant recours, souvent confrontées à des résultats anxiogènes ou difficiles à interpréter, se tournent vers le système de santé français pour obtenir confirmation et accompagnement (5). Face à l’angoisse exprimée, les médecins peuvent se sentir contraints de prescrire des ACG de confirmation via les canaux légaux. Ces analyses, bien que potentiellement rassurantes si le test initial s’avère être un faux positif, comme dans le cas de Mr. C. (5), représentent un coût non négligeable pour la collectivité, puisque les ACG médicales sont prises en charge par l’assurance maladie en France (5,11). Cet usage détourné des tests génétiques génère donc des dépenses de santé publique pour vérifier des informations obtenues illégalement et dont la fiabilité est souvent incertaine (5).
Cadre légal aux États-Unis
Aux États-Unis, les tests génétiques sont autorisés. La Food and Drug Administration (FDA) régule certains aspects du marché des tests génétiques, en particulier ceux qui peuvent être utilisés pour le diagnostic de variants génétiques prédisposant à certaines maladies. Cependant, une grande partie des tests génétiques est disponible sans prescription médicale ni accompagnement professionnel (ex. : par un conseiller en génétique) obligatoire. Des entreprises comme AncestryDNA dominent ce marché, offrant des services permettant aux consommateurs d’obtenir des informations sur leurs origines, leurs traits génétiques, et sur d’éventuelles prédispositions à certaines maladies (dont certains cancers) (3). Cette simplicité d’accès soulève des questions éthiques mais aussi des inquiétudes concernant l’exactitude des résultats et leur interprétation. Les premiers tests en libre accès pour la détection de prédisposition génétiques à certaines maladies de 23andMe ont été autorisés par la FDA en avril 2017 (12). La réglementation des tests génétiques aux États-Unis est cependant plus restrictive dès lors qu’il s’agit de les utiliser au cours d’essais cliniques (13).
Confidentialité des données et Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD)
La confidentialité des données personnelles est un enjeu majeur dans le contexte des tests génétiques. Le RGPD, qui s’applique à tous les États membres de l’Union Européenne, impose des normes strictes concernant la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles, y compris les données génétiques. Les entreprises commercialisant des tests génétiques doivent garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs, obtenir leur consentement éclairé et offrir des droits aux consommateurs sur leurs informations. Notamment, l’article 9 du RGPD (14) traite des catégories particulières de données personnelles, y compris les données génétiques, et stipule des conditions spécifiques pour leur traitement. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions financières sévères et nuire gravement à la confiance des consommateurs. Les entreprises doivent donc mettre en place des mécanismes robustes pour assurer la conformité avec les exigences du RGPD et préserver la confidentialité des informations génétiques de leurs utilisateurs.
LES ENJEUX ÉTHIQUES DES TESTS GÉNÉTIQUES EN LIBRE ACCÈS : LE CAS DES GÈNES DE PRÉDISPOSITION AU CANCER
Les tests génétiques posent des enjeux éthiques complexes, notamment en ce qui concerne les principes d’autonomie, de justice, de bienfaisance et de non-malfaisance (6), d’autant plus, quoiqu’interdits en France, des personnes peuvent y avoir accès très facilement. En utilisant l’exemple de l’article de De Pauw et al. (5) publié dans l’European Journal of Cancer (2020) nous illustrerons ces enjeux tout en soulignant d’éventuelles complémentarités ou tensions entre la loi française et ces enjeux éthiques, avec un accent particulier sur les implications des gènes de prédisposition au cancer et les risques liés à la divulgation des données génétiques.
Autonomie
Le concept d’autonomie est central dans la commercialisation des tests génétiques. Les entreprises commercialisant ces tests les présentent comme une opportunité pour les personnes de gérer leur santé de manière autonome (3), sans passer par un professionnel de santé. Cette promesse occulte toutefois la complexité des résultats, notamment pour les gènes de prédisposition au cancer (comme BRCA1/2, TP53 ou APC), dont l’interprétation exige une expertise médicale. Cette autonomie est partiellement illusoire. L’exemple de Mr. C. décrit par De Pauw et al. (5) met en lumière ce problème. Mr. C. a effectué un test en libre-accès « par curiosité », sans information adéquate, ni consentement libre et éclairé. En effet, en commandant le test en ligne, Mr. C. acceptait de facto des conditions générales de vente avec 29 clauses dont une seule décrivait les limites du test. Il a reçu des résultats indiquant des prédispositions génétiques à des cancers graves — syndrome de Li Fraumeni (lié à des mutations du gène TP53) et syndrome de polypose adénomateuse familiale (PAF; associé au gène APC) —, ce qui a entraîné une grande anxiété. Ces syndromes, bien que rares, illustrent la gravité des conséquences d’une mauvaise interprétation des variants génétiques. Les conséquences auraient pu être néfastes pour sa santé (voir point ci-dessous autour de la non-malfaisance). À la suite de la consultation dans un service de génétique médicale en France, les analyses ont été répétées, en utilisant des méthodes validées et plus fiables que le test en libre accès. Les résultats ont révélé qu’il s’agissait de faux-positifs, le patient n’avait pas de variant génétique pour les syndromes de Li Fraumeni et de PAF.
L’accès non encadré aux tests de prédisposition au cancer pose un défi supplémentaire : la possibilité que des individus prennent des décisions irréversibles (ex. : chirurgie préventive) sur la base de résultats mal contextualisés, comme le soulignent des études récentes (15,16).
L’étude de 2011 « Ethical, Legal, and Social Aspects and Implications of Direct-to-Consumer Genetic Testing » financé par la Commission Européenne (via CORDIS) (17) mettait déjà en évidence plusieurs problèmes éthiques, notamment l’autonomie des personnes qui ont recours aux tests génétiques. Certaines entreprises permettent aux enfants mineurs de se soumettre à des tests pour des maladies qui ne se déclarent qu’à l’âge adulte. Dans le cas des cancers héréditaires, cette pratique est particulièrement problématique : connaître son statut génétique dès l’enfance peut engendrer un stress durable sans bénéfice médical immédiat. Cela va à l’encontre des recommandations professionnelles — de tels tests ne devraient être effectués que si des mesures thérapeutiques ou préventives sont possibles (18). Par ailleurs, des entreprises comme deCODE Genetics utilisent les données génétiques de leurs clients à des fins de recherche (19), brouillant la frontière entre les services médicaux, les produits de consommation et la recherche.
La loi française impose que les tests génétiques soient prescrits par un médecin et accompagnés de conseils appropriés (médecin généticien ou conseiller en génétique) pour garantir que les individus comprennent pleinement les résultats et leurs implications, ce qui permet un respect de l’autonomie des personnes (qui ont recours à un tel test). Comme vu plus haut, les personnes ont aussi le « droit à l’ignorance » concernant les résultats. Enfin, il n’y a aucune recommandation de procéder à un test chez l’enfant s’il n’y a pas de traitements ou prophylaxie possible avant l’âge adulte. La loi française garantit l’autonomie des patients ayant recours à un test génétique médical. Cependant, cette protection légale ne s’étend pas aux données génétiques collectées par des entreprises étrangères. Une fuite ou une exploitation commerciale de ces informations pourrait exposer les individus à des discriminations systémiques, comme le refus d’assurance-vie ou l’exclusion de certains emplois, ce qui est un risque accru pour les porteurs de variants associés aux cancers. On parle dans ce cas de « discrimination génétique » (20).
Les tests génétiques commercialisés par des entreprises américaines sur internet contournent les exigences légales et réglementaires françaises, et posent donc des tensions avec les principes d’autonomie, car ils fournissent des informations médicales sans soutien clinique — ce qui n’est pas sans conséquences (5) —, et de nombreuses questions subsistent quant à la fiabilité de leurs tests.
Justice
Tous les individus devraient avoir un accès équitable aux soins (principe de justice) (2) et ainsi (s’ils en font le choix) pouvoir effectuer des tests pour savoir s’ils ont des prédispositions génétiques à certaines maladies. Les tests génétiques, en étant peu coûteux et plus accessibles, pourraient théoriquement bénéficier d’un accès démocratisé. En contrepartie, cette démarche pourrait aussi exacerber les inégalités, car les utilisateurs doivent être accompagnés pour savoir comment interpréter les résultats, et pouvoir accéder à une prise en charge médicale adaptée en cas de détection d’anomalies génétiques. Ce fossé est particulièrement marqué pour les ACG de prédisposition au cancer, où l’accès aux consultations d’oncogénétique — déjà saturées — reste limité pour les populations défavorisées ou rurales (21). Dans le cas de Mr. C. (5), s’il a pu bénéficier d’une consultation en oncogénétique et de nouvelles ACG, il est probable que ce ne soit pas systématiquement le cas d’autres patients — les services d’oncogénétique n’étant pas facilement accessibles (21) sur le territoire français (ressources et moyens limités).
Par ailleurs, la divulgation involontaire de résultats génétiques pourrait renforcer les inégalités socio-économiques. Par exemple, une personne identifiée comme porteuse d’un variant BRCA1 pourrait se voir refuser une assurance-emprunteur, essentielle pour l’accès à un crédit immobilier, ou subir des préjudices en milieu professionnel. Aux États-Unis, le Genetic Information Nondiscrimination Act interdit (en théorie) de telles discriminations, mais en Europe les protections restent fragmentaires (22).
En France, le cadre légal prévoit que les analyses génétiques soient réalisées sous la supervision de professionnels de santé qualifiés, garantissant une interprétation correcte des résultats et un suivi approprié. Les tests génétiques, en se soustrayant à ces règles, risquent de créer des inégalités d’accès à une information génétique fiable et de qualité, ainsi qu’à une prise en charge médicale adéquate.
Bienfaisance
Le principe de bienfaisance (6) exige que les actions menées visent à faire le bien, en maximisant les bénéfices et en minimisant les risques pour les individus. Les entreprises commercialisant des tests génétiques prétendent offrir des outils pour mieux gérer la santé individuelle, mais sans cadre médical approprié, les résultats peuvent être mal interprétés et mal utilisés. Dans le cas de Mr. C. (5), les tests génétiques ont entraîné un stress majeur pour le patient, avec des résultats de tests génétiques alarmants et non corroborés par une analyse clinique ainsi que des examens médicaux inutiles, ne maximisant en aucun cas les bénéfices potentiels pour Mr. C. Pour les porteurs réels de variants pathogènes, l’absence de suivi adapté — comme des programmes de dépistage renforcés ou des mesures préventives — annule tout bénéfice potentiel, transformant ces tests en outils anxiogènes plutôt qu’en leviers de santé publique.
Avant leur approbation en 2017, 23andMe avait été avertie par la FDA (Warning Letter) (23) sur la fiabilité de leurs tests et des risques pour les clients de recourir à des décisions médicales inappropriées (voir aussi ci-dessous le point sur la non-malfaisance).
La loi française garantit que les analyses génétiques soient réalisées dans un cadre bien défini, avec un conseil génétique, avant et après le test, afin de maximiser les bénéfices et minimiser les risques pour les individus. Les bénéfices des tests génétiques, moins fiables et non associés à un accompagnement par un conseiller en génétique, présentent également un risque de « surdiagnostic », c’est-à-dire le diagnostic de maladies asymptomatiques qui n’évoluent pas et pour lesquelles il n’y a pas de bénéfice (pas de mesures de prévention ni de traitements) pour le patient de connaître son diagnostic.
Non-malfaisance
Le principe de non-malfaisance stipule que les actions ne doivent pas causer de tort (6). Les tests génétiques, lorsqu’ils manquent de conseils appropriés et sont mal interprétés, peuvent causer des dommages psychologiques et physiques aux individus, comme dans le cas de Mr. C. (5) qui a subi un stress majeur et des examens médicaux inutiles et non sans risques potentiels (une endoscopie et deux biopsies). La mauvaise interprétation des résultats, combinée à une information insuffisante et à l’absence de consentement éclairé, va à l’encontre du principe de non-malfaisance. De plus, la divulgation de données génétiques sensibles — comme les prédispositions au cancer — pourrait entraîner des discriminations génétiques systémiques :
-
Accès à l’assurance : En France, les assureurs n’ont actuellement pas le droit de demander d’analyses génétiques, mais une fuite de données pourrait inciter à des ajustements de primes ou des exclusions de couverture, comme cela a été observé dans des pays sans cadre protecteur strict (24).
-
Emploi : Des employeurs pourraient écarter des candidats perçus comme « à risque » de développer un cancer, malgré l’interdiction légale, en s’appuyant sur des informations génétiques obtenues illicitement.
-
Prêts bancaires : Les banques pourraient exiger une assurance-vie renforcée pour les porteurs de variants génétiques potentiellement pathogènes, rendant l’accès au crédit plus coûteux ou impossible.
Un autre exemple contraire au principe de non-malfaisance est le piratage massif des données de 23andMe en 2023 ; les données génétiques de millions de clients ont été exposées (25). Cet incident souligne la vulnérabilité des bases de données génétiques, où des informations sensibles — une fois divulguées — pourraient être exploitées à des fins discriminatoires pendant des décennies.
La loi française, en exigeant une prescription médicale et un suivi par un conseiller en génétique, cherche à minimiser les risques de malfaisance en fournissant des informations fiables et en assurant un soutien approprié pour l’interprétation des résultats. Les tests génétiques, en accès libre sur internet, qui contournent donc la réglementation française peuvent mettre en danger les individus en fournissant des informations potentiellement erronées et anxiogènes.
Enjeux de justice intergénérationnelle et de consentement familial
Un aspect éthique sous-exploré concerne l’impact des tests génétiques sur les dynamiques familiales et les générations futures. La découverte d’une prédisposition génétique à un cancer (comme une mutation du gène BRCA1/2) ne concerne pas uniquement l’individu testé, mais aussi ses apparentés biologiques, qui pourraient être porteurs du même variant sans avoir consenti à le savoir. Des études montrent que certains des utilisateurs de tests génétiques partagent leurs résultats avec des membres de leur famille, parfois contre leur gré (26), violant ainsi leur droit à l’ignorance. Par ailleurs, ces tests soulèvent des questions de justice intergénérationnelle — les données génétiques stockées par des entreprises privées pourraient être exploitées pour prédire des risques chez les descendants, sans leur consentement. Certaines plateformes, comme MyHeritage, intègrent déjà des outils de pairage génétique reliant des utilisateurs à des cousins éloignés, créant un réseau de données où la vie privée d’un individu dépend de celle de dizaines d’autres (27).
CONCLUSION
Les tests génétiques en libre accès, particulièrement ceux informant sur la prédisposition au cancer, soulèvent des enjeux éthiques majeurs qui nécessitent une vigilance constante pour protéger les individus (27). L’illusion d’autonomie, les inégalités d’accès à une information fiable et à un suivi médical (justice), les doutes sur les bénéfices réels (bienfaisance) et les risques avérés de préjudices psychologiques, physiques ou sociaux (non-malfaisance) doivent être sérieusement considérés. Si le cadre légal français, en encadrant strictement les ACG à des fins médicales, s’aligne sur les principes éthiques fondamentaux (6), la facilité d’accès à ces tests en ligne fragilise cette protection. Leur fiabilité reste questionnable et leur utilité hors d’un contexte médical et d’un conseil génétique adapté est très limitée, voire négative (5), comme le soulignent des analyses récentes pointant les risques de mauvais diagnostics ou de surtraitements (5,27).
Plutôt que de se reposer uniquement sur l’interdiction, qui s’avère poreuse face aux possibilités disponibles sur internet, des solutions préventives axées sur l’information et l’éducation du public semblent nécessaires. Il est crucial d’informer les citoyens français sur les limites, les risques (y compris pour leurs données personnelles et les implications familiales) et le cadre légal des tests génétiques. Des campagnes d’information menées par les instances gouvernementales pourraient jouer un rôle-clé.
Il est important d’évoquer la situation dans les pays où ces tests sont autorisés : les mêmes questions éthiques se posent, même si les réglementations varient. Cela soulève des questions sur la façon de trouver un équilibre entre la protection des citoyens par des lois strictes et la promotion de l’autonomie individuelle dans une société où l’accès à l’information est de plus en plus vaste. Le rôle d’organismes consultatifs, comme le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) en France par exemple, est crucial pour éclairer ces débats et guider les changements législatifs. Il s’agit de faire en sorte que les avancées génétiques apportent de réels bénéfices aux individus sans les exposer à des décisions difficiles ou à des risques inutiles.
Appendices
Remerciements / Acknowledgements
L’auteur remercie Paul Véron, professeur de droit du master éthique de Nantes Université, pour lui avoir inspiré le sujet de cet article en y apportant un éclairage juridique complémentaire à la dimension éthique.
The author would like to thank Paul Véron, professor of law at the Master in Ethics program at Nantes Université, for having inspired the subject of this article by providing a legal perspective that complements the ethical dimension.
Bibliographie
- 1. Legifrance. Code de la santé publique. Article L1131-1. 4 aout 2021.
- 2. Legifrance. Code civil. Article 16-10. 21 mai 2023.
- 3. Thiebes S, Toussaint PA, Ju J, Ahn JH, Lyytinen K, Sunyaev A. Valuable genomes: taxonomy and archetypes of business models in direct-to-consumer genetic testing. J Med Internet Res. 2020;22(1):e14890.
- 4. Roblin M, Crivelli L. Conseil génétique et impacts psychologiques. Bull Cancer. 2025;112(3):251-52.
- 5. de Pauw A, Schwartz M, Colas C, et al. Direct-to-consumer misleading information on cancer risks calls for an urgent clarification of health genetic testing performed by commercial companies. Eur J Cancer. 2020;132:100-3.
- 6. Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics: marking its fortieth anniversary. Am J Bioeth. 2019;19(11):9-12.
- 7. Maudot C, Koual M, Azaïs H, Benoit L, et al. Hystérectomie prophylactique (syndrome de Lynch, BRCA et autres). Bull Cancer. 2025;112(3):326-34.
- 8. Legifrance. Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales. 7 juin 2013.
- 9. Gladieff L, Lyonnet DS, Lortholary A, Leary A, Genestie C, Ray-Coquard I. Cancers de l’ovaire BRCA muté : consultation d’oncogénétique et prescription des inhibiteurs de PARP. Bull Cancer. 2017;104(Suppl 1):S16-23.
- 10. Legifrance. Code pénal. Article 226-28-1. 9 juillet 2011.
- 11. Assurance Maladie. Tableaux récapitulatifs des taux de remboursement. 26 février 2025.
- 12. US Food and Drug Administration. FDA allows marketing of first direct-to-consumer tests that provide genetic risk information for certain conditions. Press Release. 6 Apr 2017.
- 13. Ménard T, Barros A, Ganter C. Clinical quality considerations when using next-generation sequencing (NGS) in clinical drug development. Ther Innov Regul Sci. 2021;55(5):1066-74.
- 14. Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD). Article 9 - Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel.
- 15. Gamble LA, Grant RRC, Samaranayake SG, et al. Decision-making and regret in patients with germline CDH1 variants undergoing prophylactic total gastrectomy. J Med Genet. 2023;60(3):241-46.
- 16. Dwyer AA, Shen H, Zeng Z, Gregas M, Zhao M. Framing effects on decision-making for diagnostic genetic testing: results from a randomized trial. Genes. 2021;12(6):941.
- 17. European Commission. Ethical, Legal, and Social Aspects and Implications of Direct-to-Consumer Genetic Testing. CORDIS. 21 Mai 2011.
- 18. Tabor HK, Kelley M. Challenges in the use of direct-to-consumer personal genome testing in children. Am J Bioeth. 2009;9(6-7):32-4.
- 19. Hakonarson H, Gulcher JR, Stefansson K. deCODE genetics, Inc. Pharmacogenomics. 2003;4(2):209-15.
- 20. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Tests génétiques sur Internet: la CNIL appelle à la vigilance. 6 mars 2024.
- 21. Groupe de travail Ligue nationale contre le cancer, Unicancer. Accès aux tests génétiques en oncologie. Février 2021.
- 22. Joly Y, Dalpe G. Genetic discrimination still casts a large shadow in 2022. Eur J Hum Genet. 2022;30(12):1320-22.
- 23. Yim SH, Chung YJ. Reflections on the US FDA’s warning on direct-to-consumer genetic testing. Genomics Inform. 2014;12(4):151-5.
- 24. Suter SM. GINA at 10 years: the battle over ‘genetic information’ continues in court. J Law Biosci. 2019;5(3):495-526.
- 25. Credential Stuffing Incident: What happened? 23andMe. 5 décembre 2023.
- 26. Guerrini CJ, Robinson JO, Bloss CC, et al. Family secrets: Experiences and outcomes of participating in direct-to-consumer genetic relative-finder services. Am J Hum Genet. 2022;109(3):486-97.
- 27. Bonomi L, Huang Y, Ohno-Machado L. Privacy challenges and research opportunities for genomic data sharing. Nat Genet. 2020;52(7):646-54.
- 28. Gram EG, Copp T, Ransohoff DF, et al. Direct-to-consumer tests: emerging trends are cause for concern. BMJ. 2024;387:e080460.