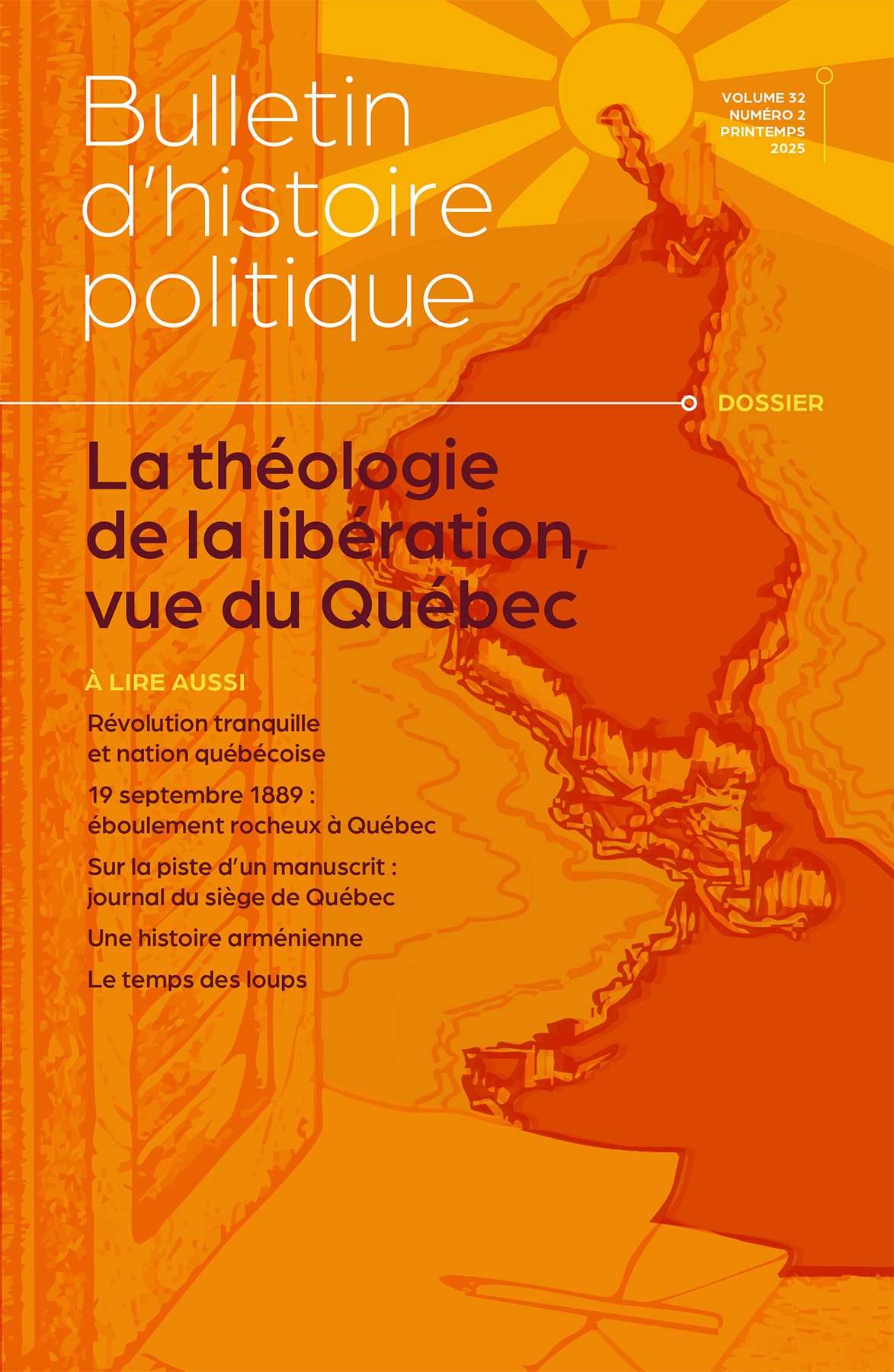Il y a 110 ans, les Arméniens de Turquie étaient victimes de ce que l’on considère être le premier génocide moderne. Les contours de l’affaire sont connus, et ils l’étaient dès l’époque. Toutefois, certains petits faits le sont moins, et d’autres méritent une reconsidération. Parmi les premiers, il y a le mécanisme de la survie individuelle ; des seconds, la réaction des autorités à l’endroit des réfugiés, qui conduit à revenir sur le mythe populaire d’un Canada havre d’immigration. Ainsi, à partir d’une histoire familiale, je voudrais explorer le lien entre un drame individuel et la politique d’un État supposé libéral dans l’accueil des réfugiés, et ce sur un fond d’événements qui mirent à mal la désirable adéquation entre éthique et politique. À la fin du XIXe siècle, la population arménienne est estimée à entre 2,5 et 3 millions de personnes réparties entre la Perse, la Russie des tsars et l’Empire ottoman, en particulier la zone frontalière entre ces États. La majorité vivait du côté turc. Les Arméniens sont de très anciens chrétiens. Après l’expansion de l’Islam, ils vécurent légalement discriminés, par une forte imposition surtout, la contrepartie étant une relative autonomie civile et religieuse remise au patriarche arménien de Constantinople. Du reste, durant toute son histoire depuis la prise de Constantinople en 1453, le sultanat jouait les communautés minoritaires les unes contre les autres. Il en restera quelque chose en 1914. Ce statut était fragile et ne protégeait guère la minorité arménienne des violences de la majorité lorsque, à intervalles plus ou moins lointains, des tensions internationales, des difficultés économiques ou des incidents interethniques intérieurs accroissaient la méfiance intercommunautaire. À la fin du XIXe siècle, sous le sultan Abdul Hamid II, l’intensité des violences grandit, les pogroms se rapprochèrent et devinrent très meurtriers : au milieu des années 1890, entre 80 000 et 300 000 Arméniens perdirent ainsi la vie. Plusieurs cherchèrent à quitter la région pour se réfugier en Russie, en Grèce ou en Perse, dont les peuples n’étaient pas des plus accueillants, et de plus en plus en Europe occidentale et dans les Amériques du Nord et du Sud. Là se trouve l’origine des premiers établissements au Canada. Tant partirent que la population arménienne dans l’Arménie historique stagnait ou diminuait. En 1908-1909, les Jeunes Turcs, mouvement favorable à une constitution de type occidental, chassent Abdul Hamid. La faction principale du mouvement, le Comité Union et Progrès (CUP), est nationaliste et raciste. Le Comité veut l’avènement d’une Turquie moderne capable de défendre l’empire et de tenir son rang parmi les grandes puissances. Du CUP, les Arméniens pouvaient s’attendre au pire. Dès Pâques 1909, des musulmans radicaux se livrent à un pogrom dans la ville d’Adana en Cilicie, région située au sud-est de la Turquie, sur les rives de la Méditerranée. Entre 20 000 et 30 000 Arméniens perdent la vie et une centaine de milliers fuient la région. Menacées d’une intervention navale franco-britannique, les autorités turques font stopper le nettoyage ethnique. Les tensions entre les principales communautés, musulmans, Grecs orthodoxes et autres chrétiens, s’aggravent à l’occasion des guerres balkaniques de 1912-1913, car les Ottomans y connaissent d’importants revers. Le CUP en profite pour instituer un gouvernement à parti unique qui considère les minorités religieuses nuisibles à son projet de turquisation de l’empire. En juin 1914, ils commencent l’expulsion de 150 000 Grecs de la région de Smyrne, que ceux-ci habitaient depuis 3 000 ans. Enfin, la tension s’accroît encore lorsque plusieurs volontaires arméniens joignent l’Armée russe à l’été 1914. Cependant, les Ottomans font alliance avec l’Allemagne par un traité secret le 2 août 1914, même s’ils …
Une histoire arménienne : le Service d’immigration canadien et les réfugiés au début des années 1920 (1re partie)[Record]
…more information
Yves Tremblay
Historien, ministère de la Défense nationale, Ottawa