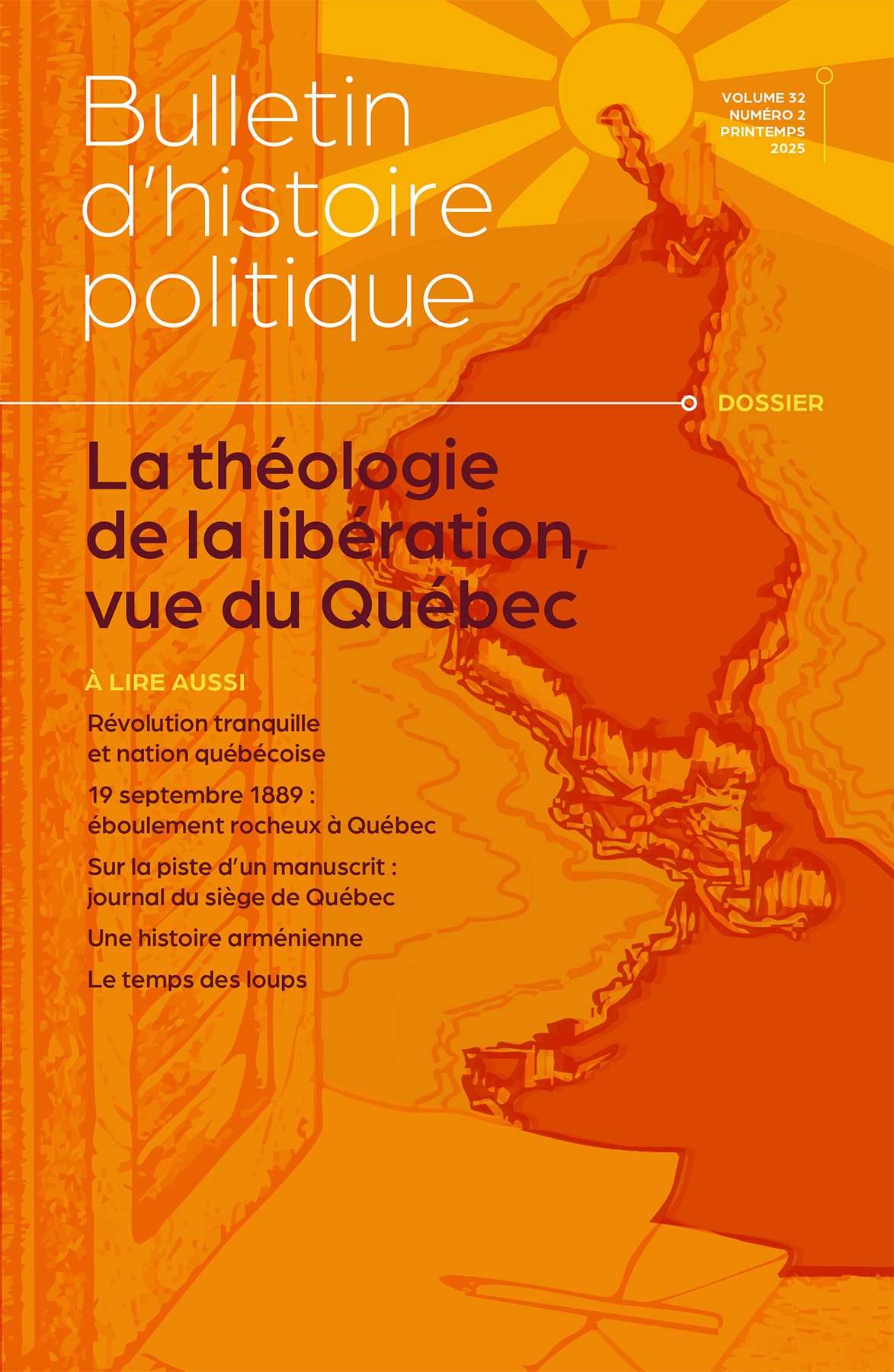L’étude du catholicisme québécois au XXe siècle, particulièrement depuis les années 1930 jusqu’aux années postconciliaires, a connu une période fort prospère au cours des deux dernières décennies, notamment avec la remise en question d’un certain discours sur la place du catholicisme comme cheville ouvrière de la Grande Noirceur, et comme institution ayant retardé le développement de la société québécoise et freiné la Révolution tranquille. En effet, la plupart des travaux d’historien·ne·s publiés au cours de ces deux décennies ont plutôt montré l’apport des catholiques à l’avènement du Québec contemporain, tel que nous le connaissons sur les plans culturel, étatique et institutionnel. La sociologie a aussi été mise à contribution pour saisir les contours des transformations du rapport des Québécois·e·s à l’institution ecclésiale de même qu’au catholicisme comme fait de culture et de croyance. Parmi les approches qui se sont démarquées, notons la perspective transnationale qui s’est imposée comme cadre d’analyse des réalités socio-ecclésiales catholiques au cours de la dernière décennie. Ces travaux ont montré que les catholiques québécois·e·s appartenaient à des réseaux inscrits dans divers contextes nationaux (Europe, Amérique latine, Afrique et Asie). La participation à de tels réseaux a favorisé la circulation d’idées, de personnes et de pratiques, ce qui a permis d’opérer des transferts socio-ecclésiaux importants. En s’attardant spécifiquement aux liens entre le Québec et l’Amérique latine, ce dossier thématique souhaite poser une pierre dans l’élaboration d’une cartographie, notamment transnationale, du christianisme social au Québec depuis les années 1950. Même si la connaissance que nous avons du rôle des catholiques sociaux au Québec des années d’avant la Révolution tranquille est importante, celle que nous avons de son évolution depuis cette période est plus limitée. En effet, on ne retrouve que quelques travaux au cours des décennies 1980 et 1990, principalement autour des enjeux relatifs à des phénomènes de reconversion de l’Église catholique dans le social ou autour de questions portant sur l’immigration. À l’exception des récents textes d’Yves Vaillancourt, lui-même acteur de cette mouvance ainsi que de l’imposant travail de vulgarisation réalisé par le Centre justice et foi, via le site Mémoire du christianisme social au Québec (mcsq.ca) dynamisé par la plume de l’historien Frédéric Barriault, bien peu de travaux nous permettent de prendre la mesure de l’évolution de ce courant depuis la Révolution tranquille. En effet, cette évolution n’a fait l’objet que de quelques travaux récents, le plus souvent comme une résultante de l’analyse du phénomène missionnaire. De plus, le Québec accuse un retard par rapport à la France, notamment, en regard de la situation du christianisme de gauche, où les travaux portant spécifiquement sur cette mouvance sont importants depuis environ une décennie. Depuis la fin des années 1960, le christianisme social québécois s’est radicalisé sur le plan politique, suivant en cela la tendance générale de cette mouvance au sein de l’Église catholique romaine, dans la foulée des enseignements de Vatican II, du pape Paul VI (Populorum Progressio, 1967) et de l’émergence de la théologie de la libération en Amérique latine. Nous posons cette hypothèse : dans ce contexte catholique globalement favorable à l’innovation sociale des années postconciliaires, et au contact des outils latino-américains de la conscientisation et de la libération, de nombreux militant·e·s chrétien·e·s du Québec ont eu l’occasion de réfléchir leur action sur le monde à partir d’une posture chrétienne engagée et dont la portée se voulait radicale. Cette radicalité s’entend, tout à la fois, comme une volonté de retourner aux sources du christianisme et d’incarner son message prophétique de transformation de soi et du monde, tel qu’il s’est déployé et s’est actualisé depuis les années 1970 dans des organisations québécoises, comme …
Plaidoyer en faveur d’une cartographie du christianisme social au Québec
…more information
Catherine Foisy
Département de sciences des religions, Université du Québec à MontréalEtienne Lapointe
Département de sciences des religions, Université du Québec à Montréal
Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.
Access options:
Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.
Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.
As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.
Access options