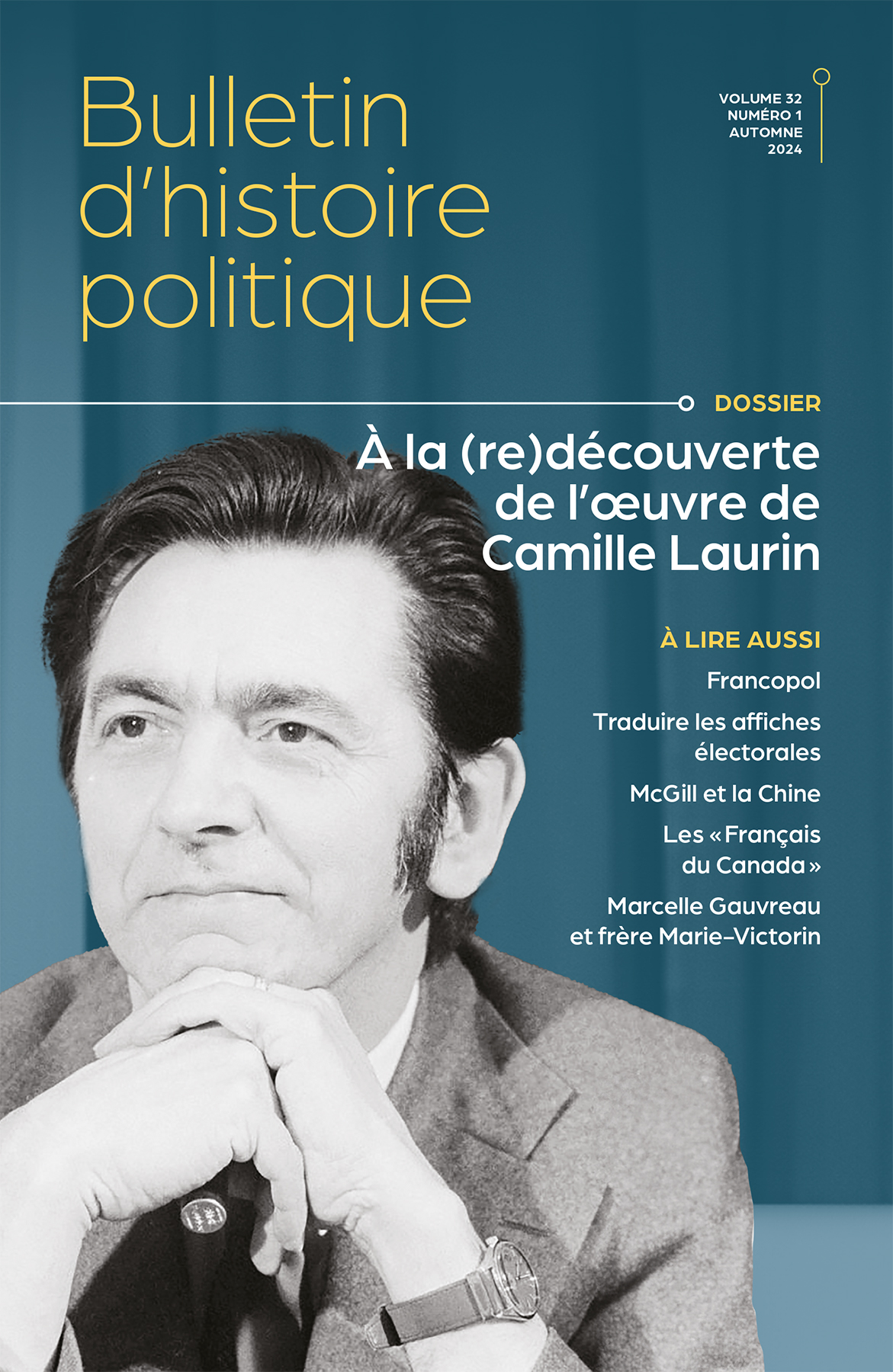Jacques Rouillard, professeur émérite en histoire de l’Université de Montréal et spécialiste de l’histoire du syndicalisme, dans Le mythe tenace de la folk society en histoire du Québec, remonte le fil de la mémoire collective et celui de l’historiographie québécoise en dépouillant des études effectuées sur la société canadienne-française par des sociologues anglo-saxons. Ces derniers auraient créé, du passé québécois, une image de noirceur qui dure encore. Pour l’historien, ces sociologues ont appliqué au Canada français un cadre théorique évolutionniste dans lequel les sociétés atteindraient la modernité lorsqu’elles seraient urbanisées et industrialisées. Apparaîtrait d’abord une société primitive, c’est-à-dire « une petite société, isolée, illettrée, homogène avec un sens profond de solidarité, détenant une culture traditionnelle avec des liens familiaux étroits, accordant beaucoup d’importance au sacré et articulant une économie peu liée au marché » (p. 21). Le Canada français incarnerait ce modèle. Rouillard explique, en trois parties et dix chapitres, comment cette vision anglo-saxonne a influencé les intellectuels québécois des années 1950 et 1960, ceux des années 1970 et 1980, dont les études sont marquées par une reconfiguration nationaliste, et ceux de l’historiographie actuelle, qui inscrivent leurs travaux dans une approche culturelle. Pour Rouillard, la représentation d’un Canada français clérico-conservateur proviendrait de l’École sociologique de Chicago. Cette conception traditionaliste proviendrait notamment du sociologue Everett C. Hugues, qui a analysé des communautés canadiennes-françaises rurales éloignées des centres urbains afin de sentir « l’âme véritable du Canada français » (p. 28). Cette « essence » canadienne-française, marquée par la culture catholique, serait à la base d’un développement social tardif. L’École de Chicago, pour Rouillard, était caractérisée par une vision de supériorité anglo-protestante qui opposait le progrès du libéralisme des sociétés anglophones au « retard dans l’évolution vers la modernité » de la société catholique francophone (p. 29). Le sociologue Jean-Charles Falardeau de l’Université Laval transpose alors cette doctrine au Québec dans les années 1950. Les intellectuels s’approprient ce cadre théorique et critiquent le « traditionalisme » et l’incapacité du gouvernement de Duplessis à assurer l’avenir des Canadiens français (p. 33). Vivant comme sous l’Ancien Régime français, ce peuple serait subordonné aux valeurs culturelles du clergé et voudrait « conserver [son] identité traditionnelle » (p. 33-34). Les sociologues québécois tenteraient aussi de noircir un passé marqué par la survivance afin d’entrer dans la modernité. Cette représentation se mythifie lorsqu’elle se retrouve au coeur des travaux de Fernand Ouellet et de l’École historique de Laval et qu’elle sert de caricature à Pierre Elliott Trudeau lorsqu’il peint une société canadienne-française antidémocratique stéréotypée dans La grève de l’amiante. Rouillard note que cette reproduction idéologique est notamment causée par les contacts entre Falardeau, Trudeau et Ouellet. Dans son troisième chapitre « Le relais d’historiens », bien que le détour soit pertinent, le bât blesse lorsque Rouillard aborde « l’interprétation historiographique libérale » (p. 69). Dans leurs critiques de la société québécoise, les sociologues, selon Rouillard, commettraient des erreurs entre autres en occultant la tradition historiographique libérale du XIXe siècle qui aurait frayé la voie vers la société libérale de la Révolution tranquille. Pour lui, le fait que François-Xavier Garneau est « convaincu de la supériorité du système démocratique et des idées de liberté » (p. 70) et qu’il défende l’autonomie des pouvoirs politiques et religieux représente le balbutiement d’une société libérale. L’aveuglement de ces intellectuels aurait permis de légitimer l’essentialisation d’un passé ancré dans la tradition et de nuancer leur application d’une société primitive. Toutefois, cette section rompt avec la chronologie que fait Rouillard, puisqu’elle oblige le lecteur à revenir au lendemain de la défaite des Patriotes et de revoir la manière dont leurs …
Jacques Rouillard, Le mythe tenace de la folk society en histoire du Québec, Québec, Septentrion, 2023, 216 p.
…more information
Gabriel Jarvis
Université du Québec à Montréal
Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.
Access options:
Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.
Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.
As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.
Access options