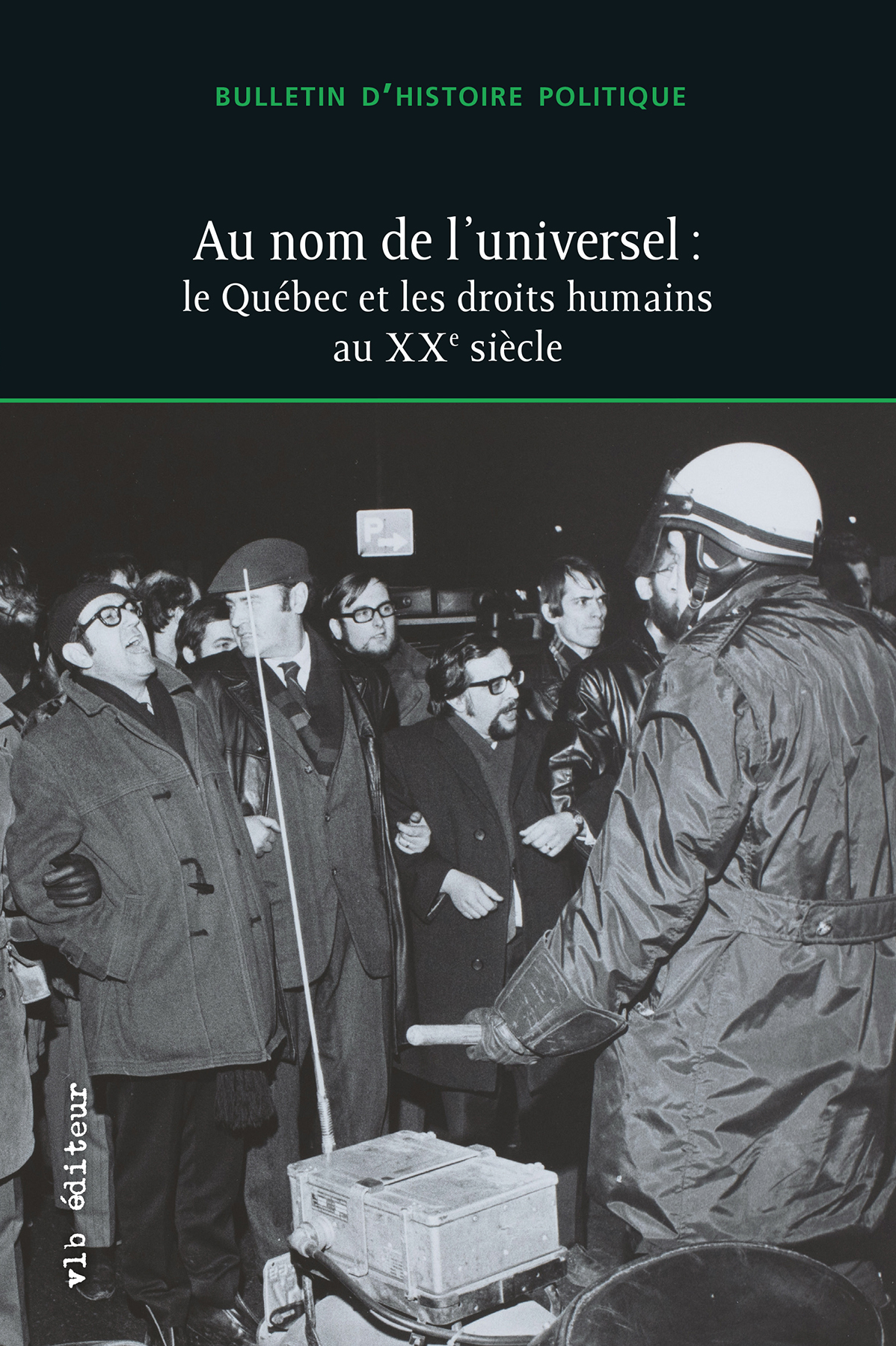Article body
Marion Pouffary est docteure en histoire moderne et contemporaine, chercheuse associée au Centre d’histoire du XIXe siècle (Sorbonne) et fonctionnaire parlementaire en France. Ce livre est une adaptation de sa thèse de doctorat, soutenue en 2019. L’historienne s’inscrit dans une historiographie s’intéressant à la construction ou la déconstruction des différents mythes autour de Robespierre[1]. Ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire de la Révolution française et, en particulier, à la vie et à l’oeuvre de Robespierre, connaissent cette boutade désespérée de l’historien Marc Bloch : « Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce, par pitié, dîtes-nous simplement, quel fut Robespierre » ! Celui qu’on surnomma l’Incorruptible fut en effet l’objet de légendes noires ou dorées, « de creux réquisitoires [succédant à] de vaines réhabilitations[2] ». Le XIXe siècle français est au coeur de l’élaboration puis de la transmission de ces légendes. L’ouvrage de Marion Pouffary s’intéresse justement à ces légendes noires et à la légende dorée sur Robespierre, que le XIXe siècle nous a transmises.
Sans répondre à l’injonction de Bloch, la chercheuse reconstitue l’histoire d’une instrumentalisation politique et militante de l’héritage de l’Incorruptible. Elle fait un travail utile en présentant ces légendes et les différents contextes conduisant à fabriquer ces dernières, nous évitant de les perpétuer aveuglément. Pour l’historienne, ce militantisme ambiant, source de plusieurs légendes déformantes sur Robespierre, sera néanmoins utile occasionnellement. En effet, certains militants reproduiront quelques sources ou archives liées à ce révolutionnaire. L’apparition de telles sources, parlementaires, familiales ou anthologies des oeuvres (discours et écrits) de Robespierre, a permis l’écriture de plusieurs histoires mieux documentées sur la Révolution ainsi qu’une importante biographie de l’Incorruptible[3]. Certes, la sélection de ces sources publiées demeurait partielle, mais l’autrice indique à la décharge de ces militants-historiens que ces dernières étaient nombreuses et éparses, donc difficiles à rassembler. Ainsi, il n’y a pas toujours une mauvaise foi militante et malgré les biais, ces sources permettront, tout au long du XIXe siècle, de préciser « les références à Robespierre » (p. 248). Reste que la hausse des publications/reproductions de ces archives n’éliminera pas l’instrumentalisation faite par les politiciens et les militants qui ne citèrent que les mêmes extraits, souvent hors contexte. Ces légendes ont continué à intoxiquer l’histoire et ce militantisme, à diminuer la complexité du réel. Chose que Marion Pouffary aurait pu affirmer plus explicitement.
À travers tous les régimes politiques français du XIXe siècle, monarchie de Juillet (1830-1848), Seconde République (1848-1851), Second Empire (1851-1870) et, finalement, la IIIe République (1870-1940), Marion Pouffary présente et analyse l’évolution des différentes légendes sur Robespierre ainsi que leur utilisation dans les différents débats politiques. Ces légendes ne sont aucunement monolithiques et n’appartiennent pas exclusivement à un groupe idéologique. Par exemple, les légendes noires ne furent pas l’apanage des contre-révolutionnaires, elles existaient aussi à « gauche ». Finalement, ces régimes politiques qui se succédèrent furent aussi marqués par de nombreux débats sociopolitiques et ceux-ci ont occasionné l’utilisation des discours de Robespierre comme forme d’autorité ou de repoussoir (p. 278).
Le livre est divisé (implicitement) en trois parties quasi autonomes. Les quatre premiers chapitres, constituant la première partie, sont ceux où Marion Pouffary présente ce qu’elle appelle le « retour de Robespierre sur la scène politique » (p. 27). Selon elle, ce dernier « aurait repris du service » en 1830, date où sa légende dorée fut relancée parallèlement et en opposition à l’avènement de la monarchie de Juillet. Les républicains radicaux, déçus par ce nouveau régime implanté rapidement par les notables libéraux, militèrent dans la « société civile » via des sociétés politiques (la Société des Amis du Peuple et la Société des Droits de l’Homme) à l’avènement d’une République. De plus, ils luttaient aussi pour l’élargissement du suffrage, voire pour l’établissement du suffrage masculin universel refusé par Louis-Philippe d’Orléans, qui préférait le système censitaire. Ces républicains radicaux trouvèrent en Robespierre références et filiation. Ils lancèrent la légende dorée robespierriste tout en exploitant de manière prépondérante le projet personnel de Déclaration des droits de 1793 élaboré par le député de Paris. Robespierre devenait l’incarnation de la république et de l’égalité politique. Avec les romantiques et les premiers socialistes, que l’autrice associe aussi à la construction de la légende dorée de Robespierre, ce dernier fut perçu comme un homme de principes, un théoricien, un rhétoricien efficace servant à réactiver, par exemple, le droit à l’insurrection du peuple. Pour l’historienne, les premiers socialistes firent évoluer la légende dorée en attribuant à Robespierre une sensibilité sociale à l’égard du peuple. Évolution remarquée en 1848 au moment où les ouvriers et les premiers socialistes se virent confisquer leur révolution sociale par les républicains modérés, libéraux et socialement conservateurs. Pour défendre leur point de vue, ces militants socialistes instrumentalisèrent des fragments des discours sociaux de Robespierre afin de lutter contre l’égoïsme des bourgeois républicains.
La légende dorée ne monopolisa guère l’opinion publique : elle sera combattue par quatre légendes noires. Celles-ci sont l’objet de la « deuxième partie » du livre (chapitres 5 à 7). Sans surprise, la première légende noire présentée par la chercheuse nous provient des contre-révolutionnaires/réactionnaires. Les trois autres furent le produit des républicains modérés et des libéraux et, surprise, d’une extrême gauche divisée entre anarchistes et communistes. À chacun sa légende. Les contre-révolutionnaires se servaient de Robespierre comme d’un repoussoir. Ils le présentaient comme un anarchiste destructeur de l’ordre politico-religieux d’Ancien Régime. Après 1871, les réactionnaires insistaient plutôt sur le caractère tyrannique de ce dernier. Selon Pouffary, l’avènement de la Troisième République (1870-71) marqua une rupture dans l’utilisation de l’image de Robespierre. Elle amenait aux commandes de l’État une nouvelle génération (à gauche comme à droite) qui n’avait pas connu directement la Révolution. De plus, la question du régime politique étant réglée, il y eut un déplacement des débats, du politique vers le social et le religieux. L’historienne ajoute que pour cette nouvelle génération politique, l’expérience de la République de 1793 fut reléguée au rang de souvenir, éclipsée par le traumatisme de la Commune de 1871. Dans cette transition mémorielle, on aurait abandonné la légende du Robespierre anarchiste pour ne conserver que celle du tyran. Il est malheureux, ici, que l’historienne ne nous donne pas de manière détaillée les étapes et les motifs conduisant à cet abandon de l’image anarchiste de Robespierre.
Les républicains modérés et les libéraux (des bourgeois) forgèrent une légende où Robespierre fut à la fois un tyran ou un « tyranarchiste » manipulant les masses populaires afin d’éliminer les Girondins et dominer le jeu politique, par la « Terreur », évidemment. Comme les réactionnaires, ces modérés et libéraux abandonneront, après 1870, l’image d’un Robespierre anarchiste pour ne conserver que celle du tyran. L’Incorruptible brimait les libertés en contrôlant un gouvernement dictatorial. Ce milieu reprochera aussi à Robespierre son « cléricalisme », lui prêtant même des sympathies pour le catholicisme. Jules Michelet fut un représentant de ce milieu. Chez les anarchistes, on blâmera Robespierre pour la centralisation excessive de l’État, retirant ainsi l’initiative politique au peuple. Pour les communistes[4], sa trahison à l’égard du peuple, notamment par son refus, selon eux, de répondre favorablement aux principales revendications sociales des sans-culottes, dont l’égalité sociale, en font un tyran bourgeois. Dans toutes ces légendes noires, l’autrice nous indique qu’on proposait des héros de substitution pour remplacer ce monstre. Pour les modérés et les libéraux, c’étaient les Girondins ou les dantonistes. Pour les anarchistes et les communistes, on optait pour Marat, les Hébertistes ou les Enragés. Ici, une déception : avec cet impressionnant travail d’érudition, Marion Pouffary aurait pu démanteler ce mythe tenace voulant que Robespierre incarne à lui seul la Révolution française ou ladite idéologie de la Révolution. Il avait des compétiteurs mémoriels.
Dans la dernière partie (chapitres 8 à 11), Marion Pouffary dénombre les occurrences de références à Robespierre dans le cadre, cette fois-ci, des débats parlementaires allant de 1830 à la fin du XIXe siècle. Quoiqu’intéressante, cette partie est quelque peu répétitive. On y reconstate l’instrumentalisation de Robespierre autour des sujets de l’heure. D’abord, l’avènement de la république et de l’égalité politique, suivi par les questions relatives aux procédures judiciaires (abolition de la peine de mort). À ce sujet, où situer l’Incorruptible entre le discours abolitionniste du Constituant et l’acceptation de cette peine par le Conventionnel ? Puis, viennent les questions sociales et religieuses (entre catholiques et anticléricaux) qui ont marqué ce siècle. Robespierre fut perçu comme un impie, un tyran, un grand pontife du culte de l’Être Suprême ou le Prophète d’une nouvelle religion du contrat social, égalitaire et fraternelle. Finalement, l’autrice constate que les parlementaires citent moins Robespierre, sinon maladroitement, sur les questions économiques et financières. Ils se servent des propos du Constituant ou du Conventionnel sur le droit de propriété (que ce dernier voyait comme social et non naturel), sur l’impôt progressif exonérant les pauvres, sur le droit au travail et à la subsistance de base. Pour tous ces sujets, l’historienne constate que chaque camp conserve sa vision partiale et tronquée de Robespierre en balayant complètement les importantes contradictions dans l’évolution politique de ce dernier.
Ceux et celles qui souhaitent répondre, à titre posthume, à l’impatience de Marc Bloch, en nous donnant une histoire de Robespierre tel qu’il fut, ne pourront pas éviter le livre de Marion Pouffary, véritable bouée afin d’éviter le piège des légendes.
Appendices
Notes
-
[1]
Voir Marc Belissa et Yannick Bosc, Robespierre. La fabrication d’un mythe, Paris, Ellipses, 2013, 572 p. ; Hervé Leuwers, Maximilien Robespierre. L’homme derrière les légendes, Paris, PUF, 2019, 262 p. et Jean-Clément Martin, Robespierre. La fabrication d’un monstre, Paris, Perrin, 2016, 368 p.
-
[2]
Marc Bloch, Apologie pour l’histoire et le métier d’historien, 2e édition, Paris, Armand Colin, 1952, p. 70.
-
[3]
Ernest Hamel, Histoire de Robespierre : d’après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits, 3 volumes, Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865-1867.
-
[4]
En France, parmi les premiers communistes, nous trouvons les babouvistes, favorables à Robespierre. Les néo-babouvistes, une autre génération de communistes, abandonna cette filiation en la critiquant.