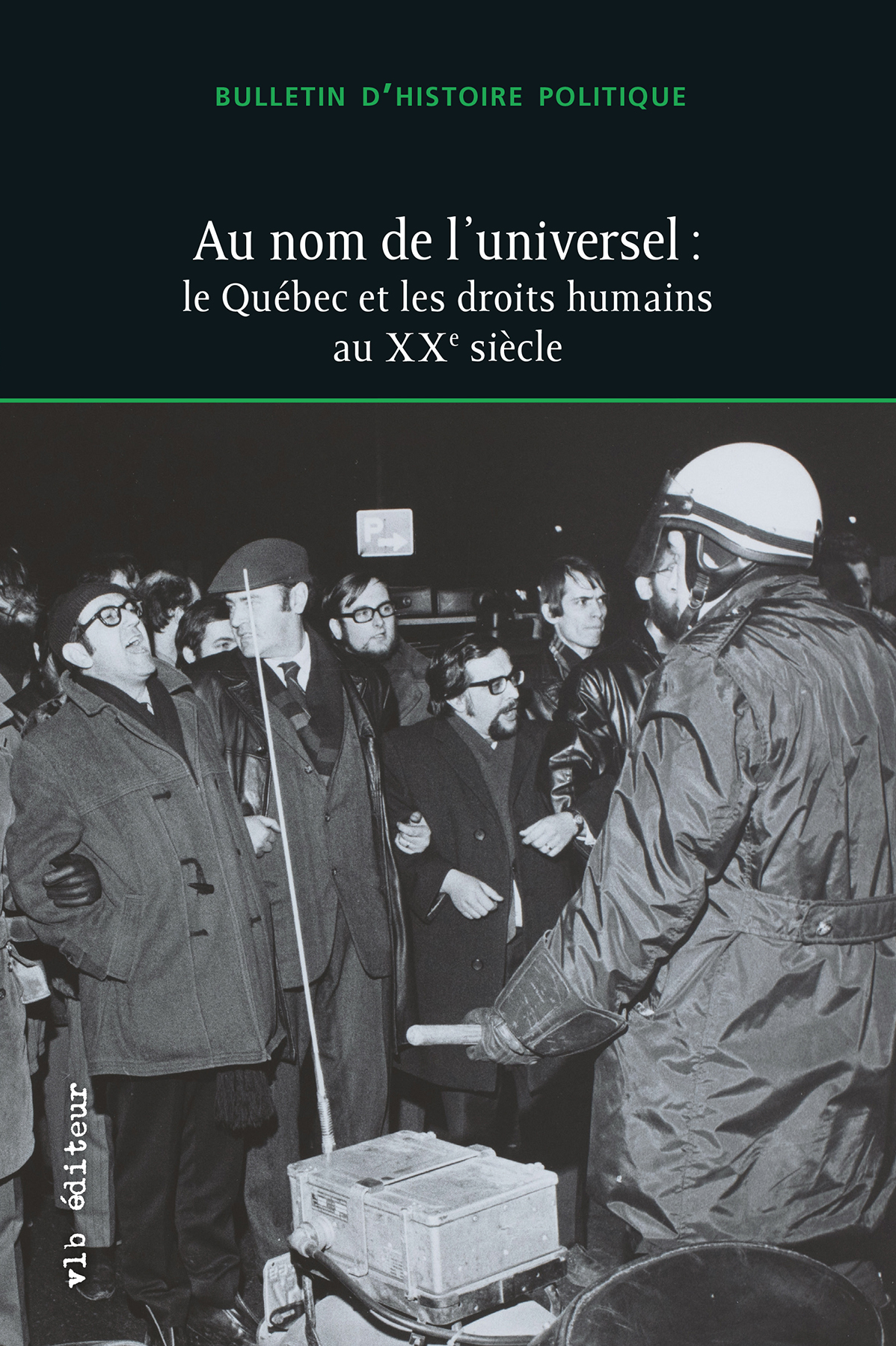Abstracts
Résumé
Cet article a pour objectif d’interroger le type particulier de violence politique que constitue le terrorisme. Pour ce faire, il propose une analyse croisée et comparative du Front de libération du Québec (FLQ) et des Cellules communistes combattantes (CCC) en Belgique. En pointant les lacunes historiographiques dans les deux pays, il entend proposer des pistes pour l’étude des organisations politiques violentes et de la manière dont les États qui y sont confrontés tentent de lutter contre le phénomène. Il s’appuie sur une série de travaux, mais également, pour l’analyse des CCC, sur un corpus de sources inédites qui permettent d’envisager de nouvelles questions sur les paramètres qui conduisent les organisations à faire le choix de la violence.
Mots-clés :
- Violence politique,
- terrorisme,
- Front de libération du Québec,
- Cellules communistes combattantes,
- historiographie,
- Belgique,
- Québec
Article body
C’est bizarre que tu dises « terroristes » à propos du FLQ… C’est vrai, tu as raison, mais c’est marrant, je n’avais jamais envisagé les choses comme ça… Pour moi, « terroriste », ce n’est pas vraiment ça[1].
Ces mots furent prononcés par mon colocataire québécois lorsque, après quelques jours de cohabitation, il me demandait ce que j’étais venu étudier au Québec en tant que chercheur en histoire. Quand je lui répondis que j’entreprenais une recherche comparative sur deux mouvements politiques « terroristes », à savoir les Cellules communistes combattantes[2] (CCC) de Belgique et le Front de libération du Québec (FLQ), telle fut sa réaction, lui qui, âgé de 36 ans, est né longtemps après les événements d’octobre 1970 et qui, par ailleurs, ne milite pour aucun mouvement politique et ne soutient pas l’indépendance du Québec. Une telle réaction m’intrigua immédiatement : en Belgique, excepté de rares cas dans certains milieux militants marginaux, l’usage du vocable « terroriste » pour qualifier les CCC n’étonnerait sans doute pas beaucoup, tant la mémoire même de ces événements demeure peu entretenue, et les actions des CCC oubliées ou méconnues[3]. Pourtant, les deux mouvements ont développé des conceptions de l’usage de la violence partiellement équivalentes, les CCC se voulant en partie les héritières de la Rote Armee Fraktion (RAF) et partageant de ce fait plusieurs références communes avec le FLQ[4]. Par sa réaction, mon colocataire exemplifiait la relativité du concept de « terrorisme » et me poussait à examiner davantage la charge politique de celui-ci.
C’est à l’établissement de quelques balises dans cette voie que cet article est dédié. Celui-ci suggère des pistes pour analyser méthodologiquement différents contextes du choix de la violence politique afin de mieux comprendre le processus qui y mène, en proposant de réfléchir au-delà des images spontanées qu’un terme comme « terrorisme », par son importante médiatisation, suscite nécessairement. En effet, appliquer à des réalités multiples le concept de terrorisme sans mener de réflexion théorique sur la violence politique enliserait le chercheur dans les représentations de son époque. Cet article entend éviter ce biais et enrichir la recherche historique touchant la violence politique des apports des autres sciences sociales. Dans cette perspective, il interroge deux cas mis en comparaison : les attentats des Cellules communistes combattantes et ceux du Front de libération du Québec.
La violence politique est ici considérée selon la définition généralement acceptée d’Harold Nieburg, qui estime qu’elle « regroupe les actes se traduisant par des destructions, des atteintes physiques, dont le but, le choix des cibles ou des victimes, la mise en oeuvre et/ou l’effet ont une signification politique, c’est-à-dire, tendent à modifier la conduite des protagonistes dans une situation de négociation qui a des conséquences pour le système social[5] ».
Quant à la notion de terrorisme, elle fait tellement débat qu’elle ne peut être appliquée sans une analyse pratique de son usage dans un contexte historique donné. Plusieurs chercheurs ont démontré que le concept demeure flou et a nourri de multiples définitions différentes. Pour comprendre l’usage de cette notion, nous l’envisageons donc comme une forme de violence politique particulière qui n’existe que parce qu’elle est nommée de cette manière par l’un ou l’autre camp, c’est-à-dire comme un moment particulier de conduite des protagonistes. Le terrorisme est une séquence dans un usage de la violence politique qui correspond quant à lui à un processus plus long et plus complexe. Pour envisager ce moment, il est nécessaire d’analyser la violence politique empiriquement (cibles, intensité, acteurs, etc.)[6].
Ces dernières années, les études sur la violence politique se sont à la fois multipliées et systématisées. Les approches multidisciplinaires qui croisent les avancées de la sociologie politique, de l’histoire ou encore de la psychologie sociale ont permis d’identifier de nombreuses variables et de créer des catégories d’analyse précises du processus d’entrée dans la violence politique. Or, de nombreux groupes violents demeurent peu étudiés par les historiens en fonction de ces apports. C’est le cas des deux organisations qui nous occupent ici. Comme l’exemple cité en introduction l’illustre, la Belgique et le Québec n’ont pas le même rapport à l’histoire de la violence politique. Pourtant, les travaux qui existent sur chacun des deux mouvements présentent des lacunes similaires, comme nous allons le voir.
Si la Belgique présente un certain vide historiographique et mémoriel par rapport au Québec, celui-ci n’est pourtant pas épargné par les lacunes. Ainsi, les très nombreux travaux sur le felquisme sont avant tout marqués par leur dimension biographique, événementielle et descriptive, et manquent également de problématisation, notamment sur la notion de terrorisme, trop souvent utilisée dans une acception commune, comme le notait très justement Philippe Côté-Martine[7]. L’éclairage de deux situations distinctes a ainsi pour objectif d’interroger concrètement l’ancrage sociohistorique de l’usage du « terrorisme ».
Isabelle Sommier a oeuvré, dans le monde francophone, à appliquer aux engagements radicaux les concepts et la théorie issus du monde anglo-saxon. Elle en a également identifié plusieurs limites. Contre une théorie trop figée d’analyse coûts/bénéfices d’une part, ou au contraire les visions psychologisantes d’autre part, elle propose d’étudier l’engagement radical de manière processuelle, en distinguant trois niveaux d’étude (micro, méso, macro) dont chacun rend compte de facteurs susceptibles de comprendre le passage à la violence : les carrières et trajectoires des militants, les ressources des organisations (école de la mobilisation des ressources) et, enfin, le contexte et l’ouverture du régime ou au contraire sa répression (structure des opportunités politiques)[8]. Inutile de dire ici que nous n’entendons pas réaliser une analyse complète de la pluralité des processus pour les deux organisations qui nous concernent. Cela demanderait bien davantage qu’un article. Nous souhaitons plutôt éclairer plusieurs dimensions de ces processus afin de suggérer des pistes aux futurs chercheurs travaillant sur la violence politique dans une perspective historique. Néanmoins, ce travail ne se contente pas d’être théorique, il part d’exemples concrets et utilise, notamment dans le cas des CCC, des sources inédites afin d’appuyer les réflexions. Enfin, il pose aussi les bases d’analyses comparatives qui doivent encore être menées afin de réfléchir sur la circulation transnationale des pratiques de violence politique, trop peu creusée à ce jour.
Dans le cadre restreint de cet article, nous mettons de côté l’analyse « macro » du contexte, d’ailleurs assez bien étudié pour le Québec comme pour la Belgique[9]. Relevons simplement qu’il s’agit de deux situations distinctes, la première étant marquée par la Révolution tranquille, un grand espoir collectif de transformations sociales et nationales avec une forte inspiration des luttes tiers-mondistes, tandis que la Belgique des années 1980 se caractérise par une importante récession économique, une forte augmentation du chômage et un reflux des mouvements de gauche. Pour l’étude de notre problématique, nous nous focaliserons sur deux éléments qui composent les deux volets de cet article : le premier envisage les lacunes et les silences de la recherche. Il suggère une approche processuelle du passage violent en offrant des pistes pour la recherche. Ensuite, en nous appuyant principalement sur le cas des CCC, à partir de sources inédites du dossier d’instruction et de la police, nous illustrerons comment interroger les différents temps de l’engagement radical, démontrant ainsi l’utilité d’envisager méthodologiquement les « carrières violentes » des militants, notamment pour l’étude du FLQ.
Dépasser les clivages historiographiques : les ambiguïtés et lacunes de la recherche sur le FLQ et les CCC
Une analyse qui quitterait le niveau macro, c’est-à-dire essentiellement l’étude du contexte et du degré d’ouverture du régime, pour se pencher sur les processus autant individuels que collectifs devrait d’abord rompre avec deux éléments qui, selon nous, occupent une place démesurée dans les recherches sur le FLQ. Le premier est la prédominance de la crise d’Octobre, qui a tendance à éclipser l’histoire de l’organisation. En prenant la crise comme l’aboutissement quasi téléologique de l’action du FLQ, beaucoup d’autrices et d’auteurs sont amenés à se pencher sur celle-ci comme le résultat d’une fuite en avant du terrorisme, qui ne peut que se radicaliser devant ses échecs, ou comme le moment d’affirmation d’un pouvoir répressif qui met fin à l’escalade violente[10]. À la suite d’écrits produits au moment des faits ou juste après, trop d’autrices et d’auteurs se sont penchés sur les moments paroxystiques de tension et, donc, sur octobre 1970, d’où une quantité élevée de travaux spécifiquement consacrés à la crise[11]. L’exemple presque idéal de ce type de travail est l’ouvrage récent de D’Arcy Jenish. Après un préambule qui évoque, dans un style particulièrement sensationnel, les obsèques de Pierre Laporte, l’introduction de l’ouvrage porte le titre suivant : « What led to this ? » D’emblée, l’idée d’un enchaînement causal linéaire est posée par l’intermédiaire d’une comparaison organique : « The seeds that produced seven and a half years of terrorism were sown in 1960, in the provincial election campaign that began on May 8 and ended on June 22 when 2.4 million Quebeckers cast their votes. A slender majority turned their backs on the past and embraced a bold new vision of the future[12]. »
Or, l’historien a peut-être ici un défaut énorme qui l’empêche de suivre au plus près les parcours des acteurs : il connaît la suite de l’histoire. Pire encore, non seulement il la connaît, mais il est abreuvé des textes de militants ou de responsables politiques qui soulignent dans leurs souvenirs cette montée inexorable vers Octobre. Pourtant, et cela paraît une évidence qui doit tout de même être rappelée : les militants du FLQ de 1966 n’avaient aucune idée de ce qui allait se produire en 1970 et, par conséquent, l’historien gagnerait donc à envisager leur parcours en tâchant d’éviter de le prendre comme un processus linéaire conduisant aux événements d’Octobre.
Ainsi, le moment paroxystique d’Octobre autorise à appliquer la notion de « terrorisme » à l’ensemble de l’organisation, à ses différentes périodes et à l’action de ses multiples militants. Mais, d’un autre côté, les réactions du gouvernement, à commencer par la Loi sur les mesures de guerre et la répression qu’elle a autorisée, nourrissent pendant longtemps une méfiance vis-à-vis des réactions jugées disproportionnées de la part de l’État. Cette méfiance explique en partie pourquoi de nombreux militants ou chercheurs refusent d’expliquer l’action du FLQ sous l’angle du seul « terrorisme[13] ».
Du côté belge, l’histoire des CCC reste encore largement à écrire, mais, surtout, à problématiser. En effet, les questionnements autour de l’usage de la violence politique en Belgique demeurent presque inexistants et les quelques rares travaux scientifiques sont avant tout descriptifs et informatifs[14]. D’autre part, il existe bien entendu quelques ouvrages journalistiques, souvent à thèse. C’est à peu près tout, si bien qu’il n’est pas exagéré de qualifier l’histoire des CCC d’histoire « occultée[15] ». Les anciens membres des Cellules ont par ailleurs produit de nombreux documents qui mettent en avant une histoire spécifique et extrêmement idéologisée de leurs actions. Au récit journalistique à thèse d’une part s’oppose donc le récit militant : les chercheurs n’ont pas tenté, à ce jour, d’interroger davantage cette période particulière en dépassant les seuls constats factuels et l’antagonisme entre les différents récits partisans. Une analyse des parcours militants et des actions permet pourtant de constater que l’imposition de la notion de terrorisme va se faire selon des modalités différentes et de manière plus affirmée qu’en ce qui concerne le FLQ, tant l’enchaînement des événements et les réponses gouvernementales ne connaissent pas la même intensité.
Le second problème de l’historiographie du terrorisme québécois repose sur le fait que les travaux journalistiques, militants et partiellement scientifiques s’entremêlent et forment une longue bibliographie. Plutôt que d’enrichir la connaissance en faisant reposer leurs analyses sur des critères méthodologiques précis, ils visent souvent à se contredire afin de confirmer ou d’infirmer une lecture particulière des événements. Posant un regard extérieur sur le FLQ, l’historien constate l’existence d’une historiographie très clivée, marquée d’une part, en négatif, par la justification partielle (ou l’acceptation) des actions du FLQ et l’indignation face aux mesures répressives : les travaux sont alors caractérisés par une mise en lumière des différentes dimensions de la Loi sur les mesures de guerre, sur le rôle des médias ou de la police, etc[16]. D’autre part, des textes s’efforcent à condamner l’usage du terrorisme et de justifier des mesures radicales pour l’endiguer. Entre ces deux pôles[17], presque aucun chercheur n’interroge l’organisation et ses membres. Continue alors la polémique sur des détails de l’histoire afin de « dénoncer les mythes » ou les « erreurs factuelles »[18]. Ce problème, présent dès la crise, n’a selon nous jamais été dépassé[19]. Il semble grand temps, plus de cinquante ans plus tard, de quitter les rivages d’une histoire quasi exclusivement positive pour tenter d’envisager une compréhension de la complexité du choix de la violence politique au Québec. De ce point de vue, le Québec et la Belgique souffrent des mêmes lacunes qui révèlent la grande difficulté de la recherche scientifique à analyser de manière apaisée les phénomènes politiques les plus clivants, à commencer par l’usage de la violence, tant les chercheurs sont eux-mêmes influencés par les conséquences des phénomènes qu’ils étudient.
Cependant, si elles sont rares, des exceptions existent au Québec. Deux d’entre elles, notoires, doivent être soulignées. Il s’agit du travail de Marc Laurendeau et de celui de Daniel Latouche[20]. Journaliste, avocat et politologue, le premier n’est pas historien et était étudiant au moment de la crise : les principaux résultats de son analyse ont d’ailleurs été écrits à chaud, deux années après Octobre. Néanmoins, il conserve le mérite d’avoir amorcé une réflexion théorique plus large sur son objet. Si nous souscrivons aux réflexions de Philippe Côté-Martine, il faut quand même s’étonner du fait que ce dernier ne cite pas, dans son examen critique, ces deux chercheurs, qui ont justement oeuvré à une meilleure compréhension du phénomène de la violence politique au Québec. En effet, si les historiens sont restés en retrait de la réflexion théorique, ces exemples issus des sciences politiques révèlent des tentatives assez précoces pour essayer d’expliquer les événements de la décennie 1962-1972. Plus qu’une absence de tentatives de théorisation, nous assistons en vérité davantage à une absence de prolongement de celles-ci : les pistes posées par les chercheurs au moment même ou juste après les événements n’ont pas par la suite été suivies par les historiens.
Marc Laurendeau propose de réfléchir à la définition de la violence politique au Québec en fonction de la rationalité de son usage, de sa légitimité ou non, et donc du rapport entre violence politique et répression, ou encore de la distinction entre violence politique et criminalité de droit commun. Très tôt, le chercheur se penchait également sur plusieurs acteurs, se basait sur les données empiriques et identifiait, lui aussi, plusieurs « moments » du FLQ. Nous avons là un premier ouvrage qui offre une base sur laquelle les historiens auraient pu largement s’appuyer. Néanmoins, la recherche présente aussi plusieurs lacunes et, à l’heure actuelle, son cadre d’analyse est, sur le plan historiographique, largement dépassé. D’abord, le choix de s’appuyer sur des sources secondaires (des travaux journalistiques ou politologiques) pour construire la typologie des violences soulève des questions. Les chercheurs en sciences sociales ont désormais proposé des méthodes de collectes des données susceptibles d’offrir un tableau plus précis et qui croisent à la fois dépouillements de presse et archives policières. Ce type d’exercice permettrait de peaufiner les bases de données sur la violence afin d’offrir une analyse quantitative plus fine et, par là, de proposer des pistes d’analyse qualitative des différents moments du FLQ. Enfin et surtout, Laurendeau se repose sur la théorie en vogue à l’époque, celle de la « frustration relative » héritée des politologues Gurr et Davies[21]. Si ce cadre d’analyse permet de comprendre partiellement les événements, les chercheurs en ont montré les limites : il ne suffit pas qu’un groupe se sente lésé ou imagine sa situation future bloquée pour qu’il fasse le choix de la violence. Dès lors, en se reposant principalement sur cette théorie, on s’interdit de comprendre la particularité du Québec par rapport à d’autres situations où la violence n’a pas été adoptée par les acteurs. Laurendeau, par ailleurs, n’a pas actualisé son cadre d’analyse dans la seconde publication datée des années 1990, alors même que les recherches sur la violence politique étaient en plein essor[22].
Ces bases posées doivent désormais être approfondies, d’autant plus que les données ne manquent pas : la réédition de l’ouvrage de Laurendeau fournit par exemple des interviews inédites de militants, une liste des actes de violence qui peut servir de base pour l’établissement de données plus précises, des répertoires de militants en vue de mener des enquêtes orales sur le milieu, la socialisation, les tendances politiques des différents groupes. Depuis lors, le nombre de témoignages publiés permet clairement aux historiens de se reposer sur des sources de plus en plus nombreuses afin de proposer un travail scientifique qui dépasse le cadre de la polémique idéologique.
Daniel Latouche adopte aussi partiellement la théorie de la frustration, tout en se rendant bien compte, déjà à l’époque, des limites d’une telle interprétation. Il pointe par exemple le peu d’efficacité de cette théorie lorsqu’il s’agit d’expliquer pourquoi la violence a cessé après 1970, alors même que les Québécois se sentaient davantage frustrés. Selon le chercheur, bien que la répression policière puisse être un élément de réponse, celui-ci ne suffit sans doute pas. Par ailleurs, l’apport fondamental de Latouche consiste à rappeler – dans un débat québécois extrêmement clivé – la nécessité d’étudier la violence comme une composante de la vie politique et non comme une « anormalité » ou une déviance[23]. Il résumait alors : « Prises collectivement, ces diverses explications projettent un éclairage fort révélateur sur cette période de la Révolution tranquille. Elles ne nous révèlent cependant pas l’ensemble du phénomène. La violence, ce n’est pas seulement une question de causes et d’effets, de frustrations et de déterminisme social, c’est aussi une question de choix politiques, une question d’idéologies[24]. »
Nous rajouterons que c’est aussi une question de parcours militant, de socialisation politique, de circulation d’idées, de rencontres, de capacité à initier ou non des relais auprès des institutions ou encore de savoirs pratiques et organisationnels. La difficulté de l’étude de ces multiples composantes réside dans la complexité de l’organisation elle-même, de ses différentes mutations, du nombre relativement étendu de ses militants sur une période longue et surtout de la dimension secrète des activités de la violence politique.
Du côté des CCC, il n’y a pas eu d’analyse scientifique précoce. Le champ a alors été laissé aux témoignages des acteurs des différents camps. Mais, elles peuvent faire l’objet d’une étude plus fine, précisément parce que l’organisation était bien plus réduite et a connu une activité très courte en comparaison du FLQ. Néanmoins, le problème du secret demeure et le parcours de quelques militants connus ne permet pas de suivre l’évolution de l’ensemble du groupe. Leur analyse donne cependant des pistes pour envisager une étude plus étendue des organisations faisant usage de la violence politique.
En repartant du cas des CCC et en nous basant sur les propositions formulées par les chercheurs en termes de niveaux d’analyses et de processus de choix de la violence par les acteurs, il est possible de tracer des temps particuliers de l’engagement violent au niveau micro et de déterminer des ruptures différentes dans l’usage de la violence politique par rapport au FLQ.
Les CCC : lieux, temps et processus de l’engagement violent ; des pistes pour l’étude du FLQ ?
Cette seconde partie envisage trois moments spécifiques du processus de choix de la violence pour les CCC. Les différentes caractéristiques qu’ils mettent en avant et les pistes qu’ils suggèrent sont partiellement transposables pour l’étude du FLQ, comme nous le montrerons en conclusion.
Le temps de l’action légale
Nous pouvons identifier plusieurs temps marquant le processus d’engagement violent des CCC. Le premier est celui de la socialisation politique au sein des comités de soutien à la Rote Armee Fraktion. Il court approximativement, selon les différents militants, entre 1975 et 1979. Il s’agit tout d’abord d’une « école » militante, celle qui va participer à la politisation des membres et à leur meilleure compréhension des enjeux nationaux comme internationaux. Dans cette socialisation, les militants sont directement touchés par une dimension importante qui influence leur trajectoire future : ils s’opposent aux pratiques liberticides d’un État démocratique, à savoir à la manière dont l’État fédéral allemand traite les prisonniers politiques[25]. Ce problème se cristallise avec le mouvement en faveur de l’avocat des membres de la RAF, Klaus Croissant[26]. Le militantisme de la seconde moitié des années 1970 est donc marqué par des mouvements sociaux qui luttent directement dans un climat de dénonciation du « terrorisme d’État ». Bertrand Sassoye, militant des Cellules, va jusqu’à dire : « L’influence de la RAF a bien sûr été déterminante. C’est l’action de la RAF qui nous a convaincu, nous et bien d’autres, de la légitimité et de l’opportunité de la lutte armée en Europe[27]. »
L’influence est fondamentale, mais entre la conviction de la légitimité et le passage à l’action violente, le processus se fait par étapes. Sassoye le reconnaît d’ailleurs : « ce serait forcer le trait que d’y voir [dans les comités de soutien à la RAF] la matrice des Cellules[28] ». Ce serait gommer un processus long. Les membres des CCC sont déjà militants à la fin des années 1970. L’engagement violent sera pourtant bien plus tardif.
Ce mouvement sert par ailleurs de premier moment de socialisation. Les militants vivent leurs premières manifestations violentes, et les confrontations avec la police et la gendarmerie, les premières actions illégales sont également opérées avec les jets de cocktails Molotov. Certains membres des futures CCC sont d’ailleurs arrêtés à l’époque lors de manifestations pacifiques. Ainsi, Carette est déjà bien connu des services de police. Il a déjà été perquisitionné et arrêté pour des actions de soutien aux prisonniers politiques allemands[29]. Bertrand Sassoye est quant à lui arrêté deux fois en 1979, alors qu’il n’a que 16 ans : lors de manifestations du Mouvement ouvrier chrétien contre la crise économique et dans une manifestation contre l’OTAN[30].
Si la lutte ne s’apparente pas à ce que réaliseront les Cellules par la suite, ces premières années constituent une première forme de socialisation où la violence, même fort modérée, n’est pas absente. Les militants se construisent donc avec cet élément. Ils sont par ailleurs arrêtés lors de leurs actions et confrontés à la police. Et l’impression d’inefficacité des actions, même quelque peu illégales, laisse un goût amer à ceux qui espèrent un renversement brutal de l’ordre établi. Un certain empressement voit le jour au sein de ces militants du fait que Pierre Carette a expliqué s’être rendu compte que les manifestations pacifiques ne pouvaient être efficaces. Voici comment il décrit ces premières années :
Comme de nombreux jeunes militants, mes premières expériences ont eu lieu dans le cadre réformiste, légaliste. J’ai participé à des luttes contre les agressions impérialistes dans les pays du Tiers-Monde, j’ai participé à des luttes de solidarité avec les luttes ouvrières. […] Et puis [j’ai été amené] à préciser la réflexion politique. Je me suis dit comme beaucoup d’autres militants : mais cette lutte dans ses limites, le réformisme, le légalisme, tout cela ne mène nulle part : si on a vraiment l’intention, la volonté de travailler et d’oeuvrer pour une révolution, il faut étudier l’histoire, il faut étudier les lois de l’histoire, il faut étudier les expériences passées et sur cette base-là, faire des choix, progresser[31].
Ce discours bétonné idéologiquement cache une certaine frustration individuelle du peu d’avancées des mouvements sociaux à l’époque. En effet, si la seconde moitié des années 1970 et le début des années 1980 sont marqués par des luttes ouvrières renouvelées, ainsi que par de puissantes mobilisations contre l’installation de missiles américains en Europe, le bilan de ces actions demeure faible, puisque les luttes ouvrières sont avant tout défensives et les manifestations monstres contre les missiles ne font pas reculer le gouvernement.
Deux critères ressortent alors de ce premier temps : tout d’abord, le constat d’une impatience face à l’insuffisance des luttes non violentes ; ensuite, et sur le plan international, l’idée que les groupes qui ont fait le choix de la violence politique subissent une répression totale. Il faut savoir qu’à l’époque, quelqu’un comme Klaus Croissant est défendu par des noms aussi brillants que Jean-Paul Sartre, Félix Guattari, Gilles Deleuze ou encore Michel Foucault. Ces deux éléments de la réalité concrète sont potentiellement assimilables à la théorie marxiste-léniniste, que les CCC défendent. Ainsi, en se basant d’une part sur la faiblesse (et même l’inutilité, voire la nuisance) du réformisme, et d’autre part sur l’existence réelle de luttes armées ailleurs en Europe et leur répression par le pouvoir, les militants peuvent arriver à la conclusion idéologique que l’heure de la lutte armée révolutionnaire est venue, pratiquant par là une lecture littérale de certains des textes marxistes et léninistes : actions violentes et répression devant progressivement conduire à une fracture binaire de la réalité sociale, désormais divisée en prolétaires révoltés unis face aux bourgeois répressifs. En fait, ce n’est pas tant une frustration d’ordre économique qu’une frustration politique qui peut marquer les militants : face à un horizon bouché, le choix de la violence peut apparaître comme la seule option opérationnelle.
Tous les militants marxistes-léninistes ne font toutefois pas le choix de la violence. Pour que ce basculement puisse s’opérer, d’autres éléments doivent intervenir. Cela nous conduit au second temps du processus de basculement dans la violence.
Le temps de la socialisation révolutionnaire
Le second temps est marqué par deux éléments centraux. Il peut être daté approximativement entre 1980 et 1983. C’est l’époque de l’élargissement du réseau militant et des connaissances théoriques, dans un climat politique qui change également. À partir de 1979, ce n’est plus seulement la RAF qui attire les futurs militants, mais les attentats menés par un autre groupe, Action directe (AD), en France. C’est ainsi que le contact avec l’un des leaders de ce groupe, Frédéric Oriach, va participer à développer plus en avant la conscientisation politique et l’engagement militant. Sassoye le reconnaît : « Une importante correspondance s’est établie, essentiellement entre Pierre Carette et Frédéric Oriach. C’est avec Frédéric Oriach, qui a été un grand théoricien révolutionnaire, que nous avons vraiment pris conscience en Belgique des limites de la ligne ultra-internationaliste de la RAF[32]. »
Mais, il est un autre élément qui contribue grandement à cette sociabilité militante. Si les contacts avec Action directe sont importants, leur accorder une place prépondérante serait une erreur qui consisterait à valider l’idée que l’engagement s’est fait uniquement par choix purement idéologiques. Or, la théorie révolutionnaire propagée par Oriach a certes exercé une influence évidente sur les futures CCC, mais ne suffit pas à faire comprendre leur engagement. Par ailleurs, les divergences idéologiques avec Action directe ont bel et bien existé, et les CCC ont développé leurs propres conceptions de la lutte. Ramener le passage à la lutte armée à une conséquence mécanique des contacts avec Oriach serait donc extrêmement réducteur.
Pour aller plus loin, il faut se pencher sur un lieu particulier : le numéro 65 de la rue d’Albanie dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles. En 1981, Pierre Carette y installe son imprimerie, les « Ateliers Graphiques », avec Didier Chevolet. Bertrand Sassoye et Pascale Vandegeerde s’y retrouvent aussi. La maison fait également office de « maison communautaire ». C’est ici que les liens entre les quatre futurs auteurs des attentats vont s’affermir. Il est clair que le lieu sert également d’espace de socialisation politique pour un nombre de militants qui, s’ils ne participent pas nécessairement aux actions violentes, gravitent autour des CCC ou participent aux actions de propagande, notamment à la revue Ligne rouge[33]. La correspondance des CCC le prouve : plusieurs personnes leur écrivent lorsqu’elles sont en prison pour se rappeler à leur souvenir, évoquant l’époque de la rue d’Albanie. Cette maison communautaire, où se retrouvent à la fois de jeunes travailleurs, des chômeurs ou des militants, constitue en vérité une photographie de la marginalisation dans laquelle le climat politico-économique plonge certains jeunes en Belgique, où le néolibéralisme commence à s’implanter. Le chômage bat des records et plusieurs manifestations de jeunes chômeurs débordent dans la violence sur fond de diffusion du mouvement punk et anarchiste : l’ambiance est à la révolte face au système qui, pour certains, offre peu, voire aucune, perspective. La description de cette maison communautaire, rédigée par un membre des CCC, est parlante de ce point de vue :
Il faut dire qu’il y avait de l’ambiance, car tout ça se faisait au sous-sol et au rez-de-chaussée de la maison communautaire de deux étages, où il est passé une foule de gens ! Au début, nous étions cinq « artistes babas-cool », puis nous avons été jusqu’à 8 permanents, mais il y avait toujours 10 à 15 personnes dans la maison ! De toutes les sortes, du militant politique au traîne-savate paumé (sic), de l’apprentie « star hystérique » à l’éducatrice pour handicapé, etc. Une vraie petite société multipersonnalités très vivante. Et même s’il m’arrivait trop souvent de travailler 14 h d’affilée, dans une ambiance un peu dingue, c’est un des meilleurs moments de ma vie[34] !
Le fait est que le lieu sert de pôle d’attraction à toute une série de jeunes chômeurs qui refusent les conditions de plus en plus difficiles qui leur sont imposées. Ainsi, faire preuve d’une activité dans une association sans but lucratif (ASBL) leur permet d’être dispensés du pointage au bureau de l’Office National de l’Emploi (ONEM) et donc de toucher leurs allocations de chômage. Servant ainsi de « refuge » à ces jeunes en opposition avec les logiques du marché du travail, les directeurs des ateliers graphiques signeront ce genre de papiers pour ceux qui gravitent dans la maison communautaire. Plusieurs dépositions en témoignent[35] : les militants proposent cette solution à leurs connaissances et amis. Par son fonctionnement même, la maison communautaire détourne les lois et les règles du marché du travail capitaliste en reconnaissant le travail des chômeurs-bénévoles, en leur permettant de vivre des allocations de chômage tout en pratiquant une activité non salariée, mais rémunérée.
Du point de vue sociologique et biographique, les quatre membres connus des CCC présentent tous une forme de marginalité relative, reflets de la société en crise qu’ils rejettent : Pierre Carette fut imprimeur militant après des études artistiques à l’Institut Saint-Luc entamées à la suite de ses échecs lors de ses humanités. C’est également de Saint-Luc que sort Didier Chevolet, en 1978, avant d’enchaîner les petits boulots et le chômage. Quant à Bertrand Sassoye, il quitte l’école secondaire à partir de la quatrième année (à 16 ans), avant de faire un petit boulot, de réaliser son service militaire et de déserter. Pascale Vandegeerde a quant à elle effectué plusieurs essais d’études (en médecine, en langues et littératures romanes, en ergothérapie) qu’elle abandonne. Tous sont issus des classes moyennes, étant fils ou fille de bouquiniste, directeur d’école, instituteurs, conseillère CPMS, fonctionnaire à l’office des étrangers. Seul un des membres possède un père directeur de société et une mère au foyer[36].
La maison de la rue d’Albanie va donc être un lieu de rencontres et de discussions politiques où ceux qui sont présents ne sont pas obligés d’adhérer aux prises de position les plus radicales des futures CCC. Il s’agit d’un moment de développement de la formation militante et de la possibilité d’élargir le cercle de militants potentiels, alors que s’opère la radicalisation au contact des membres d’Action directe et de Frédéric Oriach. À l’imprimerie, les textes de différents groupes révolutionnaires européens sont traduits, imprimés et diffusés.
Par ailleurs, au mitan des années 70, certains amis de Pierre Carette qui militent à gauche fréquentent également d’autres militants politiques et les milieux anarchistes. Beaucoup de témoins évoqueront les passages multiples dans le lieu, ainsi l’un d’entre eux parle « d’un défilé constant de personnes » alors que le père (conservateur) d’un des futurs membres des CCC décrit la maison en ces termes, révélant bien à quel point ces modes de vie sont inconcevables aux yeux d’un bourgeois :
Je suis allé un jour rue d’Albanie pour faire imprimer les faire-part de mariage de mon fils aîné. J’ai été épouvanté par ce milieu misérabiliste. Il y avait là des jeunes gens de différentes races et nationalités qui vivaient en communauté. X nous a reçus très naturellement dans une cuisine tout à fait sommaire. Un peu plus tard X est venu me trouver au bureau pour me demander conseil au sujet de la comptabilité de l’imprimerie, comptabilité qui me paraissait tout à fait inexistante[37].
Deux éléments convergent donc dans ce second temps : la pratique idéologique au contact de Frédéric Oriach et de Pierre Carette, où les lectures et les échanges épistolaires intensifient la connaissance du marxisme-léninisme au sein des futures CCC ; la diffusion de ces connaissances et de ces textes dans le petit milieu de la rue d’Albanie, qui sert en fait de lieu « d’incubation » de ces idées. À ce stade, les militants se rendent compte de ceux qui, autour d’eux, sont réceptifs à leurs conceptions politiques ou, au contraire, qui les rejettent. Se créent alors les synergies nécessaires à la mise en place de l’organisation, avant le passage à la clandestinité pour certains et, pour d’autres, la perpétuation de l’animation militante légale, à travers le travail d’impression et de diffusion de la revue Ligne rouge, qui reproduit entre autres les revendications des Cellules.
Le troisième temps : la clandestinité
Le troisième temps de ce glissement vers le choix de la lutte armée se fait dans le passage à la clandestinité qui s’impose avant même de commencer les actions violentes. Par exemple, pour Pierre Carette, il est nécessaire de devenir clandestin, celui-ci étant connu depuis de nombreuses années par les services de police. Les passages dans la clandestinité ne se font pas en bloc, Pascale Vandegeerde et Didier Chevolet étant par exemple toujours des militants « légaux » au moment de l’opération de police « Mammouth[38] » (le 19 octobre 1984), où ils sont d’ailleurs perquisitionnés : la police ne parvient pas encore à établir les liens exacts qu’ils ont avec les cellules. Ce passage à la clandestinité a toutefois été réfléchi et préparé : Bertrand Sassoye le choisit dès février 1982, soit deux ans avant les premières actions violentes des CCC. Pascale Vandegeerde et Didier Chevolet passent seulement à la clandestinité en septembre 1985, soit trois mois avant l’arrestation des quatre membres. Quant à Carette, il ne passe dans la clandestinité qu’en juin 1984, soit quelques mois avant le premier attentat des CCC, qui a lieu le 2 octobre 1984. Ces différents temps de la clandestinité révèlent à la fois la préparation anticipée de la lutte de guérilla (Sassoye), mais aussi les tentations et la nécessité d’élargir le nombre de militants clandestins (Vandegeerde et Chevolet). Ils invitent à analyser l’évolution de l’organisation et de ses besoins matériels, logistiques et humains, et témoignent de sociabilités politiques changeantes : en effet, la clandestinité demande de réorganiser complètement son existence, de limiter ses fréquentations, de réfléchir à l’ensemble de ses mouvements, la vie du militant se résumant alors au projet que le militant lui a assigné : la lutte révolutionnaire.
Dans cette perspective, sur la question de la lutte violente, il devient très difficile de ne pas poursuivre dans cette voie, même lorsque les événements sortent du cadre prévu. Ainsi, l’attentat de la FEB dans lequel deux pompiers trouvent la mort désarçonne effectivement et réellement les CCC. La juge d’instruction le reconnaît d’ailleurs explicitement[39]. Tuer deux travailleurs à l’occasion du 1er mai va tout à fait à l’encontre de l’objectif, à savoir une action de propagande contre la fédération des entreprises. Si l’attentat fait débat et que des mesures de sécurité supplémentaires sont prises pour les futures actions, le choix de la violence n’est aucunement remis en question et non pas uniquement parce que son usage serait « théoriquement » ou « idéologiquement » juste[40], mais également parce que, pour les militants ayant fait cette entrée dans l’action clandestine et violente, le retour en arrière paraît parsemé d’embûches, pour ne pas dire irréel.
Pour les militants légaux, la frontière que constitue la clandestinité apparaît comme un passage supplémentaire vers l’étape militante. Les clandestins estiment alors être au coeur de l’organisation et participer aux activités les plus fondamentales. Pour Vandegeerde et Chevolet, qui entrent plus tard dans la clandestinité, nul doute que ce passage a constitué une évolution militante visant à les faire entrer pleinement dans l’organisation, à en être enfin des éléments moteurs et même à ne plus faire qu’un avec elle. En effet, les quatre CCC arrêtés ont toujours parlé collectivement, au nom de l’organisation, et refusent de faire part de considérations personnelles : pour pouvoir abandonner cette individualité et être accepté comme membre à part entière du collectif, il est clair que l’usage de la violence est une composante fondamentale, d’autant plus que cette situation correspond à l’idéologie des cercles concentriques de l’organisation, où le noyau clandestin est au centre et que les cercles les plus proches fournissent les relais, l’aide, la logistique, la propagande, etc., dans un roulement qui vise à intégrer petit à petit la périphérie vers le centre afin de renouveler l’organisation. Au sein même des CCC, on attribue à la lutte armée cette place presque iconique. Nous pourrions parler de fierté démesurée des actions armées, au point même de dénigrer les activités légales des proches de l’organisation, comme le fait Pierre Carette :
Les Cellules comprennent très bien l’importance d’organiser des structures légales sous la direction politique de l’Organisation (c’est le débat qu’il y avait sur la table lors de nos arrestations : l’écart entre la qualité offensive de la guérilla et l’atrophie tant qualitative que quantitative de « relais aux masses » doit urgemment et impérativement être réduit, il s’impose de réorienter toutes les forces politiques de l’Organisation à la construction de structures d’agitation légales), mais c’est seulement à partir de la rencontre avec Didier et Pascale que nous avons pris conscience de la dégénérescence totale de Ligne rouge alors que nous imaginions que ce genre de structure se placerait autonomement (sic) et spontanément sous notre direction politique. […] Le collectif LR n’est plus qu’une compilation anarchique et familiale d’individus louches, d’aventuriers, de petits-bourgeois en mal d’exotisme… mais aussi certainement quelques jeunes militants qu’il est plus que grand temps de sortir de cette triste saga[41].
Les archives du service de renseignement belge révèlent la complexité du lien entretenu, au sein de l’organisation, entre les militants aux pratiques légales et les militants clandestins aux actions violentes. Ainsi, Didier Chevolet et Pascale Vandegeerde, en tant que collaborateurs à la revue Ligne rouge, sont pris en filature, espionnés, et leurs rencontres sont relevées au moins dès le mois de janvier 1985. Différents réseaux militants sont mis à jour et espionnés par la Sûreté de l’État, qui dresse une liste de 64 personnes dont les noms reviennent dans l’enquête, souvent parce qu’elles ont été en contact avec des militants. Pourtant, malgré un espionnage assez précis des réseaux légaux, les policiers admettent (nous sommes alors au moins à la mi-mars 1985) que « les derniers développements de l’enquête Sûreté de l’État sur les CCC n’ont pas permis de désigner avec certitude un membre des CCC[42] ». Mais plus intéressant encore, la police ne connaît toujours pas, six mois après les premiers attentats, le fonctionnement et la coordination entre la structure légale et la structure clandestine. Elle est alors réduite aux hypothèses non exclusives : 1) au moins une des personnes « légales » est en contact avec les clandestins (au su ou non des autres membres) ; 2) s’il n’y a pas de contacts à l’origine, au moins une des personnes tente d’en établir ; 3) au moins un membre des CCC est présent dans le réseau légal, au su ou non des autres membres[43]. Ce dont témoigne l’enquête à ce stade, c’est de la capacité des CCC à avoir organisé un réseau clandestin fonctionnant efficacement et suffisamment discrètement pour empêcher l’infiltration immédiate, malgré les tentatives.
Cette situation d’une clandestinité rondement menée explique en partie l’ambivalence du groupe militant : les clandestins, qui sont ceux qui prennent le plus de risques, sont aussi ceux qui mènent les actions et en cueillent la « gloire » symbolique auprès des militants. Cet écart est susceptible de générer orgueil et frustration, précisément quand la structure légale, avec laquelle il est difficile de construire des liens très solides étant donné la surveillance policière, déçoit. C’est toute la difficulté des structures d’extrême gauche, dont une partie des activités ou des relais restent dans la légalité : celle-ci demeure nécessaire pour diffuser la propagande, « expliquer » et justifier les actions tout en étant à la fois une porte d’entrée pour la police et un risque encouru pour l’organisation. Les clandestins, par leur statut même, peinent à garder le contrôle sur les activités légales : d’où des critiques, voire des déchirements, au sein même des militants[44]. Le choix de la violence se fait aussi dans ces interstices complexes : passer dans la clandestinité, c’est se donner pleinement à l’organisation, les tensions avec les militants « légaux » révèlent en creux les doutes, voire la peur de certains de passer effectivement à l’action violente. Vandegeerde et Chevolet franchiront ce pas, alors même qu’ils sont déjà suspects. Un long processus les y a conduits. Pour en sortir, il faut envisager un processus presque aussi complexe.
Conclusion
Ces trois temps ont sans doute également déterminé le FLQ, qui gagnerait à être étudié dans cette perspective. Entre l’organisation du début des années 1960, qui prône avant tout l’indépendantisme et dans laquelle le marxisme ne joue pas de rôle déterminant, et la rupture engendrée notamment par Vallières et Gagnon, il existe un processus complexe où l’impatience devant les grands bouleversements internationaux a joué un rôle. Le second temps est celui où l’exercice révolutionnaire sert également d’exemple : l’emprisonnement de Vallières et de Gagnon donne à leur cause les galons de « révolutionnaires authentiques » persécutés par le pouvoir. Par ailleurs, comme pour les CCC, une série de « lieux de rencontre » ont déjà été cités et identifiés dans différents travaux et gagneraient à être étudiés comme la rue d’Albanie, c’est-à-dire comme des espaces de sociabilité qui jouent un rôle dans le processus de choix de la violence. La troisième phase peut être envisagée comme celle marquée par un repli très fort sur les activités clandestines : l’organisation est construite en différentes cellules de plus en plus traquées, et les pratiques secrètes doivent se développer. Une certaine paranoïa gagne tant les militants que le pouvoir et l’escalade violente s’intensifie.
Si nous y retrouvons des temporalités similaires, les événements, par rapport aux CCC, sont cependant distincts. En effet, le choc de la crise d’Octobre a créé un clivage net de la société québécoise avec une condamnation du terrorisme du côté du gouvernement et, de l’autre, l’idée que les mesures prises, malgré la gravité de la situation, restaient totalement disproportionnées. Le terrorisme du FLQ se condense au moment de la crise d’Octobre, mais sa répression par le pouvoir rend l’acceptation du terme non admis pour des générations suivantes.
Il en est tout autrement en Belgique où, durant les premiers attentats, la logique terroriste ne parvient pas réellement à s’imposer au regard de la faible intensité des actions. Le gouvernement piétine et passe pour inefficace, notamment à la suite de l’échec de l’opération « Mammouth ». Les CCC ne faisant pas de victimes humaines, la qualification de leurs actions comme relevant du terrorisme fonctionne mal, d’autant plus lorsqu’elles sont comparées aux crimes ultra-violents des tueurs du Brabant[45]. Néanmoins, la situation bascule avec l’attentat du 1er mai 1985, qui coûte la vie à deux pompiers. L’organisation ayant tué, le gouvernement insiste sur sa dangerosité. L’arrestation des militants quelques mois plus tard dans une situation où les libertés n’ont pas été restreintes lui permet de construire un discours de « victoire » contre le terrorisme, sur lequel on peut tourner la page. Le refus des militants de collaborer et même de répondre aux questions lors des procès des CCC permettront aux discours médiatiques et politiques de dominer : le concept de terrorisme, utilisé pour qualifier leurs actions, finit par s’imposer.
Revenons à notre point de départ. Deux organisations distinctes donnent l’exemple de deux lectures mémorielles distinctes de la violence politique. Pour le FLQ, une tension idéologique persistante entre des camps particulièrement clivés semble empêcher les chercheurs de faire preuve de la distance nécessaire à conduire une recherche qui ne verserait pas excessivement dans la prise de position contre tel ou tel camp. En ce qui concerne la mémoire des CCC, la défaite complète du communisme, et spécifiquement de sa tendance marxiste-léniniste révolutionnaire, a rendu le débat clos : c’est comme si tout cela n’avait été qu’un mauvais épisode de l’histoire de Belgique dont personne ne semble plus se soucier, comme s’il n’était pas nécessaire de faire l’histoire de ce fantôme que constitue la lutte armée.
Or, nous faisons l’hypothèse que ce spectre hante toujours l’Europe. Refuser d’envisager le contexte, les étapes, les sociabilités et la matérialité de l’engagement militant violent contribue justement à reléguer la violence dans une « anormalité », à en faire l’extrême opposé de la pratique politique démocratique. Pourtant, il s’agit là d’une véritable lutte de pouvoir : celle de la définition imposée – ou non – de ce qu’on considère être la politique. En rejetant ainsi la violence dans la sphère de l’irrationnel, de l’insensé, voire du « démoniaque », les États imposent une certaine idée de la manière dont la politique démocratique doit être conduite : par le parlementarisme uniquement. Ce dernier ne va pourtant pas de soi ; il demeure le fruit d’un processus historique particulier porté par la bourgeoisie du XIXe siècle. En cela, il est loin de constituer la forme pure de la « politique ». L’affirmation de son lien consubstantiel avec la « démocratie » constitue pour ses défenseurs un enjeu fondamental d’affirmation de leur pouvoir et de leur rôle autant incontournable qu’essentiel. Nous pourrions dire qu’elle est un enjeu de lutte de classes et que, sur ce point, la bourgeoisie européenne a réussi – pour un certain temps – à faire triompher sa conception. Les remous actuels, liés entre autres à la pandémie, révèlent que ce triomphe n’est pas complet : si peu de gens n’opposent pas encore au parlementarisme une autre forme de pratique politique démocratique, nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas dans celui-ci le principe de réalisation de la démocratie. En Europe, la révolte des Gilets jaunes aura eu pour mérite d’en témoigner. La violence politique des années 1970 et 1980, qu’on la juge condamnable ou non, en était un autre exemple. Étudier le terrorisme comme une de ses « séquences » particulières permet d’envisager concrètement comment prennent corps ce rapport de force et cette tension politique : autour d’Octobre 1970 pour le FLQ et autour du 1er mai 1985 pour les CCC.
Au Québec, cette tension apparaît sans doute avec une netteté plus frappante au vu de la double domination que les Québécois indépendantistes ont souvent dénoncée : celle du colonialisme et celle du capitalisme. Ce refus de voir dans la pratique parlementaire telle que l’a investie le PQ l’unique option démocratique s’illustre par un épisode marquant qui a été mis en avant par le récent film de Félix Rose : l’ovation reçue par l’arrivée de Jacques Rose au congrès du PQ de 1981, devant un René Lévesque médusé et abasourdi qui menace de démissionner[46]. Plus de dix ans après les faits, le débat face à cette violence politique passée n’est pas tranché. Pour de nombreux militants, elle est loin d’être « hors de la politique ». Il semble que ce soit toujours le cas 50 ans plus tard. Prenons un exemple sous un autre angle : un journaliste du Nouvelliste s’inquiète de la scène du film et constate que « hier comme aujourd’hui les voies choisies pour tenter d’émanciper les nôtres diffèrent[47] ». Un de ses confrères du Journal de Québec, dans un article au titre évocateur (« Le démocrate et le terroriste ») relève également cette scène et s’alarme même d’une jeunesse actuelle touchée par « la montée du radicalisme politique » et de « la violence avec laquelle ils [les jeunes] condamnent tous ceux qui ne pensent pas comme eux sur les médias sociaux ». Il va même jusqu’à affirmer qu’il a tendance à croire « qu’une bonne partie de la jeunesse est en train de succomber aux sirènes de la révolution armée[48] ». Malgré l’aberration d’un tel rapprochement, nous pensons que le journaliste n’est pas stupide, mais entend imposer une vision contre une autre. Par là, il participe à la lutte selon nous jamais terminée de l’imposition de la conception bourgeoise de la pratique politique démocratique.
Nous avons tenté, par l’intermédiaire des exemples exposés plus haut, de montrer que nous gagnons à interroger cette violence dans ce qu’elle a de processuel et de réfléchi, de contingent et d’instrumental autant que dans les liens qu’elle entretient avec une situation politique donnée. Loin d’être le fruit du hasard, seules des analyses de ses conditions de formation et d’utilisation, de son intensité matérielle, de ses cibles et des effets répressifs qu’elle engendre permettent d’éviter les condamnations idéologiques, qui n’apprennent rien et qui figent les deux camps dans des positions finalement dogmatiques. Une dernière remarque doit encore être proposée : les chercheurs actuels, par la mise en avant de processus complexes, ont peut-être tendance à reléguer quelque peu la dimension idéologique, devenue presque secondaire. Nous avons suivi cette piste tout en tentant de laisser à l’idéologie la place qui lui revient. Car si la violence est le fruit d’un processus, il est clair que l’adhésion complète à une théorie politique aussi réfléchie, retravaillée et polémiquée que le marxisme (et surtout le marxisme-léninisme) joue un rôle évident dans les décisions de rupture des militants. Bien entendu, l’idéologie n’explique pas à elle seule la violence politique, mais la réduire à un prétexte revient à ne pas comprendre comment un individu peut se livrer tout entier à une cause qu’il croit juste, qu’elle soit celle de l’indépendance ou celle du socialisme. Car l’idéologie n’est jamais, pour les militants du FLQ comme pour ceux des CCC, que l’incarnation de l’espoir toujours recommencé de la possibilité de changer radicalement la face du monde.
Appendices
Notes
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[1]
Elie Teicher, Conversation d’Elie Teicher avec D. T., Trois-Rivières, octobre 2021.
-
[2]
Entre 1984 et 1985, les Cellules communistes combattantes sont à l’origine d’une vingtaine d’attentats en Belgique. D’obédience marxiste-léniniste, le groupe, qui possède des liens avec l’organisation Action directe en France ainsi qu’avec la Rote Armee Fraktion en Allemagne, entend réaliser des actions de « propagande armée » afin de réaffirmer la lutte des classes en Belgique et d’amorcer, à plus long terme, un processus de guerre révolutionnaire. Il cible alors les intérêts de « l’impérialisme américain » (les pipelines de l’OTAN, les firmes américaines productrices de matériel militaire), mais également la finance et les symboles du capitalisme (les banques, les sociétés multinationales) ainsi que les organisations politiques jugées coupables de l’austérité budgétaire et de la politique néolibérale. Alors que les attentats des CCC entendent faire des dégâts matériels et ne visent jamais directement des personnes, leur action du 1er mai 1985, qui consiste à faire sauter une charge devant le siège du patronat (la Fédération des entreprises de Belgique), engendre la mort de deux pompiers appelés sur place. L’événement crée un vif émoi, et l’organisation elle-même accentue les mesures de « sécurité » lors de ses attentats afin d’éviter de nouvelles victimes. En décembre 1985, quatre membres des CCC sont finalement arrêtés par la police après une traque qui durait depuis plus de deux ans : c’est la fin de l’organisation, et les quatre inculpés sont condamnés à des peines allant de 14 à 17 ans de prison.
-
[3]
À l’époque, pourtant, le climat d’anxiété qui se développait en Belgique face à la recrudescence de la violence, dans un contexte d’attentats politiques, mais aussi de tueries dans des supermarchés par un groupe de braqueurs, avait déjà invité certains observateurs à relativiser l’usage de la notion de « terrorisme ». Ainsi, le journaliste Théo Hachez estimait à propos des CCC : « Au sens strict, seuls des événements de type tuerie dans les supermarchés peuvent être qualifiés de terroristes par les poussées irrationnelles auxquelles ils donnent lieu. En ce qui concerne les CCC, on a plutôt affaire, jusqu’à présent, à des sabotages quelque peu démonstratifs. » Théo Hachez, « La nouvelle violence », La Revue nouvelle, n° 1,1986, p. 56.
-
[4]
Pour une analyse qui montre les similitudes de contexte, mais également les références communes de la RAF et du FLQ, voir Frauke Brammer, « Legs d’automne : le terrorisme des années 1970 au Canada et en Allemagne de l’Ouest », dans Ivan Carel, Robert Comeau et Jean-Philippe Warren (dir.), Violences politiques : Europe et Amériques (1960-1979), Montréal, Lux, 2013, p. 193-220. Brammer rappelle la centralité prise par la problématique du terrorisme dans les crises de ce que certains chercheurs appellent désormais « la longue décennie 1970 ». Il a ainsi identifié des points communs entre les mouvements québécois et allemands, qui partageaient entre autres l’influence des guerres de décolonisation, la lutte anti-impérialiste de pays en voie de développement et l’appropriation locale de l’usage de la violence à des fins politiques.
-
[5]
Harold Nieberg, Political Violence. The Behavioral Process, New York, St. Marin’s Press, 1969, p. 13.
-
[6]
Pierre-Alain Clément, « Le terrorisme est une violence politique comme les autres : vers une normalisation typologique du terrorisme », Études internationales, vol. 45, n° 3, p. 355-378.
-
[7]
Philippe Côté-Martine, « L’historiographie québécoise et le terrorisme : une historicité à définir pour un objet encore fuyant », Bulletin d’histoire politique, vol. 35, nos 2-3, 2013, p. 136-137.
-
[8]
Isabelle Sommier, « Engagement radical, désengagement et déradicalisation. Continuum et lignes de fracture », Lien social et politiques, n° 68, automne 2012, p. 15-35 ; Isabelle Sommier, Xavier Crettiez et François Audigier, Les violences politiques en France de 1986 à nos jours, Paris, Presses de Sciences Po, 2021.
-
[9]
Els Witte, Alain Meyen et Dirk Luyten, Histoire politique de la Belgique de 1830 à nos jours, Bruxelles, Samsa, 2017 ; Martin Pâquet et Stéphane Savard, Brève histoire de la Révolution tranquille, Montréal, Boréal, 2021, p. 170-177 ; Paul-André Linteau, René Durocher, Jean-Claude Robert et François Ricard, Histoire du Québec contemporain. Tome II : le Québec depuis 1930, Montréal, Boréal, 1989, p. 421-426 ; Éric Bédard, Chronique d’une insurrection appréhendée : jeunesse et crise d’Octobre, nouvelle édition revue, Québec, Septentrion, 2020.
-
[10]
Éric Bédard a effectué cette analyse dans le mouvement étudiant et a bien montré qu’on est loin d’être au bord d’une insurrection de masse préparée et organisée. Ce type d’étude doit être mené auprès des militants du FLQ eux-mêmes et des divers milieux d’où ils provenaient, au-delà du seul cadre étudiant. Parmi les exemples de témoignages qui demeurent téléologiques, il faut citer celui de William Tetley, qui estime qu’« en octobre 1970, tout laissait présager une insurrection appréhendée ». William Tetley, Octobre 1970 : dans les coulisses de la crise, Saint-Lambert, Héritage, 2010, p. 113. Il est d’autant plus urgent de pratiquer une analyse du recours à la violence politique que les processus de choix répressifs effectués par l’État sont maintenant bien connus et que de nombreuses précisions ont été apportées par les témoignages et les travaux récents d’historiens. Contentons-nous de citer Michael Gauvreau, « Winning Back the Intellectuals : Inside Canada’s ‘First War on Terror’, 1968–1970 », Revue de la société historique du Canada, vol. 20, n° 1, 2009, p. 161-190. Des analyses du contexte des luttes de l’époque ont par ailleurs été menées et permettent d’interroger finement les forces en présence et l’influence de luttes proches de celles du FLQ. Citons les travaux de Sean Mills, The Empire Within : Postcolonial Thought and Political Activism in Sixties Montreal, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2010 ; Jean-Philippe Warren, Ils voulaient changer le monde : le militantisme marxiste-léniniste au Québec, Montréal, VLB, 2007 ; Bryan D. Palmer, Canada’s 1960s : The Ironies of Identity in a Rebellious Era, Toronto, University of Toronto Press, 2009. Le chapitre 9 du livre de Palmer, « Quebec : Revolution Now ! » (p. 311-365), contextualise la lutte du FLQ en n’évoquant pas uniquement la crise d’Octobre. Plusieurs dimensions des actions et des militants sont décrites, mais le cadre théorique reste malheureusement absent. Concernant Warren, il s’agit d’une analyse des groupes marxistes-léninistes, et on n’y retrouve pas le FLQ. Quant à Sean Mills, il s’agit avant tout d’une histoire des idées et de leur radicalisation plutôt que d’une enquête sur les organisations.
-
[11]
Pour s’en convaincre, la consultation de la bibliographie consacrée à la crise d’Octobre est très parlante : l’immense majorité des travaux l’étudie pour elle-même, sans interroger la place qu’elle occupe dans l’histoire plus large de la violence politique au Québec. The History of Rights, Bibliographie sur la crise d’octobre, historyofrights.ca.
-
[12]
D’Arcy Jenish, The Making of the October Crisis : Canada’s Long Nightmare of Terrorism at the Hands of the FLQ, Mississauga, Anchor Canada, 2020.
-
[13]
Selon nous, l’histoire la plus complète du FLQ, évoquée dans ses différentes étapes en fonction des années d’activité des militants, reste l’ouvrage de Louis Fournier. Celui-ci possède néanmoins une forte dimension journalistique, et Fournier apporte moult détails dans la description des actions et des événements, mais ne cherche pas à comprendre les processus de choix de la violence politique. Devant ces constats, il est étonnant de ne pas avoir vu les historiens québécois se saisir de données aussi riches pour les interroger. Louis Fournier, FLQ : Histoire d’un mouvement clandestin, Outremont, Lanctôt, 1998. Sur les réactions du gouvernement, voir Simon Tessier, Octobre de force : répression et état d’exception, Québec, Éditions du Québécois, 2012.
-
[14]
C’est le cas du tout récent Paul Ponsaers, Terrorisme in België : polarisering en politiek geweld, Turnhout, Gompel et Svacina, 2020. Les éléments présentés par Aurélien Dubuisson ne sont quant à eux pas toujours convaincants, à commencer par le manque de recul critique avec lequel il analyse l’autoconstruction historique que les organisations violentes mettent en avant. Aurélien Dubuisson, « La clandestinité au prisme du complot : l’exemple des Cellules Communistes Combattantes et d’Action directe (1979-1987) », dans Virgile Cirefice, Grégoire Le Quang et Charles Rionder (dir.), La part de l’ombre. Histoire de la clandestinité politique au XXe siècle, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019, p. 197-210.
-
[15]
Il existe également quelques mémoires d’étudiants à la valeur souvent inégale. Le dernier en date est celui d’Héloïse-Amalia Cautere, Les CCC des attentats au procès, Mémoire de maîtrise (histoire), Université libre de Bruxelles, 2020.
-
[16]
Guy Bouthiller et Édouard Cloutier (dir.), Trudeau et ses mesures de guerre vus du Canada anglais, Montréal, Septentrion, 2011 ; Bernard Dagenais, La crise d’Octobre et les médias : le miroir à dix faces, Montréal, VLB éditeur, 1990 ; Manon Leroux, Les silences d’octobre : le discours des acteurs de la crise de 1970, Montréal, VLB éditeur, 2002.
-
[17]
Il existe bien entendu des chercheurs qui se penchent sur certains aspects particuliers et qui ont fait avancer la recherche. Nous parlons ici d’études qui analyseraient l’organisation dans son ensemble, les recherches particulières constituant une source précieuse pour interroger le processus d’engagement violent de manière plus générale.
-
[18]
Preuve que cette histoire n’en finit pas d’opposer deux camps, les titres des ouvrages témoignent de ces querelles : « Révélations sur », « Pour en finir avec », « Les silences de… », « Ce qui s’est vraiment passé », etc. Récemment encore, le témoignage de Robert Comeau révélait cette ambiguïté par l’usage du déterminant possessif « Mon » : Robert Comeau avec Louis Gill, Mon octobre 70. La crise et ses suites, Montréal, VLB, 2020, 238 p.
-
[19]
Le constat suivant, posé par Daniel Latouche, reste d’une brûlante actualité : « Il faut reconnaître que la violence est l’une de ces formes d’action à propos desquelles on retrouve des attitudes très engagées, parfois même extrêmes. À ce titre, les oppositions entre les interprétations contraires qui circulent sur la violence politique ne sont que le reflet de ces conflits idéologiques qui déchirent le Québec et que la crise d’Octobre a fait ressortir avec une franchise brutale. » Daniel Latouche, « Violence et politique dans une révolution dite tranquille », dans Idem, Une société de l’ambiguïté : libération et récupération dans le Québec actuel, Montréal, Boréal, 1979, p. 70.
-
[20]
Marc Laurendeau, Les Québécois violents, la violence politique (1962-1972), Montréal, Boréal, 1990 ; Daniel Latouche, « Violence et politique… », loc. cit.
-
[21]
Hugh Davis Graham et Ted Robert Gurr, Violence in America : Historical and Comparative Perspectives, New York, The New American Library, 1969 ; James Chowning Davies, When Men Revolt and Why, New York, Free Press, 1971.
-
[22]
Parmi de nombreux travaux novateurs, citons Sidney Tarrow, Democracy and Disorder : Protest and Politics in Italy (1965–1975), Oxford, Oxford University Press, 1989.
-
[23]
Il semble qu’on peut appliquer parfaitement au FLQ cette remarque récente formulée par Sommier, Crettiez et Audigier, spécialistes de la violence politique : « Dans un contexte marqué par les attentats en Europe et au Moyen-Orient et, en conséquence, par une forte demande sociale et politique sur le sujet, [l’objet violence] finit par n’être abordé que sous le prisme du “terrorisme” dans une littérature hybride mêlant témoignages, récits journalistiques et analyses d’experts en tout genre, rarement universitaires, qui en font un phénomène exceptionnel, voire pathologique. » Isabelle Sommier, Xavier Crettiez et François Audigier, op. cit. C’est le grand mérite de l’ouvrage déjà cité d’Ivan Carel, Robert Comeau et Jean-Philippe Warren de proposer d’étudier la violence comme une composante de la vie politique.
-
[24]
Daniel Latouche, loc. cit., p. 89.
-
[25]
De ce point de vue, des études comparatives doivent encore être menées sur le FLQ, tant les « procès politiques » de plusieurs de ses membres ont également été des catalyseurs, et ont provoqué débats et mobilisations importantes.
-
[26]
Liora Israël, « Défendre le défenseur de l’ennemi public. L’affaire Croissant », Le Mouvement social, n° 240, mars 2012, p. 67-84. Klaus Croissant était l’avocat des militants de la première génération de la RAF et fut poursuivi par l’État allemand, qui l’accusait de complicité avec les terroristes. Réfugié en France, il y est tout de même arrêté, et un mouvement d’opposition se met en branle pour le faire libérer et refuser son extradition, qui a néanmoins lieu. Ce conflit dépasse le cadre français, et un mouvement naît en Belgique en faveur de Croissant, mais également de plusieurs autres prisonniers politiques de la RAF : divers comités de soutien voient le jour dans la seconde moitié des années 1970. Ces initiatives posent frontalement la question du droit à la défense et de la manière dont les États de droit mettent en oeuvre des méthodes répressives pour lutter contre le terrorisme.
-
[27]
Laboratoire Urbanisme insurrectionnel, Interview de Bertrand Sassoye, en ligne, laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com.
-
[28]
Ibid.
-
[29]
Par exemple, le 17 mars 1978, Pierre Carette et six de ses comparses du comité qu’il a fondé, le « Comité de soutien aux prisonniers politiques de la FAR », occupent l’ambassade des Pays-Bas à Bruxelles en soutien de la grève de la faim entamée par des militants de la FAR arrêtés aux Pays-Bas. L’imprimerie de Pierre Carette est perquisitionnée le lendemain. Jos Vander Velpen, Les CCC : l’État et le terrorisme, Berchem, EPO, 1988, p. 12.
-
[30]
Alain Guillaume, « La Belgique juge ses terroristes (VI) », Le Soir, 24 septembre 1988.
-
[31]
VRT, Nachtwacht met Pierre Carette, 20 septembre 2003, en ligne, youtube.com.
-
[32]
Laboratoire Urbanisme insurrectionnel, loc. cit.
-
[33]
Le collectif Ligne rouge, créé en 1983, va constituer la structure légale chargée de la propagande communiste à travers la publication d’une revue éponyme. Outre des textes du mouvement communiste international, la revue publiera les revendications des CCC après leurs attentats.
-
[34]
Seraing, Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES), CCC : dossier judiciaire, Correspondance des CCC, 13-14 septembre 1986.
-
[35]
Seraing, IHOES, CCC : dossier judiciaire, auditions diverses lors de l’enquête.
-
[36]
Alain Guillaume, loc. cit.
-
[37]
Seraing, IHOES, CCC, Instruction judiciaire, dépositions diverses.
-
[38]
L’opération Mammouth consiste en une forte opération de perquisitions et d’interrogatoires dans les milieux d’extrême gauche. En tout, 92 personnes seront perquisitionnées, et plusieurs seront interrogées. La police obtient pourtant peu de résultats concernant directement les CCC. L’opération déclenche d’ailleurs de vives protestations de la part des défenseurs des droits qui estiment que le pouvoir en a profité pour cibler très largement l’opposition de gauche sous prétexte de lutter contre le terrorisme.
-
[39]
Celle-ci explique : « C’est ce que j’ai dit devant la cour d’Assises : ils n’ont pas voulu tuer. Et comme je détournais leur correspondance, ils le savaient d’ailleurs, je lisais leur correspondance, ça me prenait tous mes weekends parce que Carette écrivait, écrivait, écrivait… Et j’étais très contente qu’on lui donne une machine à écrire parce qu’il avait une toute petite écriture… Et ils se sont mordu les poings de cet [attentat ?]. Ils ont dit notamment “mais c’était des travailleurs comme nous et nous n’avons pas voulu les tuer” ». Témoignage de Francyne Lyna, dans « La Croisade des CCC », documentaire RTBF, 43 min 30 s.
-
[40]
La question idéologique du choix de la violence n’explique en vérité pas ses degrés d’intensité. Ainsi, les CCC estiment « juste » l’usage de la violence, selon eux inhérente à l’histoire de la lutte des classes. Néanmoins, Sassoye reconnaît, lorsqu’on lui demande si les CCC avaient effectivement prévu l’enlèvement et l’assassinat du patron belge Albert Frère (comme les en accuse la police), que l’état de la lutte des classes et du rapport de force ne justifiait pas ce type d’action (« Le niveau du mouvement révolutionnaire en Belgique était trop bas pour assimiler une action pareille. »). RTL, Émission Reporter sur les Cellules Communistes Combattantes, 2e partie, 11 min 19 s. Ce type de réflexion oblige l’historien à questionner comment les militants mesurent ce « niveau » : en vérité, au-delà de l’idéologie justificatrice, toute une série de dimensions interviennent afin d’expliquer le recours à telle ou telle méthode. Il n’est en effet pas du tout pareil de jeter un cocktail Molotov sur la façade d’un bâtiment que d’assassiner un patron… Ces différents niveaux expliquent le commentaire cité plus haut de Théo Hachez, qui parle (avant l’attentat du 1er mai) de « sabotages ». L’intensité des actions elles-mêmes doit être questionnée, car elle reconfigure sans cesse la perception des uns et des autres : du danger perçu par les autorités, de l’organisation et de la sympathie qu’on peut éventuellement lui témoigner du côté de la population, d’où l’intérêt majeur, ciblé par les recherches récentes, pour la matérialité de la violence.
-
[41]
Jos Vander Velpen, op. cit., p. 29.
-
[42]
Une question demeure ici, qui est de savoir à quel point la Sûreté de l’État est « honnête » avec le ministre. En effet, les services de renseignement, qui visent à la plus grande efficacité et à la plus grande discrétion, ne dévoilent pas leurs pratiques ni l’entièreté de leurs connaissances afin de couvrir les agents et d’augmenter les chances de succès. Il n’est pas impossible qu’à ce stade, les militants aient été en vérité infiltrés (le document dit « et sa possible infiltration [du mouvement] »), mais, à partir de l’état actuel de la documentation, on peut supposer que le service de renseignement, même par l’infiltration, reste encore peu informé sur l’organisation et notamment sur sa dimension clandestine : en tous cas, son autorité politique en reste encore au stade de ne pas connaître grand-chose. L’infiltration du réseau s’est sans doute opérée par l’intermédiaire de l’agent de la Sûreté Maurice Appelmans, comme le révélèrent par la suite plusieurs témoins et une enquête du journal De Morgen. Néanmoins, il semblerait qu’Appelmans ait infiltré Ligne rouge dès 1984, mais qu’il n’aurait pas pu réellement approcher les structures clandestines. Paul Ponsaers, Terrorisme in België…, op. cit., p. 86.
-
[43]
Arlon, Archives générales du Royaume, Archives Nothomb, 1104, Rapport confidentiel relatif aux attentats des CCC en Belgique, 1985.
-
[44]
Ainsi, un des enquêteurs de la Sûreté estimait qu’il « n’était pas très difficile d’infiltrer le réseau » : « Ce n’était finalement pas difficile en soi, commente aujourd’hui l’un de ces enquêteurs, compte tenu de la réputation de “révolutionnaire” que traînait Pierre Carette dans les milieux d’extrême gauche. Et surtout, compte tenu de l’existence de Ligne rouge, ce collectif de militants éditant une brochure où l’on retrouvait les textes revendicatifs d’une série d’“organisations communistes combattantes” parmi lesquelles, avant tout, les C.C.C. » Ce que le policier ne dit pas, c’est que, s’il a été facile de cibler le terrain légal, les enquêteurs ont mis un temps bien plus long à pénétrer les structures clandestines, dont ils n’ont sans doute jamais réellement identifié l’ensemble des membres. Alain Guillaume, « La Belgique juge ses terroristes (II) », dans Le Soir, 20 septembre 1988.
-
[45]
Entre 1982 et 1985, une série de braquages sanglants eut lieu en Belgique, entraînant 28 décès et une vingtaine de blessés, sans que l’on ait identifié formellement de coupables.
-
[46]
Félix Rose, Les Rose, Babel Films/ONF, 2020.
-
[47]
Martin Rejean, « Paul Rose, quand même pas un héros », Le Nouvelliste, 25 août 2020.
-
[48]
Richard Martineau, « Le démocrate et le terroriste », Le Journal de Québec, 12 septembre 2020.