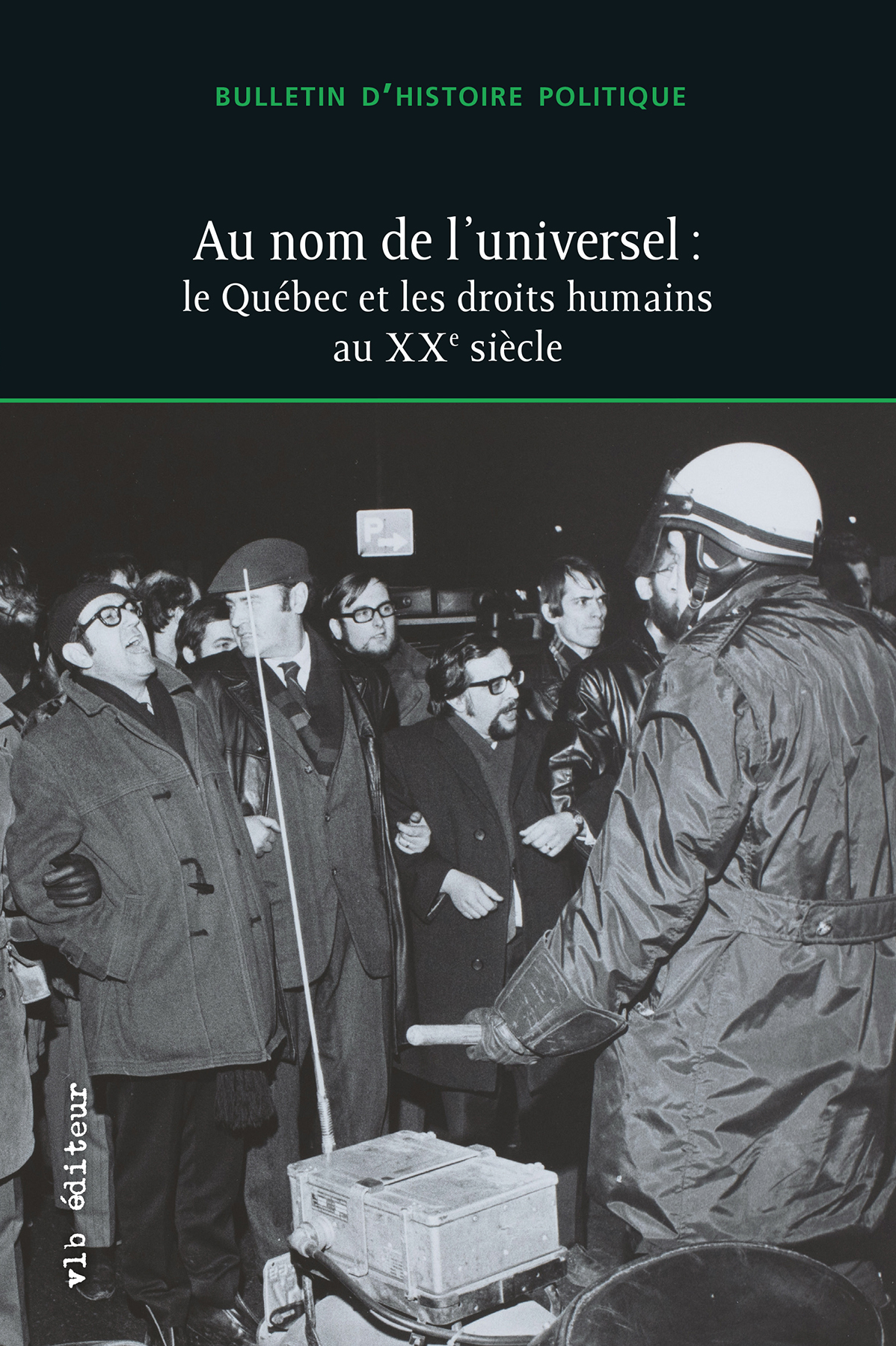Abstracts
Résumé
Pour relire l’histoire des féminismes au prisme des droits, je fais dans un premier temps un survol discontinu et parcellaire des luttes menées par les féministes québécoises en mettant l’accent sur la production de droits qu’ont permis ces luttes. Dans un deuxième temps, je m’interroge sur la citoyenneté des femmes et sur ce qu’elle révèle des apories de la citoyenneté démocratique dans les sociétés occidentales, une citoyenneté fondée sur une double exclusion : les objets « légitimes » du politique et les catégories sociales qui n’y ont pas accès. À cet égard, il est possible d’analyser la contribution des mouvements féministes comme un arrachement des femmes à la généralité de la « condition féminine » pour en faire des individues, ce qui implique une critique de la vision monadique de l’individualité pour lui substituer une vision de l’interdépendance humaine, ce qui entraîne un autre regard sur les solidarités et la justice sociale.
Mots-clés :
- Droits,
- femmes,
- féminisme,
- citoyenneté,
- individuation,
- solidarité,
- justice sociale,
- mobilisation
Article body
Depuis le début du XXe siècle, les mouvements féministes qui se sont développés au Québec ont été des vecteurs de droits à deux titres. Par leur existence et leur action, ils ont permis de constituer les femmes en sujets politiques. De plus, ils ont revendiqué (et parfois obtenu) des droits civils, politiques et sociaux pour les femmes. Les luttes pour la liberté et l’égalité des femmes ont permis et permettent encore aujourd’hui de mettre en lumière les discriminations qui persistent sur la base du genre et fournissent l’occasion d’élargir la sphère des droits au Québec, soit en revendiquant de nouveaux droits, soit en élargissant aux femmes des droits déjà existants.
Relire l’histoire des féminismes au Québec à travers le prisme des droits, c’est poser la question de la citoyenneté des femmes et du long chemin qu’elles ont dû parcourir pour y parvenir. C’est aussi réfléchir à la question des droits humains et aux modes de leur universalisation. Cela implique également de s’intéresser aux processus d’individuation qui sont à la base de la citoyenneté moderne. Assez récemment, en 1993, l’ONU a fini par reconnaître que les droits des femmes sont des droits humains et a même développé un cadre juridique pour éliminer les discriminations à l’encontre des femmes, la Convention pour l’élimination de la discrimination envers les femmes (CEDEF, mieux connu sous son acronyme anglais CEDAW). En ce qui me concerne, je m’inscris davantage dans les réflexions concernant la citoyenneté des femmes en insistant sur le fait que les luttes féministes leur ont permis de s’extirper de la généralité de la « condition féminine » pour devenir des individus, socle de la citoyenneté et des droits dans les sociétés libérales modernes. Je ferai état des débats qui entourent cette notion dans la dernière section de cet article.
Cela s’inscrit dans la logique des travaux de l’équipe de recherche Inter-Reconnaissance[1], qui cherchait à documenter, à partir de témoignages de militantes et militants, le rôle de divers mouvements sociaux dans la progression des droits au Québec depuis la Révolution tranquille[2]. Ce texte prendra appui sur le matériel recueilli au cours de cette recherche, mais il sera complété par les contributions des historiennes féministes et les témoignages écrits de militantes.
Je me propose donc de faire, dans un premier temps, un parcours historique des luttes portées par le mouvement des femmes au Québec en en faisant ressortir la dimension de lutte pour les droits, ce qui a pour conséquence que des pans entiers de l’action de ces mouvements seront passés sous silence. Je m’interrogerai ensuite sur la base de ce fond historique, sur la signification qu’il est possible de lui conférer, a posteriori, concernant la citoyenneté des femmes.
Les féminismes de l’entre-deux-guerres
Si les premiers groupes féministes se forment à Montréal dès 1893[3], ce n’est que dans l’entre-deux-guerres que les mouvements féministes prennent véritablement leur essor. Ce qui domine durant cette période, c’est la lutte pour le suffrage féminin, mais il ne faudrait pas oublier les batailles que les féministes ont dû mener pour le droit à l’éducation, l’accès aux professions et contre l’incapacité civile des femmes mariées, luttes qui connaîtront une issue favorable ultérieurement.
La lutte pour le suffrage féminin, du fait du contexte politique québécois de l’entre-deux-guerres et de la prédilection des autorités politiques provinciales pour des régimes traditionalistes, doit se dérouler simultanément sur deux plans : défendre le suffrage comme mode de sélection des gouvernants, d’une part, et, d’autre part, revendiquer le droit des femmes à exercer le suffrage. Ces deux défis, les mouvements féministes les ont relevés avec brio.
Dès 1921, la lutte pour le droit de vote au niveau provincial, puisque celui-ci avait été obtenu au plan fédéral en 1918, s’organise au Québec, regroupant des femmes qui avaient joué un rôle pour l’obtention de ce droit à l’échelle canadienne, ainsi que de nouvelles venues, comme Idola Saint-Jean. Celles-ci s’empressent d’organiser une rencontre avec le premier ministre Taschereau qui leur rétorque qu’il n’a aucunement l’intention de leur octroyer le droit de vote. Sur ce point, celui-ci tiendra parole jusqu’à la fin de son mandat en 1936. En outre, le clergé catholique local, fortement opposé au suffrage féminin, fera pression sur les féministes d’obédience catholique pour qu’elles abandonnent ce combat[4].
Malgré la présentation de projets de loi privés chaque année à partir de 1922, il faudra attendre la fin de la décennie pour voir réellement se structurer le mouvement suffragiste québécois. Idola Saint-Jean fonde l’Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes du Québec en 1927 pour rompre avec l’attentisme du Comité provincial pour le suffrage féminin tandis que Thérèse Casgrain prend la tête du Comité pour le suffrage provincial et le transforme en Ligue des droits de la femme en 1928[5]. Malgré les différences de tactiques de ces deux féministes, elles se rejoignent sur les plans suivants : le vote est un droit dans une société démocratique et les femmes doivent en jouir pour influer sur les politiques publiques ; elles mènent un travail important de sensibilisation des femmes sur la question de leurs droits en utilisant ce nouveau média qu’est la radio ; elles font du droit de vote la clé de voûte pour l’obtention par les Québécoises de l’égalité civile et sociale[6]. Ainsi, ces deux organisations soulignent que le déni des droits politiques aux femmes a pour conséquence une absence de droits économiques et sociaux dont peuvent jouir les femmes dans d’autres provinces canadiennes. Une illustration, bien avant que l’idée ne devienne plus répandue, de l’interdépendance des droits.
Comme je l’écrivais dans mon ouvrage sur le mouvement suffragiste, dans l’argumentaire des suffragistes et des antisuffragistes, ce sont deux conceptions diamétralement opposées de la société canadienne-française qui s’affrontent[7]. Les antisuffragistes développent une conception de la société canadienne-française essentiellement rurale, se pliant à la houlette du clergé, et où le rôle des femmes se limite à celui de mère, quitte à élargir cette maternité sur un plan social par le biais des « bonnes oeuvres ». Les suffragistes, associées à une certaine modernisation du Québec, prennent acte de l’urbanisation, se préoccupent d’enjeux comme le logement, l’hygiène et les équipements collectifs. Elles ne rejettent pas d’emblée les institutions politiques représentatives qui sont celles du Canada et voient un progrès dans la sélection des autorités politiques par le vote populaire.
Car il ne faudrait pas oublier que c’est au nom d’une certaine conception de la nation canadienne-française qu’un Henri Bourassa s’oppose au vote des femmes et lie clairement le suffrage féminin à la progression de certaines idées démocratiques. Dans ses éditoriaux du Devoir au moment des débats sur le droit de vote des femmes au plan fédéral, repris plus tard en brochure, il écrivait :
Du moment que l’on voit dans le régime électoral et démocratique l’état idéal des sociétés, dans l’individu humain le pivot et la fin de l’ordre social ; du jour où l’on écarte le concept traditionnel, fortifié par le christianisme, de la famille cellule sociale, de la hiérarchie des autorités, de la subordination des droits aux devoirs et des privilèges aux fonctions, on aboutit logiquement à la conception protestante, rationaliste et individualiste dont le féminisme n’est qu’une des manifestations[8].
On retrouve un écho amplifié d’une telle position dans l’intervention du député libéral Joseph-Édouard Fortin en 1934, lorsqu’il souligne que « [l]e démocratisme moderne a déplacé l’axe des valeurs. Il faut donc, si nous voulons sauver du désastre notre armature sociale dans notre province, mettre un frein au flot qui monte et qui menace la clé de voûte de notre société, l’autorité. Et l’émancipation des femmes est l’une de ces menaces[9] ».
Quant aux suffragistes, elles sont amenées à défendre une conception de la démocratie qui inclut toutes les composantes de la société. Idola Saint-Jean insiste sur le fait que « [n]ous voulons voter parce que, dans un régime démocratique, le vote est un facteur qui permet au citoyen d’être représenté au parlement et de participer à la vie publique[10] ». Elle mentionne même que « [l]es ouvriers ont obtenu les réformes sociales qu’ils réclamaient quand ils sont devenus des entités politiques[11] ». Comme le soulignent ses biographes : « C’est en somme le concept moderne d’inclusion universelle qu’Idola Saint-Jean défendra dans ses luttes sociales[12] ». Bref, pour elle, le suffrage ne vaut que si toutes et tous peuvent effectivement l’exercer.
Il en sera de même pour l’autre leader importante des mouvements féministes de l’entre-deux-guerres, Thérèse Casgrain. Dans un témoignage, Michèle Jean souligne : « Elle n’était pas, selon moi, vouée aux droits des femmes seulement, mais aux droits humains en général[13] ». Et si on regarde le matériel de propagande développé par la Ligue pour les droits de la femme, par exemple les tracts produits lors des campagnes de financement, ou ceux qui relient l’absence de droit de vote des femmes au Québec à leur infériorité consacrée par le Code civil ou aux bas salaires qu’elles perçoivent[14], on se rend compte que Thérèse Casgrain lie constamment l’absence de droits politiques pour les femmes à l’absence de politiques sociales au Québec, thème que nous aborderons dans la dernière section de ce texte.
Comme le mentionne Denyse Baillargeon, on peut noter des inflexions importantes dans les discours féministes en faveur du vote des femmes et un estompement progressif du féminisme maternaliste, très présent dans le Comité provincial pour le suffrage des femmes à ses débuts, notamment chez Marie Gérin-Lajoie, vers un discours plus centré sur l’égalité des droits. « Si le but ultime de la lutte, c’est-à-dire accéder aux urnes, demeure le même, les arguments avancés pour la soutenir varient au fil du temps. Au tournant des années 1920, il s’agit surtout de permettre aux femmes de mieux accomplir leurs devoirs maternels, à partir de la fin de cette décennie, c’est davantage les droits des femmes à tous les égards qu’il s’agit de défendre[15] ».
Cette attention portée au suffrage ne les détourne pas d’autres enjeux concernant les droits des femmes. À l’instar de Marie Gérin-Lajoie, qui l’avait fait dès 1910, les féministes de l’entre-deux-guerres dénoncent l’iniquité que constitue le statut civil des femmes mariées (qui, à l’époque, sont tellement absorbées dans l’unité familiale dirigée par le mari qu’elles doivent adopter non seulement son nom de famille, mais également son prénom). Même si en 1929 le gouvernement du Québec met en place la commission Dorion sur le Code civil, celle-ci fait rétrospectivement figure de manoeuvre de diversion pour détourner les féministes de leur combat pour le droit de vote. Ceci est attesté par le fait que la montagne de la commission Dorion n’accouchera que d’une souris[16].
Les revendications féministes ne parviendront à transformer le droit familial que bien plus tard. Il faudra attendre le projet de loi 16 en 1964, déposé par la première femme à siéger à l’Assemblée législative (nom de l’Assemblée nationale à l’époque), pour commencer à mettre fin à l’incapacité juridique des femmes mariées, un processus qui s’étendra jusqu’à la réforme du Code civil de 1980 consacrant l’égalité des époux dans la codirection de la famille.
Les féministes sont également actives en ce qui concerne le droit à l’éducation des femmes. Là encore, le mouvement commencé durant l’entre-deux-guerres ne connaîtra une issue positive qu’ultérieurement, avec la réforme de l’éducation consécutive à la commission Parent dont le rapport sera déposé en 1963. Les premières femmes qui accèdent malgré tout aux études supérieures se heurtent souvent à l’impossibilité d’adhérer aux ordres professionnels régissant l’exercice de leur profession. Là aussi, les féministes ont joué un rôle pour permettre aux femmes d’accéder au Collège des médecins ou au Barreau (1941).
Les mouvements féministes interviennent également pour faire en sorte que les femmes mariées qui exercent un emploi rémunéré puissent disposer des revenus liés à leur emploi, même pour celles qui sont mariées en communauté de biens (ce qui est le régime matrimonial par défaut au Québec à l’époque). C’est d’ailleurs l’un des seuls débouchés positifs de la commission Dorion. Ceci sera capital du fait de l’essor sans précédent du travail féminin rémunéré durant la Deuxième Guerre mondiale.
Après l’obtention du droit de vote en 1940, les mouvements féministes organisés entrent dans une période de latence. De plus, l’immédiat après-guerre est, surtout en Amérique du Nord, une période où les femmes sont invitées à rentrer dans leurs foyers et à produire beaucoup d’enfants. Les féministes de l’entre-deux-guerres n’abandonneront pas le militantisme pour autant puisque certaines seront actives dans les mouvements de la jeunesse catholique, dans les mouvements étudiants, dans les mouvements de consommateurs, dans les organisations internationales, dans le mouvement syndical ou dans le mouvement pour la paix.
Les féminismes des années 1970
En se présentant comme mouvement de libération des femmes, les groupes féministes des années 1970 semblaient à première vue assez éloignés de l’objectif de l’égalité des droits promu dans l’entre-deux-guerres. En fait, la majorité des féministes radicales de cette période pensaient que l’égalité de droit était acquise et qu’il fallait passer à l’égalité de fait[17]. Cependant, il ne faudrait pas oublier qu’à côté de la frange radicale du mouvement existe également ce que l’on peut qualifier de courant libéral qui fait de l’égalité entre les femmes et les hommes son leitmotiv, en s’appuyant sur les recommandations des commissions d’enquête tant fédérales que provinciales, ainsi que sur les organisations internationales, pour faire une intense activité de lobbying en faveur des droits des femmes.
En effet, au milieu des années 1960, on voit se réorganiser les forces féministes. À la suite des célébrations ayant entouré les 25 ans de l’obtention du droit de vote des femmes, on peut assister à la naissance d’une nouvelle organisation, la Fédération des femmes du Québec (FFQ), qui entreprendra diverses actions pour assurer l’égalité en droits des femmes dans la société québécoise, et qui se situe symboliquement dans l’héritage laissé par la Ligue des droits de la femme, puisque Thérèse Casgrain en est la première présidente. De plus, les femmes des petites villes et des milieux ruraux se réorganisent en dehors de la tutelle de l’Église catholique et fondent en 1965 l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS)[18]. Ces deux organisations profiteront de la conjoncture ouverte par la Révolution tranquille pour faire avancer les droits des femmes et travailleront étroitement avec le Conseil du statut de la femme pour ce faire. Elles joueront un rôle de premier plan pour traduire en réalités effectives les recommandations du rapport Pour les Québécoises, égalité et indépendance.
Car, ce qui est nouveau dans les années 1970, c’est qu’on voit se mettre en place des organismes gouvernementaux chargés de promouvoir les droits des femmes. Ceci résulte des recommandations de la Commission royale d’enquête sur le statut de la femme au Canada qui a remis son rapport au gouvernement fédéral en 1972. La prochaine section sera consacrée à l’analyse de leur action.
Du côté des groupes se réclamant de la libération des femmes, le droit à l’avortement libre et gratuit en vient rapidement à jouer le rôle unificateur qu’avait joué la revendication du suffrage dans l’entre-deux-guerres, et leur permet également d’établir des ponts avec les féministes libérales. De plus, ces jeunes militantes se heurtent à divers obstacles législatifs ou réglementaires qui viennent leur rappeler que l’égalité entre les femmes et les hommes est loin d’être acquise dans le Québec des années 1970.
Certains lieux publics comme les tavernes leur sont toujours fermés. Des militantes du Front de libération des femmes (FLF) entreprendront d’aller dans certaines tavernes et d’exiger d’être servies[19]. Le résultat de leur action sera mitigé. Les tavernes réservées aux seuls hommes perdureront jusqu’en 1986, tandis que s’ouvriront des lieux mixtes, notamment les brasseries, servant de la bière en fût. Si l’enjeu peut sembler anecdotique, la question des tavernes a été pensée par les groupes féministes de l’époque comme l’une des manifestations de l’exclusion des femmes des lieux publics et de l’espace public en général. Elle témoigne aussi de la volonté de jeunes femmes d’avoir accès, sans nécessairement devoir être accompagnées par un homme, à une vie sociale à l’extérieur du domicile, comme en témoignera dans les années ultérieures l’émergence des cafés, librairies, maisons de femmes, etc.
De même, les femmes ne peuvent accéder à la fonction de juré. En mars 1971, lors du procès de Lise Balcer, accusée d’appartenance au Front de libération du Québec (FLQ), et proche des militantes du FLF, certaines d’entre elles envahiront le banc des jurés et réclameront l’accès des femmes à cette fonction. Cette revendication sera assez rapidement couronnée de succès, le Québec étant à l’époque la seule province, avec Terre-Neuve, à interdire aux femmes l’accès à cette fonction. Les féministes ayant participé à cette action écoperont néanmoins de peines de prison pour outrage au tribunal[20].
En outre, si des jeunes femmes ont pu accéder à une meilleure formation académique et visent à exercer les emplois pour lesquels elles ont été formées, elles se heurtent à un obstacle de taille, l’absence de structures de garde pour celles qui ont des enfants d’âge préscolaire. Ces féministes sont à l’origine des premières garderies populaires, et joueront un rôle dans la formation du groupe SOS Garderies. Cela permettra de mettre en place des structures participatives incluant le personnel des garderies et les parents. Ce sera aussi à l’origine des politiques sociales de conciliation travail-famille. Là encore, les revendications sont formulées en matière de droits des femmes.
Les mobilisations pour le droit à l’avortement se dérouleront tout au long des années 1970, la première manifestation à cet effet ayant été organisée par le FLF le jour de la fête des Mères. Ce ne sera pas nécessairement un rendez-vous annuel, mais de grandes manifestations à ce sujet ponctueront la fin des années 1970 et le début des années 1980. En marge de la cause Daigle contre Tremblay, il y aura également de grandes manifestations féministes à l’été 1989[21].
Ces mobilisations verront alterner actions « illégales » et mobilisations de masse. En effet, très rapidement, le FLF met en place un service de référence pour les femmes qui souhaitent obtenir un avortement, et contribue à procurer des avortements aux femmes en contournant le Code criminel, un service qui sera ensuite repris par le Centre des femmes et, ultérieurement, par le Comité de lutte pour l’avortement libre et gratuit. Lorsque le Parti québécois arrive au pouvoir en 1976 et annonce qu’il ne poursuivra plus les médecins qui, comme Henry Morgentaler, pratiquent des avortements au Québec, des alliances se nouent avec des militantes syndicales et des médecins afin de pratiquer des avortements dans les Centres locaux de services communautaires (CLSC) et dans les Centres de santé de femmes, malgré la loi fédérale qui en limite la pratique aux hôpitaux jusqu’à l’arrêt Morgentaler de la Cour Suprême en 1988.
En marge de ces actions, il y aura tout un travail de construction de coalitions très larges pour obtenir ce droit. Les milieux étudiants, communautaires et syndicaux seront appelés à se joindre aux féministes, et un travail en profondeur d’éducation populaire se développera sur la question, ce qui permettra d’ancrer dans toutes les couches de la population qu’il n’appartient qu’aux femmes de décider dans ce domaine. Les effets de ce travail se feront sentir dans les années subséquentes puisque chaque fois que des gouvernements ou des députés voudront faire adopter des projets de lois restreignant la liberté d’avortement, ceux-ci susciteront des levées de boucliers au Québec[22].
La question de l’avortement soulève des enjeux de droits complexes. Il y a évidemment, pour la femme, la libre disposition de son corps qui est un critère central de l’individuation libérale. Il y a également la capacité de faire des choix moraux, à savoir si une femme veut ou non devenir mère à tel moment précis de son existence. Il y a également toute la question de la dissociation entre « femmes » et « mères ».
Les luttes féministes de cette période ont permis de sécuriser trois éléments. Le premier, reconnu dans l’arrêt Morgentaler de la Cour suprême du Canada en 1988, est le droit pour les médecins de pratiquer des avortements dans les mêmes conditions que les autres actes médicaux, c’est-à-dire sans avoir à recourir à l’approbation d’un comité thérapeutique, d’où l’abrogation des articles du Code criminel établissant ces comités thérapeutiques. Le deuxième, reconnu dans l’arrêt Daigle contre Tremblay, en 1989, est la liberté des femmes de décider si elles veulent ou non poursuivre une grossesse ; il s’agit donc du principe de la libre disposition de son corps. Le troisième, lié à la mise en place de cliniques de planification familiale dans toutes les régions du Québec, dites cliniques Lazure, est une certaine offre de services, inégale d’une région administrative à l’autre, en matière d’avortement et de contraception[23].
Comme le souligne Louise Desmarais, une militante du Comité de lutte pour l’avortement libre et gratuit, celui-ci « juge prioritaire de convaincre les femmes qu’il s’agit d’une lutte politique, que ce droit n’est pas accessoire, mais une première étape et une condition essentielle à leur libération[24] ». Elle souligne également l’ampleur de la mobilisation à ce sujet et les alliances qu’il a fallu nouer pour donner corps à ce droit fondamental pour les femmes.
Les suites de Pour les Québécoises, égalité et indépendance
Les années 1980 ont marqué une institutionnalisation de certaines idées féministes et leur prise en charge partielle par l’appareil d’État. C’est à cette époque que l’on a vu le développement de mécanismes de prise en charge étatique d’une partie des revendications mises de l’avant par les organisations féministes, et leur transformation en politique publique ou en extension aux femmes de droits déjà existants. C’est aussi à cette période que l’on a pu voir se nouer des alliances fructueuses entre militantes féministes, universitaires et politiques qui ont permis de faire progresser les droits des femmes, notamment en ce qui concerne l’avortement et l’équité salariale. Outre l’avortement, les deux principaux enjeux sur lesquels il y a des avancées sont le travail et les violences envers les femmes.
Il est intéressant de voir le processus qui a permis de parvenir à une telle situation. Dès 1967, la FFQ s’est jointe à des groupes du Canada hors Québec pour demander une commission royale d’enquête au plan fédéral. Cette commission a entrepris un vaste travail de consultation publique qui excédait largement le processus de consultation pour ce genre de commission. Monique Bégin, qui en était la secrétaire, raconte qu’elle a d’abord dû familiariser la plupart des commissaires au féminisme et qu’ensuite, elle a pris des moyens pour une participation importante des femmes et des groupes de femmes alors en formation un peu partout au Canada[25].
Au Québec, un peu pour gagner du temps alors qu’il n’avait pas vraiment de politiques à proposer, le gouvernement du Québec a aussi entrepris de consulter les groupes de femmes, d’abord à l’occasion de Carrefour 75, qui s’inscrivait dans le cadre de l’Année internationale de la femme de l’ONU, puis lors d’une deuxième enquête sous la houlette du Conseil du statut de la femme (CSF), ce qui a donné lieu au rapport Pour les Québécoises : égalité et indépendance, élaboré par plusieurs chercheuses universitaires et validé par le CSF. Cela a permis au CSF de consulter très largement, mais aussi de former des équipes de recherches sur divers enjeux, avec comme ambition de synthétiser l’ensemble des revendications pour ensuite voir à la manière de les traduire en politiques publiques ou en droits sociaux[26].
Dans le domaine du travail, plusieurs avancées se font sentir : les congés de maternité payés qui deviendront ensuite des congés parentaux, la mise en place de services de garde publics et abordables avec les Centres de la petite enfance et la loi sur l’équité salariale. Il faut également mentionner la question du partage du patrimoine familial et de la compensation financière des femmes collaboratrices dans une entreprise familiale lors d’une séparation ou d’un divorce.
En fait, l’objectif poursuivi par le rapport Pour les Québécoises : égalité et indépendance, est d’assurer l’autonomie économique des femmes, qui passe essentiellement par l’accès et le maintien d’un emploi rémunéré. Ceci a des conséquences en ce qui concerne l’action du CSF, qui le conduit à « s’opposer à des mesures fiscales ou allocations, qui tout en permettant d’améliorer la situation économique des femmes, ne dépendent pas de l’emploi et peuvent encourager la division sexuée du travail[27] ». Révillard mentionne que cela conduit à un investissement ultérieur dans le domaine du droit familial, « non seulement comme lieu d’affirmation d’une égalité en droit (égalité de traitement juridique), mais aussi comme levier pour accroître la sécurité économique des femmes et lutter contre les inégalités économiques entre les conjoints[28] ».
Les congés de maternité et les congés parentaux joueront un rôle essentiel dans le maintien des femmes sur le marché du travail salarié et dans la continuité de l’emploi des femmes, puisqu’elles n’ont plus à choisir entre devenir mères et exercer une activité rémunérée. De plus, ils viennent concrétiser le principe de la grossesse comme motif illicite de discrimination, principe présent dans la Charte québécoise. Ces congés sont principalement le résultat des luttes menées par les syndicats pour leur inclusion dans les conventions collectives, mais ils ont été ensuite traduits en politiques sociales avec le Régime québécois d’assurance parentale.
Si les premières garderies populaires ont été mises en place par des membres du Front de libération des femmes, c’est principalement à l’organisme SOS Garderies que l’on doit à la fois les mobilisations sur cette question et la mise en place de ce qui, à l’époque, se nommait les garderies populaires. Il faudra cependant attendre jusqu’en 1997, avec la mise en place des Centres de la petite enfance (CPE), pour qu’il y ait une prise en charge réelle par l’État des services de garde.
Cependant, ils s’avèrent toujours insuffisants pour permettre à toutes les femmes qui le désirent d’exercer un emploi salarié sans consacrer l’essentiel de leur salaire au paiement de services de garde puisque les politiques publiques, depuis le début des années 2000, ont moins favorisé les CPE que les garderies privées.
La loi sur l’équité salariale[29] est le produit d’une alliance entre militantes féministes, syndicalistes féministes et féministes d’État. La première occasion publique qui a permis aux féministes de discuter de cet enjeu avec des syndicalistes a été le colloque organisé par le YWCA en mars 1989, dont les actes sont publiés par Marie-Claire Dumas et Francine Mayer[30]. Ce colloque réunissait des militantes féministes (et faisait place à la diversité de situations des femmes puisqu’il comprenait des interventions de femmes vivant avec un handicap ou racisées), des militantes syndicales, des « fémocrates[31] » et des universitaires. Il a joué un rôle névralgique en ce qui concerne cette lutte. Il a permis de généraliser dans ces divers milieux le passage de l’idée de « À travail égal, salaire égal » qui prévalait dans les années 1970 à celle de l’équité salariale qui exige d’entrevoir de façon plus complexe la valeur même du travail en tentant d’aller au-delà des préjugés genrés pour prendre en compte qui effectue le travail, la formation nécessaire et le milieu d’exercice. Ce colloque débouche également sur la mise sur pied de la Coalition en faveur de l’équité salariale (1989) qui rassemble des femmes et des hommes d’organisations syndicales, mais aussi de nombreux groupes de femmes, tels que la Fédération des femmes du Québec (FFQ), Au bas de l’échelle, le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) et Relais-femmes[32].
En ce qui concerne la violence envers les femmes, les avancées sont plus timides. Le Code criminel, de juridiction fédérale, requalifie le viol et reconnaît la possibilité de viol conjugal en 1983. À la fin des années 1970, le gouvernement québécois s’engage dans une campagne publique de sensibilisation à la violence conjugale et entreprend de sensibiliser la magistrature et les corps policiers à l’existence de cette violence, d’une part, et, d’autre part, à la nécessité d’une intervention pour la contrer. Les résultats sont toutefois mitigés. L’essentiel des politiques publiques passe, à partir de 1977, par un soutien financier assez chiche aux maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence, mais laisse aux groupes de femmes la charge de lutter contre ces types de violence. La violence en milieu de travail, qu’elle prenne la forme de harcèlement sexiste ou sexuel, n’est pas vraiment prise en charge, ni par le biais des lois, ni par celui des conventions collectives.
Les mobilisations contre la violence et la pauvreté
La Marche Du pain et des roses en 1995 marque un nouveau chapitre des mobilisations féministes après le coup de massue de l’attentat antiféministe de Polytechnique en 1989. Cependant, le virage néolibéral pris par l’État québécois dans la foulée de l’échec référendaire de 1995 ne rend pas cette période très propice à l’obtention de droits par les femmes, et les luttes de cette période concernent davantage la défense de droits déjà acquis que l’obtention de nouveaux droits.
À cet égard, il est cependant important de distinguer ce qui s’est produit lors de la Marche de 1995 de ce qu’on a pu voir avec la Marche mondiale des femmes (MMF) depuis 2000. Il importe de préciser que la conjoncture de 1995 est cruciale. À la veille d’une nouvelle bataille référendaire, le mouvement souverainiste ne pouvait se permettre de s’aliéner le vote d’une partie des féministes comme cela avait été le cas en 1980 avec le mouvement des Yvettes. Aussi, le gouvernement a-t-il semblé intéressé par les revendications mises de l’avant par la Marche Du pain et des roses, mais les gains réels en matière de droits seront mitigés : la perception automatique des pensions alimentaires, une réduction du temps de parrainage pour les femmes immigrantes (ce qui concerne le gouvernement fédéral) et la loi sur l’équité salariale qui sera adoptée un an après.
La MMF, commencée en l’an 2000, a donné lieu à des réflexions importantes en ce qui concerne les droits, principalement à travers la formulation d’une Charte mondiale des femmes pour l’humanité en 2010. Cette Charte, articulée autour de cinq principes (égalité, liberté, paix, solidarité et justice), vise à synthétiser une partie des expériences féministes un peu partout sur la planète, mais aussi à en inscrire les revendications partielles dans une perspective commune et générale[33].
Cette nouvelle inflexion du féminisme québécois a aussi eu un effet dans la constitution du féminisme comme un mouvement de justice sociale appréhendant les enjeux féministes à travers une grille de plus en plus intersectionnelle (en conjonction avec les autres grands systèmes de domination que sont le capitalisme et le racisme). Elle a rendu possibles les États généraux du féminisme québécois (2011-2013), qui, plus que les autres grands rassemblements féministes du passé comme Femmes en tête[34] ou Pour un Québec féminin pluriel[35], ont fait place dans leur organisation aux femmes autochtones et aux femmes de toutes origines ethniques ou nationales.
Enfin, la question des violences envers les femmes s’est imposée dans l’actualité depuis le milieu des années 2010 et pose deux jalons fondamentaux en termes de droits : d’abord, le droit à la sécurité ; ensuite, la libre disposition de son corps et la défense de son intégrité corporelle. Le harcèlement sexuel dans les universités a obligé celles-ci à se doter d’une politique institutionnelle pour le contrer. Le mouvement #Metoo a mis en lumière l’ampleur des violences sexuelles dans les milieux de travail, même si le traitement policier et judiciaire des plaintes en la matière laisse à désirer. Les féminicides de femmes autochtones ont retenu l’attention et même suscité la formation d’une commission d’enquête dont les conclusions sont malheureusement allées rejoindre, quelque part sur une tablette, d’autres conclusions d’enquêtes gouvernementales sur les Autochtones. Le confinement pandémique a également rappelé à la mémoire collective la question de la violence conjugale sans que l’on puisse parler d’une politique cohérente et surtout proféministe en la matière.
Les mouvements féministes, de formidables producteurs de droits
Cet aperçu succinct et parcellaire des combats menés par les mouvements féministes depuis plus d’un siècle en faveur des droits des femmes en font des producteurs de droits. Premièrement, ils ont permis de faire passer la notion de l’égalité entre les femmes et les hommes au rang de valeur fondamentale de la société québécoise, même si nous sommes encore loin de sa réalisation concrète. Deuxièmement, ils ont permis aux femmes de devenir des sujets politiques alors que durant de nombreux siècles, elles n’avaient été, au mieux, que des objets de politiques qui s’élaboraient sans leur participation. Troisièmement, ils ont permis de penser les apories de la citoyenneté démocratique dans les sociétés occidentales.
Pour paraphraser Hannah Arendt, il est possible de soutenir que les féministes représentent des figures de parias conscientes. D’abord, elles ont cherché à politiser ce qui semblait « naturel » dans la société hétérosexiste et à combattre les diverses manifestations du patriarcat. Ensuite, les mouvements collectifs ont permis aux féministes de trouver leur(s) voix et de les faire entendre dans les débats politiques. Enfin, elles ont réussi à construire des solidarités qui ne reposent pas sur une identité partagée ou sur une généralité abstraite (comme l’Homme), mais sur un agir en commun pour transformer des situations jugées injustes et donc faire bouger les frontières du juste et de l’injuste.
Le travail politique des féministes a d’abord été de montrer qu’il n’y a rien de « naturel » dans la division sexuelle du travail et des rôles sociaux entre les femmes et les hommes. Dans une société sexiste, les femmes sont constituées en groupe subalterne sur la base d’une catégorisation (différentes ou autres par rapport au groupe de référence que sont les hommes), d’une hiérarchisation entre les femmes et les hommes, et finalement d’une naturalisation qui attribue cette catégorisation à des traits biomorphologiques. Comme le soulignait Monique Wittig[36], la catégorie « femme » est liée à cette autre catégorie à prétention universelle, « homme ». Une des tâches des féminismes a donc été de dénaturaliser ce que veut dire être « femme » dans une société sexiste en faisant apparaître la construction sociale du groupe derrière le recours à la nature. Sur cette base, les féminismes ont aussi entrepris de cerner les diverses manifestations du sexisme en en faisant émerger le caractère à la fois global et très spécifique dans ses ramifications quotidiennes et de les problématiser en termes d’injustice. Cela a conduit à pluraliser ce que « femme » peut signifier et, surtout, à individualiser des personnes dont le sort était autrefois lié à l’appartenance à une catégorie sociale discriminée.
À travers les féminismes, les femmes ont trouvé leur(s) voix. Cela peut s’entendre à la fois comme l’espace d’interlocution qu’elles ont créé dans les divers collectifs féministes, mais aussi comme le fait de trouver ensemble des mots pour décrire leurs maux. Si le sentiment d’injustice a permis de se regrouper, le fait de se parler dans un espace autonome par rapport à la société sexiste – les collectifs féministes – a permis qu’émergent des espaces publics oppositionnels, ainsi que des mots pour décrire les diverses ramifications et manifestations concrètes des injustices de genre et détricoter une à une les mailles du filet patriarcal. Le rôle de tels espaces publics subalternes dans la réalisation effective de la parité de participation est particulièrement mis en lumière par Nancy Fraser dans ses réflexions sur la justice sociale[37].
Les féminismes ont également permis de développer des solidarités qui reposent moins sur une identité partagée, même si un identitarisme stratégique a souvent été de mise, que sur un agir en commun. Cet agir en commun est un entrelacement du « je » et du « nous » à travers l’émergence de coalitions à géométrie variable, souvent éphémère, mais permettant de tisser des liens de confiance et de reconnaître que, si l’oppression est généralisée, elle n’est pas la même pour toutes, et que la liberté ne réside pas dans la substitution d’une « femme universelle » à l’« homme universel ». À cet égard, le tournant intersectionnel, au coeur des États généraux du féminisme, a permis de mieux comprendre que les situations concrètes des femmes sont multiples et liées à l’intrication du sexe, du genre, de la classe, de la race, de l’orientation sexuelle ou des capacités physiques. Cette multiplicité de situations des femmes, y compris dans un même ensemble politique comme le Québec, n’empêche pas d’agir ensemble, mais rend problématique le fait d’ériger l’expérience de certaines femmes en norme universelle, comme le prétendent les féministes dites universalistes.
Enfin, à travers les féminismes, c’est le caractère exclusif de la citoyenneté démocratique moderne qui a été mis en lumière. En insistant sur le caractère public et individuel de la citoyenneté, il devenait inévitable d’en exclure de larges pans de la population (grosso modo les pauvres, les esclaves et les femmes). Car, en même temps qu’elles proclamaient les « droits de l’Homme », les révolutions modernes de la fin du XVIIIe siècle s’empressaient de faire des femmes, à travers les codes civils, des êtres privés soumis au chef de famille et les empêchaient d’accéder à l’individuation en les désignant comme dépendantes et irrationnelles[38]. En outre, elles reposaient sur une définition monadique de l’individualité permettant difficilement de faire place à l’interdépendance des êtres humains et contribuant ainsi à dévaloriser le travail de reproduction humaine (au sens social et biologique) qui repose encore largement sur les épaules des femmes dans la plupart des sociétés contemporaines.
À cet égard, il est possible d’analyser la contribution des mouvements féministes comme arrachement des femmes à la généralité de la « condition féminine » pour en faire des individus. Pour cela, il importe de considérer autant les droits politiques que les droits civils et les droits sociaux. Cela a amené les féministes à critiquer la vision monadique de l’individualité pour proposer une vision de l’interdépendance humaine.
Ainsi, la séquence d’obtention de droits pour les femmes depuis le XXe siècle opère de façon différente du modèle développé par T.H. Marshall en ce qui concerne l’obtention des droits pour les ouvriers (masculins) britanniques : droits civils, droits politiques, droits sociaux. En fait, il serait presque possible de dire que cette séquence a été inversée pour les femmes, mais il serait plus juste de soutenir, comme l’ont fait les suffragistes, que les droits politiques ont été la clé de l’acquisition des droits sociaux et des droits civils pour les femmes. En effet, avant d’obtenir le droit de vote, les femmes pouvaient bénéficier de certaines politiques sociales, et il est même possible de soutenir que le développement de celles-ci a souvent été la porte d’entrée des femmes et des mouvements féministes dans le domaine politique. Cependant, ces politiques sociales s’élaboraient largement en dehors de la participation des femmes, souvent sur un mode extrêmement paternaliste[39]. Par ailleurs, la pleine égalité civile pour les femmes intervient assez tardivement dans le XXe siècle, puisqu’il faut attendre une transformation égalitaire du droit de la famille et des législations qui permettent l’accès à l’avortement pour parler de droits civils pour les femmes. Il est également permis de se demander si les violences sexistes à l’encontre des femmes et la relative impunité qui les accompagnent (féminicides, violence conjugale, harcèlement sexuel, viol, etc.) ne constituent pas un déni d’une liberté civile fondamentale, le droit à la sécurité.
Par ailleurs, les féministes ont été amenées à revoir la notion d’individuation et à mettre en lumière les larges pans d’externalisation qui lui sont associés. En effet, le contrat social libéral, fiction nécessaire à l’État moderne, se double, comme l’a fait remarquer Carole Pateman[40], d’un contrat sexuel. Si l’individu libéral peut être indépendant, rationnel et responsable, c’est parce qu’il y a d’autres êtres humains (des esclaves, des serviteurs ou des femmes) qui se chargent d’une grande partie du travail de reproduction sociale et humaine. Imaginer une organisation sociale fondée sur l’individuation généralisée[41], à moins de se contenter de l’anomie de l’individu néolibéral performant, implique de prendre en compte l’interdépendance des êtres humains, leur vulnérabilité et de valoriser le prendre soin et la responsabilité plutôt que la compétition comme mode privilégié de relations humaines.
Ainsi, les mouvements féministes et d’autres mouvements sociaux ont contribué à la vie sociale des droits, alors qu’une grande partie des mouvements féministes se conçoit comme des producteurs ou des défenseurs de droits[42]. Comme le souligne Francine Saillant : « La vie sociale des droits s’observe ainsi à travers les différentes façons dont les acteurs exposent, pratiquent, critiquent, s’approprient les droits humains et en font un usage stratégique selon diverses finalités[43] ».
Les mouvements de femmes ont effectivement contribué à la vie sociale des droits. Ils ont contribué à montrer les limites d’application de droits pourtant présumés universels dans les diverses déclarations nationales et internationales. Ils ont également fait des femmes des actrices politiques, décidant de pratiquer et de s’approprier des droits qu’on leur déniait en réalité. Ils ont également contribué à donner un nouveau sens ou à étendre le champ d’application de droits déjà reconnus. Dans cette optique, les mouvements de femmes ont montré que l’on peut difficilement dissocier les droits de leur énonciation et surtout de leur mise en oeuvre.
Appendices
Notes
-
[1]
Équipe de recherche sous la direction de Francine Saillant, subventionnée par le CRSH de 2012 à 2017. J’étais responsable du volet « femmes » de l’équipe qui a enquêté également sur les mouvements de personnes vivant avec un handicap, sur les mouvements en santé mentale, les mouvements LGBTQ+, ceux liés à l’immigration et au refuge, de même que sur les artistes liés à ces mouvements.
-
[2]
Outre plusieurs communications, deux textes ont porté sur la question des droits dans le mouvement des femmes : Diane Lamoureux et Stéphanie Mayer, « De grandes avancées en droits », dans Francine Saillant et Ève Lamoureux (dir.), Inter-Reconnaissance. La mémoire des droits dans le milieu communautaire, Québec, Presses de l’Université Laval, 2018, p. 19-48 et Stéphanie Mayer et Diane Lamoureux, « Le féminisme québécois comme mouvement de défense des droits des femmes », Recherches féministes, vol. 29, no 1, 2016, p. 91-109.
-
[3]
C’est le moment de la formation du Montreal Local Council of Women, regroupant surtout des anglophones, mais comptant dans ses rangs certaines francophones comme Mme Rosaire (sic) Thibodeau, Joséphine Marchand-Dandurant ou Marie Gérin-Lajoie. Voir Marie Lavigne et Yolande Pinard, Les femmes dans la société québécoise, Montréal, Boréal Express, 1977, p. 69.
-
[4]
Ce qui aura pour effet, pratiquement, de mettre en veilleuse le Comité provincial pour le suffrage féminin, puisque l’animatrice principale, Marie Gérin-Lajoie, était une féministe catholique.
-
[5]
Ironie de l’histoire, celle-ci sera également une des membres fondatrices de la Ligue des droits de l’Homme (devenue depuis la Ligue des droits et libertés) en 1963. Ceci démontre bien la préoccupation pour les droits des personnes discriminées tout au long de sa carrière politique.
-
[6]
Ces deux groupes défendent l’égalité civile des femmes mariées et un accès des femmes à la vie sociale, principalement en ce qui concerne l’éducation et l’accès aux professions. Dans un tract publié par le Comité « féministe » du Montreal Women’s Club, celles-ci attribuent l’absence de pension pour les mères, l’absence des pensions de vieillesse pour les femmes, la fermeture de certaines professions aux femmes, l’inégalité dans les lois régissant le mariage et la non-scolarisation obligatoire des enfants au fait que les femmes québécoises ne jouissent pas du droit de vote au plan provincial. Ce tract est reproduit dans Diane Lamoureux, Citoyennes ? Femmes, droit de vote et démocratie, Montréal, Remue-ménage, 1989, p. 46.
-
[7]
Voir Ibid., p. 64.
-
[8]
Henri Bourassa, Femmes-hommes ou hommes-femmes ?, Montréal, Éditions du Devoir, p. 41-42.
-
[9]
Propos rapportés dans L’Action catholique, 22 février 1934, cité dans Diane Lamoureux, op.cit., p. 74.
-
[10]
Propos rapportés dans La Presse, 25 mars 1939, cité dans Ibid., p. 75.
-
[11]
La Sphère féminine, 1935, cité dans Ibid., p. 76. Ce périodique est celui de l’Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec.
-
[12]
Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean, Idola Saint-Jean, l’insoumise, Montréal, Boréal, 2017, p. 263.
-
[13]
Michèle Jean, « Les ambivalences de la pensée d’une extraordinaire femme d’action », dans Anita Caron et Lorraine Archambault (dir.), Thérèse Casgrain, une femme tenace et engagée, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1993, p. 367. Voir aussi supra note 5.
-
[14]
Voir Diane Lamoureux, op. cit., p. 60 et 62.
-
[15]
Denyse Baillargeon, Repenser la nation. L’histoire du suffrage féminin au Québec, Montréal, Remue-ménage, 2019, p. 210.
-
[16]
Voir à ce sujet Collectif Clio, L’histoire des femmes au Québec, Montréal, Éditions du jour, 1992, p. 353-354.
-
[17]
Voir à ce sujet Véronique O’Leary et Louise Toupin, Québécoises deboutte ! Tome 1, Montréal, Remue-ménage, 1982.
-
[18]
Voir à ce sujet, Archives FFQ, Fonds P977, BAnQ, Jocelyne Lamoureux, Michèle Gélinas et Katy Tari, Femmes en mouvement, Montréal, Boréal, 1993, de même que Collectif Clio, op.cit., p. 461-486.
-
[19]
La source d’inspiration est probablement le mouvement des droits civiques des Noir.es aux États-Unis et leurs nombreux sit-in pour exiger d’être servis dans les restaurants.
-
[20]
Voir à ce sujet le compte rendu de Marjolaine Péloquin, En prison pour la cause des femmes, Montréal, Remue-ménage, 2007.
-
[21]
Quelques mois après que la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire Morgentaler, un homme violent, Jean-Guy Tremblay, veut empêcher son ex-compagne, Chantale Daigle, de recourir à un avortement, en invoquant un droit de suite sur son sperme et en s’instituant protecteur du foetus. La Cour statuera qu’en matière d’interruption de grossesse, c’est aux femmes, et à elles seules, qu’appartient la décision de poursuivre ou non une grossesse.
-
[22]
Voir à ce sujet Louise Desmarais, La bataille de l’avortement. Chronique québécoise, Montréal, Remue-ménage, 2016 et Diane Lamoureux et Stéphanie Mayer, loc. cit.
-
[23]
La mise en place de ces cliniques résulte d’un effort conjugué de militantes féministes, de féministes au sein du Parti québécois (alors au pouvoir) et de l’acharnement de deux ministres, celui de la Santé, Denis Lazure, et celle déléguée à la condition féminine, Lise Payette. Voir à ce sujet Louise Desmarais, op. cit., p. 150 et suivantes. Les coupes budgétaires dans le domaine de la santé à partir du milieu des années 1980 auront raison de plusieurs de ces cliniques, même si le Québec demeure, comparativement au reste du pays, la province canadienne où les services d’avortement sont le plus accessibles.
-
[24]
Ibid., p. 474.
-
[25]
Monique Bégin témoigne du processus de consultation dans l’ouvrage de Daniel Raunet, Monique Bégin. Entretiens, Montréal, Boréal, 2016, p. 72-73. L’ouvrage collectif sous la direction de Caroline Andrew et Sandra Rodgers (Women and the Canadian State. Les femmes et l’État canadien, Montréal et Kingston, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1997) en fait état dans l’introduction et dans les contributions de Clarke et Bégin.
-
[26]
Voir l’introduction du rapport, Pour les Québécoises : Égalité et Indépendance, Québec, Éditeur officiel, 1978, p. xvi-xxi, de même que le livre de Anne Révillard, La cause des femmes dans l’État, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2016, p. 84-90.
-
[27]
Ibid., p. 156.
-
[28]
Ibid., p. 159.
-
[29]
Le principe du salaire égal pour un travail égal a été réglé lors de l’adoption de la Charte en 1975. Ceci a fait en sorte qu’il est devenu illégal d’avoir un salaire différent pour une même tâche selon le genre. Cependant, comme les emplois féminins et les emplois masculins sont souvent très différents, l’écart salarial entre femmes et hommes a perduré, même s’il s’est légèrement rétréci. Ceci a amené des groupes féministes et des syndicats à prôner le principe de l’équité salariale, c’est-à-dire un salaire égal pour un travail équivalent. Dans le processus de mise en oeuvre de l’équité salariale, on a donc mis en place des mécanismes complexes de comparaison entre des emplois différents (niveau d’étude, pénibilité, etc.). La récente épidémie de Covid a permis au grand public de réaliser que, malgré cette loi, des emplois exercés très majoritairement par des femmes, souvent racisées, comme préposées aux bénéficiaires, infirmières, enseignantes du préscolaire et du primaire, avaient besoin d’une revalorisation salariale importante. Lorsque l’Intersyndicale des femmes a lancé sa campagne en faveur de l’équité salariale, elle a comparé le salaire d’un gardien de zoo (métier largement masculin) et d’une éducatrice de garderie (métier largement féminin) où l’on pouvait assez aisément réaliser que le gardien de zoo était mieux payé que l’éducatrice en garderie.
-
[30]
Marie-Claire Dumas et Francine Mayer (dir.), Les femmes et l’équité salariale, Montréal, Remue-ménage, 1990.
-
[31]
C’est le sobriquet utilisé pour parler des féministes qui travaillent à l’intérieur des structures étatiques.
-
[32]
On retrouve un excellent compte rendu des mobilisations et des alliances en faveur de l’équité salariale dans Olga Artemova, La lutte pour l’équité salariale au Québec, Montréal, Cahiers CRISES, 2008.
-
[33]
Voir Isabelle Giraud et Pascale Dufour, Dix ans de solidarité planétaire, Montréal, Remue-ménage, 2010.
-
[34]
Femmes en tête est un rassemblement organisé par Relais-Femmes en 1990 pour souligner le 50e anniversaire du droit de vote pour les Québécoises et également pour réaffirmer l’existence et la pertinence du féminisme quelques mois après l’attentat antiféministe de Polytechnique. La plupart des groupes de femmes étaient impliqués dans son organisation. Cependant, les choses se sont gâtées lorsque le comité organisateur a décidé de faire appel à Lise Payette comme marraine de l’événement, alors que des groupes de femmes lui reprochaient la définition ethnique de la nation québécoise promue dans le documentaire Disparaître.
-
[35]
Rassemblement organisé en 1992 par le groupe des 13 (réseaux nationaux de groupes de femmes et Intersyndicale des femmes) pour tenter de panser les cicatrices laissées par Femmes en tête. Si des femmes de toutes origines s’y retrouvent, le comité organisateur ne comprend ni les femmes autochtones ni les groupes de femmes organisées sur une base ethnique (haïtiennes, grecques ou italiennes, par exemple). Comme son nom l’indique, il introduit un large pluralisme ethnique dans la définition de Québécoises.
-
[36]
À ce sujet, voir Monique Wittig, « La pensée straight », Questions féministes, no 7, février 1980, p. 45-53.
-
[37]
Voir, entre autres, Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale ? Paris, La Découverte, 2009 et Le féminisme en mouvements, Paris, La Découverte, 2012.
-
[38]
Les divers mouvements en faveur d’une plus grande participation des femmes aux assemblées représentatives dans les années 1990 ont suscité une ample littérature sur la citoyenneté des femmes. Il est impossible de mentionner la totalité de ces ouvrages, mais on en trouve une excellente synthèse dans l’ouvrage de Bérangère Marques-Pereira, La citoyenneté politique des femmes, Paris, Armand Colin, 2003.
-
[39]
Et souvent en assimilant les femmes aux enfants, ce qui correspond au statut légal de plusieurs femmes, comme dans les législations concernant le travail de nuit des femmes.
-
[40]
Carole Pateman, The Sexual Contract, Stanford University Press, 1988.
-
[41]
Car les enjeux féministes ont souvent été liés à la progression des droits de l’enfant.
-
[42]
On retrouve de plus longs développements sur ce thème dans Stéphanie Mayer et Diane Lamoureux, loc. cit.
-
[43]
Francine Saillant, « Pour une anthropologie critique des droits humains », dans Francine Saillant et Karoline Truchon (dir.), Droits et culture en mouvements, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, p. 17.