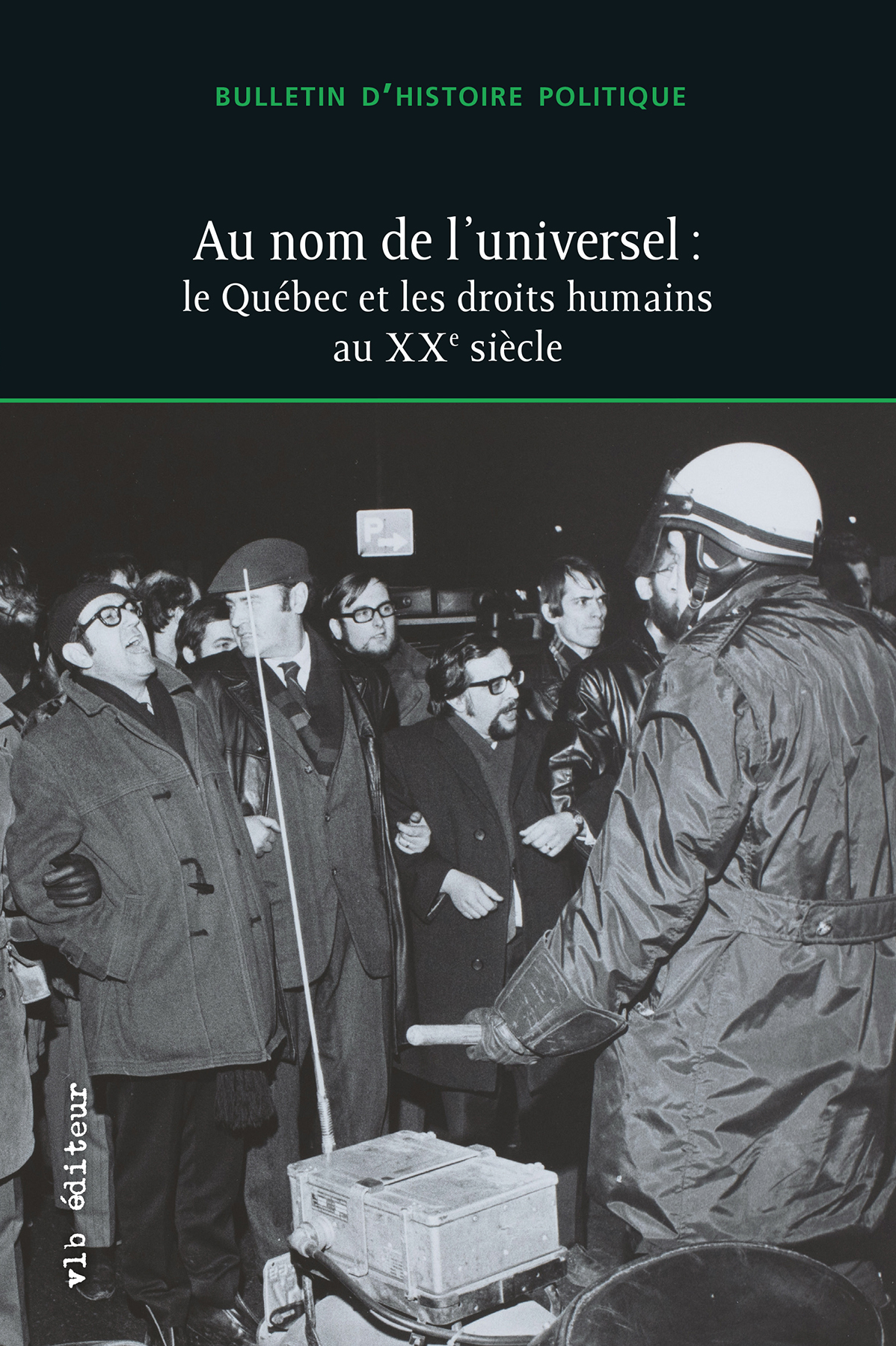Abstracts
Résumé
Cet article propose de jeter un éclairage, à partir du Québec, sur l’histoire de l’idée transnationale d’un « droit du social » émanant de l’autodétermination collective dans les relations de travail. Nous étudierons d’abord le projet, formulé au Québec à partir de 1934, d’une élaboration du droit du travail par l’entremise du régime des conventions collectives d’ordre public. Nous verrons ensuite comment Jean-Pierre Després, fonctionnaire du ministère provincial du Travail, a tenté d’institutionnaliser cette idée en s’inspirant des mécanismes tripartites du Bureau international du Travail, établi à Montréal entre 1940 et 1946. Cet échec de la reconnaissance d’un droit du social est riche d’enseignements pour comprendre la nature de l’État social au Québec et au Canada.
Mots-clés :
- Droit social,
- droit du travail,
- syndicalisme,
- relations de travail,
- conventions collectives,
- citoyenneté sociale,
- État social,
- État providence,
- Organisation internationale du travail
Article body
Plus la politique économique et sociale canadienne se rapprochera des conventions et des recommandations de l’Organisation internationale du Travail, plus nous nous acheminerons dans la voie du progrès social sans lequel la démocratie politique devient vite une expression vide de sens[2].
Jean-Pierre Després, 1946
Le droit social est un objet historique complexe qui ne se présente jamais comme un corpus intégré de normes relativement stables dans le temps et dans l’espace. Des traditions sociopolitiques, juridiques et culturelles diverses ont en effet généré des régimes très différents composés de droits collectifs du travail, de droits individuels à des prestations sociales, de droits fondamentaux énoncés dans les chartes, de dispositifs législatifs et réglementaires, etc. Bien que suggestive, la thèse classique de Thomas H. Marshall, présentant l’histoire de la citoyenneté sociale comme le produit de la reconnaissance étatique successive des droits civils, politiques et sociaux, n’est plus tenable face à cette diversité. Elle l’est d’autant moins que le développement de ces régimes de citoyenneté a été vécu très différemment non seulement selon la classe sociale, comme l’a bien reconnu Marshall, mais aussi selon les identités de genre, de race ou d’ethnicité. Enfin, le renversement, à partir du tournant des années 1980, de la tendance à une reconnaissance progressive de droits sociaux montre bien que les régimes de citoyenneté peuvent coexister avec une croissance significative des inégalités[3].
L’historien Jean-Marie Fecteau a proposé une généalogie moins linéaire du droit social en insistant sur le point de rupture que représente la crise de l’ordre juridique libéral à la fin du XIXe siècle. Les transformations sociales impulsées par le capitalisme industriel auraient alors remis en cause les fondements individualistes de cet ordre juridique. Selon Fecteau, deux principales voies de sortie de crise sont alors envisagées dans les sociétés de tradition juridique libérale. La première est ce qu’il nomme la voie d’un « pluralisme normatif associatif », c’est-à-dire un droit du social reconnaissant à des associations, par exemple aux organisations syndicales et patronales dans leurs secteurs d’activité économique, un pouvoir de définition et d’application du droit. La seconde est celle du « monopole normatif étatique » qui s’impose avec les politiques sociales et économiques keynésiennes adoptées à partir des années 1940. Pour Fecteau, toute évaluation historique de la montée en puissance de l’État social keynésien, ou « fordiste », nécessite de prendre en compte le rejet simultané d’un droit du social reposant sur la reconnaissance d’un pouvoir d’élaboration du droit aux associations de la société civile. Ce rejet d’une démocratie sociale aurait été partiellement compensé par la reconnaissance étatique de droits sociaux aux individus, mais sans que ces derniers se fassent reconnaître un contrôle effectif sur leurs modalités d’application[4].
L’historiographie s’est principalement intéressée à ces droits sociaux définis au Québec et au Canada par la législation sur l’assurance-chômage, les allocations familiales, la sécurité de la vieillesse, l’assurance-maladie, etc. Ces études ont bien analysé l’instauration d’un régime de citoyenneté fondé sur la reconnaissance étatique de droits sociaux aux personnes en tant qu’individus, et non en tant que membres de collectivités constituées dans le cadre des relations de travail[5]. Ces études, y compris celles de Fecteau, ont donc accordé peu d’attention à l’analyse d’une conception collective d’un droit du social encore dynamique au Québec dans la première moitié des années 1940[6]. Des travaux récents, comme ceux du juriste français Alain Supiot, nous invitent cependant à corriger cet oubli en rappelant que le projet initial de l’État social est
[…] d’ajouter à l’ordre juridique une nouvelle dimension – celle de l’autodétermination collective – qui ne se confond ni avec la dimension horizontale des rapports du droit privé, ni avec la dimension verticale des rapports de droit public. La reconnaissance de cette dimension collective permet de faire procéder la règle de droit de la libre association des individus, des conflits d’intérêts qui les opposent et des compromis auxquels ils parviennent. […] La place ainsi concédée aux libertés collectives dans l’élaboration du droit est le trait le plus distinctif de l’État social[7].
Cet article propose donc de jeter un éclairage sur la présence de cette conception d’un droit du social émanant de la libre association et de l’autodétermination collective au Québec, une opération qui peut être riche d’enseignements sur la formation de l’État social au début des années 1940, tout comme sur la nature des conflits autour de celui-ci jusqu’à nos jours. Dans la première partie de cet article, nous étudierons le projet, formulé dans le contexte du mouvement de réforme incarné par le gouvernement libéral d’Adélard Godbout (1939-1944), d’une élaboration démocratique du droit du social par l’entremise du régime des conventions collectives d’ordre public. Dans la deuxième partie, nous verrons comment Jean-Pierre Després[8], intellectuel et fonctionnaire du ministère provincial du Travail, a justifié ce projet de reconnaissance d’un droit du social, sans laquelle « la démocratie politique devient vite une expression vide de sens », en s’inspirant des activités de l’Organisation internationale du Travail (OIT)[9]. J.-P. Després est alors un observateur attentif des travaux du Bureau international du Travail (BIT), le service de secrétariat et de recherche de l’OIT qui s’est réfugié à Montréal entre 1940 et 1946 pour échapper à l’invasion allemande en Europe.
Les conventions collectives d’ordre public
Dès son élection en 1939, le gouvernement libéral d’Adélard Godbout s’engage dans la voie de nombreuses réformes sociales. Au cours de son mandat qui se termine en 1944, il adopte la Loi accordant aux femmes le droit de vote et d’éligibilité, participe à la création des systèmes d’assurance-chômage et d’allocations familiales, nomme une commission d’étude sur les hôpitaux et l’assurance-maladie, reconnaît le droit des enfants à l’éducation publique, fait la promotion de la protection de la jeunesse, crée la société d’État Hydro-Québec, et plus encore[10]. Plus important pour notre propos, il entreprend en 1940 de réformer la législation relative à la convention collective et au salaire minimum qui avait été discréditée aux yeux du mouvement ouvrier durant le mandat du gouvernement de l’Union nationale de Maurice Duplessis (1936-1939). Grâce à cette réforme législative, le droit du social apparaît dans l’ordre juridique aux côtés des droits privé et public, en tant que produit des libertés collectives dans le domaine des relations de travail.
Adoptées en 1940, la Loi du salaire minimum et la Loi de la convention collective font explicitement référence aux notions de justice sociale, de dignité et de besoins fondamentaux associées au nouveau langage des droits de la personne[11]. Fait révélateur, leur préambule contient une première partie identique, ce qui témoigne de leur complémentarité dans l’esprit du Législateur : « Considérant que la justice sociale impose la réglementation du travail lorsque la situation économique entraîne pour le salarié des conditions contraires à l’équité ; Considérant que tolérer l’acceptation forcée d’une rémunération insuffisante c’est ne pas tenir compte de la dignité du travail et des besoins du salarié et de sa famille ». Tout aussi révélateur est le fait que la seconde partie du préambule de chaque loi introduit une hiérarchie dans cette complémentarité. La Loi du salaire minimum est d’abord présentée comme une législation résiduelle : « Considérant que s’il est préférable que la réglementation nécessaire soit faite par le moyen de conventions collectives rendues obligatoires, il faut cependant, lorsque cette méthode n’est pas applicable, prévoir la fixation, par une corporation publique, des minima de salaires requis pour empêcher les abus ». La Loi de la convention collective est quant à elle présentée comme le socle de la protection sociale des salariés : « Considérant qu’il est opportun d’adopter, d’étendre et de rendre obligatoires les conditions de travail consignées dans les conventions collectives, tant pour prévenir la concurrence déloyale faite aux signataires que pour établir le juste salaire et satisfaire à l’équité[12] ».
Le Législateur reconnaît donc la contribution des associations d’employés et de patrons à l’élaboration du droit du travail par le biais de conventions collectives « obligatoires » d’ordre public, c’est-à-dire ayant force de loi non seulement pour les signataires du contrat, mais aussi pour l’ensemble des salariés du secteur économique concerné. L’esprit de la législation peut être mieux compris si on revient à l’adoption, en 1934, de la Loi sur l’extension des conventions collectives (loi Arcand) introduite par le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau. La loi Arcand accorde au ministre du Travail le pouvoir de rendre obligatoires par décret, à la demande des parties ouvrières et patronales contractantes, certaines dispositions d’un contrat collectif de travail ayant acquis « une signification ou une importance prépondérante » dans un secteur économique. En 1934, seules les dispositions relatives aux salaires et aux heures de travail peuvent faire l’objet d’une convention collective d’ordre public. La législation autorise au cours des prochaines années l’ajout d’autres dispositions, comme certaines normes relatives à l’apprentissage et à l’organisation du travail. Le ministre du Travail Arcand donne les raisons qui l’ont motivé à présenter ce projet de loi : « le gouvernement pouvait, [face aux nombreuses plaintes de travailleurs insatisfaits du niveau des salaires durant la crise], prendre trois attitudes : ne rien faire ; agir d’autorité par l’établissement du salaire minimum légal [pour les hommes] ; ou, enfin, collaborer avec les patrons et les ouvriers par la méthode des conventions collectives de travail rendues obligatoires[13] ».
En adoptant cette loi, le gouvernement entend ainsi reconnaître, en partie, la capacité d’élaboration du droit des associations de salariés et des patrons. Ainsi, il ne confie pas le pouvoir d’application et de modification d’une convention collective à l’État, mais bien à un comité paritaire composé d’un nombre égal de représentants de salariés et d’employeurs du secteur économique concerné, auxquels peuvent toutefois s’ajouter des membres désignés par le ministre du Travail. Ces comités se font reconnaître une personnalité juridique qui leur accorde notamment les pouvoirs d’élaborer des règlements, de recevoir des plaintes, d’enquêter sur les lieux de travail, d’exiger la tenue de livres et de sanctionner les salariés et les employeurs déviants. Bien que le ministère du Travail exerce un rôle important dans la décision de donner ou non force de loi à une convention, ou même d’en modifier les termes selon certaines conditions, l’avocat et professeur de l’Université Laval Léo Pelland insiste sur le fait que les « Comités paritaires sont la pièce maîtresse de toute cette réorganisation professionnelle[14] ».
Dans l’historiographie, la loi Arcand, et les comités paritaires qu’elle institue, est généralement présentée comme une première pièce dans l’édifice corporatiste promu par un groupe d’intellectuels nationalistes canadiens-français gravitant autour de l’École sociale populaire et sa conception rigide de la doctrine sociale de l’Église[15]. C’est en partie le cas, mais il faut rappeler que le principe de l’extension juridique de la convention collective n’est pas spécifiquement corporatiste, catholique ou nationaliste. Lors de la présentation de son projet de loi, le ministre Arcand évoque bien sûr la lettre pontificale Quadragesimo Anno, qui mentionne la reconstitution « des corps professionnels », mais il s’appuie aussi sur les travaux du BIT qui témoignent bien du fait que le principe de l’extension juridique de la convention collective a été adopté dans des pays de traditions culturelles et religieuses différentes[16]. Le fait qu’un observateur aussi attentif que Leonard Marsh n’évoque à aucun endroit le corporatisme dans son analyse critique et minutieuse d’une vingtaine de pages de la loi Arcand invite à nuancer l’interprétation de la législation sur les conventions collectives d’ordre public comme un projet essentiellement corporatiste[17].
L’aspect crucial de cette législation est donc qu’elle reconnaît aux organisations professionnelles la capacité d’élaborer le droit non seulement pour leurs membres, mais également pour les parties non contractantes de leur secteur économique, y compris les salariés non syndiqués. Cette précision est importante puisqu’elle permet de comprendre pourquoi le régime des conventions collectives d’ordre public reconnaît la liberté individuelle d’association et le pluralisme syndical, deux enjeux sur lesquels nous reviendrons. Une fois son extension décrétée, un contrat de travail devient ainsi une « convention collective à juridiction provinciale[18] », c’est-à-dire d’ordre public et obligeant tous les employés et employeurs d’un secteur visé. L’esprit de la législation est bien compris par Le Monde ouvrier, une revue qui s’adresse aux syndicats internationaux du Québec ayant très peu d’affinités avec la doctrine sociale de l’Église et son courant corporatiste. Elle explique son appui à la loi dans ces termes : avant le régime d’extension, « le contrat collectif de travail intervenu entre une union ouvrière et un groupe d’employeurs couvr[ait] uniquement ceux qui sont parties contractantes mais non pas les autres. […] Que valait alors un contrat collectif si tous n’étaient pas obligés de s’y conformer[19] ? »
Le spécialiste en droit du travail Jean Bernier a souligné que la loi québécoise s’inspire notamment de la législation française, qui a reconnu le principe de l’extension des conventions collectives en 1919[20]. Comme l’affirme le sociologue français Claude Didry, cette législation reconnaît un droit du social, puisque l’action des travailleurs organisés « est à même d’engager l’ensemble des membres de la communauté professionnelle », et donc qu’elle est « comparable à celle du pouvoir politique, [en ce qu’elle] est de l’ordre de la souveraineté dans le domaine des relations professionnelles[21] ». Soulignons qu’au milieu des années 1930, le régime d’extension est même revendiqué par le Front populaire, une coalition de partis de gauche qui réussit à faire adopter le principe des conventions collectives de branche, une pièce centrale du droit du travail en France jusqu’à ce jour, si on fait exception de sa suppression durant la période du régime « corporatiste » de Vichy. À l’évidence, les conventions collectives d’ordre public ne se résument pas à une composante de l’idéologie corporatiste.
La législation québécoise sur les conventions collectives d’ordre public a eu un certain impact sur les relations de travail. Jacques Rouillard estime qu’une quarantaine de conventions collectives d’ordre public ont été adoptées avant décembre 1935. Six années plus tard, c’est environ 17 000 employeurs et 130 000 salariés qui sont régis par une convention, principalement dans les secteurs de la construction, de la chaussure, de l’imprimerie et du vêtement[22]. L’élection du gouvernement de l’Union nationale en 1936 contribue toutefois à discréditer la législation. Des amendements à la législation donnent par exemple au gouvernement le pouvoir de modifier unilatéralement les termes d’une convention collective, minant ainsi la souveraineté des comités paritaires[23]. De plus, le contrôle fédéral des salaires, imposé en 1941 dans le contexte de la planification économique de guerre, paralyse le développement des conventions collectives jusqu’en 1946, et ce malgré la réforme de 1940 apportée par le gouvernement Godbout[24]. En conséquence, le régime des conventions collectives est de plus en plus menacé en tant que principal mécanisme de régulation des relations de travail au Québec. Il subit d’ailleurs la concurrence d’un autre modèle d’encadrement juridique des relations de travail qui se développe rapidement aux États-Unis à la suite de l’adoption du National Labor Relations Act (Wagner Act) en 1935.
Au tournant des années 1940, une partie du mouvement syndical québécois, celle qui a les contacts les plus étroits avec le syndicalisme états-unien, revendique avec de plus en plus d’insistance un régime de relations de travail inspiré du Wagner Act, et non de celui des conventions collectives d’ordre public[25]. À la différence de la loi Arcand, le Wagner Act définit une « convention collective » comme un contrat de travail d’ordre privé entre un syndicat d’employés et un employeur dans le cadre d’une entreprise. Un tel contrat n’a donc pas pour fonction de réglementer l’ensemble d’un secteur économique, comme c’est le cas d’une convention collective d’ordre public. À la différence de la loi Arcand, toutefois, le Wagner Act offre une plus grande protection légale aux syndicats sur les lieux de travail, en confiant à l’organisation majoritaire le monopole de la représentation des intérêts des salariés concernés au sein d’une entreprise[26]. En conséquence, la viabilité d’un contrat de travail collectif d’ordre privé selon le Wagner Act dépend ultimement de la sanction d’un marché très peu réglementé, c’est-à-dire que ce contrat devra offrir une certaine protection aux employés syndiqués sans toutefois miner la position de l’entreprise face à ses concurrents. Pour plusieurs entreprises, ce fragile équilibre sera atteint par des gains de productivité selon une organisation du travail « fordiste »[27]. Étant donné l’intégration économique des États-Unis et du Canada, ce régime a évidemment une très grande force d’attraction auprès d’une bonne partie du mouvement syndical québécois et canadien.
C’est pourquoi, en 1943, le ministre provincial du Travail Edgar Rochette confie à son Conseil supérieur du travail (CST) le mandat de faire des recommandations afin d’adopter un projet de loi inspiré du Wagner Act[28]. Créé en 1940 par le gouvernement Godbout, le CST est un conseil tripartite sous l’autorité du ministre du Travail. Conçu comme une organisation démocratique représentative, le CST est composé de 24 membres votants, dont huit représentants syndicaux, huit représentants patronaux et huit spécialistes des questions économiques et sociales, dont George-Henri Lévesque[29]. À ce groupe s’ajoutent six « membres adjoints » provenant du ministère du Travail et de celui de l’Industrie et du Commerce. Le fait que ces membres adjoints représentant l’État soient non votants témoigne de la volonté de s’en remettre à l’autodétermination collective des douze représentants des organisations professionnelles dans la réglementation du travail, tout en laissant la « balance du pouvoir » aux six experts nommés par le gouvernement[30]. J.-P. Després est nommé secrétaire non votant du CST, une nomination qu’il doit sans doute en bonne partie à une recommandation de G.-H. Lévesque.
Toujours en 1943, le CST transmet au ministère du Travail ses douze recommandations adoptées à l’unanimité. Bien que le CST soit favorable à une législation similaire au Wagner Act, deux de ses recommandations témoignent d’une crainte quant à son impact sur les conventions collectives d’ordre public. Premièrement, le CST rejette le principe du monopole de représentation syndicale des salariés d’une entreprise, une préoccupation qui répond aux intérêts du syndicalisme catholique qui compte plusieurs sympathisants au sein du conseil. Cela dit, puisque les conventions collectives d’ordre public doivent en principe s’étendre à tous les salariés (syndiqués ou non) d’un secteur économique, elles ne nécessitent pas de restreindre la liberté d’association des salariés en imposant le monopole de représentation au syndicat majoritaire, une disposition centrale du Wagner Act. Deuxièmement, le CST recommande la création d’un tribunal du travail indépendant, composé d’un nombre égal d’avocats spécialistes et de représentants salariés et patronaux afin d’appliquer la loi. Cette recommandation reconnaît donc la souveraineté des associations professionnelles dans le domaine des relations de travail. Le CST s’oppose ainsi à la création d’une commission nommée par le pouvoir exécutif comme c’est le cas aux États-Unis. Ces deux recommandations sont finalement rejetées par le ministre provincial du Travail, qui présente en 1944 son projet de loi sur les relations ouvrières. Pour la première fois de sa jeune existence, le CST condamne à l’unanimité la position du gouvernement libéral, qui prétend pourtant publiquement agir en parfaite continuité avec ses recommandations[31].
Cette condamnation témoigne visiblement de l’inquiétude du CST à l’endroit de la nouvelle législation, qui risque d’interférer avec le développement du régime des conventions collectives d’ordre public. Les sources consultées ne nous permettent malheureusement pas de connaître avec précision l’avis de l’ensemble des membres du CST à ce sujet, mais nous savons que son secrétaire J. -P. Després souligne à plusieurs reprises sa préférence pour les conventions collectives de la loi Arcand. Ces dernières permettraient, selon lui, une élaboration démocratique d’un droit du travail qui assurerait une bien plus grande protection à la classe ouvrière. Rappelant les considérants de la législation de 1940 sur la justice sociale et la dignité des salariés, il soutient que ce régime est « la technique par excellence des unions ouvrières […] par laquelle il est possible de fixer une réglementation générale des salaires et des conditions de travail » et qu’elle « a surtout le mérite d’être essentiellement démocratique car elle reconnaît à la fois les droits et les obligations du patronat et du travail organisé[32] ». Il ajoute :
L’État n’absorbe pas les associations professionnelles, mais délègue à celles-ci un pouvoir réglementaire qui a force de loi dans les sphères qui relèvent de leur compétence. Tels sont les principes généraux que l’on doit trouver à la base d’un régime d’organisation professionnelle vraiment démocratique. Les lecteurs qui connaissent la loi [d’extension] de la convention collective se sont sans doute aperçus que nous venons d’en esquisser les grandes lignes […][33].
Malgré ses limites, la législation des conventions collectives d’ordre public suscite donc l’espoir dans le contexte des réformes sociales du début des années 1940. On peut le constater lorsque le CST est mandaté, aussi en 1943, pour réaliser un mémoire sur la législation ouvrière et sociale en vigueur au Québec. Ce mandat est confié à la suite de la publication, quelques mois plus tôt, du Rapport sur la sécurité sociale de Leonard Marsh, lui-même fortement inspiré par le Report on Social Insurance and Allied Services de William Beveridge paru en 1942. Le CST confie donc à G.-H. Lévesque et J.-P. Després le mandat de rédiger un mémoire qui doit servir de guide factuel et technique pour orienter les réflexions du conseil sur une foule de sujets. En peu de temps, ils produisent une recension minutieuse et factuelle de la législation provinciale et fédérale pertinente, et de son impact sur le droit d’association et de grève, la réglementation du travail, ainsi que les différents dispositifs de protection sociale existants[34].
La correspondance conservée aux archives de G.-H. Lévesque contient un texte de J.-P. Després qui n’a pas été retenu dans la version finale du mémoire, sans doute parce qu’il ne décrit pas la législation, mais présente plutôt sa conception du droit social. Critiquant les rapports Marsh et Beveridge, il soutient qu’ils défendent une définition minimale et résiduelle de la sécurité sociale, c’est-à-dire « comme la garantie d’un minimum vital à chaque individu » pour faire face à l’insécurité économique de la condition salariale[35]. J.-P. Després croit plutôt qu’il faut aller plus loin et reconnaître à la classe ouvrière un pouvoir d’agir collectif lui permettant de participer à l’élaboration du droit, et donc de pousser les normes de la justice sociale au-delà de la simple subsistance. Il faudrait en somme « procéder à un nouvel aménagement de notre structure économique » afin de reconnaître un droit encore plus fondamental :
Si l’on nous demande quel est le principe qui doit orienter toute la reconstruction économique et sociale d’après-guerre, nous répondons : le droit au travail. En d’autres termes, un emploi pour tous les gens désireux et capables de travailler. Voilà notre conclusion. Les assurances sociales sont nécessaires, voire indispensables. Soit. Mais les prestations d’assurance seront toujours des minima, c’est-à-dire ce qui est absolument indispensable pour subsister. Là n’est pas l’idéal de l’humanité, lorsque nous considérons les progrès techniques de notre civilisation. Subsister est indispensable. Bien vivre, vivre selon les possibilités de notre économie est mieux. C’est ce vers quoi nous devons tendre[36].
Pour le secrétaire du CST, ce sont les conventions collectives d’ordre public qui offrent la meilleure solution au partage des richesses produites par l’économie industrielle. Ces conventions permettraient, à terme, l’élaboration démocratique de droits sociaux qui iraient au-delà d’une simple garantie à la subsistance présentée dans les rapports Marsh et Beveridge. Au moment où le régime de relations de travail inspiré du Wagner Act tend à se répandre au Québec et au Canada, J.-P. Després peut se revendiquer de son côté d’une tendance internationale favorable à la généralisation des conventions collectives d’ordre public. En 1946, il soutient que
[…] les employeurs et les travailleurs conviennent que la convention collective est l’instrument par excellence de la réglementation des conditions de travail. Dans la province de Québec, en particulier, le régime des conventions collectives est très avancé. Grâce à l’extension juridique, il existe dans plusieurs secteurs industriels une convention collective standardisée pour tous les employeurs et les employés des entreprises formant un même secteur industriel. Bref, les associations patronales et ouvrières sont résolument engagées dans la voie des conventions collectives. Nous disposons donc d’un mécanisme qui sera essentiel dans l’application d’un grand nombre de décisions des commissions d’industrie [de l’OIT][37].
Il faut dire que, depuis quelques années, les défenseurs de la législation des conventions collectives au Québec n’ont qu’à regarder vers le Bureau international du Travail (BIT) établi à Montréal pour observer cette élaboration transnationale d’un droit du social.
L’élaboration transnationale du droit du social
Le BIT est le service de secrétariat et de recherche de l’Organisation internationale du Travail (OIT), une institution fondée en 1919 en même temps que la Société des Nations. La fondation de l’OIT est alors justifiée selon l’idée, affirmée dans sa constitution et réclamée par le mouvement ouvrier international, que la « paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ». Malgré son statut de colonie britannique sur la scène internationale, le Canada est admis en 1919 à l’OIT en tant que l’une des huit « puissances industrielles », ce qui lui procure un siège permanent au sein de son conseil d’administration. Puisque les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre en 1940, l’OIT accepte l’offre du gouvernement fédéral et de l’Université McGill d’établir son service de secrétariat et de recherche à Montréal[38]. Une fois la guerre terminée, le BIT regagne donc ses bureaux à Genève, suivi d’ailleurs par J. -P. Després qui devient fonctionnaire de cette organisation en 1946.
En 1919, le Canada s’est donc engagé à respecter la constitution de l’OIT qui déclare que les gouvernements, syndicats et patrons des pays membres doivent collaborer, selon les mécanismes de la démocratie tripartite, à la mise en place d’un « régime de travail réellement humain », ce qui implique la reconnaissance d’une série de droits économiques et sociaux à la population salariée : réglementation du temps de travail, garantie d’une rémunération suffisante pour vivre convenablement, respect du principe « à un travail égal, un salaire égal », protection contre la maladie, les accidents du travail, la vieillesse et l’invalidité, ou droit à la liberté syndicale. Le Canada appuie également, en 1944, la Déclaration de la Conférence internationale de Philadelphie qui élargit les objectifs de l’OIT. Celle-ci affirme que « tous les êtres humains, quelles que soient leur race, ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales[39] ». Elle annonce ainsi la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies en 1948.
C’est surtout à partir de la Conférence de Philadelphie que J.-P. Després s’engage dans une réflexion sur la compatibilité du contexte québécois à l’élaboration transnationale du droit social que symbolise l’OIT. Tout comme la quarantaine de pays présents à la Conférence de Philadelphie, le Canada désigne une délégation tripartite de quatre membres votants : deux gouvernementaux (le ministre du Travail Humphrey Mitchell et son assistant parlementaire Paul Martin), un syndical (Percy-R. Bengough, du Congrès des métiers et du travail du Canada) et un patronal (William C. Coulter, de l’Association des manufacturiers du Canada). À ces représentants s’ajoutent des dizaines de conseillers techniques et observateurs qui n’ont cependant pas le droit de vote. C’est à la demande du CST et du ministère provincial du Travail que J.-P. Després est nommé « conseiller technique suppléant du délégué gouvernemental canadien[40] ».
De retour de Philadelphie au printemps 1944, le secrétaire du CST rend compte avec grand enthousiasme de l’importance de cette Conférence à la radio, dans les journaux et les revues, ainsi que dans une brochure publiée dans les Cahiers de la Faculté des Sciences sociales de l’Université Laval. Il présente l’événement comme la plus importante conférence de toute l’histoire de l’OIT, « car elle décida de l’avenir de l’Organisation et s’attaqua aux problèmes économiques et sociaux d’après-guerre – embauchage intégral, niveaux de vie, sécurité sociale – dont la solution adéquate assurera la prospérité de tous les peuples ». La Déclaration de Philadelphie incarne selon lui l’espoir d’une démocratie sociale qui viendrait compléter la démocratie politique :
[L]a lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté par lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun […]. La démocratie est précisément le régime politique qui permet de promouvoir les objectifs sociaux qui conditionnent la liberté des peuples et des individus. Refuserons-nous de seconder cette évolution des esprits vers une économie plus humaine[41] ?
La Conférence donne l’occasion à J.-P. Després d’observer l’élaboration tripartite de la juridiction internationale du travail. À partir de ce moment, il insiste de plus en plus sur les « avantages que peuvent retirer les travailleurs de la réglementation internationale, grâce aux divers mécanismes de l’Organisation internationale du Travail[42] ». Reprenant les termes de la Déclaration de Philadelphie, il affirme qu’on « ne conçoit plus que l’ouvrier soit traité comme une marchandise sur le marché du travail » et que
[d]e nombreuses législations établissent des conditions minima que doivent respecter les employeurs sous peine de poursuites judiciaires. Bien plus, les gouvernements de tous les pays ont signé des conventions internationales par lesquelles ils s’engagent à rendre obligatoires tel et tel standard de travail. Pour résumer, un Droit social est en gestation. […] Aujourd’hui il ne reste plus qu’à perfectionner les méthodes de collaboration tripartite (l’État, l’union ouvrière et l’employeur) qui sont l’aboutissement normal des relations industrielles[43].
L’enthousiasme de J.-P. Després pour l’OIT se maintient malgré le conflit opposant le CST et le gouvernement provincial libéral au moment de l’adoption de la Loi des relations ouvrières. Il se maintient aussi au moment de l’élection du parti de l’Union nationale de Maurice Duplessis au mois d’août 1944. Le changement de gouvernement signifie même une promotion pour J.-P. Després. Il est ainsi nommé chef adjoint intérimaire du cabinet de Maurice Duplessis, puis promu directeur général des nouveaux services d’information du ministère du Travail, sous la responsabilité d’Antonio Barrette. Ce dernier lui confie en conséquence la coordination de la 95e session du Conseil d’administration de l’OIT qui se tient à l’Assemblée législative du Québec en juin 1945. En octobre, J.-P. Després accompagne le ministre Barrette à la 27e Conférence internationale du Travail à Paris, dont l’enjeu majeur est l’intégration de l’OIT à la nouvelle Organisation des Nations Unies. À l’été 1946, il se fait confier l’important mandat de coordonner l’organisation de la 29e Conférence internationale du Travail, tenue sous les auspices de l’Université de Montréal[44].
Malgré son enthousiasme pour l’OIT, J.-P. Després prend de plus en plus conscience des difficultés d’une participation du Québec à l’élaboration transnationale du droit social. En effet, les perspectives de collaboration des gouvernements provincial et fédéral pour le développement de la législation sociale ne sont guère réjouissantes alors que les mesures d’assistance durant la crise économique, la planification économique de guerre, le plébiscite sur la conscription de 1942 et les projets de politiques sociales inspirés du Rapport Marsh alimentent une crise constitutionnelle qui favorise l’élection du parti de l’Union nationale en 1944. À cela s’ajoutent les difficultés constitutionnelles rencontrées dans l’application de la juridiction internationale du travail au Québec et au Canada. Ces difficultés sont bien connues depuis la création de l’OIT, et concernent tous les États fédératifs comme le Canada ou les États-Unis. Brièvement, soulignons qu’une convention adoptée lors d’une Conférence internationale du Travail entraîne l’obligation pour le pays membre de la présenter à son parlement afin qu’elle soit discutée et adoptée, liant de cette façon les législations nationale et internationale. Ce mécanisme est toutefois difficile à appliquer au Canada, dans la mesure où l’autorité fédérale, qui détient le pouvoir constitutionnel de ratifier les conventions internationales, n’a pas celui de faire adopter ou d’appliquer une législation sociale[45]. Si bien qu’en 1944, le Canada n’a toujours ratifié que 9 des 67 conventions de l’OIT, dont la majorité porte sur le travail maritime, de compétence exclusivement fédérale[46].
J.-P. Després est bien conscient qu’une délégation des pouvoirs de l’État provincial au niveau de l’État fédéral pour résoudre le problème d’application des conventions internationales, telle que proposée par la Commission royale sur les relations entre le Dominion et les provinces (Rowell-Sirois), serait décriée par plusieurs, et notamment par le gouvernement du Québec, comme une atteinte sévère à « l’autonomie provinciale ». Il explore en conséquence un projet de « procédure sauvegardant l’autonomie des provinces tout en permettant au Canada de prendre pleinement ses responsabilités dans le développement de la législation du travail sur le plan international[47] ». Il le formule pour la première fois au moment de sa participation à la préparation de la position constitutionnelle du gouvernement provincial à l’occasion de la Conférence fédérale-provinciale de reconstruction en août 1945. Cette conférence, impliquant 200 délégués des gouvernements provinciaux, aborde les propositions ambitieuses du comité fédéral sur le plein emploi, l’assurance-maladie, les travaux publics, la sécurité de la vieillesse et le prélèvement fédéral de l’impôt[48]. Le moment semble donc propice à J.-P. Després pour proposer un mécanisme de négociation interprovinciale afin de contourner les problèmes constitutionnels de ratification et d’application des conventions internationales. Il se confie à G.-H. Lévesque sur ce projet :
[C]oncernant la Création d’une Commission interprovinciale du Travail qui serait permanente en vue d’aboutir à une plus grande uniformité de la législation du travail entre les diverses provinces. Tout mon plan est basé sur la structure et le mécanisme de l’O.I.T., sauf l’obligation formelle des provinces de ratifier les recommandations d’une telle Commission qui tiendrait des conférences annuelles dans chaque province, à tour de rôle. Il s’agirait d’une Commission véritablement interprovinciale et non d’une Commission fédérale-provinciale. Hon. Barrette doit soumettre mon projet à Duplessis. – Peut-être se réalisera-t-il dans quelques mois. Ce projet est strictement confidentiel pour le moment[49].
Le CST serait ainsi appelé à jouer un rôle important dans cette solution constitutionnelle puisqu’il « repose sur un principe d’organisation professionnelle très démocratique ». Chaque province devrait créer une instance similaire au CST qui aurait la responsabilité de nommer des représentants des salariés, des employeurs et des experts au sein du Comité interprovincial du Travail.
Ce Comité permettrait d’intéresser d’une façon permanente les employeurs et les travailleurs à l’oeuvre de l’Organisation internationale du Travail. L’une des premières tâches du Comité consisterait à analyser la législation de chaque province en fonction des conventions et des recommandations de la Conférence internationale du Travail. […] Sans un mécanisme pouvant déclencher un mouvement d’ensemble chez les gouvernements provinciaux et les organisations professionnelles patronales et ouvrières, la force de l’inertie administrative conservera le dessus[50].
Toutes ces difficultés constitutionnelles semblent avoir eu raison du projet de J.-P. Després pour l’élaboration d’un droit du social qui serait davantage qu’une simple garantie à un minimum de subsistance. Délaissant apparemment l’idée que les salariés devraient bénéficier pleinement des progrès techniques et économiques, il se replie à partir de ce moment sur la notion de droits sociaux minima. Ce déplacement semble conforter J.-P. Després lorsqu’il contemple « l’hypothèse invraisemblable » qu’une province puisse s’opposer aux
[…] conventions internationales de travail [lesquelles] fixent toujours des minima. On ne voit pas comment une province pourrait éventuellement rappeler une loi fixant des conditions de travail considérées dans les autres pays et les autres provinces du Canada comme des minima. Et si cela devait arriver, une province qui agirait de la sorte à l’égard de la classe ouvrière ne pourrait oser revendiquer son autonomie. Le principe de l’autonomie comporte des responsabilités qu’une province ne doit pas éluder. Cette forme de délégation de pouvoirs ne met aucunement l’autonomie des provinces en danger[51].
Ce projet de création d’un Comité interprovincial du Travail ne suscite toutefois aucunement l’intérêt du gouvernement de l’Union nationale, qui compte précisément sur « la force de l’inertie administrative » et les difficultés constitutionnelles pour s’opposer à la reconnaissance de droits sociaux. Durant la Commission fédérale-provinciale de la reconstruction, Duplessis fait ainsi vigoureusement campagne sur le thème de l’autonomie provinciale, sans proposer un modèle provincial d’État social[52]. « L’hypothèse invraisemblable » évoquée par J.-P. Després est bientôt confirmée par les actions du gouvernement Duplessis, qui s’attaque aux droits syndicaux, s’engage dans la répression du mouvement ouvrier et abandonne divers projets comme un programme provincial d’assurance-maladie que le secrétaire du CST avait énergiquement défendu[53]. Le temps de la réforme est donc bien terminé en 1946. C’est dans ce contexte que J.-P. Després, après avoir organisé la Conférence internationale du Travail de Montréal et terminé sa thèse de doctorat sur l’OIT et le Canada, décide de quitter le ministère provincial du Travail pour devenir fonctionnaire du BIT à Genève.
Conclusion
Cet éclairage historique nous a donné l’occasion de présenter une conception du droit social prenant pour appui la législation sur les conventions collectives d’ordre public adoptée en 1934. Reconnaissant les principes de la liberté associative et de l’autodétermination collective dans le domaine des relations de travail, cette législation pose plus précisément les bases d’une reconnaissance d’un « droit du social », distinct du droit privé et du droit public, dans l’ordre juridique québécois. Cette reconnaissance d’un droit du social suscite toujours un grand espoir au tournant des années 1940, alors qu’un gouvernement libéral réformateur est élu à Québec et que Montréal accueille le service de recherche et de secrétariat de l’OIT en exil. Cette organisation internationale est à ce moment l’incarnation la plus éclatante du dynamisme du projet d’institutionnalisation d’une démocratie sociale devant consolider la démocratie politique menacée par la montée du fascisme et du communisme en Europe. Pour le réformateur J.-P. Després, les mécanismes de la négociation des normes du travail, depuis les conventions collectives d’ordre public jusqu’aux conférences internationales de l’OIT, en passant par les travaux du CST au sein du ministère provincial du Travail, rendent très prometteuse la voie d’une élaboration démocratique et transnationale d’un droit du social au début des années 1940.
Quelques années plus tard, cet espoir se bute toutefois aux résistances d’un gouvernement provincial hostile au mouvement syndical, ainsi qu’aux droits sociaux. Cependant, c’est peut-être la nouvelle législation du travail inspirée du Wagner Act qui est l’élément le plus déterminant dans l’échec de la reconnaissance d’un droit du social au Québec. En effet, la Loi sur les relations ouvrières de 1944 offre aux organisations syndicales une bien plus grande protection juridique que le régime de conventions collectives d’ordre public en vigueur au Québec. Cette protection est toutefois accompagnée d’une stricte limitation du pouvoir juridique des organisations syndicales à l’élaboration de conventions collectives d’ordre privé[54]. En restreignant ainsi le champ du pouvoir normatif du syndicalisme au territoire de l’entreprise, privée ou publique, cette législation bloque effectivement la voie de la reconnaissance d’un droit du social. Elle contribue par le fait même à baliser le terrain des luttes à venir autour de l’enjeu de la reconnaissance étatique de droits sociaux offrant une protection modeste à certaines catégories de la population, tout en laissant les mécanismes d’un marché peu réglementé redistribuer, le plus souvent inéquitablement, les revenus du travail et du capital.
Appendices
Notes
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[1]
Je tiens à remercier Cory Verbauwhede pour sa contribution très importante à ma recherche et à ma réflexion. Merci à Paul-Étienne Rainville et à Brian Young pour leurs commentaires sur une première version de ce texte. Merci aussi à Isabelle Lespinet-Moret qui a attiré mon attention sur l’histoire de l’Organisation internationale du Travail. J’ai pu compter sur l’aide très appréciée de Milan Busic et de Renaud Béland pour la cueillette d’une partie des sources utilisées dans cet article. Merci enfin à Marcelle Cinq-Mars pour son travail de révision. Cette recherche a bénéficié du soutien financier du FRQ, du CRSH et de la FCI.
-
[2]
Jean-Pierre Després, Le Canada et l’Organisation internationale du Travail, Montréal, Fides, 1946, p. 223.
-
[3]
Thomas H. Marshall, Citizenship and Social Class, London, Pluto Press, 1992 [1950]. Pour une introduction au champ de recherche de l’histoire de la citoyenneté sociale, voir Martin Petitclerc, « La dimension politique des régulations sociales », dans Martin Petitclerc et al. (dir.), Question sociale et citoyenneté. La dimension politique des régulations sociales (XIXe et XXe siècles), Québec, Presses de l’Université du Québec, 2020, p. 1-20. Sur la croissance des inégalités économiques au Canada, voir Emmanuel Saez et Michael R. Veall, « The Evolution of High Incomes in Canada, 1920–2000 », dans A. B. Atkinson et T. Piketty (dir.), Top Incomes Over the Twentieth Century : A Contrast Between Continental European and English-Speaking Countries, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 226-308.
-
[4]
Jean-Marie Fecteau, « Du droit d’association au droit social : essai sur la crise du droit libéral et l’émergence d’une alternative pluraliste à la norme étatique, 1850-1930 », Revue canadienne Droit et société, vol. 12, no 2, 1997, p. 143-157. Le pluralisme normatif associatif s’apparente à la conception du droit social de Georges Gurvitch : Jean-Guy Belley, « Le “droit social” de Gurvitch : trop beau pour être vrai ? », Droit et société, vol. 88, n° 3, 2014, p. 731-746. Le monopole normatif de l’État social peut également être problématisé dans les termes d’un rapport de consommation « fordiste ». Voir Paul Bélanger et Benoît Lévesque, « La “théorie” de la régulation, du rapport salarial au rapport de consommation. Un point de vue sociologique », Cahiers de recherche sociologique, n° 17, 1991, p. 17-51.
-
[5]
Voir notamment Robert Bureau, Katherine Lippel et Lucie Lamarche, « Développement et tendances du droit social au Canada (1940-1984) », dans A. Lajoie et Y. Bernier (dir.), Le droit de la famille et le droit social au Canada, Ottawa, Commission royale sur l’union économique et les perspectives du développement au Canada, 1986, p. 79-147 ; Georges Campeau, De l’assurance-chômage à l’assurance-emploi. L’histoire du régime canadien et de son détournement, Montréal, Boréal, 2001 ; Katherine Lippel, « Le droit des accidentés du travail à une indemnité : analyse historique et critique », Mémoire de maîtrise (sciences juridiques), UQAM, 1986 ; Yves Vaillancourt, L’évolution des politiques sociales au Québec, 1940-1960, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1988 ; Jane Jenson, « Fated to Live in Interesting Times : Canada’s Changing Citizenship Regimes », Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, vol. 30, n° 4, 1997, p. 636-637.
-
[6]
La revendication du mouvement syndical catholique pour la démocratisation de l’entreprise s’inscrit pleinement dans cette histoire. À ce sujet, voir Suzanne Clavette, Les dessous d’Asbestos : une lutte idéologique contre la participation des travailleurs, Québec, Presses de l’Université Laval, 2005. Un certain nombre d’études ont insisté sur l’idéologie corporatiste qui circulait chez les intellectuels nationalistes et catholiques à partir des années 1930, mais sans approfondir le projet « libéral » d’un droit du social qui reconnaîtrait un pouvoir normatif aux corps intermédiaires. Pour Pierre Trépanier, le corporatisme, seule idéologie promouvant l’idée d’une « concertation organisée entre le patronat et le salariat », est exclusivement une « idée de droite » avant les années 1960. Voir Pierre Trépanier, « Quel corporatisme ? (1820-1965) », Les Cahiers des dix, n° 49, 1994, p. 159-162.
-
[7]
Alain Supiot, Grandeur et misère de l’État social, Paris, Collège de France, leçon inaugurale prononcée le jeudi 29 novembre 2012.
-
[8]
Nous préparons un article biographique sur Jean-Pierre Després (1919-1982). Il est l’un des premiers étudiants de l’École des sciences sociales de l’Université Laval. Il devient un protégé de George-Henri Lévesque, qui l’implique dans plusieurs de ses initiatives à l’université, au Conseil supérieur de la coopération et au Conseil supérieur du Travail. En plus des textes mentionnés dans cet article, J.-P. Després a produit la première monographie universitaire en français sur le mouvement ouvrier canadien. Cette monographie, sympathique au mouvement ouvrier, se distingue des études existantes à cette époque par son refus d’opposer le syndicalisme international et le syndicalisme catholique. Voir Jean-Pierre Després, Le mouvement ouvrier canadien, Montréal, Fides, 1946.
-
[9]
Sur l’OIT, voir Isabelle Lespinet-Moret et Vincent Viet (dir.), L’Organisation internationale du Travail : origine - développement - avenir, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, et Joelle Droux et Sandrine Kott (dir.), Globalizing Social Rights. The International Labour Organization and Beyond, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.
-
[10]
Ce mouvement de réformes a notamment été étudié par Dominique Marshall, Aux origines sociales de l’État-providence : familles québécoises, obligation scolaire et allocations familiales, 1940-1955, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1998 ; Renée Joyal et Carole Chatillon, « La Loi québécoise de protection de l’enfance de 1944 : genèse et avortement d’une réforme », Histoire sociale/Social History, vol. 27, no 3, 1994, p. 33-63. Jacques Rouillard a récemment fait un bilan des idées et des réformes du gouvernement Godbout, les situant dans la mouvance sociale-démocrate : Jacques Rouillard, « Aux sources de la Révolution tranquille : le congrès d’orientation du Parti libéral du Québec du 10 et 11 juin 1938 », Bulletin d’histoire politique, vol. 24, n° 1, 2015, p. 125-158.
-
[11]
À ce sujet, voir Dominique Clément, Canada’s Rights Revolution : Social Movements and Social Change, 1937-82, Vancouver, UBC Press, 2008 ; Paul-Étienne Rainville, De l’universel au particulier : les luttes en faveur des droits humains au Québec, de l’après-guerre à la Révolution tranquille, thèse de doctorat (études québécoises), UQTR, 2018.
-
[12]
« Loi de la convention collective » et « Loi du salaire minimum », Statuts de la province du Québec, 4 Georges IV, 1940, chap. 38 et 39.
-
[13]
Débats de l’Assemblée législative du Québec, 18e Législature – 3e session, vol. 1, 8 février 1934, p. 202.
-
[14]
Léo Pelland, « L’extension juridique des conventions collectives de travail », Le Canada français, vol. XXVI, no 7, mars 1941, p. 694.
-
[15]
Pierre Trépanier, loc. cit., p. 174 et suivantes. Pour des interprétations plus nuancées, mais dans le même esprit, voir Jacques Rouillard, « Genèse et mutation de la loi sur les décrets de convention collective au Québec », Labour/Le Travail, vol. 68, 2011, p. 17 ; Céline Saint-Pierre, La première révolution tranquille : syndicalisme catholique et unions internationales dans le Québec de l’entre-deux-guerres, Montréal, Del Busso, 2017, p. 195, 200 et suivantes.
-
[16]
Débats de l’Assemblée législative du Québec, 18e Législature – 3e session, vol. 1, séances du 9 janvier au 8 mars 1934 et séance du 8 février 1934, p. 203. C’est également l’avis du président du Conseil central des syndicats catholiques de Montréal Alfred Charpentier, lui-même promoteur du corporatisme, qui souligne que « les représentants ouvriers, de même que les délégations patronales et gouvernementales à la “Conférence” [internationale du Travail] de 1928 reconnurent que les conventions collectives sont la méthode normale de réglementation ». Alfred Charpentier, « Loi du salaire minimum pour les hommes », La jeunesse ouvrière, vol. III, nos 3-4, décembre-janvier 1935, p. 20. Charpentier considère que l’extension des conventions collectives est « un palier vers une autre réforme plus complète, plus compréhensive : l’organisation corporative de la profession ». Voir « La Question ouvrière », Le Programme de Restauration sociale, Montréal, École sociale populaire, 1934, p. 19-39.
-
[17]
Leonard C. Marsh, « The Arcand Act : A New Form of Labour Legislation ? », The Canadian Journal of Economics and Political Science, vol. 2, n° 3, 1936, p. 418.
-
[18]
Alfred Charpentier, Les mémoires d’Alfred Charpentier, Québec, Presses de l’Université Laval, 1971, p. 151.
-
[19]
« L’extension des conventions collectives de travail », Le Monde ouvrier, samedi 24 août 1935, p. 1.
-
[20]
Jean Bernier, « L’extension des conventions collectives dans le droit du travail : France, Grande-Bretagne et Canada », Relations industrielles, vol. 24, n° 1, 1969, p. 142-144 ; Gérard Hébert, « L’extension juridique et les métiers de la construction au Québec », Relations industrielles, vol. 18, n° 3, 1963, p. 300 ; Céline Saint-Pierre, op. cit., p. 191-193.
-
[21]
Claude Didry, « La production juridique de la convention collective. La loi du 4 mars 1919 », Annales. Histoire, Sciences sociales, vol. 56, n° 6, 1er décembre 2001, p. 1276.
-
[22]
Jacques Rouillard, « Genèse et mutation de la loi… », loc. cit., p. 16. Jacques Rouillard, Le syndicalisme québécois : deux siècles d’histoire, Montréal, Boréal, 2004, p. 65. Voir aussi Gérard Hébert, L’extension juridique des conventions collectives dans l’industrie de la construction dans la province de Québec 1934-1962, Thèse de doctorat (économie), McGill University, 1963. Pour une analyse fine de l’impact de la loi sur l’industrie du vêtement, et notamment sur le renforcement de la division sexuelle du travail, voir Mercedes Steedman, « Canada’s New Deal in the Needle Trades : Legislating Wages and Hours of Work in the 1930s », Relations industrielles, vol. 53, n° 3, 1998, p. 535-563.
-
[23]
Jacques Rouillard, « Genèse et mutation de la loi… », loc. cit., p. 17.
-
[24]
Gérard Tremblay, « Conventions collectives et extension juridique », Relations industrielles, vol. 7, n° 12, 1951-1952, p. 3.
-
[25]
Jacques Rouillard, « Genèse et mutation de la loi… », loc. cit., p. 19-26.
-
[26]
De plus, les contrats collectifs de travail ne sont pas limités aux seules dispositions concernant les salaires, les heures de travail et l’apprentissage, comme c’est le cas dans le régime instauré par la loi Arcand.
-
[27]
Pour une comparaison éclairante des deux régimes, voir Gérard Tremblay, « Conventions collectives et extension juridique », loc. cit., p. 5. Pour un aperçu récent de la régulation fordiste en contexte canadien, voir Gérard Boismenu, Les Trente Glorieuses au Canada : un fordisme à forte tonalité libérale, Montréal, Del Busso, 2020.
-
[28]
« L’hon. E. Rochette nomme une commission patronale pour étudier les relations syndicales », La Gazette du Nord, 27 août 1943, p. 1 ; « Pas de mesures ouvrières dictatoriales… », Le Monde ouvrier, 18 décembre 1943, p. 7.
-
[29]
« Nomination du Conseil supérieur du Travail de Québec », Le Soleil, 27 décembre 1941, p. 1 et 6. Les syndicats catholiques militent pour la création d’un Conseil supérieur du Travail depuis plusieurs années. Voir Denys Chouinard, « Alfred Charpentier face au gouvernement du Québec, 1935-1946 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 31, no 2, 1977, p. 215-219 ; Alfred Charpentier, « Pourquoi un Conseil supérieur du travail ? », Le Travail et La Vie syndicale, vol. XVIII, no 3, mars 1942, p. 7.
-
[30]
« Arrêté en Conseil, Chambre du Conseil exécutif, no 3510, Québec, le 3 janvier 1942 », Archives de l’Université Laval, P151-D3.5, Dossier Nomination des membres du Conseil supérieur du Travail, 1941-1960. La délégation syndicale compte trois représentants « internationaux » de la Fédération provinciale du Travail, trois de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada et deux des syndicats canadiens oeuvrant dans les chemins de fer. Trois des délégués patronaux ont été désignés par l’Association des manufacturiers canadiens ; les autres membres proviennent des associations d’employeurs des pâtes et papiers, de marchands détaillants et de maîtres-imprimeurs, en plus de deux employeurs de pêche et de produits chimiques. Enfin, cinq des « économistes et sociologues » sont universitaires, dont deux proviennent de Laval, un de Montréal, un de McGill et un de l’École des hautes études commerciales. Un membre de la Chambre de commerce de Montréal et un autre de la Fédération des comités paritaires complètent ce groupe de spécialistes puisqu’un siège est alors vacant. Leonard Marsh est nommé en tant qu’expert du CST, mais il le quitte rapidement pour se consacrer à la recherche et à la rédaction du Rapport de la sécurité sociale commandé par le gouvernement fédéral.
-
[31]
Lettre de J.-P. Després à G.-H. Lévesque, Québec, 23 novembre 1943 ; « Procès-verbal de la 17e séance de la Commission permanente du CST tenue à Québec le 31 janvier 1944 ; “Procès-verbal de la 19e séance de la Commission permanente du CST tenue à Montréal le 3 avril 1944”, Archives de l’Université Laval, P151-D3.2, dossier Commission permanente du CST.
-
[32]
Jean-Pierre Després, Le marché du travail et les unions ouvrières, op. cit., p. 10 et 22-23.
-
[33]
Jean-Pierre Després, « Progrès de l’organisation professionnelle », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 1, n° 4, 1945, p. 5.
-
[34]
G. -H. Lévesque et J. -P. Després, Mémoire sur la Législation du travail et la sécurité sociale dans la Province de Québec, Québec, Conseil supérieur du Travail, 1943.
-
[35]
« L’assurance-maladie obligatoire », L’Action catholique, 1er mai 1943, p. 4.
-
[36]
Lettre de J.-P. Després à G.-H. Lévesque (29 mars 1943) et annexe « La Sécurité sociale », Archives de l’Université Laval, P151-D3.4, Dossier Mémoire sur la législation du travail et la sécurité sociale (1943-1945).
-
[37]
Jean-Pierre Després, « Les commissions d’industrie du Bureau international du Travail », La Revue dominicaine, septembre 1946, p. 81-82.
-
[38]
Jean-Pierre Després, Le Canada et l’Organisation internationale du Travail, op. cit. Voir également J. Mainwaring, The International Labour Organization : A Canadian View, Ottawa, Labour Canada, 1986. Sur l’histoire de l’International Labour Organization (ILO) en Amérique du Nord, voir Bernard Delpal, « Le refuge américain de l’OIT (1940-1946). De l’esprit de Genève à l’esprit de Philadelphie, place du syndicalisme dans la stratégie de reconstruction », dans Isabelle Lespinet-Moret et Vincent Viet (dir.), op. cit., p. 107-120.
-
[39]
La Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie sont reproduites dans Jean-Pierre Després, Le Canada et l’Organisation internationale du Travail, p. 235 et suivantes. La Déclaration est en annexe de la Constitution de l’OIT.
-
[40]
« Le Canada aura 32 délégués au congrès de Philadelphie », L’Action catholique, 6 avril 1944, p. 13.
-
[41]
Jean-Pierre Després, La Déclaration de Philadelphie, Québec, Cahiers de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, 1944, p. 14, 28-29 et 33. Pour une analyse des mécanismes du tripartisme à l’OIT ainsi que sur la notion de la démocratie sociale dans la formation de l’État social en France, voir Isabelle Lespinet-Moret, « Santé et citoyenneté au travail, réforme sociale, tripartisme et l’Organisation internationale du Travail (OIT) » et « L’échec de la démocratie en France ou l’impossible promotion citoyenne par la protection sociale », dans Martin Petitclerc et al. (dir.), Question sociale et citoyenneté. La dimension politique des régulations sociales (XIXe et XXe siècles), Québec, Presses de l’Université du Québec, 2020, p. 131-148 et p. 149-164.
-
[42]
« Sur le front du travail », Le Devoir, 10 avril 1945, p. 6 ; « Le marché du travail et les unions ouvrières », Le Monde ouvrier, 7 avril 1945, p. 3.
-
[43]
« Le service social à l’usine », L’Action catholique, 28 mai 1944, p. 3.
-
[44]
« M. J.-P. Després au ministère du Travail », Le Devoir, 25 octobre 1944, p. 3 ; « Une promotion pour J.-P. Després », Le Devoir, 27 octobre 1944, p. 8 ; « Un service d’information », Le Monde ouvrier, 24 février 1945, p. 4 ; « J. -P. Després, chef-adjoint du cabinet de l’U.N. », Le Canada, 25 septembre 1944, p. 2 et 14 ; « Le cabinet élit les membres du Conseil supérieur du Travail », Le Soleil, 24 février 1945, p. 3 et 10. La presse libérale semble satisfaite du fait que « l’hon. M. Duplessis, dans le choix de ses hommes de confiance, a un penchant pour ceux qui ont servi ses adversaires politiques ». « J. -P. Després, chef-adjoint du cabinet de l’U.N. », loc. cit., p. 2 et 14 ; « Important congrès tenu à Québec », Le Devoir, 14 juin 1945, p. 3 ; « Monsieur Barrette se rendra à Rome », Le Devoir, 11 septembre 1945, p. 3 ; « La conférence internationale du Travail s’ouvre à Paris », Le Soleil, 15 octobre 1945, p. 1 ; « La conférence de l’O.I.T. à l’Université », Le Devoir, 3 août 1946, p. 13 ; J.-P. Després, « La Conférence internationale du Travail à Montréal », Revue dominicaine, novembre 1946, p. 54-56.
-
[45]
Ces difficultés avaient été mises en lumière en 1935 avec l’adoption du « New Deal » de Richard B. Bennett, premier ministre du Canada. Ce programme législatif est alors présenté comme une obligation internationale de l’État fédéral découlant de la ratification des conventions de l’OIT relatives au repos hebdomadaire, à la limitation des heures de travail, aux salaires minima et à l’assurance-chômage. Après un intense débat juridique, le Conseil privé avait conclu que la législation était inconstitutionnelle en 1937. J.-P. Després, Le Canada et l’Organisation internationale du Travail, op. cit., p. 169 et suivantes.
-
[46]
Henri Binet, « La participation du Canada à l’Organisation internationale du Travail », dans Raymond Tangue (dir.), Le Canada dans l’ordre international, Montréal, Fides, 1944.
-
[47]
J.-P. Després, La Déclaration de Philadelphie, op. cit., p. 18.
-
[48]
« À la conférence d’Ottawa », Le Soleil, 6 août 1945, p. 3.
-
[49]
Lettre de J.-P. Després à G.-H. Lévesque, St-Jean, Île d’Orléans, 4 août 1945, Archives de l’Université Laval, P151-D11, Dossier Correspondance Després, J.-P., 1939-1990.
-
[50]
Després revient sur ce projet en 1946 : J.-P. Després, Le Canada et l’Organisation internationale du Travail, op. cit., p. 228-229.
-
[51]
Ibid., p. 172.
-
[52]
Voir la position officielle du Québec à cette conférence fédérale-provinciale, Mémoire du Gouvernement de la province de Québec présenté à la Conférence fédérale-provinciale par l’Honorable Maurice L. Duplessis, Premier ministre, Québec, 1946.
-
[53]
J.-P. Després, Quelques aspects de l’assurance-maladie/Some Aspects of Health Insurance, Québec, Cahiers de la Faculté des Sciences sociales, 1943.
-
[54]
Ce qui entraîne par ailleurs une restriction importante de la liberté de grève des salariés. Martin Petitclerc et Martin Robert, Grève et paix : une histoire des lois spéciales au Québec, Montréal, Québec, Lux éditeur, 2018 (chapitre 1).