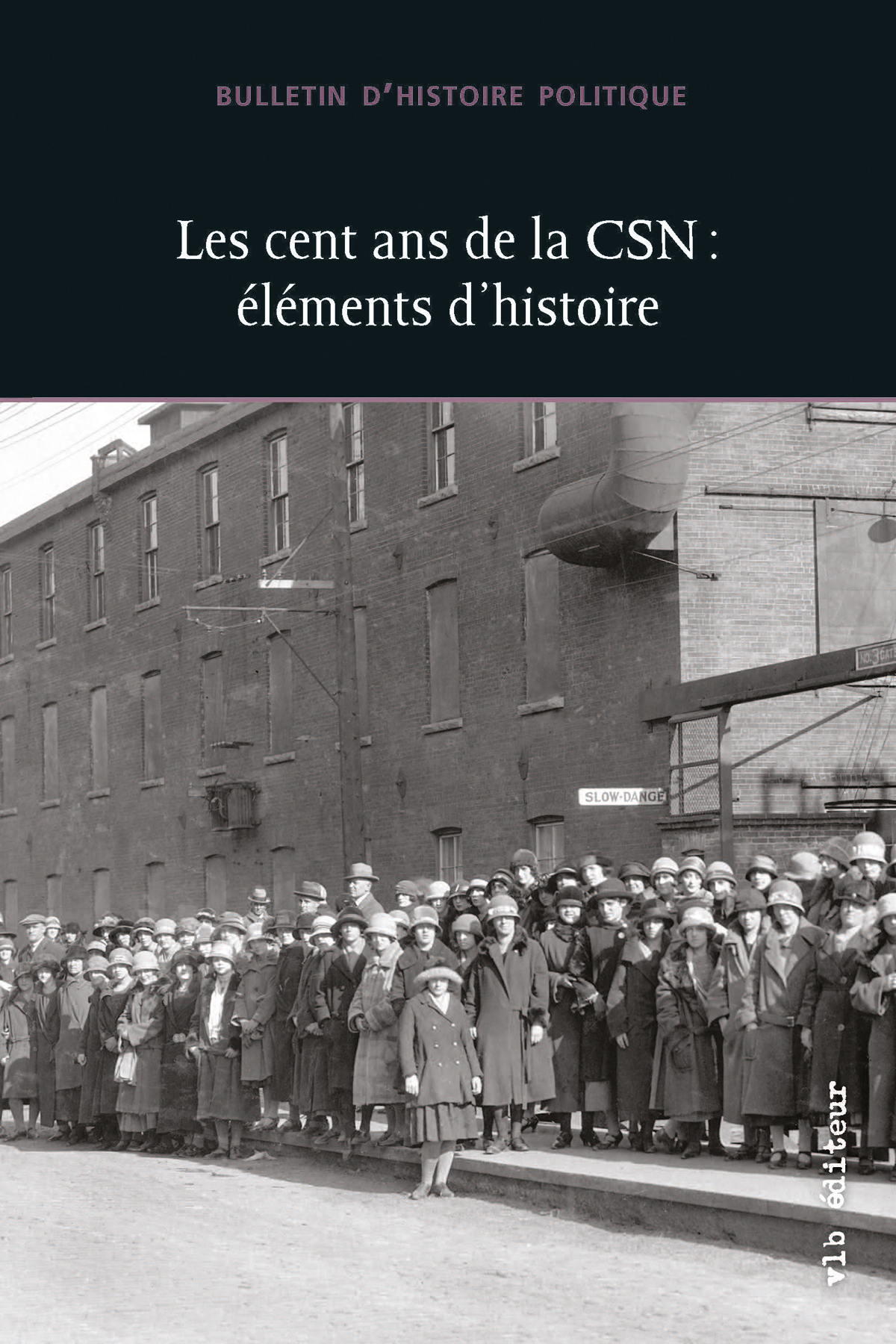Dans l’environnement canadien et nord-américain, la fondation et le développement de la CTCC-CSN représentent une originalité particulièrement significative, car nulle part ailleurs il n’existe une centrale syndicale ayant regroupé un nombre aussi significatif de syndiqués et qui a perduré pendant cent ans. Elle ne montre pas non plus de signe d’une fin prochaine. C’est un exemple du caractère distinctif du Québec dans l’environnement nord-américain, qui se manifestera tout au long de son histoire tant dans son idéologie que dans son action. Dès la fondation des premiers syndicats catholiques au début du XXe siècle, ses dirigeants font la promotion d’un syndicalisme emprunté au modèle du syndicalisme chrétien belge et français. Cette influence européenne déteindra sur l’histoire de la centrale sous différentes formes jusqu’à tout récemment. Son orientation est aussi façonnée par les syndicats dont elle veut contrer l’expansion, qui sont affiliés aux unions dites internationales venues des États-Unis et membres de l’American Federation of Labor. Ces syndicats adoptent l’épithète « international » lorsqu’ils s’implantent au Canada et au Québec à partir de la fin du XIXe siècle. Ils en viennent rapidement à dominer le syndicalisme canadien et ils acquièrent une présence prépondérante au Québec. C’est en tenant compte de ces deux familles syndicales que notre article veut mettre en évidence la façon dont les syndicats catholiques ont manifesté leur singularité dans le paysage syndical pancanadien sous quatre volets : idéologie, nationalisme, pratique syndicale, et législation du travail. Au moment où le clergé catholique s’efforce de mettre sur pied des syndicats, les syndicats internationaux sont déjà bien implantés au Québec. Selon nos estimations, de 20000 membres en 1911, leur nombre atteint 55 000 en 1921. Il ne faudrait pas croire non plus qu’ils soient composés en majorité de travailleurs anglophones et allophones. Au contraire, nous estimons que les francophones constituent entre 70 et 75 % de leurs effectifs. C’est lorsqu’ils s’efforcent de syndiquer des travailleurs à l’extérieur de Montréal que les autorités religieuses s’émeuvent et qu’elles commencent à mettre sur pied des syndicats confessionnels. En janvier 1911, un groupe de prêtres provenant de tous les diocèses de la province se réunissent à Montréal où ils tracent un bilan de la situation du syndicalisme dans chaque diocèse et s’entendent pour recommander à l’épiscopat la fondation d’organisations confessionnelles comme il en existe dans certains pays d’Europe. Les évêques répondent graduellement à cette invitation à mesure que les syndicats internationaux deviennent une menace dans leur diocèse. Des premiers syndicats catholiques sont mis en place à Chicoutimi en 1912, à Trois-Rivières en 1913 et à Thetford Mines et Hull en 1915. À Montréal, une fédération de syndicats catholiques voit le jour en 1914 dans le même but. On reproche aux syndicats internationaux d’inciter à la lutte de classes, de diffuser des idées socialistes et anticléricales, notamment parce qu’ils proposent la nationalisation des entreprises de services publics et réclament l’école publique gratuite et obligatoire. On craint que la classe ouvrière ne soit en train d’être contaminée par les grèves et les idées socialistes comme en Europe et qu’elle échappe ainsi à l’influence de l’Église. Les cinq regroupements de syndicats catholiques fondés avant la guerre se réclament de la doctrine sociale de l’Église telle que définie dans l’encyclique Rerum Novarum (1891). Par son enseignement moral, l’Église ambitionne de transformer la mentalité des employeurs et des salariés en imprégnant leur esprit des valeurs de justice et de charité. Elle compte ainsi pacifier les relations de travail, éliminer les conflits et restaurer la bonne entente avec les employeurs. C’est pourquoi les constitutions des premiers syndicats ne prévoient rien …
La singularité de l’histoire de la CTCC-CSN (1912-1960)[Record]
…more information
Jacques Rouillard
Département d’histoire, Université de Montréal