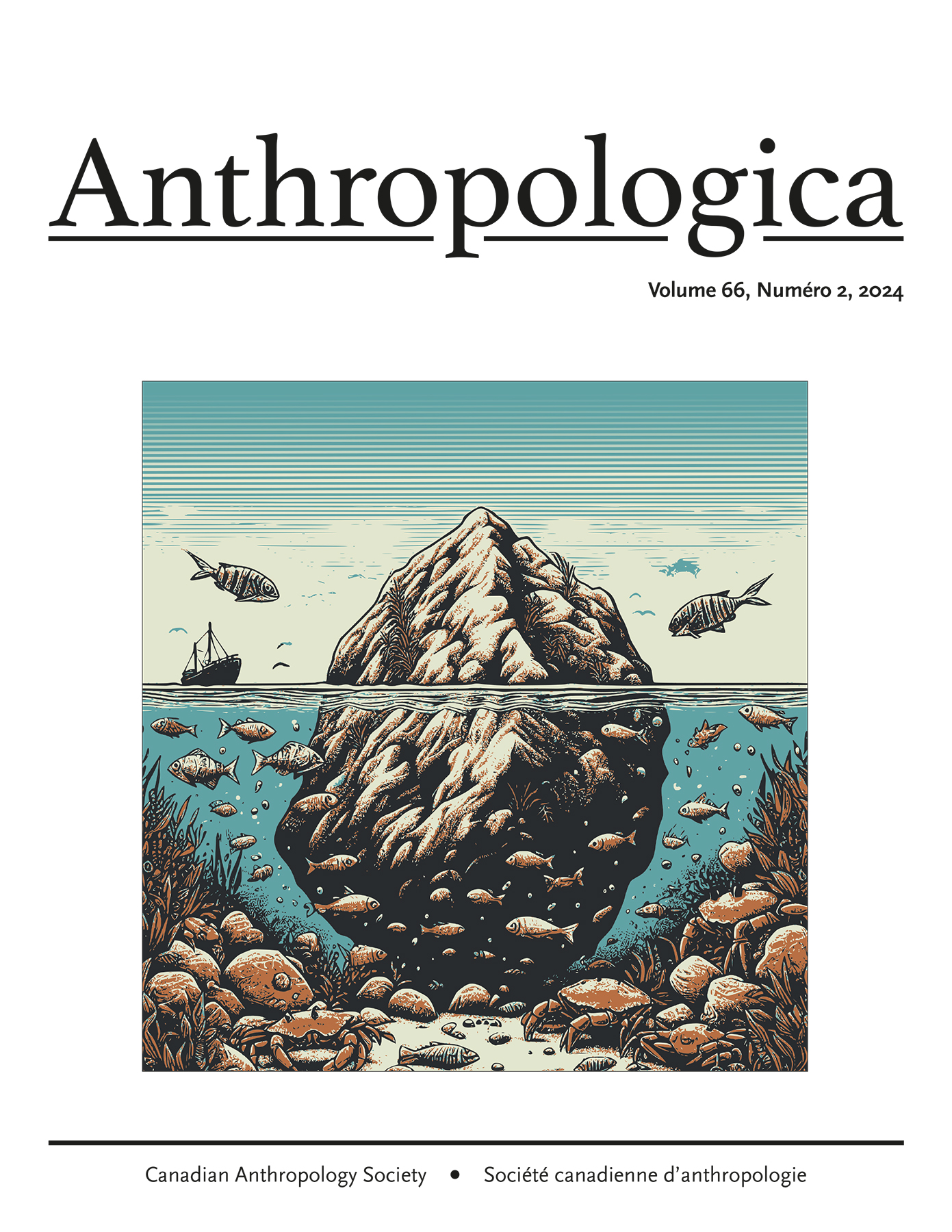Abstracts
Résumé
Vingt-trois ans après les attentats du 11 septembre 2001, l’analyse anthropologique reste cruciale pour appréhender les dynamiques complexes du terrorisme et de la violence. L’anthropologie, en tant que discipline dédiée à l’étude de l’humanité, permet de comprendre que la violence n’est pas un phénomène isolé, mais un outil souvent instrumentalisé pour réguler les sociétés et structurer les rapports de pouvoir. Bien que les évènements du 11 septembre soient fréquemment associés à un extrémisme religieux, il est essentiel de souligner que le terrorisme est un phénomène pluriel, nourri par des facteurs idéologiques, culturels et sociaux variés. Une caractéristique marquante du terrorisme contemporain est la déshumanisation des victimes, souvent réduites à des abstractions telles que « pertes humaines » ou « chiffres de la tragédie ». Parallèlement, les auteurs de ces violences sont parfois représentés comme des « monstres », un mécanisme de déshumanisation réciproque. Ce processus empêche la reconnaissance véritable de la souffrance individuelle, tout en entravant une réflexion plus profonde sur les causes sociales, politiques et économiques de la violence. L’anthropologie offre un éclairage précieux sur ces mécanismes et permet d’ouvrir la voie à une prévention plus efficace des violences futures. La génération interconnectée actuelle, joue un rôle central dans la transformation de ces perceptions, en rejetant ou non les réponses violentes au profit de solutions plus inclusives, solidaires et adaptées aux réalités locales.
Mots-clés :
- terrorisme,
- déshumanisation,
- perceptions,
- 11 septembre,
- génération interconnectée
Abstract
Twenty-three years after the September 11, 2001 attacks, anthropological analysis remains crucial to understanding the complex dynamics of terrorism and violence. Anthropology, as a discipline dedicated to studying humanity, allows us to understand that violence is not an isolated phenomenon, but an oft-instrumentalized tool to control societies and shape power relations. Although the events of September 11 are frequently associated with religious extremism, it is important to highlight that terrorism is a multi-faceted phenomenon, fuelled by a variety of ideological, cultural and social factors. One striking characteristic of contemporary terrorism is the dehumanization of victims, often reduced to abstractions, such as “human losses” or “number of dead.” Concurrently, those responsible for the violence are sometimes portrayed as “monsters,” a reciprocal mechanism of dehumanization. This process prevents the true recognition of individual suffering, while hindering a deeper reflection on the social, political and economic reasons for violence. Anthropology provides valuable insight into these mechanisms and paves the way to more effectively preventing future violence. The current interconnected generation plays a key role in transforming these perceptions by rejecting—or not—violent responses in favour of solutions that are more inclusive, supportive, and adapted to local realities.
Keywords:
- terrorism,
- dehumanization,
- perceptions,
- September 11,
- interconnected generation
Article body
En septembre 2024, le monde a commémoré le 23e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, une journée qui a profondément altéré la géopolitique mondiale et modifié les perceptions des relations humaines à l’échelle globale. Les répercussions de cette tragédie ont créé un avant et un après dans l’histoire contemporaine.
Au fil de ces trois décennies, une nouvelle génération a vu le jour, marquée par cette question persistante : « Que faisiez-vous le 11 septembre ? ». Cette interrogation est devenue le symbole d’un évènement qui, tout en unissant le monde dans la solidarité face à l’adversité, a également semé la division et la peur. En effet, force de constater que la violence terroriste de cette journée a engendré de nouvelles guerres géopolitiques, tant intra-religieuses qu’inter-religieuses, et alimenté des discours identitaires qui ont fragmenté des sociétés déjà fragiles (Bat 2005 ; Burgat 2016 ; Camus 2011 ; Corm 2017 ; Gresh 2004 ; Huntington 2007 ; Liogier 2012 ; Todd 2015). La rupture entre l’avant et l’après 11 septembre reflète les complexités des enjeux contemporains et leurs répercussions à long terme.
Le 12 septembre 2001, en hommage aux victimes, une minute de silence a été observée à l’échelle mondiale. Cet acte symbolique, qui rappelle les commémorations des guerres mondiales, a permis au 11 septembre 2001 de devenir un jour mémorable, transcendant les frontières internationales (Figure 1). Depuis, chaque année, cette minute de silence est maintenue non seulement aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la France, l’Allemagne et l’Italie (Radio-Canada 2021b). Si la manière de rendre hommage peut varier selon les politiques locales, cette tradition a néanmoins contribué à la transformation du 11 septembre 2001 en une antonomase, une date qui, à elle seule, incarne les attentats terroristes mondiaux. Depuis cette tragédie, l’expression « 11 septembre » ou « 9/11 » (en anglais) est utilisée pour évoquer non seulement cet évènement, mais aussi d’autres tragédies similaires (Fragnon 2007). Cependant, malgré la gravité d’autres attentats qualifiés de « terroristes » tels que ceux du 11 mars 2004 à Madrid, ceux du 13 novembre 2015 à Paris, les attaques du 22 mars 2016 à Bruxelles ou encore, plus récemment, les attaques du 7 octobre 2023 en Israël, aucune de ces dates n’a acquis la même portée symbolique en devenant aussi un symbole de choc collectif global. Bien que tout aussi dramatiques, ces évènements restent ancrés dans les mémoires nationales, sans bénéficier de la même immortalisation dans la conscience collective internationale. Les attentats du 11 septembre se distinguent par le fait qu’ils ont été la première attaque suivie en direct et immédiatement catégorisée comme « terroriste » à l’échelle planétaire, frappant de manière inattendue la plus grande puissance mondiale (Dassetto 2011).
Figure 1
Image représentant des personnes réunies 20 ans après les attaques du 11 septembre. Source : ©Getty Images / Chip Somodevilla. Reprise dans Radio-Canada, 2021a, « 11 Septembre : 20 ans après, le monde entier se souvient », Radio-Canada, 11 septembre. Consulté le 13 décembre 2024, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1823400/11-septembre-20-ans-apres-en-direct-emission-commemoration.
Avant 2001, des scènes de violence avaient déjà été diffusées en direct à la télévision, visant d’autres populations. En 2000, la mort du Palestinien Mohammad al-Doura, captée en direct, a notamment marqué les esprits (Radio France 2017 ; Figure 2). Cet évènement terrible avait mis en lumière la capacité des médias à retransmettre en temps réel des scènes violentes, annonçant l’impact des diffusions à venir. De même, en 1999, lors de la guerre du Kosovo, les chaînes de télévision diffusaient, en heure de grande écoute, les souffrances des populations kosovares, prises dans la tourmente d’un conflit majeur (Radio-Canada 2020 ; Figure 3).
Figure 2
Image représentant Jamal Al-Durra et son fils Mohammed, un Palestinien et son enfant, cherchant à se protéger derrière un baril, pris dans le feu croisé entre l’armée israélienne et les Palestiniens le 29 septembre 2000. Source : ©AFP - FRANCE 2, reprise dans France Inter, 2017, « Un enfant est mort » : l’affaire Mohammed Al-Dura, 23 mars, France Inter. Consulté le 13 décembre 2024, https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/un-enfant-est-mort-l-affaire-mohammed-al-dura-6503643.
Ces deux exemples, parmi tant d’autres, soulèvent une question essentielle : pourquoi une minute de silence est-elle observée pour certains évènements et pas pour d’autres ? Pourquoi certaines tragédies, comme les attentats du 11 septembre, suscitent-elles une attention immédiate, tandis que d’autres sont reléguées à de simples chiffres ou ignorées, alors que les violences – qu’elles soient liées à la guerre ou au terrorisme – frappent des civils innocents, souvent réduits à des statistiques ou à des dommages collatéraux dans une rhétorique déshumanisante ?
Figure 3
Image du 24 mars 1999 illustrant les ravages de la guerre en Yougoslavie, reprise dans Miladinovic Alexandre, 2024, Les bombardements de l’OTAN qui ont déclenché une nouvelle ère de guerres, 28 mars, BBC News Afrique. Consulté le 1er décembre 2024, https://www.bbc.com/afrique/articles/c3gkj87ekgpo.
Ces questions prennent une dimension particulière à la suite de l’attaque terroriste sur le sol israélien du 7 octobre 2023, dont les répercussions ont été dévastatrices selon les chiffres recensés : plus de 1 200 Israéliens tués, 7 500 blessés et 253 otages enlevés, dont 101 restent toujours retenus. Du côté palestinien, plus de 44 700 personnes ont perdu la vie, dont plus de 14 100 enfants, et plus de 106 000 ont été blessées. Au Liban, au moins 4 047 personnes ont été tuées et plus de 16 600 blessées. Ces pertes humaines pourraient en réalité être bien plus lourdes, les bilans restant provisoires, notamment du côté palestinien et libanais, où de nombreuses personnes sont encore sous les décombres. Ces tragédies ont également causé des destructions massives d’infrastructures. (Meloche-Holubowski et Samspon 2024, UNICEF 2024). Si l’immense solidarité internationale envers les otages et les pertes humaines israéliens est légitime, elle contraste fortement avec la souffrance des populations palestinienne et libanaise, souvent minimisée dans certains discours politiques internationaux, malgré les appels à une reconnaissance de cette souffrance, comme ceux portés par la Cour internationale de justice de la Haye (Cour internationale de justice 2024). Pourquoi la vie de ces otages serait-elle perçue comme plus précieuse que celle de millions d’autres ? Cette distinction repose largement sur la désignation de certains groupes comme terroristes, reléguant leurs victimes – qui vivent dans le même environnement mais n’en font pas partie – au rang de pertes collatérales, créant ainsi une hiérarchisation des souffrances déshumanisante. Comprendre cette déshumanisation et les mécanismes qui poussent certains à recourir à la violence, et de surcroit terroriste, me semble essentiel pour saisir les fondements de ces tragédies.
Violence à travers le temps : réflexion anthropologique
Quelques années plus tard, au fil de mes recherches, j’ai pris conscience que l’anthropologie est une discipline scientifique profonde, qui scrute les complexités de l’être humain. Elle explore son passé, analyse son présent et conjecture sur ses futurs possibles. Dans le cadre de l’évolution humaine, plusieurs jalons significatifs marquent ce parcours, tels que l’acquisition de la marche, l’élaboration de mécanismes de protection, la quête alimentaire, la reproduction et l’épanouissement des relations sociales (Cowgill 2004 ; Hayden 2009). L’augmentation démographique a également conduit à l’élaboration de règles sociales destinées à réguler les relations humaines et à prévenir les conflits. Parmi ces pratiques culturelles, on trouve diverses formes de régulation des comportements, comme la diplomatie, mais aussi, dans certains contextes, des formes de violence. Bien que la violence ne soit pas une pratique valorisée, elle a parfois émergé comme un moyen d’exprimer des conflits ou des rapports de pouvoir, en complément d’autres mécanismes tels que la négociation ou la coopération (Nugent et Vincent 2004 ; Wolf 1999). Ainsi, pour assurer leur survie, les humains ont développé des pratiques culturelles qui vont bien au-delà de simples instincts. Ces pratiques leur permettent non seulement de s’adapter à leur environnement, mais aussi d’améliorer leur vie sur Terre, contribuant ainsi au maintien d’un équilibre social (Darnell 2009). Contrairement aux animaux, qui dépendent uniquement de leurs instincts, les humains transmettent des savoirs, des valeurs et des comportements, formant ainsi une culture partagée (Kluckhohn et Maben 1968 ; MacDonald 1991 ; Tylor 1920). Cette culture partagée est en constante évolution, s’adaptant aux changements de contexte et aux dynamiques sociales.
Dans ce cadre, bien que la violence ne soit pas valorisée, elle peut constituer un moyen de régulation des comportements humains. Elle est souvent perçue comme un outil d’affirmation du pouvoir ou de gestion des conflits (Coombe 2007 ; Nugent et Vincent 2004). Parmi les différentes formes de violence, le terrorisme se distingue par l’absence de normes universelles, telles que celles définies par le droit international, générant ainsi une perturbation particulière et alimentant la peur (Cooper 2001 ; Meggit 2020). Il vise à transmettre des messages idéologiques, religieux ou politiques, et est souvent perçu comme un dernier recours, voire le seul moyen de se faire entendre, tout en portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique et morale des victimes. Cela dit, la qualification d’un acte ou d’un individu comme « terroriste » dépend largement des facteurs contextuels, émotionnels et historiques, tels que la perspective politique, géographique et sociale des acteurs impliqués : ce qui peut être qualifié de terrorisme par certains peut ne pas l’être par d’autres (Chaliand et Blin 2015).
Comme le souligne Steven Pinker en 2011, l’utilisation de la violence a toujours existé à des niveaux variés, dépendant des contextes et des circonstances. Malgré l’impression que la violence semble plus présente et cruelle de nos jours, ce n’est pas nécessairement le cas. Il est essentiel de noter que notre perception peut être influencée par le fait que nous sommes directement au courant des évènements grâce aux avancées technologiques et à la diffusion rapide de l’information (Bronner 2016). Aussi, les moyens utilisés pour perpétrer des actes violents ont également évolué au fil du temps. Alors qu’auparavant, des méthodes moins sophistiquées, telles que l’utilisation de machettes, étaient couramment employées, aujourd’hui, nous observons l’émergence de techniques plus avancées, notamment l’utilisation d’armes hautement spécialisées. Des engins explosifs sophistiqués, les méthodes de tortures psychologiques, des cyberattaques, et d’autres moyens modernes peuvent être déployés, ce qui rend les actes de violence potentiellement plus dévastateurs et difficiles à contrôler et donc apparaissant plus cruels (Pinker 2011).
Bien que la violence reste une réalité dans notre monde, ses formes et ses méthodes ont évolué, nécessitant des ajustements constants dans nos approches pour la prévenir. Ce défi devient particulièrement complexe lorsqu’il s’agit du terrorisme, dont la menace peut rapidement se transformer en un cycle de peur globale, alimenté par la capacité des médias sociaux à amplifier chaque acte violent (Dassetto 2011). Depuis les années 2000, l’avènement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux a modifié la communication mondiale, permettant aux actes terroristes d’avoir des répercussions immédiates à travers le monde, renforçant ainsi la perception d’une menace omniprésente, souvent disproportionnée par rapport au danger réel (Bronner 2016). À cet effet, Scott Atran (2016) met en lumière la disparité entre le danger réel posé par le terrorisme et la perception de ce danger, soulignant l’amplification résultante due à la médiatisation de la violence. Ainsi, en 2024, exprimer les souffrances et les injustices devient non seulement plus accessible, mais aussi plus visible, grâce aux réseaux sociaux qui permettent une diffusion instantanée des informations, amplifiant ainsi l’impact des actes terroristes à l’échelle mondiale.
Cependant, cette amplification de la perception du terrorisme soulève une question cruciale : pourquoi certains individus, malgré cette visibilité accrue des violences et les moyens alternatifs de communication disponibles, continuent-ils de recourir à la violence, notamment par le biais du terrorisme ? Le terrorisme, bien que non nouveau, garde une appellation et une connotation résolument négatives, stigmatisant les individus qui lui sont associés de près ou de loin. Ces derniers sont souvent perçus comme des « autres », des inhumains, constituant un groupe distinct du « nous » (la société dominante), ce qui justifie, aux yeux de certains, leur élimination ou leur exclusion (Todd 2015). Ce processus de déshumanisation repose sur une opposition identitaire, où ceux qui recourent au terrorisme sont dépeints non seulement comme hostiles à un certain ordre social, mais aussi comme une menace aux intérêts de ce groupe perçu comme majoritaire (Livingstone Smith 2020). Cela soulève un débat plus large : l’idée d’une éradication totale du terrorisme mérite réflexion. Est-il réellement possible d’imaginer un monde sans ces violences dites terrorisantes, qu’elles soient psychologiques ou physiques ? Les êtres humains peuvent-ils véritablement coexister sans tenter d’inspirer la peur ou la terreur chez autrui ? Cette question conduit à revisiter la notion même de terrorisme. Quelle est la véritable signification de ce terme ? Pourquoi est-il si fréquemment utilisé aujourd’hui et pourquoi son évocation déclenche-t-elle une peur immédiate, un malaise qui questionne l’avenir jusque-là exempt de telles préoccupations ? Qu’est-ce qui confère à ces termes une aura aussi négative et puissante ? Il semble que la réponse réside, en partie, dans la crainte de perdre notre humanité, une peur alimentée par l’image de l’autre comme un être déshumanisé, menaçant, à éliminer.
Exploration de la complexité attribuée au terme « terrorisme » au fil du temps
Le terrorisme repose sur l’usage de la terreur, qu’elle prenne la forme d’actes violents ou de discours, dans le but d’atteindre des objectifs sociaux, politiques, idéologiques ou religieux. Son objectif principal est de semer la peur au sein d’une population ciblée, afin de manipuler cette dernière et de parvenir ainsi à ses fins par le biais de la terreur.
Le terme « terrorisme » engendre des connotations variées, suscitant des nuances distinctes en fonction des personnes locutrices. Ces associations peuvent évoquer des souvenirs précis, des lieux emblématiques, voire des moments marquants, tels que des traumatismes d’enfance. Par exemple, la crainte semée par des parents qui recourent à des menaces du type « si tu n’es pas sage, on pourrait t’abandonner près d’une poubelle » illustre comment un acte peut provoquer un sentiment de terreur. Ainsi, le terrorisme peut également se manifester dans des contextes familiaux.
Il peut également faire référence à des expériences de violence physique ou psychologique au sein de la famille, perpétrée par des groupes armés spécifiques. Ces expériences variées contribuent à la complexité du concept de terrorisme, mettant en lumière la subjectivité de son interprétation en fonction des vécus personnels. Ainsi, l’analogie de la terreur s’immisçant dans les relations familières souligne que les conséquences émotionnelles du terrorisme ne se cantonnent pas aux évènements mondiaux, mais peuvent se manifester dans des contextes plus intimes et sociaux, influençant la perception de soi et des autres. Malgré la sévérité apparente de cette image, elle met en lumière la profondeur des marques que la terreur peut laisser chez un enfant qui est comparé à un déchet dans ce cas précis.
Aborder le sujet du terrorisme dévoile une dimension délicate et émotionnellement chargée, surtout pour ceux qui en ont été victimes ou qui le subissent. Le terme lui-même suscite une image effrayante de l’assaillant, accentuant la division entre « nous » (les victimes du terrorisme) et « eux » (les assaillants), créant ainsi une séparation entre deux catégories de personnes : les humains dotés d’émotions et les non-humains dépourvus d’émotions (Livingstone Smith 2020). Ce qui dérange, avec l’utilisation du terrorisme comme instrument politique, à mon sens, c’est qu’avec le terrorisme, non seulement les personnes victimes sont déshumanisées, mais aussi celles qui perpétuent ces actes. Les assaillants ne sont pas considérés comme des humains, tout comme les personnes subissant les actes terroristes ne voient pas les assaillants comme des êtres humains. L’humain redoute cette perte d’humanisation. Cette polarisation, résultante du terrorisme, risque non seulement d’aggraver les traumas des victimes, mais également de contribuer à une stigmatisation sociale, érigeant des barrières émotionnelles entre les individus (Goffman 1975).
De même, un autre exemple pertinent est celui des militants véganes antispécistes qui, pour transmettre leurs convictions, terrorisent les boucheries et les agriculteurs, suscitant chez ces derniers la perception qu’ils sont des bourreaux sans coeur (Marris 2010). L’exemple des militants véganes antispécistes élargit la perspective en montrant une similarité dans l’utilisation de la terreur pour exprimer des convictions pour atteindre son but. Cette extension du concept de terreur au-delà du cadre du terrorisme traditionnel souligne la complexité du sujet et met en évidence comment la terreur peut être employée comme moyen de faire valoir des idées, que ce soit au niveau familial, relationnel ou dans des mouvements sociaux. Ils soulignent la nécessité d’une approche nuancée pour comprendre et traiter toutes les ramifications émotionnelles du terrorisme dans divers contextes de la vie quotidienne.
Comme je l’expose dans mon article publié dans The Conversation (El Khoury 2023), les mots ont un pouvoir déterminant sur la perception des individus, des groupes et des nations. L’usage du terme « terrorisme » implique une responsabilité considérable, car il façonne les interprétations et les réactions du public. Il est donc essentiel que ce terme soit employé avec une précision rigoureuse afin d’éviter toute distorsion ou stigmatisation injustifiée.
Les attentats du 11 septembre ont associé le terme « terrorisme » à des groupes se réclamant d’une interprétation de l’islam, créant une perception réductrice où le terrorisme est systématiquement lié à des acteurs s’identifiant comme des musulmans. Aurélie Campana (2018) critique cette approche biaisée, soulignant la tendance à dissocier les attaques des groupes musulmans de celles commises par des groupes non musulmans, et à appliquer le terme « terrorisme » de manière automatique aux premiers. Graham Fuller (2008) plaide pour une remise en question de cette association systématique. Ces critiques sont corroborées par les statistiques qui montrent que les actes terroristes commis par des groupes non musulmans reçoivent moins d’attention médiatique (Europol 2021). Malgré les critiques, l’étiquette de terroriste reste majoritairement associée aux musulmans.
Bien que né durant la Terreur révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle, le terme « terrorisme » désignait d’abord un outil politique de l’État, avant de devenir, en 1798, une stratégie violente utilisée par des groupes révolutionnaires en réponse à la terreur étatique, eux-mêmes qualifiés de « terroristes » (Chaliand et Blin 2015). Avant cela, la terreur était souvent associée à des mouvements idéologiques, comme les Zélotes-Sicaires en Palestine. Au XXe siècle, les répressions étatiques ont visé divers mouvements qualifiés de « terroristes », que l’on peut classer en quatre catégories, selon Quentin Michel (2005) : les mouvements ouvriers, les nationalistes, les révolutionnaires idéologiques et les groupes religieux extrémistes. Parallèlement, David C. Rapoport (2022) distingue plusieurs vagues de terrorisme, à savoir la « vague anarchiste » (Anarchist-wave), la « vague anticoloniale » (Anticolonial-wave), la « nouvelle vague de gauche » (New Left-wave) et la « vague religieuse » (Religious-wave). Or Honig et Ido Yahel (2019) suggèrent, quant à eux, une cinquième vague, celle des États semi-terroristes en prenant l’exemple de Daesh.
Le terrorisme est souvent attribué à des acteurs non étatiques, tandis que les États qualifient leurs propres tactiques de « contre-terrorisme », désignant l’ensemble des stratégies adoptées pour prévenir, intercepter et neutraliser les actes terroristes. Cependant, il est important de noter que certaines tactiques politiques de certains États, bien que qualifiées de « contre-terrorisme », peuvent être perçues comme des actes de terrorisme par les populations locales qui les subissent, instaurant un climat de terreur pour atteindre leurs objectifs par des moyens politiques et militaires.
Ainsi, tout au long de l’histoire, divers acteurs, des groupes communistes et anarchistes aux mouvements religieux extrémistes, et plus récemment, des activistes contemporains, ont eu recours à des méthodes controversées, parfois terroristes, pour atteindre leurs fins. Le terrorisme persiste comme un outil politique de dernier recours, utilisé lorsque d’autres stratégies semblent inopérantes et que l’usage de la terreur semble être la seule option.
11 septembre 2001 : de la lutte contre les terrorismes à la guerre contre le terrorisme
Les attaques du 11 septembre ont indéniablement marqué un tournant majeur dans la manière dont la communication violente et le terme terrorisme sont perçus et abordés. Avant cette tragédie, les efforts pour contrer le terrorisme se concentraient principalement sur des manifestations spécifiques de cette menace. Cependant, après le 11 septembre, le président George W. Bush a adopté une approche radicalement différente en proclamant une guerre contre le terrorisme le 20 septembre 2001 (Figure 4) à l’échelle internationale, visant à éradiquer cette menace, souvent associée à des interprétations radicales et extrémiste de l’islam et, de fait, liée à la religion elle-même et à ses milliards de fidèles (Radio-Canada 2021a. ; Radio-Canada 2021b).
Figure 4
Image de George W. Bush, 43e président des États-Unis, annonçant la guerre contre le terrorisme le 20 septembre 2001, à la suite des attaques du 11 septembre. Source : The Economist. Consulté le 13 décembre 2024, disponible sur le profil X du journal The Economist, https://x.com/TheEconomist/status/750757153300971520.
Les attaques du 11 septembre ont indéniablement marqué un tournant majeur dans la perception du terrorisme et dans les stratégies de lutte contre celui-ci. Cette vision réductrice a simplifié le phénomène en le limitant à l’oeuvre de groupes extrémistes, occultant la diversité des formes de violence terroriste existantes. Désormais, il n’était plus question de formes multiples de terrorisme, mais d’un seul : celui des diverses interprétations extrémistes d’une religion spécifique.
Cette déclaration de guerre a généré de profondes répercussions, créant une dichotomie nette entre ceux qui soutenaient activement l’usage de la force et ceux qui prônaient des solutions non violentes pour résoudre les conflits, ces derniers étant souvent accusés de complicité avec les terroristes. Cette polarisation a engendré un climat où toute personne ne soutenant pas cette guerre était susceptible d’être étiquetée comme complice.
Ainsi, les évènements du 11 septembre ont non seulement transformé la perception de la violence terroriste, mais ont également redéfini la manière dont la lutte contre le terrorisme était menée, faisant de cette lutte une confrontation globale, complexe et souvent controversée. Cette approche visant à réduire le terrorisme, souvent associé à diverses interprétations extrémistes de l’islam, a été considérée comme un devoir partagé, impliquant la contribution active de chacun. Avant 2001, la lutte contre le terrorisme était principalement l’affaire d’agences de sécurité telles que les polices nationales, la CIA (Central Intelligence Agency) et le FBI (Federal Bureau of Investigation) spécifiques aux États-Unis, par exemple. Cependant, après les attaques du 11 septembre, cette lutte est devenue une question mondiale, impliquant non seulement l’armée américaine et le Pentagone, mais aussi la population américaine et ses alliés internationaux (Figure 5).
Figure 5
Image de la campagne « If You See Something, Say Something® » du gouvernement états-unien, disponible sur le site officiel du U.S. Department of Homeland Security (https://www.dhs.gov/see-something-say-something/about-campaign). Source : ©Fabio Cremasco et Madsh, photographie publiée sur Flickr (Editorial/Getty Images, reprise dans Ferguson, Chriss 2014, « The See Something, Say Something Seesaw », Time, 6 mai 2014. Consulté le 13 décembre 2024, https://time.com/88269/the-see-something-say-something-seesaw/.
La déclaration de guerre contre le terrorisme, visant des groupes armés interprétant l’islam de manière extrémiste et violente, a transformé cette lutte en une opération internationale, avec des interventions militaires telles que celles en Afghanistan, en Irak, au Sahel et en Syrie. Toutefois, 20 ans plus tard, après le retrait des troupes états-uniennes d’Afghanistan en 2021 et la fin de l’opération Barkhane au Sahel en 2022, la question de la poursuite de cette guerre s’est posée. Le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan et les changements géopolitiques ont profondément modifié la perception de la menace. Si un groupe comme Daesh reste idéologiquement actif, malgré sa chute politique en 2019, notamment au Sahel, en Syrie et en Irak, la menace semble moins immédiate. La guerre contre le terrorisme a évolué en une lutte plus ciblée avec des stratégies adaptées aux contextes locaux.
Nous pouvons prendre l’exemple de la situation en Syrie, qui a pris un tournant majeur à la fin de l’année 2024, le 8 décembre, avec l’ascension de Mohammed Al-Jolani, ancien membre de Daesh, leader du groupe Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) (Al-Lami 2024). Ce basculement s’inscrit dans une dynamique de transformation du paysage syrien, marquée par le renversement du régime syrien en place depuis plus de 54 ans par Al-Jolani et son groupe. Ce changement a profondément modifié les rapports de force dans la région et marque une évolution notable dans la stratégie de HTS, qui, selon ses dires, s’éloigne de ses précédentes affiliations terroristes pour adopter un discours plus pragmatique, tout en restant un acteur radical sur le terrain (Vohra 2024). HTS, qui a été désigné comme un groupe « terroriste » cette dernière décennie, est perçu depuis ces dernières semaines comme « libérateur » et même « révolutionnaire » par certains commentateurs politiques, au point que le Royaume-Uni se pose la question de savoir s’il doit l’enlever de sa liste de groupes terroristes, alors qu’il y figure depuis plus d’une décennie (Wright et Rhoden-Paul 2024). Il semble que toutes les exactions commises par ce groupe sont désormais passées sous silence. Cela rejoint ce que disait Gérard Chaliand et Arnaud Blin (2015) à propos de la désignation du terme où l’on peut être perçu comme terroriste ou révolutionnaire assez rapidement, selon différents facteurs : contextuels, politiques, temporels et selon les désignateurs. Les États-Unis, qui avaient mis une rançon de plus de 10 millions de dollars pour toute information sur Al-Jolani, reconsidèrent cette sanction (Gouthière 2024 ; Middle East Eye 2024). Les États-Unis et leurs alliés dans la région du Levant sont en train de réévaluer les sanctions internationales contre la Syrie et son isolement, affirmant que leur objectif vise à « lutter contre le terrorisme et l’extrémisme » en Syrie après que HTS ait renversé le pouvoir syrien en place depuis le 8 décembre 2024 (La Presse 2024). Ce développement souligne la complexification de la situation en Syrie et la transformation de la lutte contre le terrorisme, qui se fait désormais dans un contexte de plus en plus localisé et politique. Ainsi, malgré la persistance de factions terroristes au Sahel, en Syrie et en Irak, la menace terroriste semble aujourd’hui moins immédiate et la lutte contre le terrorisme s’est transformée en interventions ciblées, adaptées aux dynamiques locales spécifiques.
La fin du terme guerre contre le terrorisme soulève une question clé : cela signifie-t-il la disparition de la menace posée par les organisations armées justifiant leurs actions par une interprétation extrémiste de l’islam ? En réalité, des acteurs comme le Hezbollah, le Hamas, Al-Qaïda et ses branches, ainsi que Daesh, demeurent des menaces persistantes. La lutte contre ce terrorisme reste complexe, car éliminer les membres d’une organisation ne suffit pas tant que l’idéologie qui la soutient perdure. Le conflit entre Israël et le Hamas, relancé en 2023, et le rôle continu du Hezbollah, en sont des exemples frappants.
L’utilisation de la violence, lorsqu’elle est désignée comme terroriste, repose sur une déshumanisation systématique de l’adversaire, ce qui empêche de comprendre les causes profondes de leurs actions. Reconnaître l’humanité de l’ennemi, même dans sa violence, est essentiel pour déconstruire l’idéologie qui la justifie. Cela montre que la réponse militaire, bien qu’elle soit parfois nécessaire, reste insuffisante à long terme. Les pertes humaines, aussi tragiques soient-elles, ne résolvent pas les causes sociales, économiques et idéologiques de l’extrémisme. Une approche plus durable nécessite de coopérer avec les populations locales et d’analyser les racines des idéologies violentes. Cela est particulièrement pertinent au Sahel, où les interventions militaires ont échoué à endiguer la menace et ont exacerbé les tensions régionales, alimentant des coups d’État successifs.
Dans cette perspective, il est essentiel de privilégier des partenariats authentiques avec les communautés locales. Plutôt que de tenir une population entière responsable des actions d’une minorité, une approche nuancée permet de reconnaître la diversité des opinions et des positions au sein de ces sociétés. Un dialogue inclusif, impliquant les acteurs locaux tels que les groupes religieux, les leaders tribaux et la société civile, pourrait favoriser l’élaboration de solutions contextuellement adaptées. Parallèlement, il convient de renforcer la responsabilité gouvernementale, de lutter contre la corruption et de restaurer la confiance entre les autorités et la population. Enfin, des réformes éducatives et des politiques économiques inclusives sont des leviers cruciaux pour contrer l’endoctrinement et limiter les conditions favorables au recrutement par des groupes extrémistes.
Conclusion
En guise de conclusion, revenons sur les deux questions qui ont guidé notre réflexion, que je répète ici : pourquoi une minute de silence est-elle observée pour certains évènements et pas pour d’autres ? Pourquoi certaines tragédies, comme les attentats du 11 septembre 2001, suscitent-elles une attention immédiate, tandis que d’autres sont reléguées à de simples chiffres ou ignorées, alors que les violences – qu’elles soient liées à la guerre ou au terrorisme – frappent des civils innocents, souvent réduits à des statistiques ou à des dommages collatéraux dans une rhétorique déshumanisante ?
Ces questions révèlent des dynamiques complexes entre la perception publique, les médias, les réseaux sociaux et les motivations derrière chaque évènement tragique. La manière dont nous réagissons à un évènement dépend de plusieurs facteurs, tels que sa visibilité, ses implications géopolitiques et la manière dont il est rapporté dans les médias. Certaines tragédies, comme les attentats du 11 septembre, attirent une attention immédiate en raison de leur portée mondiale, de leur impact sur la sécurité internationale et du symbolisme qu’elles portent. D’autres violences, bien qu’aussi dévastatrices, sont souvent réduites à des statistiques ou ignorées, surtout lorsqu’elles touchent des civils dans des contextes géopolitiques complexes, comme ceux liés à la guerre ou au terrorisme.
Les violences liées au terrorisme sont particulièrement dévastatrices car elles impliquent une déshumanisation systématique, non seulement des auteurs directs, mais aussi de toutes les personnes associées, même indirectement. Cette déshumanisation empêche une reconnaissance pleine et entière de la souffrance des victimes et rend difficile une réflexion sur les causes profondes des violences. Lorsque les victimes deviennent des statistiques anonymes, leur individualité et leur dignité sont effacées, renforçant une vision déshumanisante qui facilite l’acceptation de leur perte.
Ces 23 dernières années, le terrorisme a été, dans l’inconscient collectif, souvent associé à des groupes et des individus agissant au nom d’une interprétation de l’islam violente et manichéenne, notamment après les évènements du 11 septembre et la guerre lancée par George W. Bush contre le terrorisme. Cependant, comme nous l’avons vu, le terrorisme est un phénomène beaucoup plus complexe, et il n’existe pas un seul terrorisme, mais plusieurs formes de terrorismes, chacun ayant des racines et des motivations variées.
Tout être humain évolue avec le temps et l’espace, et ses pratiques culturelles et de communication changent en conséquence. De même, les groupes terroristes ajustent leurs stratégies en fonction des contextes locaux et politiques, compliquant ainsi la lutte contre le terrorisme. Bien que souvent associés à des idéologies religieuses ou politiques, les actes terroristes ne peuvent être réduits à l’élimination des individus. Comprendre la logique qui les sous-tend et les causes profondes qui les nourrissent est essentiel pour les déconstruire. La lutte contre le terrorisme doit être multidimensionnelle, alliant analyse des causes et mesures pratiques pour garantir la sécurité des populations. Une réponse globale et collaborative reste indispensable pour éradiquer cette menace complexe, en tenant compte de sa diversité et de ses origines multiples.
Aujourd’hui, la génération post-11 septembre, en particulier les milléniaux (nés dans les années 1980-90), joue un rôle central dans la promotion de la paix et de la coopération internationale, rejetant les solutions militaires au profit de valeurs telles que la solidarité, la justice sociale et la diversité. Bien qu’il soit important de ne pas généraliser, une forte majorité de cette génération semble incarner ces idéaux. Cette dynamique s’inscrit dans la continuité des mouvements pacifistes des années 1960, comme celui des Hippies, qui, en réponse aux guerres et injustices sociales, prônaient l’amour et la tolérance. Si les militants de cette époque s’exprimaient principalement à travers des manifestations physiques, les milléniaux contemporains utilisent désormais les réseaux sociaux pour amplifier leur voix et réagir instantanément aux injustices mondiales. Comme l’a observé le professeur Arnaud Mercier, cette génération forte de sa présence numérique peut prendre connaissance des violences mondiales et y répondre presque en temps réel (Groguhé 2024). Cette réactivité devient d’autant plus cruciale dans un contexte où la déshumanisation des victimes, souvent réduites à des « dommages collatéraux » dans les discours médiatiques, demeure un défi majeur.
Dans ce contexte, un désir fort d’humanisation et de respect de la diversité émerge, en particulier à travers des formations sur l’équité, le genre et la culture au sein des institutions de sécurité. Ces initiatives renforcent la capacité des jeunes générations à promouvoir la compréhension interculturelle et à oeuvrer pour un monde plus juste.
En conclusion, bien que les défis restent considérables, des solutions semblent existée. La lutte contre le terrorisme doit être collective et internationale, combinant une analyse des causes profondes et des actions préventives. Les tragédies actuelles soulignent l’importance de privilégier des moyens diplomatiques fondés sur la dignité humaine et de renforcer la solidarité face à l’injustice. Le véritable défi réside dans notre capacité à traduire cette prise de conscience en actions concrètes pour réduire la souffrance et prévenir les violences futures. En déconstruisant les logiques idéologiques sous-jacentes et en favorisant un dialogue constructif, il est possible de tracer une voie plus humaine.
Appendices
Bibliographie
- Al-Lami Mina, 2024. « From Syrian Jihadist Leader to Rebel Politician : How Abu Mohammed Al-Jolani Reinvented Himself », BBC, 8 décembre. Consulté le 13 décembre 2024, https://www.bbc.com/news/articles/c0q0w1g8zqvo.
- Atran, Scott, 2016 L’État islamique est une révolution. Paris, Les liens qui libèrent.
- Bat, Yeor, 2005. Eurabia : The Euro-Arab Axis. Madison, NJ, Fairleigh Dickinson University Press.
- Burgat, François, 2016. Comprendre l’islam politique : Une trajectoire de recherche sur l’altérité islamiste, 1973-2016. Paris, La Découverte.
- Bronner, Gérald, 2016. La pensée extrême. Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. Paris, Presses universitaires de France.
- Campana, Aurélie, 2018. L’impasse terroriste : Violence et extrémisme au XXIe siècle. Montréal, Multimondes.
- Camus, Renaud, 2011. Le Grand Remplacement. Paris, David Reinharc.
- Chaliand, Gérald et Arnaud Blin, 2015. Histoire du Terrorisme de l’antiquité à Daesh. Paris, Fayard.
- Coombe, Rosemary J, 2007. « The Work of Rights at the Limits of Governmentality », Anthropologica, 49 (2) : 284-289. Consulté le 14 décembre 2024, https://www.jstor.org/stable/25605365.
- Cooper, H. H.A, 2001. « Terrorism : The Problem of Definition Revisited », The American Behavioral Scientist, 44 (6) : 881-93. https://doi.org/10.1177/00027640121956575.
- Corm, Georges, 2017. La nouvelle question d’Orient. Paris, La Découverte.
- Cour internationale de justice, 2024. Ordonnance du 24 mai 2024, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël). La Haye, Cour internationale de justice.
- Cowgill, George L, 2004. « Origins and Development of Urbanism : Archaeological Perspectives ». Annual Review of Anthropology, 33 : 525-49. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.32.061002.093248.
- Darnell, Regna, 2009. « Anthropological Approaches to Human Nature, Cultural Relativism and Ethnocentrism ». Anthropologica, 51 : 187-194. https://www.jstor.org/stable/25605466.
- Dassetto, Felice, 2011. L’iris et le croissant : Bruxelles et l’islam au défi de la co-inclusion. Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain.
- El Khoury, Emilie, 2023. « How We Define and Use the Word Terrorism in the Israel-Hamas War Matters a Lot », The Conversation, 18 octobre. Consulté le 23 décembre 2024, https://theconversation.com/how-we-define-and-use-the-word-terrorism-in-the-israel-hamas-war-matters-a-lot-215670.
- Europol, 2021. European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015. Europol, 6 janvier, La Haye, Europol. Consulté le 13 décembre 2024, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015.
- Fuller, Graham, 2008. « Ask the Author : Graham Fuller », Foreign Policy, 31 Janvier. Consulté le 23 janvier 2024, https://foreignpolicy.com/2008/01/31/ask-the-author-graham-fuller/.
- Goffman, Erving, 1975. Stigmate. Paris, Minuit.
- Gouthière Florian, 2024. « CheckNews Une prime de 10 millions de dollars est-elle promise pour toute info permettant la capture d’Abou Mohammed al-Joulani, le chef d’HTS ? », Libération, 10 décembre. Consulté le 15 décembre 2024, https://www.liberation.fr/checknews/une-prime-de-10-millions-de-dollars-est-elle-promise-pour-toute-info-permettant-la-capture-dabou-mohammed-al-joulani-le-chef-dhts-20241210_SD32JOMJN5HIHMDFZUR3HBZDFQ/.
- Gresh, Alain, 2024. L’islam, la République et le monde. Paris, Fayard.
- Groguhé Marissa, 2024. « Quand TikTok doit se défendre d’être pro-Palestine », La Presse, 29 janvier. Consulté le 14 décembre 2024, https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/israel-et-le-hamas-en-guerre/instaguerre/2024-01-29/quand-tiktok-doit-se-defendre-d-etre-pro-palestine.php.
- Hayden, Brian, 2009. « The Proof is in the Pudding : Feasting and the Origins of Domestication ». Current Anthropology, 50 : 597-601. https://doi.org/10.1086/605110.
- Honig, Or et Ido Yahel, 2019. « A Fifth Wave of Terrorism ? The Emergence of Terrorist Semi-States ». Terrorism and Political Violence, 31 (6) : 1210-1228. https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1330201.
- Huntington, Samuel, 2007. Le choc des civilisations. Paris, Odile Jacob.
- Julien, Fragnon, 2007. « Quand le 11-Septembre s’approprie le onze septembre. Entre dérive métonymique et antonomase », Mots. Les langages du politique 85. https://doi.org/10.4000/mots.1197.
- Kluckhohn, Clyde et Kay Maben, 1968. Mirror for Man a Survey of Human Behavior and Social Attitudes. Greenwich, Fawcett.
- La Presse, 2024. « Les États-Unis en contact “directˮ avec les rebelles islamistes », La Presse, le 14 décembre. Consulté le 15 décembre 2024, https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2024-12-14/syrie/les-etats-unis-en-contact-direct-avec-les-rebelles-islamistes.php.
- Liogier, Raphaël. 2012. Le mythe de l’islamisation : Essai sur une obsession collective. Paris, Seuil.
- Livingstone Smith, David, 2020. On Inhumanity. Dehumanization and How to Resist It. Oxford, Oxford University Press.
- MacDonald, George F, 1991. « What Is Culture ? », The Journal of Museum Education 16 : 9-12. Consulté le 14 décembre 2024, http://www.jstor.org/stable/40478873.
- Marris, Emma, 2010. « Animal Rights “terrorˮ law challenged ». Nature, 466 : 424. https://doi.org/10.1038/466424a.
- Meggit, Justin J, 2020. « The Problem of Apocalyptic Terrorism ». Journal of Religion and Violence, 8 (1) : 58-104. Consulté le 23 décembre 2024, https://www.jstor.org/stable/27092320.
- Meloche-Holubowski et Ximena Samspon, 2024. « Un an après l’attaque du Hamas, portrait de douze mois de guerre », Radio-Canada, 5 octobre. Consulté le 13 décembre 2024, https://ici.radio-canada.ca/info/long-format/2108520/un-an-guerre-israel-hamas-bande-gaza-cartes-graphiques.
- Michel, Quentin, 2005. Terrorisme : Regards Croisés = Terrorism : Cross Analysis, Bruxelles, Peter Lang.
- Middle East Eye, 2024. « US Officials Discussed Merits of Removing $10m Bounty on HTS Leader», Middle East Eye, 8 décembre. Consulté le 15 décembre 2024), https://www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/us-officials-discussed-merits-removing-10m-bounty-hts-leader?nid=415088&topic=Syria%2520War&fid=540725.
- Nugent, David et Joan Vincent (dir.), 2004. A Companion to the Anthropology of Politics. Malden (Mass.), Blackwell Publishing.
- Pinker, Steven, 2011. The Better Angels of Our Nature : Why Violence Has Declined. New York, Viking.
- Radio-Canada, 2020. « L’odeur de la mort, ou les souvenirs de la guerre du Kosovo de Manon Globensky », 27 mai. Consulté le 13 décembre 2024), https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/175016/kosovo-guerre-souenirs-manon-globensky.
- Radio-Canada. 2021a. « 11 Septembre : 20 ans après, le monde entier se souvient », Radio-Canada, 11 septembre. Consulté le 13 décembre 2024, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1823400/11-septembre-20-ans-apres-en-direct-emission-commemoration.
- Radio-Canada. 2021b. « Le discours va-t’en guerre de Bush après le 11 Septembre », Radio-Canada, 1e septembre. Consulté le 13 décembre 2024, https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/entrevue/369539/georges-w-bush-discours-11-septembre-cuccioletta-parenteau.
- Radio France, 2017. « “Un enfant est mortˮ : L’affaire Mohammed Al Dura » Radio France, 23 mars. Consulté le 13 décembre 2024, https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/un-enfant-est-mort-l-affaire-mohammed-al-dura-6503643.
- Rapoport, David C, 2022. Waves of Global Terrorism : From 1879 to the Present. New York, Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/rapo13302.
- UNICEF, Fond des Nations unies pour l’enfance, 2024. « Proche-Orient : Les enfants pris au piège d’une guerre sans fin », UNICEF pour chaque enfant. Portail UNICEF, 11 décembre. Paris : UNICEF Consulté le 15 décembre 2024, https://www.unicef.fr/article/israel-palestine-les-enfants-paient-le-prix-de-la-guerre/.
- Todd, Emmanuel, 2015. Qui est Charlie ? Sociologie d’une crise religieuse. Paris, Seuil.
- Tylor, Edward, 1920 [1871]. Primitive Culture : Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custum. Londres, John Murra.
- Vohra, Anchal, 2024. « Is Jolani Any Better Than Assad ? How to Read the Tea Leaves on Syria’s New Leaders », Foreign Policy, 10 décembre. Consulté le 15 décembre 2024, https://foreignpolicy.com/2024/12/10/jolani-assad-syria-regime-government-democracy-hts/.
- Wolf, Eric R, 1999. Envisioning Power : Ideologies of Dominance and Crisis. Berkeley, University of California Press.
- Wright, George et André Rhoden-Paul, 2024. « Too Early to Remove Syrian Rebels from Terror List-Starmer», BBC, 9 décembre. Consulté le 15 décembre 2024, https://www.bbc.com/news/articles/cz7qenxy8r2o.
List of figures
Figure 1
Image représentant des personnes réunies 20 ans après les attaques du 11 septembre. Source : ©Getty Images / Chip Somodevilla. Reprise dans Radio-Canada, 2021a, « 11 Septembre : 20 ans après, le monde entier se souvient », Radio-Canada, 11 septembre. Consulté le 13 décembre 2024, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1823400/11-septembre-20-ans-apres-en-direct-emission-commemoration.
Figure 2
Image représentant Jamal Al-Durra et son fils Mohammed, un Palestinien et son enfant, cherchant à se protéger derrière un baril, pris dans le feu croisé entre l’armée israélienne et les Palestiniens le 29 septembre 2000. Source : ©AFP - FRANCE 2, reprise dans France Inter, 2017, « Un enfant est mort » : l’affaire Mohammed Al-Dura, 23 mars, France Inter. Consulté le 13 décembre 2024, https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/un-enfant-est-mort-l-affaire-mohammed-al-dura-6503643.
Figure 3
Image du 24 mars 1999 illustrant les ravages de la guerre en Yougoslavie, reprise dans Miladinovic Alexandre, 2024, Les bombardements de l’OTAN qui ont déclenché une nouvelle ère de guerres, 28 mars, BBC News Afrique. Consulté le 1er décembre 2024, https://www.bbc.com/afrique/articles/c3gkj87ekgpo.
Figure 4
Image de George W. Bush, 43e président des États-Unis, annonçant la guerre contre le terrorisme le 20 septembre 2001, à la suite des attaques du 11 septembre. Source : The Economist. Consulté le 13 décembre 2024, disponible sur le profil X du journal The Economist, https://x.com/TheEconomist/status/750757153300971520.
Figure 5
Image de la campagne « If You See Something, Say Something® » du gouvernement états-unien, disponible sur le site officiel du U.S. Department of Homeland Security (https://www.dhs.gov/see-something-say-something/about-campaign). Source : ©Fabio Cremasco et Madsh, photographie publiée sur Flickr (Editorial/Getty Images, reprise dans Ferguson, Chriss 2014, « The See Something, Say Something Seesaw », Time, 6 mai 2014. Consulté le 13 décembre 2024, https://time.com/88269/the-see-something-say-something-seesaw/.