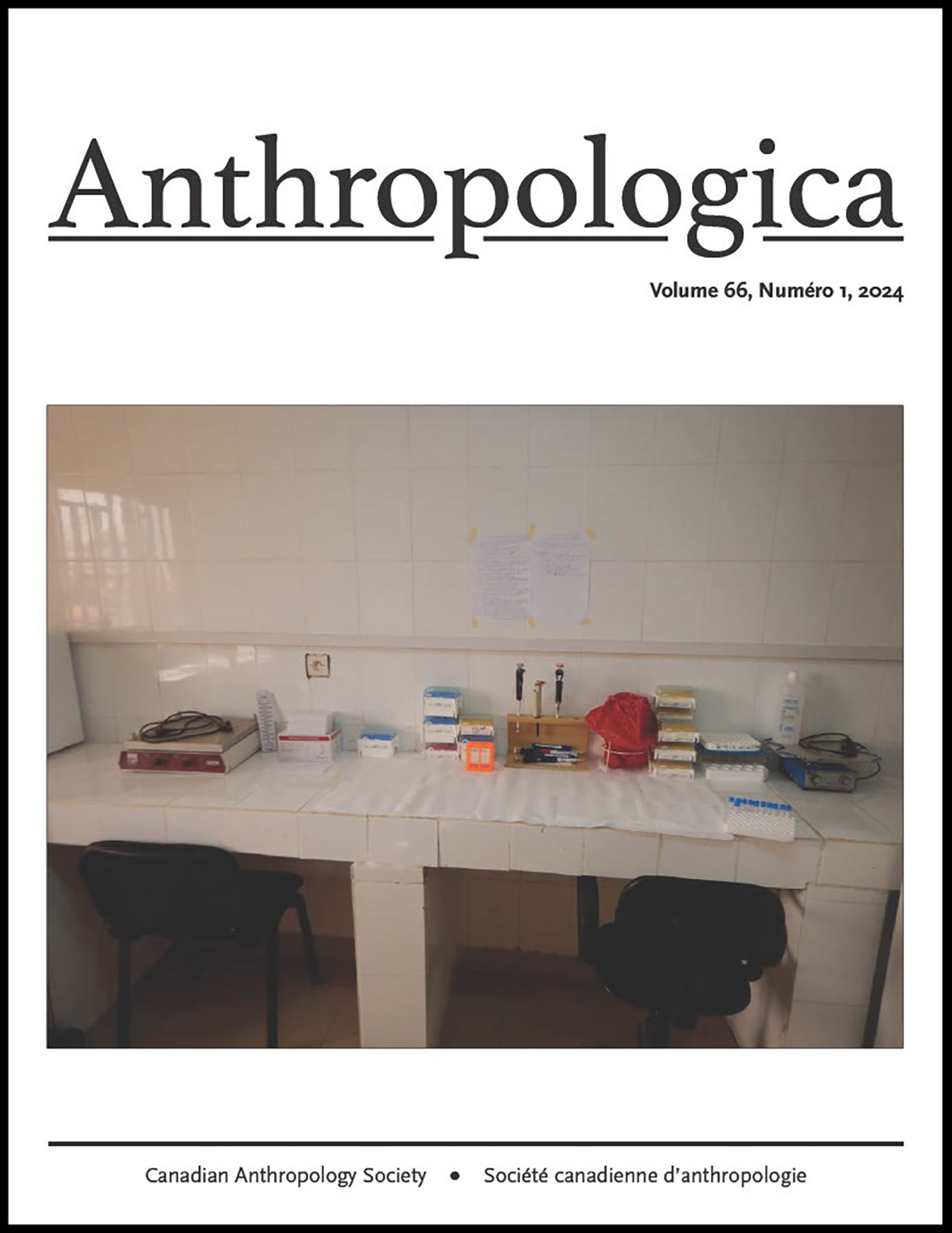Abstracts
Résumé
La Guinée présente une faible couverture vaccinale contre la COVID-19 (28% en 22 février 2023). Au lieu de penser ce faible taux de vaccination comme un échec, nous proposons de le discuter comme une mise en cause locale de l’agenda de la santé globale. Cette étude repose sur l’ethnographie de la mise en oeuvre de la vaccination en Guinée, réalisée par les deux auteurs, de mars 2020 à octobre 2022 dans la capitale et à l’intérieur du pays. Des acteurs de la santé et des individus vaccinés ou non ont été interrogés, et le contexte politique dans lequel la campagne s’est déroulée a été analysée. Loin d’une lecture homogène des acteurs de la santé globale, nous décrivons en quoi la politique vaccinale est tributaire de relations multilatérales et bilatérales qui façonnent son offre vaccinale. L’approvisionnement en intrants, la situation sanitaire, les tensions politiques concomitantes à la COVID-19 mettent en cause la légitimité des mesures préventives, notamment la vaccination. D’autre-part, les actions promues dans l’arène de la santé globale pour répondre à l’épidémie de COVID-19 (confinement, vaccination) ont fait fi des conditions politiques et biologiques que le virus rencontre en Guinée. En mobilisant la notion de biologie située (Lock), il s’agit de discuter de la pertinence d’un agenda universel pour la santé globale.
Mots-clés :
- Ethnographie,
- vaccination,
- biologie située,
- inégalités,
- COVID-19,
- santé globale
Abstract
Guinea has a low COVID-19 vaccination coverage (28% as of 22 February 2023). Instead of seeing this low vaccination rate as a failure, we suggest discussing this as a local response to the global health agenda. This study is built on the ethnography of Guinea’s vaccination implementation and was conducted by the authors from March 2020 to October 2020 in the capital and the country’s interior. Healthcare stakeholders and individuals, both vaccinated and unvaccinated, were surveyed, and the political context under which the campaign was rolled out was analyzed. Far from being a homogeneous commentary by global healthcare stakeholders, we describe how the vaccination policy is dependent on multilateral and bilateral relations that shape its vaccination availability. Procuring input, the health situation and political tension associated with COVID-19 call into question the legitimacy of preventive measures, specifically vaccination. On the other hand, promised actions in the global health arena to respond to the COVID-19 epidemic (lockdown, vaccination) disregarded the political and biological conditions encountered by the virus in Guinea. By mobilizing the concept of situated biology (lock), the relevance of a universal agenda for global health must be discussed.
Keywords:
- Ethnography,
- vaccination,
- situated biology,
- inequalities,
- COVID-19,
- overall health
Article body
À l’échelle mondiale, la réponse à la pandémie de COVID-19 s’est traduite par un double mouvement. Tout d’abord le recours au confinement, l’une des mesures les plus anciennes de gestion des épidémies, ensuite, la mobilisation massive d’une réponse technologique (Hirsch 2020). Celle-ci a pris la forme de tests (rapide, ARN) et de vaccins (ADN ou ARNm, protéiques, à virus inactivé et atténué) dans une logique d’éradication virale[1]. Pour autant, cette dynamique mondiale – dernier développement d’un mouvement dont Anne-Marie Moulin (1996) rappelle la longue histoire et l’accélération dès 1990 – présente une réalité contrastée lorsqu’elle est observée depuis des réalités situées. L’état de la couverture vaccinale en témoigne. Le 22 février 2023, elle atteint un taux de 86 % en Amérique du Sud, 76% en Amérique du Nord, 78 % en Asie et de 70% en Europe, tandis qu’en Afrique seulement 35 % de la population a reçu au moins deux doses (Our World in Data 2023). En Guinée, seuls 28 % de la population totale présente un schéma vaccinal complet[2] (ANSS et al. 2023). L’objectif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’une couverture vaccinale de 70 % de la population est loin d’être atteint. Plusieurs arguments ont d’abord été avancés pour expliquer cette réalité : la faiblesse de l’État et du système de santé, dont les difficultés à garantir les conditions optimales de conservation des doses sur l’ensemble du territoire (Desclaux et Sow 2021), le manque d’adhésion des populations africaines réputées généralement réfractaires à la vaccination (Afolabi et Ilesanmi Olayinka 2021 ; Mutombo et al. 2021), la crainte des manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) (Leach et al. 2022), le manque d’approvisionnement en vaccins par les organisations internationales (Kêdoté, Sossa-Jérome et Wewe 2022). La reconnaissance d’une immunité acquise naturellement, démontrée dans le cadre d’enquêtes de séroprévalence menées dans la population générale à Conakry (Soumah et al. 2022), a conforté les autorités sanitaires dans le choix de privilégier une vaccination ciblée[3]. La vaccination contre la COVID-19 connaît plusieurs étapes, de la quête de vaccins pour une vaccination généralisée dans un contexte de ressources limitées, à la mise en place de politiques ciblées.
Les données présentées ici sont issues d’une ethnographie de la réponse à la pandémie de COVID-19 en Guinée. Des observations participantes et « flottantes » (Pétonnet 1982) ont été réalisées principalement à Conakry (la capitale) sur les sites de vaccination, dans les quartiers (premier auteur) et dans deux villes de l’intérieur de la Guinée : Kindia et Mamou (second auteur et équipe de recherche[4]). Elles ont consisté en une présence, de mars 2020 à octobre 2022, auprès de familles dont certains membres avaient été déclarés porteur d’anticorps contre la COVID-19, dans le cadre d’une étude de séroprévalence[5]. Des observations ont porté sur les interactions entre patients et vaccinateurs, et sur le déroulement des séances d’information et le recueil du consentement. La participation aux activités vaccinales a concerné l’installation des équipements de vaccination sur les sites et le remplissage du certificat vaccinal pour les patients.
L’observation flottante « consiste à rester en toute circonstance vacant et disponible, à ne pas mobiliser l’attention sur un objet précis, mais à la laisser ‘flotter’ afin que les informations la pénètrent sans filtre, sans a priori, jusqu’à ce que des points de repères, des convergences, apparaissent et que l’on parvienne alors à découvrir des règles sous-jacentes » (Pétonnet 1982, 32). Appliquée à la question vaccinale, elle s’est traduite par une déambulation sur les sites de vaccination avec comme objectif de se laisser prendre par ce qui semblait compter pour les acteurs présents. Il s’agissait de noter ce qui se jouait, ce qui s’énonçait sur les sites. Vaccinateurs, patients et badauds ont été rencontrés lors de ces observations. Les déambulations ont aussi concerné les quartiers. Des entretiens ont été menés avec des professionnels de santé[6] et dans la population générale[7].
Nous rappelons d’abord comment le confinement et la vaccination se sont imposés, au moins dans les discours, comme réponse globale à la pandémie pour ensuite démontrer empiriquement comment cette réponse a rencontré une réalité locale. Mais le champ de la santé globale dominé par des acteurs tels l’OMS, l’Alliance globale pour l’initiative vaccinale (GAVI), l’Union européenne gagne à être pensé comme « arène » dans laquelle des acteurs moins homogènes et plus dynamiques coopèrent ou sont en compétition (Gaudillière et al. 2022). C’est le cas de la Russie ou de la Chine qui, en Guinée, apparaissent comme une alternative avec laquelle le gouvernement collabore pour produire sa réponse à la pandémie tout en mobilisant des ONG comme l’alliance pour l’action médicale internationale (ALIMA), l’agence belge de développement (ENABEL), Terres des Hommes et des bailleurs comme l’agence française de développement (AFD) ou encore des conseillers techniques tels que le Centre for Disease Control and Prevention (CDC) (Brown, Cueto et Fee 2006 ; Gomez-Temesio et Le Marcis 2021). Ces acteurs de la santé mondiale développent des programmes standardisés et donnent le sentiment tout en étant sur le terrain d’y intervenir sans en tenir compte, ils « semblent figurer dans la scène depuis l’arrière-scène » (Gaudillière et al. 2022, 37).
L’arène de la santé globale est structurée par des enjeux commerciaux, sécuritaires et sanitaires (King 2002, 764). Différents acteurs aux logiques multiples y émettent des recommandations. Ce faisant ils garantissent de nouveaux marchés ou font de la santé un outil diplomatique ou de responsabilité sociale des entreprises, les deux étant souvent liés. En Guinée, les activités de recherche ou de diagnostic russes sur le virus Ebola ou la COVID-19 sont financées en partie par l’entreprise de bauxite Rusal. D’autres acteurs traduisent et négocient les recommandations et programmes à une échelle locale (structures gouvernementales comme l’agence nationale de sécurité sanitaire, les ONG) et les appliquent, y adhèrent ou y résistent (les professionnels de santé et les patients). La La chronologie vaccinale et les caractéristiques de la pandémie en Guinée sont décrites. Si officiellement, la Guinée s’engage dans le confinement et la vaccination, son expérience de la COVID-19 est très différente des pays du Nord (du point de vue du vécu de la maladie et de l’ampleur de la vaccination). Plutôt que d’analyser le faible taux de vaccination en Guinée comme une situation d’échec, nous le discutons comme une résistance intentionnelle et involontaire à des politiques de santé globale sourdes aux contextes locaux (Brives, Le Marcis et Sanabria 2016).
Le gouvernement guinéen met en scène son engagement dans la lutte contre la COVID-19. Il témoigne de son engagement dans la gestion internationale de la pandémie et s’assure d’un soutien même minimal des acteurs internationaux du champ de la santé globale. La COVID-19 sert également ses intérêts politiques dans un contexte de vote[8] et lui permet d’afficher sa bienveillante attention à la santé des guinéens. Ceux-ci ne sont pas inactifs. Ils interviennent dans cette arène par l’exposition de leur corps au virus, par leurs négociations avec ce dernier et par leurs réponses à l’appel vaccinal. Nous verrons en quoi ce contexte a favorisé la résistance aux mesures préventives et la minimisation du risque de la COVID-19. Le virus rencontre en Guinée des biologies locales (Lock 2017) ce qui se manifeste par un important taux de transmission[9] de la COVID-19 (Soumah et al. 2022) lié à la difficile application des mesures préventives comme le confinement, mais aussi par une faible expérience collective de la maladie. En cause la jeunesse de la population peu sensible au virus et des corps pour lesquels la COVID-19 n’est ressentie le plus souvent que comme un rhume sans gravité. Dans ce contexte, le faible taux de vaccination est moins une faillite de la traduction locale des campagnes promues par les acteurs internationaux qu’une réponse pragmatique à un agenda vaccinal global. Notre approche est fondée sur la reconnaissance de l’agentivité des acteurs institutionnels et individuels face au mouvement vaccinal mondial. L’inefficacité des politiques de vaccination contre la COVID-19 devient alors la manifestation d’une résistance et d’une alternative locale à l’agenda vaccinal global.
Des modèles universels de gestion épidémique à leur négociation locale
De l’invention de la quarantaine pour lutter contre la peste à Dubrovnik au XIVe siècle (Grmek 1980) aux centres de traitement de la fièvre hémorragique Ebola (Gomez Temesio et Le Marcis 2017), l’isolement et l’enfermement sont des modalités universelles de la gestion des risques sanitaires. En Guinée, l’isolement a été décrit pour la variole (Hayden 2008) avant et pendant la période coloniale. Il a constitué un mode de gestion épidémique entre ensembles coloniaux, en témoigne une affiche transmise par l’administration anglaise de Sierra Leone aux autorités françaises de Conakry (Figure 1). La quarantaine entre territoires coloniaux est courante[10].
Figure 1
Le confinement s’inscrit dans l’histoire des modalités de lutte contre la contagion et donne aux acteurs étatiques l’occasion d’incarner « l’État au travail » (Bierschenk et Olivier de Sardan 2014). La vaccination est depuis l’époque coloniale une des dimensions du gouvernement des risques par les autorités (Hayden 2008 ; Moulin 1996, 2006 ; Salvadori et Vignaud 2019). La pandémie de COVID-19 témoigne de la modification des manifestations étatiques dans le domaine de la santé publique (dans ses dimensions à la fois sécuritaires et préventives) induites par les logiques de préparation (preparedness). Elle consiste en un ensemble de techniques combinées formant une norme d’anticipation développée de l’après-Seconde Guerre mondiale à nos jours. Depuis les années 1990, la « preparedness » est au coeur des programmes portés par les institutions sanitaires internationales (Lakoff 2017). L’émergence ou la réémergence des épidémies justifie depuis le développement de technologies : surveillance, diagnostic, masques, vaccins (David et Le Dévédec 2019). L’éradication virale et l’appréhension de l’épidémie par le prisme du R0 (taux moyen de contamination produit par un cas positif) sont le moteur de la gestion épidémique hégémonique globale (Richardson 2022). En Guinée, en temps épidémiques, cela se traduit par des réunions journalières, matinales, diffusées en ligne. Les données chiffrées sont mobilisées pour orienter l’action. D’un point de vue technique, des technologies de surveillance (dont des capacités de diagnostic) ont été introduites sur l’ensemble du territoire (Gen-expert, Test RT-PCR) créant un isolat de haute technicité dans un système de santé qui reste sous financé. Ce régime épistémologique et les politiques de surveillance qui l’accompagnent, participent de la production de l’ignorance sur la négociation de la vie avec les virus en fonction de modalités situées – c’est-à-dire inscrites dans des réalités politiques, historiques, économiques et biologiques (Brives 2020) – et sur le fait que les épidémies se répètent rarement à l’identique. Au début de l’épidémie de COVID-19 à Conakry, les autorités sanitaires soutenues par l’alliance pour l’action médicale internationale ALIMA ont mis en place un centre de traitement épidémique au CHU de Donka identique à ceux ouverts pendant les épidémies de fièvre à virus hémorragique Ebola et de choléra. Il aura fallu six mois pour que la différence des modes de contamination une fois reconnue, l’organisation du centre soit révisée et les procédures de décontamination des soignants allégées (Bonnet et al. 2021 ; Le Marcis 2023).
La Guinée est le premier pays d’Afrique subsaharienne à vacciner contre la COVID-19 le 30 décembre 2020, avec le vaccin russe Sputnik V (Figure 2). La vaccination concerne d’abord les hauts cadres de l’administration autant pour donner un exemple à la population que pour protéger les élites. La campagne de vaccination massive commence le 5 mars 2021 mais se déploie de manière inégale. De faible quantité de doses sont disponibles, et la campagne limitée à la capitale[11] cible d’abord le personnel de santé, les individus âgés de 60 ans et plus, les individus présentant des pathologies les rendant à risque de développer des formes sévères de la COVID-19 (diabète, cardiopathie, etc.) et les cadres occupant des postes jugés stratégiques. Elle progresse ensuite lentement dans l’intérieur du pays. L’offre vaccinale repose sur de multiples sources d’approvisionnement : d’abord russe (Sputnik V) et chinoise (Sinovac, Sinopharm) puis, occidentales (AstraZenaca, Pfizer-Biotech, Moderna et Janssen). Elles ont aussi été indiennes (AstraZeneca d’Oxford produit par le Serum Institute of India). En février 2023, 8742407 doses vaccinales avaient été administrées (ANSS et al. 2023) pour une population estimée à plus de 19 millions d’individus[12].
Figure 2
Chronologie vaccinale COVID-19 en Guinée, évènements sanitaires et politiques. Guinée mars 2020 – août 2022.
La vaccination a reposé sur un tri entre les demandeurs de vaccin souhaitant voyager en Europe (et nécessitant des vaccins jugés efficaces par les pays occidentaux) et les autres pouvant se contenter des vaccins chinois et russe. Pour ces derniers, le vaccin russe bénéficiait d’un a priori plus favorable que le vaccin chinois et a fait l’objet, avant la mise à disposition de vaccins occidentaux, de la convoitise des élites guinéennes (notamment en sciences médicales). Les plus anciens parmi eux avaient reçu leur formation dans les pays de l’Est sous la première et la deuxième République. C’est le cas de Mohamed Diane, ministre de la Défense nationale et des Affaires présidentielles pendant l’épidémie et biologiste médical formé en Bulgarie. Ce dernier aurait effectué plusieurs voyages en Russie pour négocier l’obtention des vaccins.
Après deux ans d’une politique de vaccination massive à l’échelle mondiale, la couverture vaccinale en Guinée reste faible et hétérogène. Le déploiement vaccinal en Guinée, inscrit dans des relations bilatérales anciennes, s’est accompagné d’une remise en cause de la pertinence sanitaire du vaccin. Celle-ci doit se comprendre au regard de biologies locales, de l’usage pragmatique du vaccin et de sa valeur politique dans le contexte d’une modification constitutionnelle et d’élections contestées.
Un bilatéralisme vaccinal miroir inverse du nationalisme vaccinal
Le premier temps de la vaccination contre la COVID-19 en Guinée révèle autant qu’il repose sur des liens bilatéraux qui existent depuis l’époque soviétique entre la Guinée et la Russie, et entre la Guinée et la Chine (depuis l’époque du mouvement des pays non alignés dans lequel la Chine est observatrice et la Guinée membre). Ces relations anciennes entre la Guinée, la Chine (Cabestan 2013) et la Russie (Diallo 2021) se sont concrétisées à partir des années 1970 par des collaborations scientifiques, des réalisations en termes d’infrastructures (stades, universités, routes palais) et l’octroi de concessions minières.
Les stratégies d’obtention de vaccins reposent sur des rapports bilatéraux sino-russo guinéens basés sur la coopération économique et le développement d’infrastructures. Elles contredisent empiriquement la rhétorique d’une aide multilatérale promue par les organismes à l’échelle planétaire.
De 1972 à 1990, l’Union soviétique s’engage dans la coopération avec la Guinée de Sékou Touré[13]. L’actuelle CBK (Compagnie des bauxites de Kindia) est issue de l’OBK (Office des bauxites de Guinée), une compagnie créée en 1973 dans le cadre d’une coopération soviéto-guinéenne (Elzein 2014). Dans le secteur scientifique, dès 1972, quatre premiers étudiants guinéens sont envoyés en URSS pour y effectuer leur doctorat dans le cadre de la politique de formation des universitaires africains promue par Nikita Krushchev (Matusevich 2009 ; Diallo 2021). En Guinée, les soviétiques occupent la place laissée vacante par les Français, depuis l’indépendance en 1958, dans les universités et les centres de recherches. C’est le cas de l’Institut de Recherche en Biologie Appliquée (IRBAG), fondé en 1922 comme Institut Pasteur de Kindia (Rode 1937) et jusqu’à aujourd’hui couramment appelé Pastoria[14]. Arrivés dans ce centre en 1972, les chercheurs soviétiques le quittent en 1990, après l’effondrement de l’URSS. Des chercheurs russes reviennent à Pastoria à la faveur de l’épidémie d’Ebola (2014-2016), mais cette fois-ci la rhétorique des « pays frères » laisse place à un partenariat public-privé. L’institut de virologie russe Gamaleya développe des travaux sur les fièvres hémorragiques dans un laboratoire construit dans l’enceinte de Pastoria (le CREMS) avec un financement de l’entreprise Rusal qui exploite la bauxite dans les régions de Boké et de Kindia. Un essai clinique sur le vaccin ebola GamEvac-Combi y est développé et prend en charge des patients. Plus tard, les personnes positives au SARS-CoV-2 y sont reçues. L’engagement sanitaire de l’entreprise Rusal lui permet de mettre en avant sa responsabilité sociale. Elle reçoit le premier prix récompensant l’engagement des entreprises privées dans la lutte contre la COVID-19 en 2021 (Rusal 2021).
La présence de vaccins chinois en Guinée, et d’intrants de laboratoire ou d’équipements de protection individuels sont le pendant sanitaire des investissements massifs consentis dans le secteur minier, routier et ferroviaire par des entreprises chinoises. Shandong Weiqiao et Yantai Port sont associées dans le cadre du Winning consortium pour l’exploitation des gisements de fer du Simandou et la construction de 650 kilomètres de voies ferrées reliant ce site au port minéralier de Senguelen en construction[15]. Cette présence chinoise n’est cependant pas nouvelle puisque la Chine a contribué en 1965 à l’édification du palais du peuple situé à Conakry. Celui-ci abrite l’Assemblée nationale (Pauthier 2013), et a été le plus grand site de vaccination anti-COVID du pays.
Ces collaborations bilatérales renouvellent d’anciennes relations en lien avec les activités extractives en Guinée. Elles se développent dans le contexte de l’inefficience des mécanismes COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) et AVATT (Africa Vaccine Acquisition Task Team)[16] pour un accès solidaire et équitable aux vaccins (Usher 2021). La réponse vaccinale à la pandémie à l’échelle internationale a consacré ce que Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, a dénoncé comme relevant du « nationalisme vaccinal » (Nations Unies 2021).
Contrairement au credo d’une santé devenue globale – pour laquelle la prise en compte des problèmes de santé des plus pauvres par les plus riches relève à la fois d’un devoir moral et d’un enjeu de sécurité sanitaire à l’échelle mondiale (Lakoff 2010) –, les pays producteurs ou ceux en mesure de préfinancer l’achat de vaccins ont préempté les doses avant même qu’elles ne soient produites. Les firmes ne se sont pas engagées à faire du vaccin un « bien commun » (Gaudillière, Izambert et Juven 2021 ; Desclaux et Sow 2021). Le bien public supposé « mondial » est devenu un bien public « local » (Gaudillière, Izambert et Juven 2021).
La multiplicité de sources d’approvisionnement et l’irrégularité des livraisons des vaccins ont donné lieu à des campagnes discontinues, entraînant une vaccination incomplète et une combinaison de vaccins différents comme l’illustre cet échange observé en juillet 2021, chez Camara, le président du conseil de quartier de Bonfi[17], situé en périphérie de Conakry et dépourvu d’infrastructures sanitaires.
Ce matin, Camara est assis sous la véranda de sa maison. Il reçoit les habitants du quartier et règle les différents qui lui sont exposés, transmets des informations, dispense des conseils ou boit du thé avec ses amis. Un habitant du quartier se présente :
L’habitant du quartier : « Menge[18], pourquoi les docteurs [vaccinateurs] ne sont pas revenus pour nous donner la deuxième dose [du vaccin Sputnik] ? Que dois-je faire pour obtenir la deuxième dose ? ».
Camara : « Ça fait plusieurs mois, le vaccin russe est en manque, et je ne sais pas quand il sera disponible. La Guinée ne fabrique pas ces vaccins. Comme je le propose à tout le monde, il faut partir prendre [se faire vacciner] un des vaccins chinois [Sinopharm ou Sinovac] qu’on trouve actuellement sur tous les sites de vaccination à Conakry. »
L’appariement des vaccins a fait l’objet de mise en garde de la part de l’OMS[19]. Il a été cependant pratiqué, permettant aux autorités sanitaires de satisfaire la demande. La diversité de l’offre vaccinale et les différents intrants (reconnus dans les pays à faibles revenus, non homologués dans les pays occidentaux, notamment la France) ont favorisé le développement d’usages pragmatiques de la vaccination. Ces derniers s’articulent aux biologies locales sous-tendant la construction (ou non-construction) du risque de la COVID-19.
Vaccination globale et biologies locales
Au début de la pandémie, la préoccupation des autorités sanitaires guinéennes semble de convaincre la population, perçue comme ignorante du risque de la COVID-19 et du bienfait de la vaccination. Mais les objectifs évoluent tout au long de la pandémie. Aujourd’hui, la vaccination n’est plus envisagée que pour les personnes à risque de complication (état de santé, âge). Cette évolution a été anticipée par les Guinéens sur la base de leur expérience. Peu de familles ont connu un décès ou une forme grave de COVID-19 mais personne n’a échappé aux mesures prises contre la COVID 19 : contrôle systématique de non positivité à la sortie de Conakry, restriction du nombre de passagers dans les transports en commun, interdiction des rassemblements, fermeture des établissements d’enseignement et des lieux de culte, réduction des horaires d’ouverture des marchés, obligation du port du masque dans les bâtiments publics, vaccination ou test négatif obligatoire pour quitter le pays par avion ou encore échapper au harcèlement policier au nom de l’application des mesures, etc. Dans une famille, l’expression « épidémie tournevis » a été utilisée pour décrire cette expérience.
À l’ampleur des mesures mises en place, répond la faible visibilité de la maladie. Ce paradoxe renforce le scepticisme quant à la menace de la COVID-19. Les études de séroprévalence révèlent un niveau d’exposition virale autour de 70 % (cf. supra). Les Guinéens ont été exposés au virus, mais cela ne s’est pas traduit par la construction d’une expérience collective[20]. Présenter des d’anticorps ne signifie pas nécessairement d’avoir été malade de la COVID-19.
La notion de biologie (pour biologie locale) locale invite à dépasser l’analyse des points de vue des acteurs en termes de représentation de la maladie et à interroger le sens de leur discours au regard de leurs biologies situées. Margaret Lock estime qu’une part de la tâche des anthropologues intéressés par la question du corps « consiste à reconnaître les biologies locales, c’est-à-dire les différences biologiques entre les personnes qui résultent des réponses corporelles à des environnements différents dans le temps et dans l’espace » (Lock 2017, 5)[21]. Avec Lock, il s’agit de prendre acte que :
la notion de biologies locales renvoie à la manière dont les processus biologiques et sociaux sont en permanence enchevêtrés tout au long de la vie, ce qui garantit un certain degré de différence biologique entre les êtres humains, où qu’ils se trouvent, qui n’a généralement que peu ou pas d’importance, mais qui, parfois, influe profondément sur le bien-être.
Lock 2017, 8[22]
Dès lors, il convient moins d’analyser les formes d’engagement des Guinéens avec la vaccination comme manifestation de ce qu’ils croient que de les penser comme le résultat de l’incorporation de l’histoire, des inégalités qui façonnent leur existence, des enjeux politiques qui structurent leurs relations avec l’État ou encore de l’exposition aux différents SARS-CoV qui contribuent à la compétition virale dont leur corps est le terrain (INSP, 2021)[23]. La reconnaissance de ces biologies situées prolonge l’approche syndémique (Singer 2009) en approfondissant la dimension biosociale de la santé et de la maladie avec la question de la production située des corps. Au-delà du lien entre contexte et conditions de l’exposition au risque et de la production du soin, la notion de biologie située invite à penser comment les individus de manière phénoménologique questionnent avec leur corps l’agenda vaccinal porté par les acteurs de la santé globale.
Monsieur Bah est un commerçant de rue à la retraite. Marié à deux épouses, il est père de neuf enfants. Il partage son logement (trois chambres et un salon) avec ses femmes et six enfants. La maison est de petite taille et présente une peinture défraîchie, une toiture rouillée et couverte de poussière. Sa cour est située dans un quartier périphérique de Conakry en bordure de l’autoroute qui traverse la ville d’Est en Ouest. Le quartier ne dispose pas de routes goudronnées ni d’adduction d’eau, ni de structures de santé. L’offre de soins la plus proche est à 4 kilomètres. Pour l’eau, les habitants se retrouvent autour de forages dans le quartier. Non vacciné contre la COVID-19, Monsieur Bah apprend sa séropositivité à la faveur d’une enquête de séroprévalence menée en décembre 2020. Il n’a jamais ressenti de symptômes liés à la COVID-19 :« Ma maladie est loin de corona qu’on voit ailleurs. Je souffre d’un simple rhume qui est une maladie ordinaire chez moi, je le contracte via les poussières inhalées dans la circulation comme à la maison. » (M. Bah).
Le rapport qu’entretient monsieur Bah avec la COVID-19 est ténu, quand bien même il est attesté par une sérologie positive. Son corps et le rhume qui relève de son ordinaire, renvoient aux violences structurelles qui frappent la Guinée (Farmer 2002) et façonnent la vie de plus de 2 000 000 d’habitants de la capitale. Le faible engagement étatique pour le bien-être de la population, l’absence de rues goudronnées dans les quartiers périphériques et d’équipements fabriquent des biologies locales qui résistent à la COVID-19 et questionnent la pertinence d’une vaccination pour une maladie à peine visible.
Madame Fofana approche 60 ans. Elle est veuve et vit avec ses deux petits-enfants. Ses deux filles mariées ne la soutiennent que de loin, son unique garçon est parti « en aventure » sans laisser de nouvelles. Elle vit dans une cour commune partagée avec une dizaine de familles à Dixinn, un quartier populaire de Conakry. La cour jouxte l’une des deux voies ferrées de la capitale, dédiées à l’exportation de la bauxite. En plus d’un petit commerce assuré par ses petits-enfants, elle fait partie des femmes balayeuses de la ville de Conakry dont le travail est payé par le gouvernorat environ 500 000 francs guinéens par mois[24]. Chaque matin, après avoir balayé les rues de 7 à 10 heures, son corps lui fait mal[25]. Pour calmer ses douleurs, ses petits-enfants la massent avec un onguent d’origine chinoise. Ses ressources ne lui permettent pas de chercher auprès des agents de santé un moyen d’apaiser ses douleurs. Elle ne peut ni payer son transport ni ses consultations, encore moins ses médicaments… Comme Monsieur Bah, Madame Fofana découvre qu’elle a été exposée à la COVID-19 dans le cadre d’une enquête de séroprévalence en novembre 2021, sans jamais l’avoir ressentie :
Je n’ai jamais été touchée par Corona. La seule chose qui me fatigue ce sont des douleurs prolongées, qui ne datent pas d’aujourd’hui. Elles sont dues à mon activité, qui est assez difficile avec mon âge. Mais, je n’ai pas le choix, car je ne subviens à mes besoins quotidiens qu’avec l’argent que mon travail me rapporte.
Mme Fofana
Le soir, lorsque son corps lui fait mal et que ses petits-enfants la soulagent avec l’onguent, les murs de sa maison vibrent en raison du passage des wagons chargés de bauxite. Son fils « en aventure », ses filles sans moyens, la douleur de son corps et le cliquetis des wagons qui accompagnent ses séances de massage, évoquent les inégalités qui structurent la Guinée, et sont au coeur de la production des biologies locales.
La COVID-19 est, à l’instar de la grippe au Niger, « un événement biologique mondialisé, mais confiné et invisible à l’échelle locale » (Thiongane 2012, 12). Nonobstant, les autorités sanitaires s’acharnent et priorisent la vaccination anti-COVID. Le directeur de l’Institut national de santé publique (INSP) de la Guinée pendant l’épidémie considère que dans plusieurs pays africains la priorité a été d’administrer rapidement les vaccins reçus pour éviter qu’ils ne soient périmés (Touré 2022, 98). En janvier 2022, les jeunes âgés de 12 à 17 ans deviennent la cible vaccinale de COVID-19 principale. Elle mobilise l’ensemble des agents de l’État dédiés à la vaccination alors qu’une épidémie de rougeole survient dans les écoles totalisant 21 914 cas et 33 décès (Gerome 2022)[26]. En août 2022, alors que les trois-quarts des centres de traitement épidémiques de COVID-19 sont fermés, une campagne de vaccination avec des doses de Comirnaty (BioNTech-Pfizer) très proches de la péremption s’intensifie auprès des porteurs de comorbidité tels que les diabétiques. Cette fois-ci, la tension se durcit entre les vaccinateurs et les patients refusant de coopérer. Un quinquagénaire (diabétique) affirme : « On prend le vaccin si c’est nécessaire. J’ai d’autres soucis sanitaires plus importants que celui de Corona. J’ai même appris au début des campagnes de vaccination que ce vaccin est dangereux[27] pour les diabétiques. »
Face au refus de patients, mais contraints par les objectifs à atteindre, les équipes vaccinent parfois sans consentement comme l’explique un agent : « Nous ne pouvons pas dire aux gens qu’il s’agit de vaccin COVID, sinon on ne pourra pas atteindre le quota de 70 vaccinés par jour, déterminant la paie de nos primes. ». La priorisation de la vaccination contre la COVID-19 au détriment d’autres programmes vaccinaux, ne repose pas seulement sur la nécessité d’écouler les vaccins, mais traduit une politique de tri fondée sur la préséance accordée à une population (ici les personnes diabétiques vaccinées au détriment des écoliers exposés à la rougeole). Prioriser la COVID-19 (invisible au sein de la population) met en évidence le décalage entre les priorités sanitaires globales et les priorités vécues localement.
Les multiples justifications de la vaccination
La demande de vaccin obéissait à de multiples logiques. Une logique était sanitaire : il s’agissait pour les acteurs de prévenir une contamination en raison d’une première pathologie favorisant une perception accrue du risque. C’est le cas d’Elhadj. Ce dernier vit à Conakry dans un quartier relativement aisé, en périphérie. Octogénaire, il est luti[28] et souffre du diabète depuis 20 ans. Sa famille est composée d’une dizaine de personnes (épouse, neveux, fils, petits-fils, etc.). Il est largement informé sur la COVID-19 par ses fils qui vivent en Europe et prennent en charge ses frais médicaux. Pendant l’épidémie, ils s’entretiennent avec lui tous les soirs via WhatsApp et l’encourage à respecter les mesures préventives (installation de dispositifs de lavage des mains à l’entrée du domicile, port de masques). Il se fait vacciner et exige que sa famille fasse de même. Son corps est en Guinée, mais une part de lui-même vit par procuration en Europe et au-delà. Les moyens financiers qu’il mobilise viennent de France, de Grande Bretagne et de Thaïlande comme la conscience aigüe du risque de contamination en cas de comorbidité. Confiant dans ses fils, il suit leurs conseils, mais eux-mêmes parlent à partir d’une autre expérience épidémique.
Pour d’autres, le désir de vaccination est lié au besoin de circuler. Pendant l’épidémie, la possibilité de voyager hors de Conakry ou de la Guinée était conditionnée à la présentation d’un certificat de vaccination. Un vaccin russe ou chinois suffisait pour sortir de Conakry, mais un vaccin occidental était requis pour prendre l’avion vers les pays du Nord. Ces logiques étaient prises en compte dans l’organisation des sites de vaccination, comme l’illustre la scène observée en mai 2021 au palais du peuple de Conakry. À 9 heures du matin, deux femmes y échangent sur les motifs de leur demande du vaccin :
Première femme : « Cet après-midi, je dois aller assister au mariage de ma soeur à Kissidougou [ville située à 753 kilomètres de Conakry]. J’ai perdu mon papier [certificat vaccinal], je suis venue pour me vacciner à nouveau afin d’obtenir un autre papier. Sinon, je serai fatiguée par les militaires [agents aux contrôles sanitaires placés à la sortie et à l’entrée des grandes villes du pays] en cours de route ».
Seconde femme : « Moi, j’avais reçu une dose du premier vaccin [Sputnik] dans mon quartier, mais il n’y avait pas de papier [certificat vaccinal]. Comme je dois bientôt voyager à l’extérieur, je suis venue pour prendre un autre vaccin et obtenir un papier. »
Le certificat vaccinal garantit à la première voyageuse d’éviter le harcèlement des forces de l’ordre. Les personnes vaccinées avec un produit chinois ou russe souhaitant se rendre dans un pays occidental sont contraintes d’effectuer une nouvelle injection avec un produit reconnu dans le pays de destination. Des files d’attente « pour l’Europe » sont mises en place dans certains sites (Sylla, Attas et Le Marcis 2022, 4).
Une matinée du mois d’août 2021, deux groupes font la queue. Certains viennent recevoir leur première dose, d’autres sont en attente d’une seconde injection. À 9 heures 30, le responsable de la logistique surnommé « Soumah vaccin » arrive à bord d’un véhicule flanqué du sceau de l’ANSS[29]. Il porte un sac à dos et un gilet avec le logo de son institution. Après avoir veillé au débarquement du matériel, il échange avec ses collègues puis, ils s’approchent des demandeurs de la seconde dose de vaccin. Beaucoup n’ont pas pu compléter leur schéma de vaccination par manque d’intrants. « Soumah vaccin » s’adresse alors à ceux qui viennent pour la première dose :
Soumah vaccin : « Bonjour, vous êtes là depuis longtemps, je m’excuse pour le retard. Aujourd’hui, nous n’avons que Sinovac et AstraZeneca. Ce dernier est donné uniquement aux personnes âgées de 50 ans et plus et les voyageurs, notamment pour l’Europe. ».
Un jeune homme demande alors : « Si on n’a pas encore atteint les 50 ans et [si] on n’a pas un projet de voyage, est-ce qu’on peut prendre ce vaccin [AstraZeneca] ? ».
Soumah vaccin lui répond : « Je ne sais pas, je ne dis qu’à ceux qui ont 50 ans et ceux qui voyagent, surtout en Europe, de le prendre. Parmi tous les vaccins qu’on a ici, c’est le seul qui est admis en Europe ».
[…]
Une candidate (étudiante) proteste : « Si tu vois que nous avons tous voulu prendre AstraZeneca, parce qu’il est autorisé par les Blancs [Européens]. Il est sûrement meilleur que celui des Chinois [Sinovac] ! »
Un autre renchérit : « AstraZeneca est le bon vaccin. Mais, certainement, il n’y a pas assez de doses, raison pour laquelle ils priorisent les 50 ans et les voyageurs. »
La dénonciation de la piètre qualité des vaccins chinois participe à la cristallisation du doute sur la vaccination (Moulin 2006). Celui-ci s’est accru lorsque les premières doses du vaccin Janssen livrés par l’Union africaine ont vu, dès leur livraison, leur date de péremption prolongée par le fabricant afin de permettre leur utilisation et que des cas de thrombose ont été rapportés en Europe.
L’approvisionnement insuffisant et l’anxiété vaccinale (Fairhead et Leach 2007) ne suffisent pas à expliquer le faible taux de vaccination en Guinée. La lecture pragmatique du risque sanitaire fondée sur les biologies locales s’articule à un contexte politique qui conduit à la mise en cause de la légitimité sanitaire des campagnes de vaccination.
L’épidémie de COVID-19 comme moment politique
En mars 2020, arrivé au terme légal de ses deux mandats présidentiels, le président Alpha Condé proposa la ratification d’une modification constitutionnelle et des élections législatives (la constitution guinéenne n’autorise que deux mandats consécutifs). La modification de la constitution lui permettait, d’un point de vue légal, de candidater pour un troisième mandat. Celui-ci ne constituant dans la logique d’Alpha Condé qu’un premier mandat dans un nouveau cadre constitutionnel (Sylla 2022). Ce projet provoqua de nombreuses manifestations. L’irruption de l’épidémie constitua une opportunité pour le chef de l’État. Au nom de la nécessaire distanciation physique, il fit interdire les rassemblements publics et instaurer un couvre-feu. Pour autant, le double vote ne fut pas reporté. L’usage politique des mesures sanitaires a été souligné par l’opposition, contribuant à reléguer leur dimension sanitaire comme en Côte d’Ivoire (Djaha et Bekelynck 2021) ou en République Démocratique du Congo (Ayimpam et Bouju 2022). La gestion de la COVID-19 fit l’objet de « surpolitisation » (Lascoumes 2009). Une junte militaire évinça Alpha Condé le 5 septembre 2021. Les premières mesures prises par son chef (le colonel Doumbouya) renforcèrent cette lecture politique de la COVID-19 puisque les contrôles militaires et sanitaires furent levées, ce qui fit dire à Conakry : « Doumbouya a chassé la COVID avec Alpha Condé » (Attas et al. 2022).
L’analyse de la couverture vaccinale relative à la poliomyélite au Nigeria (Magone 2013) met en évidence l’immersion graduelle de la santé dans le domaine politique, associé de façon croissante à la réponse aux enjeux sanitaires à l’échelle planétaire (Odabare 2005). La question de la confiance entre l’État et la population est centrale pour comprendre le « télescopage » (Thiongane 2012) entre le contexte sociopolitique, la réception des mesures sanitaires et les perceptions du risque de la maladie. Avant la chute d’Alpha Condé, d’autres évènements ont saturé la COVID-19 par le politique. À la veille du lancement de la campagne de vaccination sur le territoire guinéen, Alpha Condé et certains ministres reçoivent leur première dose de vaccin. L’évènement est relayé par la télévision nationale afin d’encourager la population à se faire vacciner. Cela est perçue de façon mitigée par la population, comme l’avait été la vaccination publique des autorités sanitaires avec le vaccin contre Ebola lors de l’épidémie de 2014-2016. Loin de favoriser la confiance, ces vaccinations télévisées sont reçues avec suspicion. Dans le prolongement des critiques émises lors de l’épidémie d’Ebola (Le Coq 2022), les autorités sont accusées de faire de la campagne vaccinale un moyen de capter des ressources. Un jeune, conducteur de taxi-moto se demande en septembre 2021 : « Pourquoi se faire vacciner contre une maladie qui n’existe pas ? Cette vaccination sert de tuyau [source] d’argent pour les gens [autorités politiques]. C’est loin de la protection de la population. Je ne prendrai pas ce vaccin. ».
En Guinée, des opposants ont mis en cause les vaccins comme produits rendant infertile et proposés à la population afin de diminuer l’électorat. L’association entre vaccination et infertilité n’est pas spécifique à la COVID-19 (Feldman-Savelsberg et al. 2000). Lorsque la vaccination antipolio se déployait au Nigéria, les vaccins ont été accusés de rendre la population infertile (Obadare 2005). Ces arguments participent des logiques de l’anxiété vaccinale (Fairhead et Leach 2007).
Vaccination globale, biologies locales et hégémonies
Sur le continent africain, les réponses sécuritaires et préventives ont été rapidement mises en oeuvre, d’autant plus qu’une catastrophe imminente était annoncée (Cabore et al. 2020 ; Bonnet et al. 2021). La faiblesse des systèmes de santé et la réticence des populations aux actions de santé publique étaient mises en avant pour annoncer une catastrophe. Celle-ci n’a pas eu lieu sans qu’il soit possible d’en attribuer les raisons à tel ou tel facteur, même si la jeunesse de la population et les immunités croisées[30] semblent avoir joué un rôle (Le Marcis 2023). Une approche pragmatique des logiques de vaccination permet d’aborder la faible couverture vaccinale non pas comme faillite, mais comme réponse contextuelle aux politiques globales de lutte contre la COVID-19. Cette réponse évolue tout au long de l’épidémie selon le contexte politique et l’expérience de la COVID-19, en fonction des biologies situées, et constitue une alternative guinéenne à l’agenda vaccinal global.
D’un point de vue politique et au regard de l’équité, il importe, certes, de penser les vaccins comme un « bien commun mondial. » Moralement aussi bien que politiquement, il n’est pas tolérable que la majorité des États à revenu élevé connaissent un déploiement accéléré et que plus de la moitié de leurs habitants soient complètement vaccinés (Marziano et al. 2021) quand d’autres pays présentent de faibles taux de vaccination, faute de moyens. Cependant, ce à quoi l’ethnographie de la COVID-19 en Guinée nous invite, c’est à interroger la pertinence d’un agenda hégémonique revendiquant une portée universelle sans reconnaître la dimension construite des épidémies et les formes nécessairement situées de la négociation avec les virus. Face au développement d’une vaccination globale (Blume et Zanders 2006 ; Moulin 2006), il importe de reconnaître la spécificité des contextes locaux et des biologies situées et prêter attention à ce qui compte vraiment pour les acteurs (Kleinman 2006). Cela détermine les conditions de la négociation avec les virus comme la pertinence des politiques vaccinales. Moins qu’une incapacité à mettre en oeuvre une campagne vaccinale, le résultat de cette négociation traduit l’action de l’État guinéen et l’agentivité de sa population, parvenant à faire entendre une voie différente alors qu’à l’échelle de la santé mondiale l’unanimité semble s’imposer pour une vaccination massive.
En Guinée, la reconnaissance du risque de la COVID-19 – ce qui est différent de celle de l’épidémie à l’échelle mondiale – est faible (Heyerdahl et al. 2023) et sa priorisation au détriment des autres maladies fait l’objet d’une interrogation des populations comme des acteurs de santé. Insister sur les écueils rencontrés par la campagne de vaccination contre la COVID-19 en Guinée (suspicion sur la qualité des vaccins, approvisionnement discontinu en intrants et offre vaccinale non homogène et peu cohérente) masque la résistance sourde à l’imposition de l’agenda de la santé globale. L’État et les acteurs de santé publique ne sont pas en mesure de véritablement discuter l’offre, tant par clientélisme vis-à-vis des opérateurs internationaux de santé que par opportunisme (quand les mesures servent des intérêts politiques). Dans ce contexte, les inégalités incarnées dans les corps et l’exposition à d’autres pathogènes sont rendues silencieuses. Elles signalent pourtant que la lutte contre la COVID-19 pourrait passer par l’équipement des quartiers en infrastructures de santé ou en routes, par une meilleure répartition des richesses dans le pays ou encore que la construction du risque COVID-19 à Genève, n’a pas forcément d’équivalent en Guinée où la rougeole tue aussi. Elles pourraient conduire à questionner les politiques de préparation aux épidémies de fièvres hémorragiques en Guinée. Elles concentrent l’attention et les moyens au détriment d’enjeux majeurs de santé publique telle que la santé maternelle ou la prise en charge du diabète. Elles rappellent enfin que l’expérience africaine de la pandémie est celle d’une relégation. Les Guinéens comme l’ensemble des habitants des pays n’ayant pas accès aux vaccins reconnus dans les arènes de la santé globale internationale, étaient doublement pénalisés : récipiendaires d’une faible quantité de vaccins reconnus en occident ou ne bénéficiant que de vaccins dont la qualité était mise en cause par l’OMS, ils se virent interdire l’accès aux pays du Nord durant toute la durée de l’épidémie. Nous défendons ici une position fragile entre un appel à une politique du bien commun (le vaccin pour tous) et la reconnaissance des biologies situées (le vaccin pas pour tout le monde). Il n’y a pas lieu d’opter pour une position ou l’autre, mais de les tenir ensemble pour que la santé globale d’un agenda hégémonique devienne vraiment un projet reconnaissant la dimension construite des mondes que nous habitons et de nos corps.
Appendices
Remerciements
Nous remercions Amadou Tidiane Barry et Gnouma Laurent Koniono pour leur partage de notes de terrain, les acteurs de la vaccination pour leur coopération et tous ceux qui ont partagé avec nous leurs expériences, espoirs et inquiétudes pendant la période épidémique. Les rédacteurs de ce numéro, les pairs évaluateurs et Abdoulaye Touré ont proposé une relecture généreuse d’une première version de ce texte, nous les en remercions. Nous restons cependant responsables des erreurs qu’il pourrait encore contenir.
Notes
-
[1]
Durant l’épidémie, les autorités sanitaires passent d’une logique d’éradication à une logique de contrôle viral, notamment en développant des campagnes ciblées de vaccination.
-
[2]
Ici, on définit comme schéma vaccinal complet l’injection de deux doses de vaccins.
-
[3]
Les résultats d’une enquête récente de séroprévalence mené par le CERFIG en mai 2022 indiquent qu’environ 70 % des habitants de Conakry sont porteurs d’anticorps contre la COVID-19 (1384 personnes prélevées), selon une communication personnelle avec Abdoulaye Touré, dont les résultats n’ont pas encore été publiés.
-
[4]
Programme ARIACOV, coordonné par l’IRD et financé (approbation éthique du Comité National d’Éthique pour la Recherche en Santé de la République de Guinée N°068/CNERS/20). Il s’inscrivait dans le cadre du Projet de recherche-action en appui à la riposte africaine à l’épidémie de COVID-19 (ARIACOV) coordonné par l’IRD et financé par l’Agence Française de Développement (AFD).
-
[5]
Le premier auteur a participé comme anthropologue à l’enquête « Dynamique de l’épidémie à SARS-CoV-2 à Conakry, Guinée (COVEPIGUI) ». Financé par l’ANRS, il a été coordonné par les professeurs Jean-François Etard et Abdoulaye Touré (approbation du Comité National d’Éthique pour la Recherche en Santé de la République de Guinée N°91/CNERS/20).
-
[6]
13 entretiens approfondis ont été menés avec des professionnels de santé, ainsi que des entretiens informels répétés avec des étudiants en sciences de la santé.
-
[7]
Des entretiens informels ont été menés avec des demandeurs de vaccin comme des personnes hésitantes à se faire vacciner lors des observations répétées menés sur le terrain (plus d’une trentaine séances d’observations réalisé).
-
[8]
En interdisant, par exemple, les rassemblements de plus de 50 personnes en raison de la COVID-19, alors que d’importantes manifestations contestent depuis plusieurs semaines l’organisation d’un référendum portant sur un projet controversé de modification de la constitution.
-
[9]
En mars 2022, on comptait 36 456 cas positifs confirmés, 36 460 hospitalisés et 440 décès hospitaliers (MSHP/ANSS 2022).
-
[10]
Voir les Archives nationales de Guinée, dossiers : 1H15 : Correspondance au sujet des maladies dans les cercles de la Guinée française ? T0 Décès, bull. politique 1901 – 1932 ; 1H38 Bull. épidémiologique (Forêt – Basse Côte), 1913 – 1957 ; 1H39 : Maladies épidémiques. Télégramme, Lettre, Certificat de Visite 1936-1942.
-
[11]
Aujourd’hui Conakry abrite 50 % de l’ensemble des personnes vaccinées (MSHP/ANSS 2022).
-
[12]
Une vaccination est jugée complète si elle a consisté en au moins deux doses, ce qui est loin d’être le cas ici.
-
[13]
Premier président de la Guinée, 1958-1984.
-
[14]
En sosoxui, langue véhiculaire de la région de Kindia, le mot Pastor-ya signifie littéralement « chez Pasteur ».
-
[15]
Voir : https://wcsglobal.com/en/.
-
[16]
COVAX est une structure rassemblant l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Alliance globale pour l’initiative vaccinale (GAVI), la Coalition pour les innovations dans la préparation aux épidémies (CEPI), l’UNICEF et des partenaires privés afin de faciliter l’accès aux vaccins des pays à faibles revenus. Quant à AVATT, mis en place par l’Union africaine et appuyé par la banque mondiale, il a comme objectif de favoriser l’obtention de vaccins afin de permettre au continent africain d’atteindre l’immunité collective.
-
[17]
Les noms des personnes enquêtées et des lieux ont été modifiés afin de respecter l’anonymat. Les descriptions des caractéristiques sociologiques restent quant à elles pertinentes.
-
[18]
En sosoxui, langue véhiculaire à Conakry, le mot « Menge » désigne un chef. Il s’agit d’un terme d’adresse usité autant pour s’adresser aux personnes bénéficiant d’une autorité, qu’elle soit d’origine traditionnelle ou légal-rationnelle.
-
[19]
Le 16 décembre 2021, l’OMS diffuse l’avis d’un panel d’experts mettant en garde contre l’appariement de différents vaccins dans un même schéma vaccinal (World Health Organization 2021) et largement relayé dans la presse.
-
[20]
Le 25 février 2024, on estime à seulement 468 le nombre de décès dus à la COVID-19 en Guinée pour 38 572 cas positifs, soit 0,2 % de la population totale (19 649 198 personnes). (Voir : https://www.worldometers.info/coronavirus/country/guinea/).
-
[21]
« That part of our task is to recognize “local biologies,” that is, biological difference among people that results from bodily responses to differing environments over time and across space. Such differences are not genetically determined, and a great number are of no consequence, although some bear profoundly on health and illness » (traduction des auteurs).
-
[22]
« The notion of local biologies refers to the manner in which biological and social processes are permanently entangled throughout life, ensuring a degree of biological difference among humans everywhere that typically has little or no significance but at times bears profoundly on well-being. » (traduction des auteurs).
-
[23]
Au plus fort de l’épidémie de COVID-19, l’Institut national de santé publique de Guinée présentait sur son site les résultats de la surveillance de la grippe. Au cours du quatrième semestre de 2021, un total de 9 474 consultations a été enregistré dans les sites sentinelles parmi lesquelles 16,7 % étaient attribuables à la grippe et 12,4 % des hospitalisations étaient associées à cette pathologie. Au même moment, les données relatives à la COVID-19 indiquait que X individus avaient été hospitalisés pour des formes graves.
-
[24]
Soit 54 EUR et 78 CAD. À titre de comparaison pour elle et ses petits-enfants la somme à consacrer par mois à l’achat du riz et des condiments quotidiens s’élève à 900 000 francs guinéens, soit 100 EUR et 146 CAD.
-
[25]
Elle dit en sosoxui : mfate ngonoma (« mon corps me fait mal »).
-
[26]
Pour plus d’information voir la principale source : https://www.afro.who.int/publications/outbreaks-and-emergencies-bulletin-week-36-29-august-4-september-2022.
-
[27]
Au tout début de la vaccination massive anti-COVID, la communication sur les vaccins n’était pas uniforme et il n’était pas rare d’entendre les agents de vaccination expliquer que les vaccins Sinovac et AstraZeneca étaient déconseillés aux porteurs de comorbidités : asthme, diabète, hypertension artérielle, etc.
-
[28]
En manikakan, le terme Luti signifie littéralement « maisonnée propriétaire », et désigne le chef de famille.
-
[29]
L’ANSS (Agence nationale de sécurité sanitaire) est une agence chargée de gérer les crises sanitaires. Mise en place pendant l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola 2014-2016 avec le soutien des bailleurs internationaux, elle est placée sous la tutelle du ministère de la Santé.
-
[30]
En immunologie, l’immunité croisée désigne le fait pour un individu de bénéficier d’anticorps relatifs à un pathogène qui le protège contre un autre pathogène proche. Par exemple, on sait que le virus de la grippe mute et qu’il est différent chaque année : un individu immunisé contre un virus de la grippe à l’année une parce qu’il a produit des anticorps peut, à l’année deux, être protégé contre le virus mutant grâce aux anticorps développés durant la première année. La question de l’immunité croisée en rapport avec la COVID-19 a fait l’objet de multiples publications scientifiques (Pinto et al. 2020).
Bibliographie
- Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), Ministère de la santé (MS), Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et Organisation mondiale de la santé (OMS). 2023. Dossier de presse campagne digitale pour la promotion de la vaccination COVID-19. https://portail.sante.gov.gn/wp-content/uploads/2023/07/230227_Dossier-Press-Factsheet-CampagnDigit-VaccinCOVID-GN_hu.pdf
- Attas, Fanny, Moustapha Keïta-Diop, Marie-Yvone Curtis et Frédéric Le Marcis. 2022. « Discours radiophoniques, cartographies épidémiques et représentations locales de la COVID-19 en Guinée », L’Espace Politique. Géographie politique et de géopolitique, 44. https://doi.org/10.4000/espacepolitique.10007.
- Afolabi, Aanuoluwapo Adeyimika et Stephen Ilesanmi Olayinka,. 2021. « Dealing with Vaccine Hesitancy in Africa: The Prospective COVID-19 Vaccine Context », The Pan African Medical Journal, 38. https://doi.org/10.11604/pamj.2021.38.3.27401.
- Ayimpam, Sylvie et Jacky Bouju. 2022. « Gouvernance de la crise sanitaire et exposition au risque de pandémie de COVID-19 en République démocratique du Congo », Global Africa, (2) : 133-143. https://doi.org/10.57832/6f5p-vh38.
- Bierschenk, Thomas et Jean-Pierre Olivier de Sardan. 2014. « Studying the Dynamics of African Bureaucracies. An Introduction to States at Work ». In Bierschenk, Thomas et Olivier de Sardan (dir.), States at Work. Dynamics of African Bureaucracies, p.3-34. Leiden: Brill.
- Blume, Sturt et Mariska Zanders. 2006. « Vaccine Independence, Local Competences and Globalisation : Lessons from Pertussis Vaccines », Social Science & Medicine, 63 : 1825-1835.
- Bonnet, Emmanuel, Oriane Bodson, Frédéric Le Marcis, Adama Faye, Emmanuel Sambieni, Florence Fournet, Florence Boyer, Abdourahmane Coulibaly, Kadidiatou Kadio, Fatoumata Binetou Diongue, Valery Ridde. 2021. « The COVID-19 Pandemic in Francophone West Africa : From the First Cases to Responses in Seven Countries », BMC Public Health, 21 (1) :1490. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11529-7.
- Brives, Charlotte. 2020. Pluribiose. Vivre avec les virus. Mais comment ? : Versailles, Sciences en question, éditions Quae
- Brives, Charlotte, Frédéric Le Marcis et Emilia Sanabria. 2016. « What’s in a Context ? Tenses and Tensions in Evidence-Based Medicine », Medical Anthropology, 35 (5) : 369-376.
- Brown, Theodore M., Marco Cueto et Elizabeth Fee. 2006. « The World Health Organization and the transition from international to global public health », American Journal of Public Health, 96 (1): 62-72. https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.050831.
- Cabestan, Jean-Pierre. 2013. « Les relations Chine-Afrique : Nouvelles responsabilités et nouveaux défis d’une puissance mondiale en devenir », Hérodote, 3 (150) : 150-171. https://doi.org/10.3917/her.150.0150.
- Cabore, Joseph Waogodo, Humphrey Cyprian Karamagi, Hillary Kipruto, James Avoka Asamani, Benson Droti, Aminata Binetou Wahebine Seydi, Regina Titi-Ofei, Benido Impouma, Michel Yao, Zabulon Yoti, Felicitas Zawaira, Prosper Tumusiime, Ambroise Talisuna, Francis Chisaka Kasolo, Matshidiso R. Moeti. 2020. « The potential effects of widespread community transmission of SARS-CoV-2 infection in the World Health Organization African Region : A Predictive Model », BMJ Glob Health, 5 (5) : e002647. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002647.
- David, Pierre Marie et Le Dévédec, Nicolas. 2019. Préparation à la prochaine épidémie : enjeux sanitaires et politiques d’un paradigme émergent‡. Santé publique critique, 29(3), 363–369. https://doi.org/10.1080/09581596.2018.1447646
- Desclaux, Alice et Khoudia Sow. 2021. « COVID-19 : Après le défi de l’accès au vaccin en Afrique, l’hésitation vaccinale ? », The Conversation. Consulté le 20 avril 2023, https://theconversation.com/covid-19-apres-le-defi-de-lacces-au-vaccin-en-afrique-lhesitation-vaccinale-167015.
- Diallo, Safiatou. 2021. Politiques de santé en Guinée. De la colonisation au début du XXIe siècle, Paris, L’Harmattan.
- Djaha, Joel Fabrice et Anne Bekelynck. 2021. « Côte d’Ivoire : Facebook comme outil de contestation des mesures anti-COVID-19 dans un contexte électoral tendu », The Conversation. Consulté le 20 avril 2023. https://theconversation.com/cote-divoire-facebook-comme-outil-de-contestation-des-mesures-anti-COVID-19-dans-un-contexte-electoral-tendu-157903.
- Elzein, Derek. 2014. « L’Afrique face aux nouvelles ambitions de la Russie », Géoéconomie, 71 : 77-88. https://doi.org/10.3917/geoec.071.0075.
- Farmer, Paul. 2002. La violence structurelle et la matérialité du social. Paris, Collège de France.
- Fairhead, James et Melissa Leach. 2007. Vaccine Anxieties : Global Science, Child Health and Society. Londres, Taylor & Francis. Consulté le 20 avril 2023, http://sro.sussex.ac.uk/10022/.
- Feldman-Savelsberg, Pamela, Flavien T. Ndonko et Bergis Schmidt-Ehry. 2000. « Sterilizing Vaccines or the Politics of the Womb : Retrospective Study of a Rumor in Cameroon », Medical Anthropology Quarterly, 14 (2) : 159-79. DOI : 10.1525/maq.2000.14.2.159
- Gaudillière, Jean-Paul, Andrew McDowell, Claudia Lang et Claire Beaudevin. 2022. Global Health for All. Newark (NJ) et Londres, Rutgers University Press New Brunswick,
- Gaudillière, Jean-Pierre, Caroline Izambert, Pierre-André Juven. 2021. Pandémopolitique : Réinventer la santé en commun. Paris, La Découverte.
- Gerome, Patrick. 2022. « Foyers de rougeole dans au moins 21 pays d’Afrique ; Mon carnet de vaccination numérique », Medecinedesvoyages.net. Consulté le 14 mars 2023, https://www.mesvaccins.net/web/news/19794-foyers-de-rougeaol-dans-au-moins-21-pays-d-afrique.
- Gomez-Temesio Veronica et Frédéric Le Marcis. 2021. « Governing Lives in the Times of Global Health », in Lene Pedersen et Lisa Cliggett (dir.), The SAGE handbook of cultural anthropology, p. 554-578. Newbury Park, in California : SAGE Publications Ltd. Consulté le 22 avril 2023, https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3ac4c28c-06ba-3e6a-b3e7-d850f6cdbd84.
- Gomez-Temesio Veronica et Frédéric Le Marcis. 2017. « La mise en camp de la Guinée : Ébola et l’expérience postcoloniale », L’Homme, 2 (222) : 57-90. https://doi.org/10.4000/lhomme.30147.
- Grmek, Mirko Dražen. 1980. « Le concept d’infection dans l’Antiquité et au Moyen Âge, les anciennes mesures sociales contre les maladies contagieuses et la fondation de la première quarantaine à Dubrovnik », Rad JAZU, 384 : 9-55.
- Heyerdahl, Leonard, Frédéric Le Marcis, Arsenii Alenichev, Totran Nguyen, Bienvenu Camara, Koen Salim et Peeters Gretens. 2023. « Parallel Vaccine Discourses in Hegemonic Global Health : Grounded Social Listening in Guinea », Critical Global Health, publié en ligne: 17 Aug 2023, 579- 593 https://doi.org/10.1080/09581596.2023.2245964
- Hirsch, Emmanuel (dir.). 2020. Pandémie 2020 : Ethique, société, politique. Paris, Cerf.
- Institut national de santé publique (INSP). 2021. Bulletin trimestriel Grippe, Semaine 39-51/2021. insp-guinee.org
- Kêdoté, Nonvignon Marius, Charles Sossa-Jérome, Binet Wewe. 2022. « Vulnérabilité et riposte à la COVID-19 en Afrique de l’Ouest », Droit, Santé et Société, 2-3 : 37-42. https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2022-2-page-37.htm.
- King, Nicholas B. 2002. « Security, Disease, Commerce : Ideologies of Postcolonial Global Health », Social Studies of Science 32 (5-6) : 763-789.
- Kleinman, Arthur. 2006. What Really Matters. Living a Moral Life Amidst Uncertainty and Danger. Oxford et New York, Oxford University Press.
- Hayden, Christopher Ellis. 2008. « Of Medicine and Statecraft : Smallpox and Early Colonial Vaccination in French West Africa (Senegal-Guinea) ». Thèse de Doctorat, Evanston, Northwestern University.
- Lakoff, Andrew. 2017. Unprepared: Global Health in a Time of Emergency. California, University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520968417.
- Lakoff, Andrew. 2010. « Two regimes of Global Health », Humanity : An International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development, 1 : 59-79.
- Lascoumes, Pierre. 2009. « Les compromis parlementaires, combinaisons de surpolitisation et de sous-politisation : L’adoption des lois de réforme du Code pénal (décembre 1992) et de création du Pacs (novembre 1999) », Revue française de science politique, 59 : 455-478. https://doi.org/10.3917/rfsp.593.0455.
- Leach, Melissa, Hayley MacGregor, Grace AKello, Lawrence Babawo, Moses Baluku, Alice Desclaux, Catherine Grant, Foday Kamara, Marion Nyakoi, Melissa Parker, Melissa Richards, Esther Mokuwa, Bob Okello, Kelley Sams, et Khiudia Sow. 2022. « Vaccine Anxieties, Vaccine Preparedness : Perspectives from Africa in a COVID-19 Era », Social Science & Medicine, 298 :114-826. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114826.
- Le Coq, Rubis. 2022. « “C’est l’État qui nous a tués !ˮ : Ebola en Guinée : la mémoire d’une histoire politique violente », Lien social et Politiques, (88) : 111-131. https://doi.org/10.7202/1090983ar.
- Le Marcis, Frédéric. 2023. « Expanding Epidemic Preparedness to Include Population Memory : A Key for Better Epidemic Management ». In Laurence Roulleau-Berger (dir.), 2022 Handbook Post-Western sociology. From East Asia to Europe. Series: Post-Western Social Sciences and Global Knowledge, 5, p. 937-955, Leiden, Brill.
- Lock, Margaret. 2017. « Recovering the Body », Annual Review of Anthropology 46 (1) : 1-14. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102116-041253.
- Magone, Claire. 2013. « Le dernier mile. Faut-il encore croire en l’éradication de la poliomyélite ? », La vie des Idées. Consulté le 14 mars 2023, http://www.laviedesidees.fr/Le-dernier-mile.html.
- Marziano, Valentina, Giorgio Guzzetta, Alessia Mammone, Flavia Riccardo, Piero Poletti, Filippo Trentini, Mattia Manica, Andrea Siddu, Antonino Bella, Paola Stefanelli, Patrizio Pezzotti, Marco Ajelli, Silvio Brusaferro, Giovanni Rezza & Stefano Merler. 2021. « The Effect of COVID-19 Vaccination in Italy and Perspectives for Living with the Virus », Nat Commun, 12 : 72-72. https://doi.org/10.1038/s41467-021-27532-w.
- Matusevich, Maxim. 2009. « Revisiting the Soviet Moment in Sub-Saharan Africa », History Compass, 7 : 1-10, https://doi.org/10.1111/j.1478-0542.2009.00626.x.
- Moulin, Anne-Marie (dir.). 1996. L’aventure de la vaccination. Paris, Fayard, Penser la médecine.
- Moulin, Anne-Marie. 2006. « Les particularités françaises de l’histoire de la vaccination. La fin d’une exception ? », Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, 54 (1) : 81-87, https://doi.org/10.1016/S0398-7620(06)76767-0.
- Mutombo, Polydor Ngoy, Fallah, Davison Munodawafa, Ahmed Kabel, David Houeto, Tinashe Goronga, Oliver Mweemba, Gladys Balance, Hans Onya, Roger S Kamba, Miriam Chipimo, Jean-Marie Ntumba Kayembe, Bartholomew Akanmori. 2021. « COVID-19 Vaccine Hesitancy in Africa : A Call to Action. Comment », Lancet Global Health, 10 (3) : 320-321 ; https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00563-5.
- Ministère de la santé et de l’hygiène publique (MSHP)/ Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS). 2022. « Situation épidémiologique et vaccination contre la COVID-19 », présentation power point à la quatrième réunion des partenaires techniques et financiers de santé : Guinée, Conakry, le 06 mai 2022.
- Nations Unies. 2021. « Covid-19 : Le nationalisme vaccinal d’une poignée de nations est moralement indéfendable, dénonce le chef de l’OMS », ONU Info. Consulté le 12 mars 2023, https://news.un.org/fr/story/2021/07/1099702 .
- Obadare, Ebenezer. 2005. « A Crisis of Trust : History, Politics, Religion and the Polio Controversy in NorthernNigeria », Patterns of Prejudice, 39 (3) : 26-84. https://doi.org/10.1080/00313220500198185.
- Our World in Data. 2023. Data Explorer. Estimated cumulative excess deaths per 100,000 people during COVID-19, Jan 27, 2024, Consulté le 10 janvier 2023, https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer.
- Pauthier, Céline. 2013. « L’héritage controversé de Sékou Touré, “héros” de l’indépendance », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 118 : 31-44. https://doi.org/10.3917/ving.118.0031.
- Pétonnet, Colette.1982. « L’Observation flottante. L’exemple d’un cimetière parisien », L’Homme, 22 (4) : 37-47. https://doi.org/10.3406/hom.1982.368323.
- Pinto, Dora, Young-Jun Park, Martina Beltramello, Alexandra C. Walls, M. Alejandra Tortorici, Siro Bianchi, Stefano Jaconi, Katja Culap, Fabrizia Zatta, Anna De Marco, Alessia Peter, Barbara Guarino, Roberto Spreafico, Elisabetta Cameroni, James Brett Case, Rita E. Chen, Colin Havenar-Daughton, Gyorgy Snell, Amalio Telenti, Herbert W. Virgin, Antonio Lanzavecchia, Michael S. Diamond, Katja Fink, David Veesler et Davide Corti, 2020. « Cross-neutralization of SARS-CoV-2 by a Human Monoclonal SARS-CoV Antibody », Nature, 583 : 290-295. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2349-y.
- Richardson, Eugene T. 2022. Epidemic Illusions: On the Coloniality of Global Public Health. Cambridge, MIT Press.
- Rode, Paul. 1937. « Pastoria, centre de recherches sur les Singes en Guinée française », Revue d’Écologie, 1937 (4) : 109-116.
- Rusal. 2021. « L’entreprise Rusal reçoit le Prix de la meilleure entreprise de Guinée pour sa contribution à la lutte contre le COVID-19 ». https://rusal.ru/en/press-center/press-releases/rusal-receives-guinea-best-company-awards-for-contribution-in-the-fight-against-covid-19/. Consulté le 12 janvier 2023
- Salvadori, Françoise et Laurent-Henri Vignaud. 2019. Antivax - Histoire de la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours. Paris, Vendémiaire.
- Soumah, Abou Aissata, Mamadou Saliou Kalifa Diallo, Emilande Guichet, David Maman, Guillaume Thaurignac, Alpha Kabinet Keita, Julie Bouillin, Haby Diallo, Raphael Pelloquin, Ahidjo Ayouba, Cece Kpamou, Martine Peeters, Eric Delaporte, Jean-Francois Etard, Abdoulaye Toure. 2022. « High and Rapid Increase in Seroprevalence for SARS-CoV-2 in Conakry, Guinea: Results From 3 Successive Cross-Sectional Surveys (ANRS COV16-ARIACOV) », Open Forum Infect Dis, 9 (5) : 52, https://doi.org/10.1093/ofid/ofac152
- Singer, Merrill. 2009. Introduction to Syndemics. A Critical Systems Approach to Public and Community Health. San Fransisco, John Wiley & Son.
- Sylla, Gassim. 2022. « Préserver la vie biologique contre la société ? Analyse des mesures de prévention contre le COVID-19 à Conakry (République de Guinée) », Global Africa, 2 : 166-176. https://doi.org/10.57832/p3pk-d724 .
- Sylla, Gassim, Fanny Attas et Frédéric Le Marcis. 2022. Un an de vaccination contre la COVID-19 en République de Guinée. Expériences et perspectives. Note de politique ARIACOV, 17. Consulté le 10 mars 2023, Présentation PowerPoint (cerfig.org).
- Thiongane, Oumy. 2012. « La méningite ‘prise en grippe’ ? », Anthropologie & Santé, 4. https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.910.
- Touré, Abdoulaye. 2022. « Le CERFIG, une recherche africaine en santé d’excellence », Global Africa, 2 : 96-98. https://doi.org/10.57832/jhq5-d054.
- Usher, Ann Danaiya. 2021. « A Beautiful Idea: How COVAX Has Fallen Short », The Lancet, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01367-2.
- World Health Organization. 2021. Interim Recommendations for Heterologous COVID-19 Vaccine Schedules: Interim Guidance, Consulté le 15 mars 2023, https://apps.who.int/iris/handle/10665/350635.
List of figures
Figure 1
Figure 2