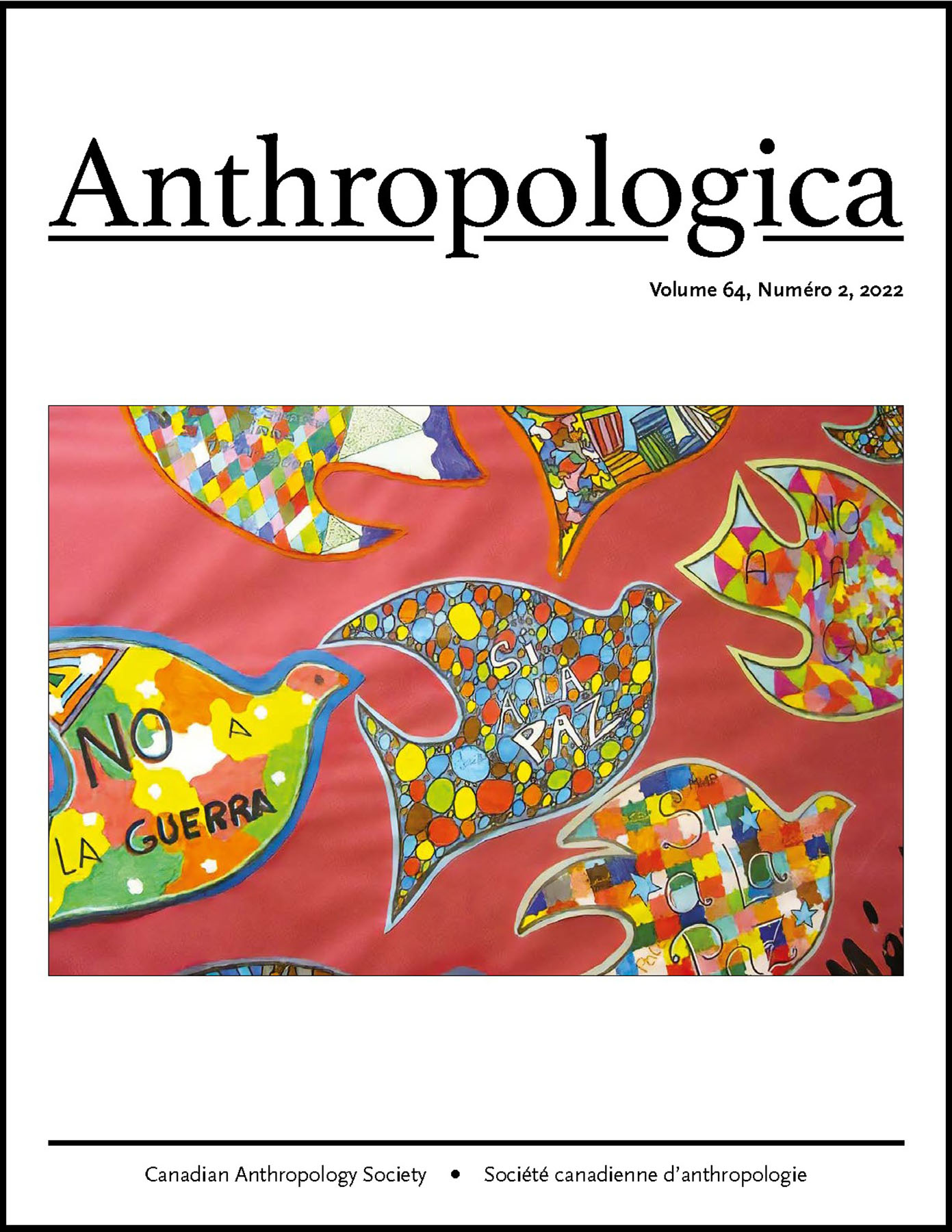L’histoire de l’Afrique, en Occident, n’est que, soit mal connue, soit inconnue. Achille Mbembe, dans l’ouvrage De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporain, démantèle les présomptions simplistes d’une Afrique « incompréhensible, pathologique et anormale » (p. 54). Les thèmes de la rationalité, de la primitivité, de la temporalité, de la mobilité, de la violence, du chaos et de la mort y sont centraux. L’auteur cherche à approfondir les questionnements qui mèneraient à répondre aux questions suivantes : qui sont les Africains dans le monde ? Avec ce lourd passé colonial, comment s’organise la postcolonie socialement, politiquement et économiquement ? Comment vit-elle dans ce monde concret ? Dès l’introduction, les enjeux sont mis sur table. L’universalité présumée et l’évolutionnisme imaginé par l’Occident positionnent l’ensemble du continent africain comme une civilisation primitive, du temps de la colonie à la fin du XXe siècle. Ces présuppositions proviennent en partie de l’idée de la raison, c’est-à-dire du concept de rationalité développé au siècle des Lumières. Cette raison, qui serait universelle au sein des populations civilisées, s’oppose à l’Afrique puisque ses habitants sont si différents qu’ils relèveraient plutôt du monde animal que de l’espèce humaine. Ces populations sont jugées comme étant des sociétés de traditions, croyant à des mythes primitifs. Ainsi, une attitude paternaliste envers le continent est toujours bien présente dans le monde académique. On parle des Africains sans pour autant les inviter à prendre la parole et sans réelle volonté d’entamer de discussion avec eux. Notamment, les productions académiques sur l’Afrique tendent à décrire ce qu’elle n’est pas, plutôt que ce qu’elle est. L’Afrique s’en retrouve donc délégitimée, puisque ses propres critères sont perçus comme étant sans importance. Pourtant, bien qu’il y ait présence d’une grande instabilité à plusieurs niveaux au sein du continent africain, cela ne signifie pas pour autant que le chaos y règne et que le désordre est standard. Ce sont les visions euro-centriques qui y imposent ce point de vue, alors que l’Afrique émerge selon ses propres termes. Durant la période coloniale, la violence est utilisée comme outil de contrôle et se révèle comme une fin en soi. Elle est mise en oeuvre par un système de structures et est appliquée par des personnes. Elle s’introduit à tous les niveaux, soit dans l’économie, dans le social, dans le langage, pour finalement devenir une forme d’idéologie. L’auteur fait la comparaison entre la pratique coloniale et le geste phallique, où le but ultime est l’assouvissement et la domination totale. Dans cette relation, le colonisateur s’impose en s’emparant d’un territoire et de tout ce qui s’y trouve, dans le but d’accroître ses richesses. Cette suprématie ne s’obtient que par le fait accompli, et ne relève d’aucune autorisation. Il en résulte que le colonisé n’existe plus et n’est réduit qu’à un être, dans la mesure où il a un corps matériel, mais sans plus. Son être en tant que chose n’a de valeur que si le colonisateur lui en donne. Au moment où le colonisateur ne le reconnaît plus ou n’admet plus son être, l’autre meurt, car il n’est plus. Il n’existe donc que dans l’imaginaire du colonisateur, ce qui démontre sa phallocratie envers les colonisés. Afin de revenir à la vie, l’Afrique se doit de transgresser cette mort et de toutes les autres formes de mort. Ces oppressions et cet autoritarisme vont permettre à toutes formes de violence de persister dans la postcolonie, où le potentat postcolonial se développe selon sa « cohérence interne […] tant du point de vue politique, économique qu’imaginaire. » (p. 111) Toutefois, avec les obligations de remboursement de dettes envers la Banque …
Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris : La Découverte, 2020, 320 pages[Record]
…more information
Pamela Léger
Université de Montréal