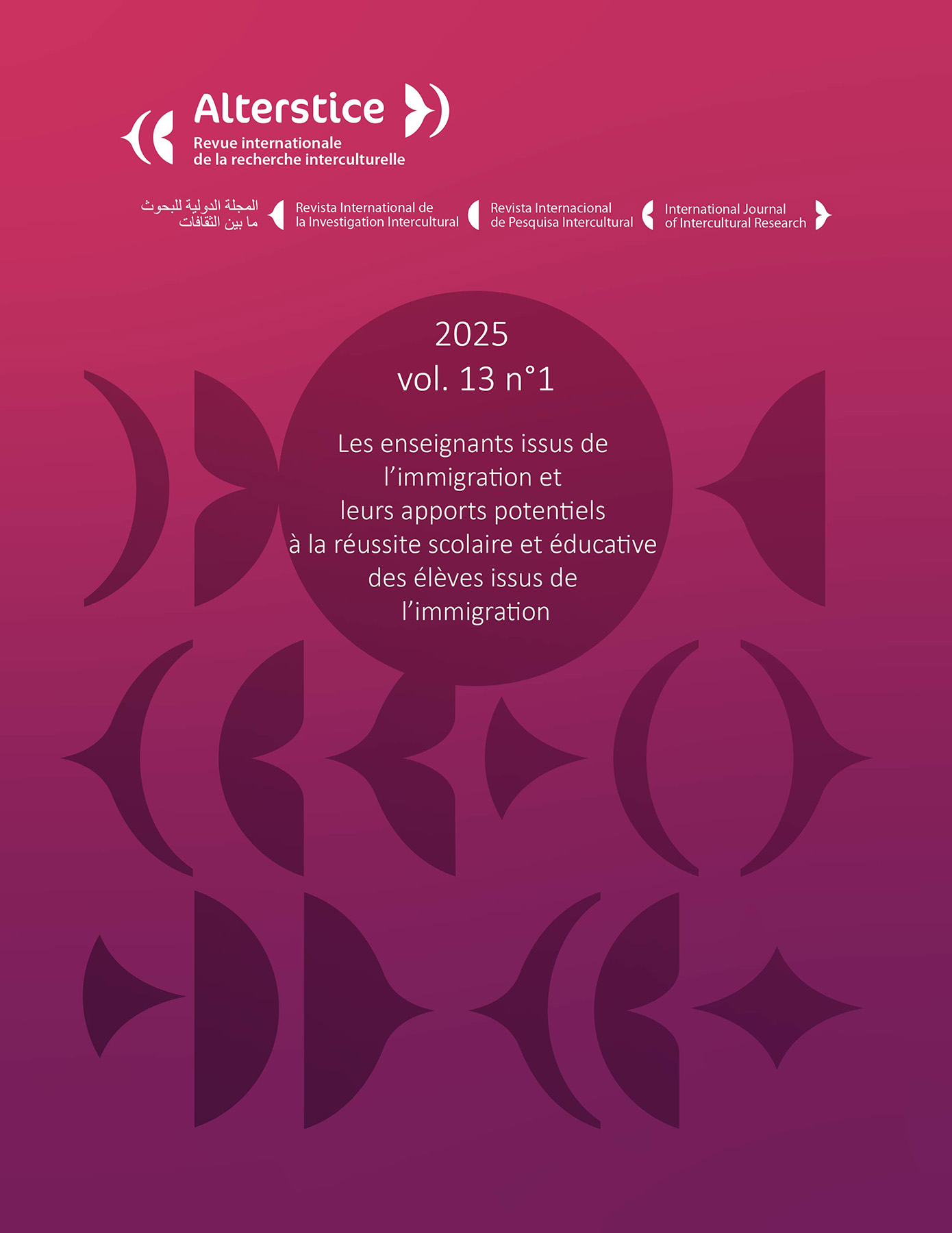Abstracts
Résumé
Pour faire face à la pénurie de main-d’oeuvre et au déficit démographique, le Québec mise sur l’immigration. Entre 2017 et 2021, il a ainsi accueilli 219 568 personnes immigrantes, dont près du tiers avaient moins de 25 ans. Ces immigrants, qui proviennent de plusieurs coins du monde, sont majoritairement allophones. Ainsi, les écoles des différentes régions du Québec établissent ou vont établir des relations avec des familles immigrantes d’ethnies, de cultures, de langues et de religions diverses, ce qui comporte d’énormes défis. Les recherches faites sur les relations entre école et familles immigrantes font souvent état de difficultés à communiquer et à établir une bonne collaboration, en raison de l’éloignement des valeurs éducatives, d’un manque de ressources, de la difficulté des parents immigrants à comprendre le fonctionnement du système scolaire et de la difficulté de l’école à bien communiquer son fonctionnement et ses attentes à leur égard. Jusqu’à présent, les recherches faites au Québec ont mis l’accent sur le rôle que jouent les agents communautaires dans les relations entre école et familles immigrantes, laissant de côté celui que peuvent jouer les enseignants issus de l’immigration. Pourtant, les recherches faites ailleurs au Canada et en Europe relèvent que ces enseignants sont susceptibles de combler les écarts entre l’école et les familles immigrantes. Cet article porte sur des données recueillies au Québec au moyen d’entrevues semi-structurées auprès de 32 enseignants issus de l’immigration et de 23 parents. Nos résultats montrent que ces enseignants apportent une plus-value dans les relations entre école et familles immigrantes : non seulement ils constituent une ressource pour l’école et les parents immigrants, mais ils aident également les parents à comprendre le fonctionnement du système scolaire. Ils jouent également un rôle de médiateur dans ces relations. Les parents sont rassurés et sécurisés par leur présence et ils les trouvent également empathiques et compréhensifs à leur égard.
Mots-clés :
- relations entre école et familles immigrantes,
- collaboration entre école et familles,
- communication entre école et familles,
- parents immigrants,
- enseignants issus de l’immigration
Article body
Introduction
Pour faire face à la pénurie de main-d’oeuvre et au déficit démographique, le Québec mise notamment sur l’immigration (Gouvernement du Québec, 2023a). Entre 2017 et 2021, il a ainsi accueilli 219 568 personnes immigrantes : 37,6 % venaient d’Asie, 31,8 % venaient d’Afrique, 14,2 % venaient d’Amérique et 16,1 % venaient d’Europe. Près du tiers (31,8 %) avaient moins de 25 ans (Gouvernement du Québec, 2023b). Bien que beaucoup de familles s’établissent dans la région métropolitaine de Montréal, le nombre de familles immigrantes augmente significativement dans d’autres régions. Ainsi, les écoles des différentes régions du Québec établissent ou vont établir des relations avec des familles immigrantes d’ethnies, de cultures, de langues et de religions diverses. Selon Benoit, Rousseau, Ngirumpatse et Lacroix (2008), « ce virage démographique pose un défi à l’école tant au niveau de son rôle d’éducation qu’au niveau de sa position charnière entre les familles immigrantes et la société hôte » (p. 314). À cet égard, une bonne collaboration entre école et familles immigrantes constitue un facteur de protection pour la réussite scolaire des élèves immigrants (Conus, 2021). L’école doit donc soutenir l’intégration des familles immigrantes et mettre en place des conditions favorables à leur implication dans la réussite scolaire et éducative de leurs enfants (Jaquet et André, 2021). Or les recherches faites au Québec et ailleurs au Canada et en Occident (Atangana-Abe et Ka, 2016; Bakhshaei, 2016; Bieri, 2015; Broyon, 2016; Deslandes, 2019; Gosselin-Gagné, 2018; Jacquet et André, 2021; Kamano, 2014; Kanouté, Gosselin-Gagné, Guennouni Hassani et Girard, 2016; Liboy et Mulatris, 2016; Macià Bordalba et al., 2021) soulignent que l’école et les parents immigrants ont souvent de la difficulté à communiquer et à établir une bonne collaboration en raison de l’éloignement des valeurs éducatives, d’un manque de ressources, de la difficulté des parents immigrants à comprendre le fonctionnement du système scolaire et de la difficulté de l’école à bien communiquer son fonctionnement et ses attentes aux parents immigrants (Charette et Kalubi, 2016). Devant cet enjeu, les milieux scolaires mettent en place des stratégies pour améliorer la communication avec les familles immigrantes. Toutefois, ces stratégies « ne produisent pas les effets attendus » (Liboy et Mulatris, 2016, p. 100). Ainsi, la collaboration entre école et familles immigrantes mérite d’être travaillée (Gosselin-Gagné et Audet, 2024). Les recherches faites au Québec ont, jusqu’à présent, mis l’accent surtout sur le rôle que jouent les agents communautaires dans les relations entre école et familles immigrantes, laissant de côté celui que peuvent jouer les enseignants issus de l’immigration. Or différentes recherches faites au Canada et ailleurs en Occident (Bauer et Akkari, 2016; Beltron, 2013; Broyon, 2016; Changakakoti et Broyon, 2013; Escayg, 2010; Liboy et Mulatris, 2016; Santoro, 2016; Schmidt et Janusch, 2016) montrent que les enseignants issus de l’immigration peuvent contribuer à combler les écarts entre les familles immigrantes et l'école. C’est dans ce cadre que nous nous posons la question de recherche suivante : quelles sont les contributions des enseignants issus de l’immigration dans les relations entre école et familles immigrantes au Québec? C’est le concept de relation entre école et famille qui nous servira de grille de lecture pour répondre à cette question.
Cadre conceptuel : relations entre école et famille
Deslandes (2019) définit les relations entre école et famille comme « les liens officiels et informels entre l’école et les parents » (p. 23). Selon Deslandes, ces liens se reflètent dans plusieurs actions, notamment à travers la communication entre parent et enseignant, la rencontre parent-enseignant, la participation des parents à des comités, des activités et des événements sociaux à l’école ou à l’extérieur de l’école. Les liens entre école et famille visent ainsi la collaboration et le partenariat avec les parents afin de favoriser la réussite scolaire et éducative des élèves. Clarke et al. (2010, cités par Deslandes, 2019) notent que « les termes collaboration et partenariat renvoient à des verbes d’action pour interagir avec les familles, et les relations école-famille représentent des qualités personnelles et affectives associées à ces actions » (p. 25). Roy (2014) abonde dans le même sens et définit la collaboration par la quantité et la qualité des rencontres entre la famille et l’école. Cette collaboration résulte « d’un partage des responsabilités, d’une confiance mutuelle et d’une communication ouverte entre les partenaires » (Deslandes, 2019, p. 6). Ainsi, une relation harmonieuse et respectueuse entre l’école et la famille favorise une bonne collaboration entre les deux partenaires (Deslandes, 2019; Roy, 2014). De plus, selon ces auteures, une bonne collaboration découle d’une bonne communication entre les partenaires. Pour qu’elle puisse contribuer au bien-être, au développement et à l’adaptation socioscolaire de l’enfant, cette communication « devrait porter sur l'enfant (ses progrès, difficultés, etc.), les attentes, les informations relatives aux activités et événements ainsi que sur l'aide qu'on peut apporter aux parents » (Roy, 2014, p. 19), ce qui n’est pas toujours le cas avec les parents immigrants (Benoit et al., 2008). En effet, l’école attend que les parents immigrants s’impliquent dans le suivi scolaire de leurs enfants (encadrement, encouragement, soutien et supervision des activités scolaires) et dans les activités organisées par l’école (Deslandes, 2019; Roy, 2014) sans toutefois prendre le temps de leur expliquer les conditions de cette implication (Charette et Kalubi, 2016). Comme les familles immigrantes intègrent un nouveau système scolaire et culturel, elles « sont ainsi particulièrement désavantagées dans l’appropriation de leur rôle puisque la manière dont ces derniers comprennent et interprètent leur rôle est fondée sur ce qu’ils pensent être leur rapport à l’école et sur leur propre vécu scolaire » (Jaquet et André, 2021, p. 33). Kanouté et Vatz-Laaroussi (2008) soulignent aussi que la relation entre l’école et la famille n’est pas facile avec les familles immigrantes ou de minorités ethnoculturelles. Plusieurs obstacles peuvent nuire à l’établissement d’une bonne communication. Outre les obstacles institutionnels déjà cités, on peut ajouter, pour les parents, l’absence de maîtrise de la langue française, les disparités entre le système scolaire de leur pays d’origine et celui de la société d’accueil, l’éloignement entre la culture familiale et la culture scolaire et l’écart entre leur représentation de l’école, du rôle des enseignants et des attentes à leur égard et celle promue par l’école (Benoit et al., 2008; Bieri, 2015; Deslandes, 2019; Kanouté et Vatz-Laaroussi, 2008). Ces différences constituent d’ailleurs des sources de tensions et de désaccords avec l’école (Benoit et al., 2008; Deslandes, 2019). En raison de leur faible présence à l’école, les parents immigrants « sont perçus [par l’école] comme démissionnaires, inadéquats, absents » (Changkakoti et Akkari, 2008, p. 420) dans l’encadrement et le suivi scolaire de leurs enfants alors que l’école ne leur a communiqué ni son fonctionnement ni ses attentes à leur égard (Deslandes, 2019).
Malgré les défis auxquels les parents immigrants font face, la réussite éducative et scolaire de leurs enfants reste une préoccupation importante pour eux (Changkakoti et Akkari, 2008; Jacquet et André, 2021). Ces parents mettent en place des stratégies afin de comprendre le fonctionnement du système scolaire et assurer le suivi scolaire de leurs enfants, notamment en demandant du soutien auprès des organismes communautaires ou à d’autres immigrants ayant déjà réussi leur intégration (Charette, 2016; Gouvernement du Québec, 2021). Toutefois, comme ces stratégies sont « invisibles » aux yeux de l’école, le personnel scolaire pense que les parents immigrants ne s’engagent pas dans l’éducation et la scolarisation de leurs enfants (Charette, 2016). Face à cette impasse, plusieurs auteurs (Jacquet et André, 2021; Liboy et Mulatris, 2016; Vatz-Laaroussi et Kanouté, 2013) soulignent qu’une bonne communication entre école et familles immigrantes nécessite que le personnel scolaire ait une bonne compréhension de la situation des familles immigrantes, de leurs parcours migratoires et de leurs défis d’intégration. De plus, Vatz-Laaroussi et Kanouté (2013) soulignent que, peu importe la nature de la collaboration entre l’école et les familles immigrantes, il doit y avoir « une forme de réciprocité dans la reconnaissance et la décentration » (p. 4).
Dans ce cadre, les enseignants issus de l’immigration pourraient être d’un apport important dans la dynamique relationnelle et collaborative entre école et parents immigrants. L’objectif de cet article est de décrire les types de contribution et le rôle des enseignants issus de l’immigration dans les relations entre école et familles immigrantes tels qu’ils émergent des regards croisés entre ces enseignants et les parents immigrants.
Cadre méthodologique
Les résultats que nous présentons dans cet article s’appuient sur les données de deux recherches qualitatives menées au Québec en 2019 auprès d’enseignants issus de l’immigration et en 2022-2023 auprès d’enseignants issus de l’immigration et de parents immigrants. Ces recherches ont reçu l’approbation des comités éthiques des universités d’appartenance des chercheurs. Les participants ont préalablement signé un formulaire de consentement.
Les participants ont été recrutés à l'aide d'un échantillonnage par réseaux ou en boule de neige (Fortin et Gagnon, 2022). Pour recruter les enseignants issus de l’immigration, nous sommes passés en premier lieu par les ressources du milieu scolaire et notre réseau de contacts. Par la suite, les participants nous ont indiqué d’autres personnes susceptibles de participer à notre recherche. Quant aux parents, nous sommes passés par les organismes communautaires et notre réseau de contacts et, par la suite, les participants nous ont mis en relation avec d’autres parents susceptibles de participer à notre recherche.
Pour être retenus, les participants devaient répondre à des critères déterminés. Dans le cadre des deux recherches, a été considérée comme personne enseignante issue de l’immigration toute personne immigrante de première génération (née à l’étranger) ayant une formation en enseignement et une expérience d’enseignement acquise dans son pays d’origine ou au Québec. De plus, pour cette étude, la personne enseignante devait avoir au moins deux ans d’expérience d’enseignement au Québec dans une école primaire ou secondaire avec présence d’élèves issus de l’immigration. Ce dernier critère a permis d’avoir accès à des enseignants issus de l’immigration qui comprennent le fonctionnement du système scolaire québécois et qui ont une bonne connaissance de la situation de l’intégration des élèves de parents immigrants. L’échantillon est diversifié quant au continent d’origine, au sexe, à l’expérience d’enseignement au Québec, à l’ordre d’enseignement et à la région scolaire : il comprend 21 hommes et 11 femmes, tous âgés de 36 ans ou plus. La majorité (25/32) vient du continent africain, les autres viennent d’Europe (2), d’Asie (2); d’Amérique latine et des Caraïbes (2). Les trois quarts d’entre eux (24/32) ont plus de six ans d’expérience d’enseignement au Québec, 8 ont entre 3 à 5 ans d’expérience. Plus de la moitié (21/32) enseignent au secondaire et 11 au primaire (classes ordinaires et classes d’accueil). Enfin, la majorité (26/32) maîtrise trois langues et plus et 6 parlent deux langues.
Quant aux parents immigrants, les critères de sélection étaient les suivants : être des personnes immigrantes de première génération (nées à l’étranger), avoir des enfants fréquentant une école primaire ou secondaire avec présence d’enseignants issus de l’immigration et être capables de tenir une conversation en français. L’échantillon de 23 parents comprend 11 hommes et 12 femmes, dont l’âge se situe entre 36 et 65 ans. La majorité (19/23) vient d’Afrique, 2 viennent d’Europe et 2 d’Amérique du Sud. La majorité (18/23) a un niveau de formation universitaire (6 ont un baccalauréat [ou une licence], 9 ont une maîtrise et 3 ont un doctorat) et cinq ont une formation secondaire. Neuf participants ont entre 1 et 7 ans de résidence au Québec tandis que 14 ont plus de 8 ans de résidence au Québec.
La collectée des données a été faite au moyen d’entrevues semi-structurées (Savoie-Zajc, 2016) dans les régions de Montréal, de Sherbrooke et de l’Outaouais auprès de 32 enseignants issus de l’immigration (12 en 2019 et 20 en 2022-2023) et de 23 parents immigrants (2022-2023). Les entrevues, d’une durée de 60 à 90 minutes, ont été enregistrées puis transcrites sous forme de verbatims anonymisés. Le codage des entrevues a été fait de façon informatisée à l’aide du logiciel d’analyse qualitative NVivo 12 (Bassett, 2010), puis les données ont été analysées en suivant la démarche de l’analyse thématique (Paillé et Mucchielli, 2021). Afin de nous assurer de la fiabilité de nos résultats et de leur interprétation, des stratégies de codage intra- et inter-juges ont été mises en place (Huberman et Miles, 1991). Ainsi, un échantillon de données a été codé par chacun des deux assistants au moins deux fois, à un intervalle d’une semaine, puis les résultats ont été comparés afin de raffiner le plan de codification. Les chercheurs ont aussi participé à la validation du plan de codification.
Résultats
Trois thèmes ressortent des résultats sur la plus-value des enseignants issus de l’immigration dans les relations entre école et familles immigrantes : 1) ressources pour les parents immigrants et l’école, 2) contributeurs à la compréhension du fonctionnement du système scolaire québécois et 3) facilitateurs dans les relations entre école et familles immigrantes.
Les enseignants issus de l’immigration comme ressources pour les parents immigrants et l’école
Tous les parents participants soulignent que l’école les considère au même titre que les parents québécois alors qu’ils ne comprennent pas encore le fonctionnement du système scolaire québécois. Selon ces parents, l’école, plutôt que de les outiller pour mieux encadrer leurs enfants, se plaint qu’ils sont négligents, qu’ils ne s’impliquent pas alors que « ce parent qui est négligent, vous ne connaissez pas son parcours académique ou son parcours migratoire » (PI_12, 2022). Ces parents, qui se sentent démunis pour accompagner leurs enfants, sont rassurés par la présence d’enseignants issus de l’immigration, peu importe leurs origines, dans l’école de leur enfant : « lui, au moins, il ne nous juge pas. » (PI_12, 2022). Ayant eux-mêmes vécu l’immigration, ces enseignants issus de l’immigration sont perçus par les parents comme des ressources de confiance : « C’est facile de lui parler, de demander les informations, de demander les conseils » (PI_13, 2022). Les enseignants issus de l’immigration mentionnent aussi que les parents immigrants les considèrent comme des ressources : « ce sont les parents qui s’approchent : “Qu’est-ce que tu nous conseillerais pour que notre enfant fasse ceci?” Alors, je peux leur expliquer. Ou même l’interprétation : “Voilà les résultats, est-ce que ça, c’est bon?” » (EII_08, 2019). En effet, ces enseignants issus de l’immigration agissent à titre de conseillers auprès des parents sur une diversité de sujets : école où inscrire leur enfant, différences entre une école internationale et une école qui offre un programme spécial, manières d’orienter leur enfant dans le choix de carrière en fonction de ses compétences, etc. De plus, ces enseignants prodiguent des conseils aux parents sur l’importance de rencontrer les enseignants ou la direction pour un bon suivi scolaire de leur enfant. Un participant (EII_07, 2019) donne l’exemple des « parents qui ne voulaient jamais rencontrer les enseignants ou la direction, comme quoi chez nous quand le directeur décide, il décide. Mais non, ce sont les parents qui doivent prendre aussi en main l’apprentissage de leur enfant ». Cet enseignant poursuit en disant que les parents viennent le voir avec une série d’interrogations dans le but de savoir « comment se comporter », qu’il enseigne à leur enfant ou pas.
Qui plus est, les enseignants issus de l’immigration conseillent aux parents immigrants de ne pas reproduire des pratiques interdites dans la société d’accueil, comme frapper les enfants. Un parent avait confié au participant (EII_08, 2022) que si c’était dans son pays, il allait frapper son enfant. Cet enseignant lui a alors fait comprendre que la société où il vit maintenant ne tolère pas les parents qui frappent ou intimident leurs enfants. De plus, il lui a mentionné que son enfant sait que son parent n’a pas le droit de le frapper. Il lui a alors donné des stratégies pour le redresser autrement, comme « essayer d’être son ami, essayer de lui montrer que tout ce que tu veux c’est sa réussite et là ça peut marcher » (EII_08, 2022). Les parents interrogés affirment aussi qu’ils consultent les enseignants issus de l’immigration pour savoir comment se comporter ou pour valider une information obtenue d’un enseignant natif :
À supposer qu’il y a un comportement que les autres considèrent que c’est un comportement inadéquat, est-ce que c’est correct? Se référer vers ces gens-là pour leur demander. Ce réflexe justement de penser qu’il y a une personne vers qui on peut aller clarifier, demander pourquoi, au lieu d’avoir des réponses fausses, aller valider.
PI_17, 2023
En outre, les enseignants issus de l’immigration affirment aussi servir de ressources aux collègues et à la direction. Étant donné qu’ils parlent et comprennent plusieurs langues parlées par les parents immigrants, les collègues et la direction ont recours à eux lors des rencontres avec les parents afin de servir d’interprète lorsque les parents immigrants ne peuvent pas s’exprimer en français : « Il y a des parents qui ne parlent ni anglais ni rien du tout, donc ils ont besoin de quelqu’un pour traduire. Donc, je suis sollicitée, justement » (EII_19, 2022). Une autre participante dit que l’école lui « avait demandé d’interpréter parce que les parents étaient espagnols et qu’on voulait en apprendre sur leur garçon, comment on pouvait l’aider… Alors oui, j’y suis allée » (EII_05, 2019). De plus, cette participante a aussi été sollicitée pour traduire « un plan d’intervention […] pour que le parent puisse comprendre, c’est quoi l’implication ». Les parents immigrants soulignent aussi que le plurilinguisme des enseignants issus de l’immigration peut constituer un atout pour l’école puisque « ces enseignants peuvent aussi jouer le rôle de facilitateur de communication. C’est un bon atout pour le personnel » (PI_17, 2022).
Les enseignants issus de l’immigration comme contributeurs à la compréhension du fonctionnement du système scolaire
Tous les parents interrogés affirment que « le fonctionnement du système scolaire est très difficile à comprendre pour quelqu’un qui vient de l’extérieur » (PI_05, 2022). Ces parents reconnaissent que les enseignants issus de l’immigration « sont là pour nous aider. […] ils jouent un grand rôle » (PI_19, 2022). Ils sont convaincus que les enseignants issus de l’immigration peuvent faire le pont entre les systèmes scolaires: « ils peuvent vraiment être un pont pour pouvoir enseigner aux immigrants qui ne sont pas dans le système scolaire les trucs et les astuces pour une meilleure intégration et une meilleure réussite scolaire » (PI_05, 2022).
Ces témoignages des parents corroborent ceux des enseignants issus de l’immigration. Ces derniers affirment être conscients, pour avoir vécu l’immigration, des difficultés que les parents immigrants et leurs enfants éprouvent face au nouveau système scolaire. C’est donc avec attention qu’ils expliquent aux parents son fonctionnement : « c’est ma condition d’immigrante qui me permet de comprendre leur statut, de les comprendre, de leur accorder du temps, d’être ouverte à eux. » (EII_19, 2022). Is le font indépendamment des origines des parents : « l’exemple de l’élève russe, j’ai expliqué aux parents le système d’ici. Maintenant, j’ai cette fille chinoise. Je parle avec sa maman, je lui ai expliqué le système d’ici » (EII_07, 2022).
Les enseignants issus de l’immigration relèvent aussi que les parents immigrants ont des difficultés à comprendre plusieurs choses, notamment les notes que l’on retrouve dans les bulletins scolaires, les journées pédagogiques, le fonctionnement des absences, les réunions des parents, le contrôle des devoirs, les activités parascolaires, etc. Comme le souligne l’un de ces enseignants, « Il est donc nécessaire pour l’enseignant issu de l’immigration de les guider à en faire une interprétation juste, ce qui les aidera à mieux intervenir auprès de leur enfant afin que celui-ci progresse dans ses apprentissages » (EII_08, 2019). Ces enseignants mentionnent que leurs interventions permettent d’assurer une continuité et une cohérence entre le milieu scolaire et le milieu familial de l’enfant immigrant.
Certains enseignants issus de l’immigration originaires d’Afrique subsaharienne observent que l’écart entre les systèmes scolaires africains et le système scolaire québécois est énorme. Afin d’y pallier, ils s’investissent au-delà de l’école pour faciliter la socialisation en matière de système scolaire des parents immigrants africains, par exemple en organisant des ateliers pour parler du système scolaire, de l’importance de la lecture et des résultats scolaires pour la suite du parcours scolaire. Ils affirment exécuter « avec plaisir ce travail supplémentaire dans le but de les [parents immigrants] aider dans ce processus difficile d’intégration sociale au Québec » (EII_07, 2022).
Les enseignants issus de l’immigration comme facilitateurs dans les relations entre école et familles immigrantes
La présence d’enseignants issus de l’immigration dans le milieu scolaire suscite beaucoup de fierté, d’admiration et de confiance chez les parents immigrants. Huit parents en mentionné être rassurés : « Ça nous donne une assurance qu’on a aussi de la place dans cette école » (PI_12, 2022). Les parents noirs ajoutent que « quand l’enfant voit un enseignant qui a la même couleur de la peau, ça le rassure » (PI_22, 2022). Quatre parents ont dit se sentir à l’aise et avoir la perception d’être mieux compris en tant qu’immigrants : « je me sens très à l’aise parce que je me dis, eux, ils comprennent mieux la situation des immigrants que les enseignants québécois » (PI_04, 2022). D’autres parents (4) éprouvent un sentiment de soulagement et de tranquillité puisque le fait de voir quelqu’un qui leur ressemble leur procure confiance d’emblée : « automatiquement, c’est comme si je savais qu’il y a quelqu’un qui va me comprendre » (PI_05, 2022). Trois parents ont un sentiment de fierté « de voir que de notre côté aussi, on a des enseignants qui enseignent dans le milieu scolaire de nos enfants » (PI_19, 2022). D’autres (4) disent aussi se sentir en confiance, estimant que les enseignants issus de l’immigration sont plus empathiques, plus compréhensifs et plus patients à leur égard.
Interrogés sur la manière dont les parents immigrants se sentent en les voyant à l’école, les réponses des enseignants issus de l’immigration vont dans le même sens que celles des parents immigrants : « ils se sentent beaucoup en sécurité. Ils se sentent rassurés. Puis, ils sont juste contents de nous voir dans le milieu » (EII_10, 2022). Ces enseignants soulignent d’ailleurs que certains parents immigrants ont plus confiance en eux qu’en l’école elle-même : « souvent ils ont plus confiance en toi qu’à l’école. […] ils savent que vous êtes immigrant donc que certainement vous partagez les mêmes problématiques » (EII_01, 2022). C’est notamment le cas des enseignants issus de l’immigration noirs, qui observent que non seulement les parents immigrants noirs se sentent soulagés de les voir dans l’école de leur enfant, mais aussi que leur présence leur permet de faire tomber les préjugés : « c’est un milieu blanc auquel ils ont toujours été confrontés. Donc quand ils voient qu’il y a un Noir c’est comme un ouf [de soulagement]! Ça fait tomber beaucoup, beaucoup de préjugés » (EII_10, 2022). Tous ces témoignages illustrent que les enseignants issus de l’immigration connectent facilement avec les parents immigrants et que leurs relations sont empreintes de confiance.
Quant aux relations avec le personnel scolaire non immigrant, autant les parents immigrants que les enseignants issus de l’immigration reconnaissent « qu’il y a un problème de communication fluide entre l’école et les familles immigrantes » (EII_01, 2022) en raison des différences culturelles : « d’un côté, je ne comprends pas les Québécois. Les Québécois, de leur côté, ne me comprennent pas » (PI_05, 2022). D’ailleurs, ces parents estiment que l’effort pour comprendre la culture de l’autre incombe aussi aux enseignants natifs, car « si je comprends sa culture, mais qu’il ne comprend pas la mienne, on fera un dialogue de sourds » (PI_05, 2022).
Face à cette situation, les enseignants issus de l’immigration soulignent qu’ils jouent le rôle de facilitateurs et de conseillers dans les relations entre école et familles immigrantes : « c’est quelque chose vraiment de très naturel […], je me considère à mon âge avec mon expérience comme un facilitateur et un conseiller » (EII_01, 2022). Les enseignants issus de l’immigration contribuent ainsi à déjouer les conflits ou les incompréhensions entre parents immigrants et enseignants natifs. Comme ces enseignants issus de l’immigration connectent facilement avec les parents immigrants, indépendamment de leurs origines, et qu’ils leur font confiance, il devient facile pour ces enseignants de leur prodiguer des conseils et d’avoir leur adhésion. Par exemple, un participant rapporte le cas d’un parent qui était fâché de voir que la direction voulait envoyer son enfant dans une classe d’adaptation scolaire. Ce parent s’est confié à cet enseignant, qui lui a tout expliqué jusqu’à comprendre les mobiles derrière la décision de la direction : « elle était rassurée et puis elle me remerciait. Après, elle a accepté l’offre de la direction » (EII_02, 2022).
De plus, pour des raisons d’ordre linguistique ou d’ordre culturel ou de peur d’être jugés, certains parents immigrants évitent de rencontrer les enseignants ou n’ont pas l’habitude de le faire, ce qui est source d’incompréhension entre enseignants et parents. Les enseignants issus de l’immigration disent qu’en pareil cas, « j’oriente le parent quant à l’attitude à adopter face à l’enseignant pour que le courant passe mieux, au bénéfice de l’enfant. Cela a souvent beaucoup aidé les parents. » (EII_13, 2022). D’autres parents viennent les consulter en cas de difficultés avec les enseignants natifs, pour leur demander quoi faire, et ils essaient alors de créer un pont entre ces parents et les autres enseignants : « je vais parler avec l’enseignant pour voir c’est quoi la difficulté puis je communiquerez avec vous [le parent]. » (EII_09, 2022). La plupart des parents immigrants d’origine africaine rapportent que dans leur pays d’origine, ils n’avaient pas à aller rencontrer les enseignants à l’école puisque « l’enseignant avait la responsabilité totale de faire réussir l’enfant » (PI_05, 2022), ce qui n’est pas le cas au Québec. Ces parents disent d’ailleurs qu’ils ont besoin d’être accompagnés pour comprendre ce que l’école attend d’eux, mais aussi pour comprendre comment ils doivent communiquer avec les enseignants. Ainsi, ils se réjouissent de la présence des enseignants issus de l’immigration qui leur viennent en aide, comme en témoigne l’un d’eux : « Il comprenait mes problématiques. Il comprenait qu’il y avait des choses qui m’échappaient. Il était vraiment à l’écoute » (PI_23, 2022).
Par ailleurs, les enseignants issus de l’immigration relèvent que les enseignants natifs ont aussi recours à eux pour comprendre les réactions ou certains comportements des parents immigrants. Par exemple, un participant (EII_12, 2022) raconte que sa collègue québécoise « ne comprenait pas ce qu’était Inch'Allah », un mot prononcé souvent par un parent immigrant. Il lui a dit que ce mot signifie « si Dieu le veut » et lui a bien expliqué que dans la culture musulmane, « c’est un réflexe » de réagir comme ça. Cet enseignant québécois pensait que c’était une insulte parce que le parent s’exprimait dans une langue qu’il ne comprenait pas. Ainsi, il l’a remercié pour « jouer l’interprète ». Selon ces enseignants issus de l’immigration, le fait d’être là « aide déjà à régler des conflits » (EII_12, 2022).
En outre, l’analyse permet de voir que ces enseignants issus de l’immigration prodiguent des conseils aux enseignants et aux autres membres du personnel scolaire sur la manière d’intervenir auprès des parents immigrants. Un participant (EII_18, 2022) donne l’exemple d’une conseillère pédagogique qui lui demandait des conseils pour gérer une situation difficile avec des parents syriens. Il lui a prodigué des conseils sur la manière de les approcher, car les parents avaient contesté la décision prise par la direction à propos de leur enfant. Après avoir reçu des conseils sur la manière d’agir, « la direction de l’école a décidé de changer. Ils ont rencontré le papa du petit Syrien. » (EII_18, 2022). De plus, les participants ont souligné qu’ils aident le personnel scolaire à comprendre les différences culturelles et la réalité des familles immigrantes, ce qui diminue l’incompréhension et les préjugés à leur égard et leur permet de mieux les comprendre et de mieux intervenir auprès d’eux : « La direction ne va pas nous demander de rencontrer un parent, ils vont venir prendre des références culturelles auprès de nous. […] “On a eu un tel élève, il vient du Cameroun. Quel élève était-il là?” » (EII_10, 2022). Ces enseignants issus de l’immigration se réjouissent que l’école les consulte pour le bien des élèves et des parents immigrants : « ils vont quand même nous demander ce qu’on en pense. Alors ça arrive qu’on va intervenir, dire qu’on va laisser passer. Parce que peut-être ce n’est pas fait intentionnellement de façon négative, mais c’est la perception culturelle, et coetera » (EII_17, 2022). Un participant indique d’ailleurs qu’ils sont comme les porte-parole des parents immigrants : « mon écoute, mon aide. J’apporte beaucoup! […] Je suis leur voix. C’est ça que je fais. C’est moi qui parle pour eux, peu importe la situation, peu importe la problématique. » (EII_19, 2022). Effectivement, cela rejoint le point de vue des parents qui considèrent l’enseignant issu de l’immigration comme « le joker par rapport au problème des immigrants. Au sein de sa structure et auprès de ses collègues, c’est lui qui va permettre aux Québécois de mieux comprendre comment nous, qui venons de l’immigration, fonctionnons » (PI_05, 2022).
Discussion et conclusion
Des relations entre école et familles immigrantes parsemées d’embûches
Il ressort des résultats que plusieurs embûches nuisent à l’établissement de relations harmonieuses entre l’école et les familles immigrantes. Selon Larivée (2010, cité par Roy, 2014), l’implication des parents dépend de « la représentation que ceux-ci ont de leur rôle, leur sentiment de compétence et s’ils perçoivent que leur enfant ou l’éducateur de celui-ci les invite à participer » (p. 20). Nos résultats le confirment. Les parents immigrants ont des difficultés à comprendre le système scolaire québécois et ce que l’école attend d’eux. Par conséquent, ils vivent « une impuissance douloureuse à apporter une forme d’aide scolaire, voire à comprendre ce que l’on attend d’eux et de leurs enfants » (Hohl, 1996, cité par Kanouté, 2007, p. 69-70). Beaucoup viennent de systèmes scolaires où l’enseignant fait non seulement figure de 2e parent, mais aussi a une grande responsabilité dans la réussite scolaire des élèves. Ainsi, ils ne s’attendent pas à jouer un grand rôle dans la réussite scolaire de leur enfant et ignorent que la collaboration avec l’école influence l’intégration et la réussite de l’enfant. Les différences entre le système scolaire d’origine et le nouveau système constituent ainsi une source d’incompréhensions voire de conflits avec les enseignants, puisque ces derniers interprètent la faible présence à l’école des parents comme un manque d’intérêt dans le suivi de leur enfant (Deslandes, 2019).
Qui plus est, les différences culturelles entraînent « une discontinuité entre la culture familiale et la culture scolaire » (Deslandes, 2019, p. 19), ce qui nuit à l’établissement d’une bonne collaboration avec les enseignants et les autres membres du personnel scolaire. Les résultats montrent que les parents immigrants ne font pas confiance au personnel scolaire et qu’il y a un faible contact entre les deux partenaires. D’un côté, les parents se sentent jugés et laissés à eux-mêmes et, de l’autre côté, l’école ne fait aucun effort pour comprendre ce qui est à l’origine du manque de collaboration des parents. D’ailleurs, les parents immigrants estiment qu’un « dialogue de sourds » va persister si leurs efforts pour comprendre la culture scolaire ne s’accompagnent pas d’efforts de la part des enseignants pour comprendre leur culture et leur situation. Ainsi, une bonne communication entre école et familles immigrantes nécessite que le personnel enseignant et scolaire ait une bonne compréhension de la situation des familles immigrantes, de leurs parcours migratoires et de leurs défis d’intégration (Changkakoti et Akkari, 2008; Jacquet et André, 2021). Plus précisément, comme le soutiennent également Vatz-Laaroussi et Kanouté (2013), il s’avère essentiel que les deux partenaires fassent preuve de reconnaissance mutuelle et de décentration.
En outre, l’absence de maîtrise de la langue française est un autre obstacle à l’établissement d’une bonne communication entre les parents immigrants et le personnel scolaire. Beaucoup de parents allophones n’osent pas se présenter dans les différentes rencontres à l’école en raison de leur difficulté à s’exprimer en français. Une recherche faite au Québec par Benoit et al. (2008) montre aussi que les parents immigrants « se sentent limités dans leur capacité de s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants » (p. 321), parce qu’ils ne maîtrisent pas la langue. Cette étude relève également que les enseignants ont de la difficulté à communiquer avec les parents immigrants en raison du manque d’interprètes.
Les enseignants issus de l’immigration, pont entre l’école et les familles immigrantes
Si les parents immigrants trouvent que le personnel scolaire manque de décentration et d’attention à l’égard de leurs particularités, ils reconnaissent néanmoins l’apport des enseignants issus de l’immigration. Les résultats permettent de voir que les enseignants issus de l’immigration font ainsi le pont entre l’école et les familles immigrantes. En effet, la proximité liée à leur statut d’immigrant, indépendamment de leurs origines, facilite le contact et l’établissement de relations de confiance entre ces enseignants et les parents immigrants (Niyubahwe, Mukamurera et Jutras, 2019). Ayant eux-mêmes vécu l’expérience de l’immigration et fait face aux difficultés d’intégration en tant qu’enseignants ou en tant que parents eux-mêmes, ils sont plus conscients et sensibles aux besoins des parents immigrants et à ceux de leurs enfants (Niyubahwe, Mukamurera et Jutras, 2019; Niyubahwe, Mukamurera, Vachon et Dridi, 2025). Nos résultats montrent d’ailleurs que les parents immigrants sont rassurés et contents de la présence de ces enseignants dans le milieu scolaire. Ils reconnaissent leur patience, leur empathie et leur compréhension à leur égard. Une recherche faite en Suisse par Changkakoti et Broyon (2013) souligne aussi que « l’attitude bienveillante par rapport aux parents distants de la norme scolaire distingue clairement les enseignants issus de la migration des autres » (p. 106). Les enseignants issus de l’immigration se considèrent d’ailleurs comme la voix des parents et des enfants immigrants.
Selon Benoit et al. (2008), l’implication des parents immigrants dans la réussite scolaire de leurs enfants nécessite qu’ils soient mieux outillés pour le faire. Les résultats montrent que les enseignants issus de l’immigration permettent aux parents de développer des capacités à mieux intervenir auprès de leurs enfants et à s’assurer d’une continuité et d’une cohérence entre ce qui se passe à l’école et en famille. Pour avoir eux-mêmes vécu des défis d’intégration, les enseignants issus de l’immigration sont conscients des difficultés auxquelles les parents immigrants font face lors de leur socialisation en matière de système scolaire et ils leur viennent en aide. Ils sont des ressources et des conseillers pour les parents immigrants. Ces derniers les consultent pour comprendre le fonctionnement du système scolaire et la manière d’encadrer leurs enfants. Ils ont aussi recours à eux pour valider certaines informations ou décisions prises par les enseignants natifs ou la direction et leur demandent des conseils sur la manière de répondre aux demandes de l’école. Les enseignants issus de l’immigration prennent aussi des initiatives pour expliquer aux parents le système scolaire québécois, ce qui facilite leur compréhension du fonctionnement de l’école et de ce que l’école attend d’eux.
Les résultats montrent également que les enseignants issus de l’immigration disposent de compétences linguistiques et culturelles qui facilitent l’établissement d’une bonne communication et d’une bonne collaboration avec les parents immigrants. La majorité des enseignants issus de l’immigration sont multilingues, ce qui facilite la communication avec les parents allophones. Qui plus est, grâce à leur maîtrise des langues parlées par les parents et élèves immigrants, ils sont une ressource pour l’école. En effet, ils jouent le rôle d’interprète ou de traducteur lors des rencontres entre un parent allophone et un enseignant natif ou un membre de la direction et ils expliquent des documents aux parents, par exemple les plans d’intervention.
De plus, les enseignants issus de l’immigration jouent le rôle de médiateurs dans les relations entre l’école et les parents immigrants. Selon Chouinard, Couturier et Lenoir (2009), « la médiation vise […] à remettre en lien, à rétablir la communication entre deux parties, sinon en conflit, du moins en tension, et ce processus se réalise grâce à l’intervention d’une tierce partie » (p. 34). Nos résultats confirment que les enseignants issus de l’immigration sont capables de déjouer les conflits ou les incompréhensions entre l’école et les parents immigrants et, pour reprendre les mots de Charrette, Kalubi et Lessard (2019), ces enseignants issus de l’immigration « permettent aux différents acteurs qui sont en relation d’analyser des situations de manière critique, en considérant des cadres de références différents des leurs » (p. 27). Les résultats montrent aussi que les enseignants issus de l’immigration sensibilisent leurs collègues sur la réalité des familles immigrantes et leur prodiguent des conseils sur la manière d’intervenir auprès d’elles. De plus, ils aident le personnel scolaire à comprendre les différences culturelles, ce qui diminue l’incompréhension et les préjugés à l’égard des parents immigrants et leur permet de mieux intervenir auprès d’eux. Tant les enseignants issus de l’immigration que les parents et les enseignants natifs reconnaissent la pertinence de la présence de ces enseignants issus de l’immigration, qui agissent comme pont, comme médiateurs culturels, comme ressource à plusieurs égards. Une étude menée en Alberta (Liboy et Mulatris, 2016) a aussi montré que les enseignants non immigrants apprécient la présence des enseignants immigrants dans le milieu scolaire et les considèrent comme des « personnes-ressources ». Ils apprécient que les enseignants immigrants leur donnent des stratégies pour bien communiquer avec les familles immigrantes.
Du côté des parents immigrants, les enseignants issus de l’immigration prodiguent des conseils sur l’importance de rencontrer les enseignants ou la direction pour un bon suivi scolaire de leur enfant et sur la manière de se comporter en cas de conflit ou d’incompréhension avec les enseignants natifs. De plus, ils permettent aux parents de comprendre que certaines pratiques permises dans leur pays d’origine, comme frapper les enfants, sont interdites dans la société d’accueil et ils leur fournissent des stratégies alternatives pour mieux encadrer leurs enfants. Grâce à cette médiation, les parents font preuve d’ouverture et adhèrent davantage aux demandes de l’école. Quant à l’école, on voit qu’elle tient compte de l’avis des enseignants issus de l’immigration et qu’elle change certaines décisions prises à l’égard des parents. Cette ouverture permet à chacun des acteurs d’être « en mesure d’opérer une transformation de son rapport au monde » (Chouinard, Couturier et Lenoir, 2009, p. 36), ce qui est nécessaire dans l’établissement de relations fructueuses entre école et familles immigrantes (Vatz-Laaroussi et Kanouté, 2013). Tous ces exemples illustrent que les enseignants issus de l’immigration facilitent la communication et la connexion entre l’école et les parents immigrants. Néanmoins, les relations entre l’école et les familles immigrantes ne devraient pas reposer sur les épaules de ces seuls enseignants issus de l’immigration. L’école doit prendre conscience des défis que rencontrent les parents immigrants et mettre en place des stratégies pour les aider à s’approprier le fonctionnement du système scolaire et ses attentes. Elle doit aussi veiller au développement des compétences interculturelles de tout le personnel enseignant et scolaire afin de déconstruire certains préjugés et d’éviter des biais à l’égard des élèves et des parents immigrants.
***
Pour conclure, il importe de rappeler qu’aucune autre recherche empirique n’avait croisé le regard des enseignants issus de l’immigration et celui des parents immigrants en matière de relations entre école et familles immigrantes. Nos résultats contribuent donc à l’enrichissement des connaissances en ce domaine. Ils montrent que les enseignants issus de l’immigration apportent une plus-value dans les relations entre école et familles immigrantes en constituant un pont entre les deux partenaires, en jouant le rôle de médiateur culturel, d’interprète, de conseiller, de facilitateur et de personne-ressource de part et d’autre. Par conséquent, il s’avère pertinent pour le milieu scolaire d’attirer et de retenir les enseignants issus de l’immigration dans la profession et de valoriser leur contribution significative dans l’intégration scolaire des enfants de parents immigrants.
Appendices
Bibliographie
- Atangana-Abe, J. et Ka, M. (2016). L’intégration des élèves nouveaux arrivants d’origine africaine dans les écoles de la division scolaire franco-manitobaine. Alterstice, 6(1), 77-90. https://doi.org/10.7202/1038281ar
- Bakhshaei, M. (2016). Synthèse : le rôle de l’enseignant, de la famille et de la communauté pour favoriser la réussite des élèves issus de l’immigration. Dans M. Potvin, M.-O. Magnan, et J. Larochelle-Audet (dir.), La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation. Théorie et pratique (p. 253-260). Fides Éducation.
- Bassett, R. (2010). Computer-based analysis of qualitative data: NVIVO. Dans A. J. Mills, G. Durepos et E. Wiebe (dir.), Encyclopedia of case study research (p. 193-195). Sage Publications.
- Bauer, S. et Akkari, A. (2016). Les enseignants issus de la diversité ethnoculturelle représentent-ils une valeur ajoutée pour la profession? Résultats d’une étude menée en Suisse romande. Revue canadienne de l’éducation, 39(4), 1-25.
- Beltron, S.-S. (2013). Les enseignants issus de la diversité : étude de cas suisse romande dans les cantons de Genève et du Valais. [mémoire de maîtrise, Université de Genève].
- Benoit, M., Rousseau, C., Ngirumpatse, P. et Lacroix, L. (2008). Relations parents immigrants-écoles dans l’espace montréalais : au-delà des tensions, la rencontre des rêves. Revue des sciences de l’éducation, 34(2), 313-332. https://doi.org/10.7202/019683ar
- Bieri, S. (2015). Comment l’école peut-elle favoriser l’intégration des enfants issus de l’immigration en contexte suisse francophone? [mémoire de bachelor, Université de Fribourg].
- Broyon, M.-A. (2016). L’insertion professionnelle des enseignants issus de la migration en Suisse romande : une insertion comme les autres? Formation et pratiques d’enseignement en questions, (21), 39-58.
- Changkakoti, N. et Akkari, A. (2008). Familles et écoles dans un monde de diversité : au-delà des malentendus. Revue des Sciences de l’Éducation, 34(2), 419-441. https://doi.org/10.7202/019688ar
- Changkakoti, N. et Broyon, M.-A. (2013). Enseignants venus d’ailleurs : tensions entre culture professionnelle et personnelle. Revue internationale d’éducation de Sèvres, (63), 99-110. https://doi.org/10.4000/ries.3491
- Charette, J. (2016). Représentations sociales sur l’école et stratégies déployées par des parents récemment immigrés pour soutenir l’expérience socioscolaire de leurs enfants dans la société d’accueil: regards croisés de parents et d’ICSI. [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16397
- Charette, J. et Kalubi, J.-C .(2016). Collaborations école-famille-communauté : l’apport de l’intervenant interculturel dans l’accompagnement à l’école des parents récemment immigrés au Québec. Éducation et Société, 2, 127-149.
- Charette, J., Kalubi, J.-C. et Lessard, A. (2019). Intervenants école-familles immigrantes : défis et perspectives du rôle de médiation. La revue internationale de l’éducation familiale, 1(45), 23-45. https://doi.org/10.3917/rief.045.0023
- Chouinard, I., Couturier, Y. et Lenoir, Y. (2009). Pratique de médiation ou pratique médiatrice? La médiation comme cadre d’analyse de la pratique professionnelle des travailleurs sociaux. Nouvelles pratiques sociales, 21(2), 31-45. https://doi.org/10.7202/038960ar
- Conus, X. (2021). Lorsque l’entrée dans le monde scolaire se heurte aux modèles d’enfant et de parent attendus. Recherches en éducation, 44, 16-29. Https://doi.org/10.4000/ree.3325
- Deslandes, R. (2019). Collaboration école-famille-communauté : recension des écrits. Tome 1 : relations école-famille. https://www.periscope-r.quebec/relations-ecole-famille_deslandes_2019.pdf
- Escayg, K.-A. (2010). Diverse classrooms, diverse teachers: Representing cultural diversity in the teaching profession and implications for pre-Service admissions. Revue canadienne des jeunes chercheures et chercheurs en éducation, 3(2), 1-8.
- Fortin, M.-F. et Gagnon, J. (2022). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (4e éd.). Chenelière Éducation.
- Gosselin-Gagné, J. (2018). Quand diversité ethnoculturelle et défavorisation se conjuguent au quotidien : regards croisés d’acteurs en contexte scolaire montréalais sur les défis et les leviers d’intervention. Alterstice, 8(2), 89-100. https://doi.org/10.7202/1066955ar
- Gosselin-Gagné, J. et Audet, G. (2024). Les collaborations école-famille immigrante-communauté (ÉFiC) : multiplier les voix et les regards pour mieux comprendre comment les soutenir. Revue hybride de l’éducation, 8(2), 1-6.
- Gouvernement du Québec (2021). Rôle des parents et de la communauté dans la réussite éducative et dans la valorisation de l’éducation (2e éd.). Ministère de l’Éducation. https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/Parents-communaute-reussite-valorisation.pdf
- Gouvernement du Québec (2023a). Orientations pluriannuelles 2024 et 2025. La planification de l’immigration au Québec pour les années 2024 et 2025. Ministères de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/planif-pluriannuelle/DOC_Orientations_PlanifPluri_2024-2025.pdf
- Gouvernement du Québec (2023b). Tableaux sur l’immigration permanente au Québec : 2017-2021. Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/publications/fr/recherches-statistiques/Immigration-Quebec-2017-2021.pdf
- Huberman, M. et Miles, M. B. (1991). Analyse des données qualitatives : recueil de nouvelles méthodes. De Boeck Université.
- Jacquet, M. et André, G. (2021). Relations école-familles immigrantes à l’école franco-albertaine : perspectives des travailleurs en établissement en école. Recherches en éducation, 44, 30-42. https://doi.org/10.4000/ree.3326
- Kamano, L. (2014). Recension d’écrits. Intégration des élèves nouveaux arrivants dans les écoles francophones du sud-est du Nouveau-Brunswick. Centre de recherche et de développement en éducation, Université de Moncton. https://www.umoncton.ca/crde/sites/crde.prod.umoncton.ca/files/wf/kamano_l._m.t._leger.pdf
- Kanouté, F., Gosselin-Gagné, J., Guennouni Hassani, R. et Girard, C. (2016). Points de vue d’élèves issus de l’immigration sur leur expérience socioscolaire en contexte montréalais défavorisé. Alterstice, 6(1), 13-25. https://doi.org/10.7202/1038275ar
- Kanouté, F. et Vatz Laaroussi, M. (2008). La relation écoles-familles immigrantes : une préoccupation récurrente, et pertinente. Revue des sciences de l’éducation, 34(2), 259-264. https://doi.org/10.7202/019680ar
- Kanouté, F. (2007). Intégration sociale et scolaire des familles immigrantes au Québec Une prise en compte globale des familles. Informations sociales, 7(43), 64-74. https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-7-page-64.htm
- Liboy, M.-G. et Mulatris, P. (2016). Enseignants immigrants et non immigrants : convergence et divergence autour de la relation entre école et familles immigrantes. Alterstice, 6(1), 91-103. https://doi.org/10.7202/1038282ar
- Macià Bordalba, M., Burriel Manzanares, F., Roig del Amor, E., Casanovas Jové, R., Lafuente, M.,Vidal, V., Lamo, J.-D., Brújula, E., Pardina, M., Baró, M., Llenas, L., Guzmán, M., Alonso, T., Gálvez, J., Sorribes, M.-L., Jiménez, M., Seguro, N., Prieto, P., Colombo, M., Kerger, S. (2021). Foreign families and schools’ innovative strategies for improving the family-school relationship. Universitat de Lleida. https://doi.org/10.21001/foreign_families.2021
- Niyubahwe, A., Mukamurera J. et Jutras F. (2019). Rôle et contribution des enseignants issus de l’immigration dans l’intégration scolaire des élèves issus de l’immigration. Revue canadienne de l’éducation, 42(2), 438-463. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26823254
- Niyubahwe, A., Mukamurera, J., Vachon, I. et Dridi, M.-A. (2025). Défis d’intégration scolaire des élèves immigrants au Québec et contributions des enseignants issus de l’immigration. Alterstice, 13(1), 109-123.
- Paillé, P. et Mucchielli, A. (2021). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales (5e éd.). Armand Colin.
- Roy, V. (2014). Facteurs favorisant la collaboration famille école : le point de vue parental. [rapport de recherche, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue]. https://depositum.uqat.ca/id/eprint/631
- Santoro, N. (2016). The cultural diversification of the Scottish teaching profession: How necessary Is It? Dans C. Schmidt et J. Schneider (dir.), Diversifying the teaching force in transnational contexts, (p. 3-13). Sense Publishers.
- Savoie-Zajc, L. (2016). L’entrevue semi-dirigée. Dans B. Gauthier et I. Bourgeois (dir.), Recherche sociale, de la problématique à la collecte de données (6e éd., p. 351-378). Presses de l’Université du Québec.
- Schmidt, C. et Janusch, S. (2016). The contributions of internationally educated teachers in Canada. Reconciling what counts with what matters. Dans C. Schmidt et J. Schneider (dir.), Diversifying the teaching force in transnational contexts, (p. 139-152). Sense Publishers.
- Vatz-Laaroussi, M. et Kanouté, F. (2013). Les collaborations familles immigrantes-écolecommunauté : défis et enjeux. Centre d’études ethniques des universités montréalaises.